


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


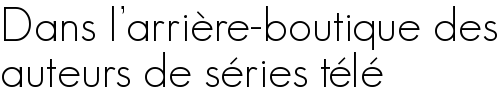
 |
|
|
Publié dans le
numéro 006 (juin 2011)
|
[Les prénoms et certaines données ont été modifiés, afin de préserver l’anonymat des personnes interrogées.]
Propos recueillis par Raphaël Meltz.
Comment devient-on auteur de séries télé ?
Patrick : J’ai fait du droit, puis à la sortie, j’ai été directeur de cabinet d’une mairie, puis d’un conseil général, le tout pendant sept ans. Je faisais de la com’, de la politique, des discours. J’avais envie d’écrire, j’avais vraiment envie d’écrire, pour la télé, des scénarios. Clairement, les séries qui me tenaillaient, c’était pas Julie Lescaut, ni Navarro, ni L’Instit, ce n’était pas ça les références. J’ai tout lâché en 2000, j’arrive à Paris, je vais voir deux potes, et, là, j’ai un coup de bol. À une copine qui était de la première promo du Conservatoire d’écriture audiovisuelle, et qui travaillait pas mal dans le métier, je dis que j’ai d’écrire des scénarios. Elle me répond : « C’est super mais c’est pas facile. » Alors je lui dis que j’ai envie d’apprendre, et là elle me donne la chance d’aller travailler sur une série policière pour France 2, à l’époque où il y avait encore des grandes séries policières le vendredi soir. Dans ce métier, on a besoin de tuteur : pour rentrer sur une série, la chaîne ne te fait pas confiance. Donc, t’es protégé soit par un auteur soit par un dir’coll’ [1] qui dit : lui, je lui fais confiance, je suis prêt à le prendre et à la former. D’ailleurs, c’est ce qu’il faudrait généraliser comme type de pratique, si on avait plus de grosses séries ça permettrait de le faire. Si je n’avais peu eu ça, je n’aurais peut-être jamais été scénariste au final. Ni, la chaîne ni la prod ne m’auraient jamais pris, avec zéro expérience. C’est quasi-certain.
Maxime : Moi, je voulais gagner ma vie, en écrivant, d’une manière ou d’une autre. J’ai fait de la philo, en écrivant pour moi, j’ai vu que je ne pouvais pas gagner ma vie en écrivant des romans. Au cinéma, j’ai entrouvert des portes qui se sont vite refermées. Quelqu’un m’a dit qu’il y avait du travail à la télé. Je me suis donné six mois : je ne connaissais pas du tout la télé, je ne l’avais pas à l’époque. Donc, j’ai regardé des téléfilms, des séries, et à chaque fois que je voyais un truc, je me disais : je vais essayer de proposer une idée d’épisode, ou un pitch. Pendant ces six mois, j’ai produit beaucoup beaucoup de copie, en les envoyant aux boîtes de prod, et j’ai eu quelques contacts. J’avais proposé trois synopsis pour Julie Lescaut : il y en a un qui a été pris. Là j’ai eu un peu de chance : un auteur qui ne peut plus, le directeur de collection qui est censé reprendre, qui n’a pas le temps. Du coup, ils n’ont pas le choix, ils me donnent ma chance, et du coup ça a marché. Très rapidement, j’ai fini un épisode d’une série très installée, en écrivant la version de tournage.
Alors que tu n’avais jamais rien écrit ?
Maxime : J’avais écris des scénarios on spec, on speculation, des scénarios que tu écris sans production. Mais à l’époque, je n’ai pas de C.V., j’ai rien. Sauf que je me rends compte qu’il y a, dans ce métier, un énorme besoin d’auteurs. Tout le monde me le dit, et je constate que c’est vrai. Même sur des séries installées où il y a pas mal de gens qui ont travaillé, ils ont du mal à trouver. Et, là, je me découvre une petite facilité pour le polar. À partir de là, je fais d’autres Lescaut. Très rapidement, j’ai eu une situation confortable - un peu piégante aussi, parce que c’est un peu limité... Après, je suis allé vers des séries polar qui m’intéressaient plus. J’ai créé une série policière pour France 3 qui a été massacrée en termes de production, c’était pas très marrant. Et puis j’ai commencé à travailler pour Canal. Je leur ai proposé une série historique, 12 x 52 minutes, j’en ai écrit cinq épisodes. Ils ont décidé de ne pas la mettre en production. J’ai enchaîné sur une série politique, toujours pour Canal, j’ai coécrit quatre épisodes, à nouveau ça ne s’est pas fait. Et là, on m’a mis sur une autre série de Canal, qui était déjà en production, j’ai repris la série, qui a été tournée et diffusée.
Anne : Tu as écrit tous les épisodes ?
Maxime : J’ai réécrit les deux premiers épisodes, un peu le premier, beaucoup le 2. Les 3 et 4, j’ai repris un peu les thèmes. Et ensuite c’était moi.
Donc pour Canal, jusqu’à présent, tu n’avais écrit que des choses inabouties ?
Maxime : Oui. Ils font écrire beaucoup plus qu’ils ne mettent en production. Mais le projet de la série politique a failli être tourné, et au dernier moment il a été abandonné, et ils m’ont fait basculer sur l’autre série, toujours parce qu’ils n’ont pas tant d’auteurs que ça.
Patrick : Moi je trouve ça très bien, qu’il y ait beaucoup de développement, et un choix limité. On va aller vers ça dans les dix prochaines années. C’est la vie d’un auteur : c’est 80% de trucs qui ne se font pas.
Maxime : Je trouve ça très bien dans l’absolu. Sauf que c’est, de loin, la moins bonne série des trois sur lesquelles j’ai travaillé qui a été mise en production. C’est pour ça que je suis dubitatif quand la chaîne dit : on n’a pas d’argent pour tourner, mais on va quand même parler des textes. Dites-moi : « On est désolés, on ne va pas pouvoir la faire », plutôt que : « Le troisième épisode, ça ne va pas. » Ils essaient de justifier une raison qu’ils ont prise pour des raisons économiques.
Patrick : À l’inverse, il y a aussi les raisons économiques qui permettent d’éviter de dire à l’auteur : « on n’a pas aimé tes textes ». Ils ont peur des auteurs. C’est chiant de dire non, de dire à un scénariste : « ton texte ne convient pas. »
Maxime (dubitatif) : Ouais...
Patrick : Mais bien sûr qu’ils ont la trouille. Dès qu’ils peuvent trouver un argument, notamment économique, ils te le sortent. Moi je l’ai vécu cent fois. Le nombre de trucs que je me suis pris dans la gueule, avec des arguments de merde.
Maxime : Bien sûr, mais là ce n’était pas le cas. Les budgets prévisionnels étaient énormes. La série historique, c’était budgété jusqu’à quatre millions l’épisode, en plus c’était en pleine crise, c’était complètement absurde. La série politique, trois semaines avant de remettre les textes, on a eu un coup de fil d’un journaliste médias qui nous a dit : « J’ai appris que votre série ne se faisait pas. » Bon... On appelle évidemment la productrice, on lui demande ce ça veut dire. Elle nous dit : « Tout va bien, j’ai eu Canal ce matin même. » On lui dit : « Non, tu appelles maintenant, pour savoir ce qu’il en est. » Canal la rassure à bloc. Or, c’était pas une rumeur, parce qu’un autre producteur m’a confirmé qu’à cette date il savait que cette série ne se ferait pas : ils ont décidé de ne pas la faire avant d’avoir eu les textes. Ils n’ont pas osé nous le dire, nous dire que ça ne servait à rien de rendre les textes.
Mais est-ce que ce n’est pas bizarre d’appeler un auteur pour lui dire de ne pas finir son travail ?
Patrick : Moi, je préfère. Tu te rends compte, l’usure ? C’est pour ça que ça serait beaucoup mieux si la saisonnalité des séries était beaucoup mieux planifiée.
On arrive à ton parcours, Anne.
Anne : Moi, j’ai d’abord fait de la gestion à Dauphine, ça m’a vite saoulé. Je faisais du théâtre, j’étais au cours Florent, et je suis rentré dans une compagnie, et j’ai passé cinq ans dans cette bande où l’on faisait tout nous-mêmes. On écrivait les textes, on construisait les décors. Tout l’argent des subventions allait en salaires, on était vingt, et tout reste on le faisait. C’est là que j’ai commencé à écrire. C’était très créatif : on faisait des tables rondes, on discutait, on partait écrire, ensuite on lisait les textes des uns et des autres, et on construisait la pièce pendant des mois et des mois. Ensuite, on jouait ces pièces en province. Et quand on est acteur en province, on ne fait rien dans la journée, on se fait chier en attendant de jouer le soir. Moi, je ne peux pas ne rien faire. Au bout d’un moment, j’ai commencé à prendre une caméra, et j’ai dit à mes potes, qui étaient tous très créatifs, « Venez, on fait un court-métrage. » Au début, c’était des conneries, autoproduits, pas de son, pas de lumière. Ensuite, j’ai écrit des choses mieux, et puis j’ai voulu que ça soit produit. J’ai fait plusieurs courts-métrages qui ont été un peu primés. Et puis un producteur m’a conseillé de participer à l’appel d’offres de la Nouvelle trilogie [2] sur Canal.
Mais tu connaissais pas le monde de la série ?
Anne : Si, la série, j’en bouffais toute la journée. Américaine. Pas française. Comme tout le monde, enfin comme toute notre génération : rien d’extraordinaire. J’ai envoyé un pitch pour la Nouvelle trilogie. Le producteur m’a dit : « ça me plaît, on va le présenter à Canal. » Ils l’ont présenté parmi six ou sept projets, alors qu’ils en reçoivent dans les sept cents... La chaîne a choisi celui-là. Les producteurs m’ont dit : « Super, c’est bon. » Moi, j’étais hyper contente, je n’avais jamais écrit de série de ma vie... Trente minutes, c’était mon max. Du coup, je me suis plongée à fond dans l’écriture, j’étais seule, et j’avais des rendez-vous toutes les trois semaines environ avec les producteurs. Ça se passait très bien.
Et, dès le début, il était prévu que tu sois aussi réalisatrice ?
Anne : Oui, c’est le principe de la Nouvelle trilogie. Découvrir des « nouveaux talents », des gens qui n’ont pas encore fait de séries pour la télévision. Ils prennent ce risque-là, ce qui est assez génial. Pendant neuf mois, j’ai écrit toute seule. Aux réunions d’écriture, ils me disaient parfois : « Non, ça c’est pas terrible », mais j’ai vraiment eu une liberté de dingue. Ça s’est fait hyper vite. En janvier, j’ai su que c’était bon, et en novembre, je tournais. Et ils ont été diffusés en mai suivant. Bon, du coup, c’était avec une logique de production assez faible, en une semaine il faut faire plus d’un épisode, c’était bien bien trash, mais super, j’ai choisi tous les acteurs que je voulais, j’avais une liberté...
Ce qui est frappant dans ta série, c’est qu’on ressent bien que c’est très différent de ce qu’on voit d’habitude à la télé.
Patrick : C’est l’avantage de la Nouvelle trilogie. C’est Bruno Gaccio qui est allé voler un budget à Canal +, en disant aux responsables de la fiction à Canal : « Ne m’emmerdez pas », pour créer au sein de Canal une espèce de labo de recherche et développement, mais en concurrence avec la fiction.
Maxime : Nous, on n’en entend jamais parler.
C’est considéré comme tabou ?
Maxime : C’est un autre truc...
Patrick : C’est comme s’il y avait un village gaulois à côté...
Anne : C’est bien !
Patrick : C’est très bien, sauf que... À force de vouloir des « jeunes » qui n’ont jamais rien fait, ils se privent d’avoir des gens plus expérimentés en fiction classique qui pourraient avoir des envies de se lâcher...
Tu veux dire que ç’aurait dû être aussi pour des auteurs confirmés ?
Patrick : Ce qui est intéressant, c’est cette idée d’un labo avec des gens qui vont écrire des fictions qui dépotent et qui sont pas formatés par ce que le système produit... Et là, ils ont raison. Moi, mon niveau de formatage est hallucinant. Le jour où tu t’arrêtes et que tu prends un peu de recul, tu te dis : « Ouh là... » Un auteur anticipe les désirs du producteur et du diffuseur parce qu’il stresse de ne pas pouvoir passer son projet de série. Ce qu’a vécu Anne, et tant mieux pour elle, c’est un hold-up. Heureusement qu’il y a encore des hold-up comme ça, parce que je pense que la fiction qui avance c’est de la fiction de hold-up...
Pour vous, les séries standard de Canal + sont formatées, au même titre que les autres ?
Maxime : Bien sûr...
Patrick : En même temps, le formatage, c’est normal.
Anne : C’est aussi les règles et les formules qui font qu’une série est bonne, de penser en termes de premier acte, deuxième acte, c’est une forme de règle.
Mais, Patrick, tu disais : « On est formatés, on anticipe... »
Patrick : C’est-à-dire que la chaîne sort de son rôle. Au lieu de faire comme un éditeur, de dire : « Vous me proposez une idée, je trouve ça génial, rendez-vous à la fin, on verra si je pense que vous êtes allés au bout de votre idée », les chaînes deviennent des producteurs. En gros, à toutes les étapes de l’écriture, on vient te casser les couilles : au synopsis [3], au traitement, au séquencier, à la version dialoguée 1, 2, 4, 12...
Maxime : Il y a la question des étapes, mais ce n’est pas la seule. Moi, sur une série pour Canal, j’ai travaillé en version dialoguée directement, et ça ne m’a pas empêché de me prendre quand même le mur...
Patrick : Ça, c’est un niveau de confiance qu’ils accordent rarement.
Maxime : Ils n’avaient pas le choix.
Tu veux dire contractuellement ?
Maxime : Ils n’avaient pas le choix, parce qu’ils savaient qu’avec moi un séquencier n’apporte pas grand-chose, alors ils tentent le coup. Ils demandent à voir, mais la liberté que je prends à ce moment-là, elle m’est reprise radicalement après. Le texte n’est pas accepté, donc il faut revenir en arrière, recommencer.
Ça revient au même, en fait.
Maxime : Ça revient un petit peu au même. Mais c’est plus agréable pour moi, parce qu’au moins j’ai eu le plaisir d’entendre les choses, de les voir, en écrivant. Je préfère toujours qu’un projet s’arrête quand j’ai écrit une version dialoguée, parce que j’ai au moins un peu appris des choses, je connais mes personnages. Mais, bon, le truc ne se fait pas quand même.
Mais dans ce cas, c’est quoi ce qu’on reproche à ton texte ? On te dit quoi ?
Maxime : On me dit des choses comme : « On ne comprend pas ». Alors je réexplique des choses qui sont dans le texte.
Ça veut dire qu’ils n’ont pas bien lu ?
Maxime : Je ne pense pas. C’est un dialogue de sourds : à la base, ils savent ce qu’ils veulent, assez précisément. Le but est de driver l’auteur et le producteur pour y arriver. En termes de thèmes, par exemple, ils veulent des voyous, des flics, même dans un autre univers qui devient un prétexte pour faire vivre des histoires qu’on pourrait avoir dans d’autres milieux. Et, dans le traitement qu’ils attendent, il y un excès d’explications, d’annonces de ce qui va se passer et de décodage de ce qui s’est passé, qui va assez loin... Et moi, je ne sais pas faire. Je rends des versions en étant sincèrement convaincu que c’est très clair, et que j’ai fait ce qu’ils ont demandé. Avec le producteur, on s’est dit : « Ça y est, on y est, on y est, on a restabiloté ce qui manquait, et on est allés extrêmement loin. »
Mais eux ils voudraient quoi ? Que tout soit sursouligné ? Regardez, lui, c’est le méchant ?
Maxime : À mon sentiment, oui. L’ambivalence des personnages, par exemple, ne peut pas être un non dit. Ça doit être conscientisé, travaillé, confronté, assez clairement posé. Moi, je considère qu’un personnage peut être ambivalent au sein même d’une scène. Ce n’est pas forcément au fil d’un épisode qu’on va découvrir qu’il a plusieurs facettes. Moi, au cinéma, ou dans les séries que j’aime, je vois ça. Et pour eux, non, c’est vraiment très difficile. Lors de la diffusion d’une série que j’avais écrite pour eux, j’ai dit dans une interview : « J’aime bien les dramaturgies incertaines, quand on ne sait pas trop où on en est », bon, ça fait un peu péteux, mais peu importe. Et quand j’ai revu les gens de Canal, ils m’ont dit que ça leur avait fait une journée de bonheur : « Il a avoué, enfin ! Ça fait des années qu’il nous dit que c’est clair, et en fait non, il aime bien quand on ne sait pas... » À Canal, il y a une petite schizophrénie de fond, dont ils sont tout à fait conscients d’ailleurs - comme c’est des gens agréables et polis, ils vont le reconnaître sans problème - : eux, ce qu’ils diffusent en prime time comme séries américaines, ce n’est pas des séries du câble. On a tendance à confondre Canal et les chaînes du câble américaines, beaucoup plus pointues. Canal, ce qu’ils passent, c’est Desperate Housewives - qui est génial par ailleurs -, c’est 24 Heures...
Anne : Il y a aussi Dexter, qui est une série du câble.
Maxime : Oui, mais Dexter, c’est une fausse série du câble, c’est hyper explicatif. Si tu n’as pas compris, la voix off te réexplique. Moi, j’ai lâché à cause de ça.
Anne : Oui, ils n’ont pas diffusé Six Feet Under et tout.
Maxime : Non, et ils n’ont pas diffusé The Wire, Mad Men ils le passent à minuit et ça ne marche pas. Quand tu leur parles de Mad Men, ils disent : « Arrêtez ! ». Ils ne veulent pas faire Mad Men...
Tu veux dire qu’on fantasme l’idée que Canal a de l’ambition parce qu’ils passent des séries américaines, mais en fait ils ne les passent pas ou très tard, et ça ne marche pas ?
Maxime : Les séries américaines câblées un peu pointues, ils ne les passent pas.
Comment ça se fait que, même proportionnellement, ces séries pointues marchent aux États-Unis ?
Maxime : Mais ça ne marche pas. The Wire, ça faisait deux millions de téléspectateurs - aux États-Unis, c’est presque un score d’Arte !
Mais Les Soprano, c’était vingt millions de personnes.
Maxime : Ça a fini par faire des énormes scores, c’est vrai, mais ça a démarré très bas.
Patrick : Tu dis à une chaîne française : « Il faut attendre sept ans pour que ça cartonne », ils ne le font pas, ils ne prennent pas ce risque financier.
Donc il y a aussi un décalage entre la vision qu’on a des séries américaines, et la réalité du marché américain ?
Patrick : C’est plus qu’un décalage. On a la crème de la crème.
Anne : Il y en a des centaines qu’on n’a jamais vues.
Patrick : Il y a tout le spectre, du feuilleton quotidien jusqu’aux séries grand public, qui elles font leurs trente millions sur les premium [4], tu ne les vois pas arriver ici. Sur Canal, ils sont hyper prudents, y compris sur des séries que nous on bouffe parce qu’on est là-dedans. Regarde Mad Men, qui devient un succès marketing hallucinant, mais que personne n’a vu. C’est très rare, y compris dans les dîners en ville, de trouver quelqu’un qui a vu les quatre saisons de Mad Men.
Maxime et Anne : Oh non, quand même...
Vous, vous en connaissez, parce que c’est un milieu. Mais dans la vraie vie, personne n’a vu Mad Men, tout simplement parce qu’il faut aller les télécharger.
Maxime (ironique) : Anne et moi, on ne connaît pas, la vraie vie.
Patrick : À Canal, ils te disent : « Mad Men est une série contemplative, pour séries addicts, qui ont le temps de trouver génial ce moment entre un homme et une femme qui fument le matin dans le lit. »
Anne : Enfin, Canal, c’est quand même la seule chaîne qui essaie de faire des choses bien. Ils recherchent, ils prennent plus de risques.
Maxime : Il vaut mieux essayer de comprendre ce qu’ils veulent, et de le devancer, si on en est capable - moi, j’ai cru à un certain moment en être capable, et en fait pas tant que ça - donc essayer d’aller dans leur sens et d’assimiler leurs contraintes et d’essayer d’en faire quelque chose, plutôt que d’aller contre leurs contraintes, parce que ça tu ne peux pas.
Patrick : La chaîne reste très identifiée au cinéma d’auteur entre guillemets, avec des auteurs-réalisateurs, alors que je pense qu’ils devraient mettre le paquet sur l’écriture d’abord, et pas forcément avec un auteur seul. Je pense qu’ils ne comprennent pas la logique de l’atelier. Ils ont compris la logique du show-runner [5] et de celui qui porte le point de vue, mais ils n’ont pas compris qu’il doit être le producteur exécutif.
Anne : Moi, j’avais écrit tous les épisodes, et je devais les réaliser. Mais, pour une histoire de calendrier, je devais faire un long-métrage, j’avais signé, je n’ai pas pu tous les réaliser. Je n’ai réalisé que la première moitié, et les autres je les ai confiés à quelqu’un d’autre. Alors, je suis D.A., j’ai un droit de regard, j’ai fait la prépa.
On est un peu dans l’idée du show-runner, là.
Anne : Eh ben ce n’est pas facile du tout. J’ai appris que je ne le referai plus. Je préfère tout faire, écrire et réaliser.
Est-ce que, structurellement, la tradition française fait qu’il est très difficile de scinder les postes d’auteur et de réalisateur ?
Anne : Je crois au show-runner. J’ai été invitée au festival de Deauville à participer à une rencontre avec David Chase [Les Soprano], Clyde Philips [Dexter], c’était complètement fou : c’est mes maîtres, et j’étais à table avec eux. Et on a beaucoup parlé, on s’est demandé pourquoi en France on faisait des séries moins bien qu’aux États-Unis. Moi, je crois vraiment au show-runner, le super-chef, qui dirige l’écriture, qui choisit les réalisateurs. Aux États-Unis, le réalisateur il arrive une semaine avant le tournage : il fait la prépa pendant une semaine, tout le reste a été fait par le show-runner. Il réalise, mais le show-runner est toujours là, ensuite il monte une semaine, et le show-runner finit le montage ! Donc, c’est le show-runner qui fait la série. Mais il ne peut pas tout faire, parce que pendant qu’il y a un épisode qui se tourne, il y en a un autre qui s’écrit. Moi, je crois beaucoup à ça, mais ça n’existe pas en France.
Maxime : On revient à la question de l’industrialisation. Le système américain, c’est des armées prussiennes, en terme de réunions, de hiérarchie, de qui fait quoi, etc. Tout est survalidé.
Anne : Je pense que la grosse différence entre la France et les États-Unis, c’est la confiance des chaînes. Pas sur les synopsis, les arches, mais sur les saisons. Quand j’ai dit à David Chase et les autres que la chaîne devait valider chaque ligne de tous les épisodes avant de commencer la prépa, ils étaient là : « Oh my god ! » Ils disaient : « Mais c’est une catastrophe ! Évidemment que vous faites de la merde. » Eux, ils montrent un pilote et quelques arches à la chaîne, et c’est parti.
C’est quoi, une arche ?
Anne : Une arche, en gros, c’est la trajectoire des personnages qui se croisent sur toute la saison. Ce n’est même pas des synopsis d’épisodes : c’est de dire que tel personnage va suivre telle trajectoire, et qu’il va croiser tel autre à peu près là. Clyde Philips me disait, pour Dexter : « Nous on sait que, environ dans le 5 ou 6, on va découvrir que le tueur ceci, environ dans le 9 ou 10 cela... » C’est très flou. Mais ils savent très bien quel sera le message de la saison. Qu’est-ce qu’ils veulent dire, et comment ça va finir. Ils montrent ça à la chaîne, et la chaîne y va. Ensuite, la chaîne voit chaque épisode avant diffusion. Du coup, c’est très réactif : ils réagissent par rapport à l’audimat, aux téléspectateurs. J’ai vu les mecs de Damages, qui racontaient que Glenn Close en jouant emmène la série dans telle direction, et que du coup ils avaient suivi cette direction. Ça, c’est génial ! Et, nous, c’est impossible de faire comme ça : ils veulent qu’on écrive les douze épisodes, et, après, même si c’est de la merde, on le fera.
On n’a pas parlé d’argent...
Patrick : C’est un autre problème en France. Les scénaristes américains ne sont pas payés pour l’épisode qu’ils écrivent, ils sont payés pour être autour d’une table et discuter. Il faudrait mettre sur pied une clause d’exclusivité : je te paie pendant six ou huit mois, pour écrire douze épisodes, et tu ne fais rien d’autre à côté. Nous, en tout cas moi, j’ai douze projets en même temps ! Aux États-Unis, ils sont en exclusivité sur une série.
Pourquoi vous avez douze projets en même temps ? Parce qu’ils ne vont pas tous se faire ?
Patrick : Pour bouffer, tout simplement.
Pourtant, c’est extrêmement bien payé d’écrire pour la télé.
Patrick : On va prendre un Julie Lescaut. C’est payé dans les soixante mille euros pour l’auteur. Sauf que : je signe pour le projet, mais imaginons que mon synopsis passe, et qu’au moment du séquencier, ça ne plaise plus. On me vire : sur les soixante mille, j’en aurais touché sept mille. Je peux être viré à n’importe quelle étape, alors si j’ai pas prévu un autre truc à côté...
Ce n’est pas le niveau de rémunération, donc, mais le fait que tu n’es pas assuré d’être payé ?
Patrick : Je prends l’exemple d’une série sur laquelle j’ai travaillé. La chaîne s’extasie, veut une suite. « On va faire douze épisodes ! ». En fait, on n’a pas le temps d’en faire douze, on va en faire huit. On démarre l’écriture en septembre : l’auteur, dans son contrat, sait qu’il va écrire un épisode. Un 52 minutes pour France Télé, aujourd’hui c’est vingt-cinq mille euros. L’auteur démarre en septembre, en atelier d’écriture. Mais pour l’atelier, les auteurs ne sont pas en exclu, la rémunération est de deux mille euros par auteur - et ça va aller jusque octobre ou novembre. L’auteur qui commence l’atelier, il sait qu’il va gagner deux mille euros sur les mois de septembre à novembre. Avant d’attaquer un séquencier, un dialogué, qui va rapporter plus d’argent. Donc, forcément, il doit faire d’autres trucs. Et donc il n’y a pas six auteurs en exclu, pendant quatre mois, pour te faire une saison en béton, pour aller chercher ce qu’il y a de plus drôle, aller à l’os de la comédie, aller poser des trucs, voir le réal... Et pareil quand tu travailles seul sur une série, tu es virable du jour au lendemain, et après avoir été viré, tu n’as pas de chèque...
Aux États-Unis, les auteurs ne sont pas virables ?
Anne : Si, c’est encore pire, ils sont sur un siège éjectable !
Patrick : Bien sûr. Le problème n’est pas de ne pas être virable, mais d’être payé pour être là. D’être payé pour ta matière grise, et pas seulement pour ce que tu écris. En France, on te paie pour ce que tu rends. Aux États-Unis, pour ce que tu penses.
Anne : Ils sont quinze, ils sont dans la même pièce, c’est un sacerdoce. Pour Damages, ils n’ont pas de week-end, ils bossent tout le temps...
Est-ce que le fait qu’en France on paie le travail rendu, ce n’est pas une histoire de culture ? La sacralisation de l’écrit ?
Patrick : C’est une histoire de pognon, surtout.
Maxime : Il y a de ça, il y a aussi un côté individualiste... Mais ce sont des obstacles surmontables, parce que des séries ont prouvé le contraire. Plus belle la vie, ça fonctionne en atelier, ça marche.
Patrick : Parce que c’est une quotidienne : ils ont un tel volume que tous les auteurs sont sécurisés en termes de rémunération. Tu ne fais que ça, tu es à cinq mille euros par mois. C’est difficile d’être admis dans l’atelier, parce que c’est un exercice très compliqué. Mais, quand tu es admis dans l’atelier, tu sais clairement quel est ton revenu sur le moyen et le long terme.
Maxime : L’aspect rémunération est important. Mais je reste inquiet par rapport à une pathologie structurelle de la fiction française : il n’y a pas de concurrence. J’ai le sentiment que les Américains ont la fiction qu’ils ont parce que, par exemple, la directrice de la fiction de HBO, après quinze ans en poste, où elle a notamment fait Les Soprano, s’est fait lourder parce qu’elle avait refusé Mad Men. Donc, il y a un niveau de compétition entre les chaînes pour avoir les talents... Et, du coup, ils paient, ils raquent à mort parce qu’ils n’ont pas le choix. Et ils laissent une liberté considérable : si tu ne le signes pas, l’autre le signe.
Pourtant, Mad Men, son créateur raconte toujours que tout le monde l’a refusé.
Maxime : Tout le monde ne l’a pas refusé. AMC l’a pris, et quand c’est devenu le succès qu’on connaît, la nana de HBO qui faisait partie des vingt personnes qui l’ont refusé s’est fait virer. Ils vivent dans le peur que la chaîne concurrente ne prenne le projet. Moi, j’ai envoyé un pilote dialogué à une chaîne que je ne nommerai pas, on a beau essayer de leur faire croire que d’autres sont intéressés, ils s’en foutent complètement. « Bon, d’accord, on a bien compris, vous êtes très pressé. On vous donne la réponse dans deux mois... » C’est le vrai souci de la télé. Dans le cinéma, il y a beaucoup de problèmes, mais au moins il y a de la concurrence : les producteurs, les studios se tirent un peu la bourre pour essayer de choper les bons projets.
À la télé, il n’y a pas de compétition, et, par ailleurs, il n’y a pas d’ambition, mais ce n’est pas forcément connecté.
Maxime : Je pense qu’il y a une connexion. À partir du moment où un diffuseur sait que s’il dit non, ça n’ira pas ailleurs, ou que s’il dit « oui mais », avec des contraintes très fortes, ça n’ira pas ailleurs, le créateur n’est pas en position de dire : « Attends, Fabrice de la Patellière [responsable de la fiction sur Canal +], si tu ne prends pas, je vais à France 2. » Il s’en fout, c’est le gag : « Mais vas-y, j’ai mille projets en attente ! »
Anne : C’est vrai qu’ils te font vraiment comprendre que tu es remplaçable.
Patrick : J’ai une anecdote, à propos de cette histoire de concurrence. Il y a quelques années, on a vu arriver les chaînes du câble et de la TNT en se disant : « Super, on va être moins payés, mais on va réussir à avoir un espace de liberté. » J’arrive à NRJ12 avec un projet sur un château : une petite principauté de nos jours, avec un roi. Le royaume est en faillite, c’est le bordel. Le roi disparaît. La mère rappelle son fils qui s’était engueulé avec son père. Sauf que le fils est devenu DJ à Berlin : il revient avec ses potes défoncés et cramés de Berlin. Ils se retrouvent dans un truc hyper compassé, avec le système aristocratique. Et ces cinq jeunes vont trouver des solutions pour sortir la principauté de l’ornière, en passant par la coke, les putes, les tables de jeu. Et c’est évidemment aussi l’histoire d’un prince qui n’a pas envie d’être prince, qui aimerait continuer de faire la fête à Berlin. Hyper classique : ce que je dois faire alors que je n’en ai pas envie... Donc, on présente ça à NRJ12, avec mon producteur. Le responsable de la fiction : « C’est super, c’est génial. Mais en fait, ça ne va pas du tout. Vous n’avez pas compris du tout NRJ12, en fait. Mais c’est génial, votre truc - je vous ai dit que c’était génial ? Mais nous, on est un mini-TF1. » Moi, je commence à pâlir...
Maxime : Déjà, en grand, c’est pas terrible, alors en mini !
Patrick : Et il continue : « Oui, c’est super, mais la coke, on enlève, les putes, on enlève, ils ne sont pas défoncés, et puis il faut qu’on les aime. Bon, on peut garder la salope, ça c’est bien. » Tu sors de là, tu as l’impression d’être passé à la moulinette d’un truc que tu ne comprends pas. C’est juste qu’ils n’ont absolument pas envie de chercher quelque chose de différent. D’ailleurs, après, il nous a dit : « Je vais vous montrer ce qu’on a envie de faire », et là il nous montre la bande-annonce de L’Été de tous les dangers, qu’ils ont dû diffuser depuis... Et je vois une espèce de soap pas possible, avec : « Ton père n’est pas ton père... » Donc, on pensait qu’il y aurait un espace de liberté sur la TNT et le câble, et en fait ils veulent juste dupliquer ce qui marche.
Maxime : Ça va à l’encontre de tout ce que j’ai dit sur la concurrence, donc je suis désespéré.
Anne : Quel intérêt de refaire, en moins bien, ce que fait TF1 ?
Est-ce que ce n’est pas ça, la télé ? Plus tu fais un truc cadré, plus les gens vont le regarder... Est-ce que ça n’est pas mécanique ?
Patrick : Oui, bien sûr.
Maxime : Mais dans un paysage éclaté comme ça, tu as besoin de te démarquer.
Anne : Ce pitch, qui est très drôle, il va plaire aux 25-35 de Paris... Les gens, ils regardent Louis la Brocante. Ce sont des vieux qui regardent la télé.
Patrick : Attendez, Louis la Brocante a vingt ans. Ils ont créé un rendez-vous.
Mais, même il y a vingt ans, c’était déjà des vieux qui regardaient...
Maxime : Il y a eu la conférence de presse surréaliste où Pfimlin [patron de France Télévision] disait : « Nos spectateurs sont à cinquante-neuf ans de moyenne d’âge sur la fiction, il faudrait qu’on descende à cinquante-sept », ou quelque chose comme ça. Un truc de fou !
Mais est-ce que vous ne devez pas accepter ça ? Les gens qui regardent la télé, c’est des vieux en province... Si vous n’êtes pas contents, ne faites pas de télé.
Patrick : Je suis d’accord.
Maxime : Non... Je ne veux pas...
Mais tu ne regardais pas la télé avant d’en faire ! Ce n’est pas anodin... Pendant ce temps-là, au fin fond de l’Eure-et-Loire, les gens regardaient France 3...
Patrick : Et tu as fait du Lescaut pour cette population-là...
Maxime : (ironique) Non, les miens, c’était que pour les jeunes...
Tu refuses que les gens qui regardent la télé ne soient pas comme toi.
Maxime : Je ne me pose jamais la question du public. La socio-composition du public, ce n’est pas mon boulot.
Patrick : Si, c’est ton boulot.
Anne : Quand tu écris pour Canal, évidemment, ce n’est pas pareil...
Tu n’es peut-être jamais sorti de Paris. Tu ne connais pas les vraies gens...
Maxime : Attends, j’ai signé mon premier autographe de ma vie, en province, avec un sexagénaire, pour ma série de Canal.
Patrick : Il ne voyait plus très bien, il pensait que tu étais une des comédiennes... (rires)
Est-ce qu’il peut y avoir un plaisir à écrire des séries pour le grand public ?
Patrick : Évidemment : le plaisir de capter un spectateur. Quand tu écris un Julie Lescaut, ton problème, c’est d’embobiner le spectateur, comme disait Hitchcock, avec les contraintes que tu as, les comédiens que tu as. Moi, je trouve ça très noble. Il y a un vrai plaisir. D’écrire, déjà : même quand tu fais de la commande, tu as l’espoir de faire changer le truc. On ne te dit pas : « Salut Patrick, je suis producteur, je vais te faire écrire de la merde, ça va être super. »
Maxime : Ça arrive, quand même. Tu te retrouves dans des situations où c’est quasiment ça.
Patrick : Ça peut arriver, mais dans toutes les chaînes du monde, avec tous les scénaristes du monde.
Maxime : C’est des cercles vicieux ou vertueux. Culturellement, en France, il y a une énorme dévalorisation de la télévision par rapport au cinéma. Donc, assez facilement, l’ensemble des gens qui font des séries ou des téléfilms peuvent être démobilisés. Même si l’exercice intellectuel de l’écriture est là, notamment dans le polar : moi, j’ai pris beaucoup de plaisir construire des intrigues, à qu’on ne sache pas qui est le coupable. Mais, quand toute la machine au service de ça est en fait une machine de cachetonnage, c’est assez pénible.
Ma question c’est : est-ce qu’il peut y avoir du plaisir à écrire quelque chose comme Julie Lescaut ?
Maxime : Oui, il y a un exercice intellectuel qui peut être marrant.
Patrick : Moi, j’en fais un en ce moment. Parce que j’étais dans la merde l’an dernier, je n’avais que des projets en développement qui ne démarraient pas... Donc, je termine un Julie avec quelqu’un... Tu fais un exercice de style : tu joues avec des trucs. Putain, 90 minutes de polar, c’est l’enfer... Moi, je n’avais fait que du 52. Tu t’emmerdes. Alors, tu commences, tu te dis : « Je vais déconstruire. » Mais non, il faut que ça soit linéaire. Ils te demandent de t’adresser à un public à qui il faut donner, à chaque étape, ce qu’il attend. Si tu lances une piste dans l’acte I, il faut qu’elle soit terminée et bouclée dans l’acte I pour lancer l’acte II. Au dir’coll’ tu dis : « Moi, j’aurais fait ça », et il te répond : « Oui, mais tu es en prime, avec un truc codifié, tu es à l’épisode 96 de Julie Lescaut qui a dix saisons, tu ne peux pas te permettre ça. » Si le mec est interrogé en séquence 14, en séquence 21 il y a la résolution, et tu passes à autre chose. Chaque chose doit être résolue toutes les cinq séquences, toutes les dix minutes ton spectateur doit avoir sa résolution.
Et là, il y a un plaisir parce qu’il y a des règles, comme un jeu logique ?
Maxime : Oui, c’est un plaisir intellectuel, d’être finaud, de cacher les choses.
Patrick : Et puis tu te dis : « Je vais peut-être dialoguer un peu mieux... » Ce qui est casse-couilles, c’est que tu sais que Julie Lescaut a toujours raison. Ça te fait chier, mais... tu joues avec quand même.
Anne : Tu n’as pas le droit de proposer que, cette fois-ci, Julie n’a pas raison ?
Maxime : Si... Il y a toujours le moment où elle doute... Si tu arrives à faire le dilemme...
Patrick : On se retrouve en situation de hold-up permanent : tu essaies d’être plus malin que le système. Toi, Anne, tu as vécu un moment de grâce où tu as pu placer un truc sans composer. Moi, je n’ai jamais vécu ce moment-là, et j’ai toujours dû me dire : « Je vais réussir à placer ça en passant par là. »
Faisons l’avocat du diable une seconde. Est-ce qu’il n’y a pas trop d’auteurs qui peuvent prendre la place des autres ?
Maxime : Plus les projets sont médiocres, plus les auteurs sont interchangeables. Plus les projets sont singuliers, ne pouvant être fait que par un seul auteur, plus c’est compliqué de le virer. Donc ça les arrange très bien ce système où on va prendre plein de petits projets un peu inconsistants. Je ne dis pas que c’est conscient, que c’est une grande conspiration. Mais ça se passe comme ça : il y a un lumpen-prolétariat, une armée de réserve, ce qui permet de ne pas monter les tarifs, de garder le contrôle.
Patrick : Je me battrai jusqu’au bout contre ça.
Anne : Je pense qu’on n’est pas interchangeables. Merde, j’ai créé la série, c’est moi qui ait créé les personnages, je pense que cette série ne peut pas se faire sans moi.
[1] Directeur de collection, qui supervise l'écriture de différents épisodes.
[2] Sorte de « concours » pour découvrir des projets originaux, écrits par des auteurs n'ayant pas encore travaillé pour la télévision.
[3] Synopsis : court texte qui synthétise l'histoire. Traitement : texte long qui développe l'ensemble de l'histoire. Séquencier : texte qui décrit toutes les séquences. Version dialoguée, ou « dialogué » : texte final, intégrant les dialogues.
[4] Grandes chaînes généralistes américaines.
[5] Aux États-Unis, le show-runner est celui qui supervise l'ensemble de la série.