


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


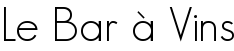
 |
|
|
Publié dans le
numéro 027 (mars 2013)
|
Cinquième épisode d’une série sur les bars, qui emmènera l’auteur sur les routes de France : le récit, qui s’appuie sur une journée complète passée sur place, obéit à dix contraintes cachées, répétées d’épisode en épisode, et qui seront dévoilées à la fin.
Episode 5.
Rue Richebourg, Gevrey-Chambertin (Côte d’Or)
« J’aime bien les cartes. Es como el aparato circulatorio. » On avait étalé par terre une grande carte routière de la France, une carte Michelin rouge de 2005. Les cartes Michelin sont beaucoup plus belles que celles de l’Institut géographique national. Leur code des couleurs est chaud : les autoroutes sont un épais trait rouge où passe un mince fil jaune ; les routes sont rouges, jaunes, blanches, la typographie est grasse et large. Sous nos yeux se déployait donc le système circulatoire de la France. Il y avait le gros cœur bouillonnant, les veines entrelacées de Paris et de sa banlieue, il y avait les artères qui partaient irriguer les organes périphériques et les métropoles lointaines, on voyait toute l’arborescence capillaire des départementales à faible pression. Je ne savais pas où aller, mais il fallait que j’y aille, et c’était le rôle de la carte de manifester l’évidence ; j’hésitais encore. Je pensais partir à Dieppe, mais j’étais déjà allé au bord de la mer, la fois précédente, et puis c’était trop près. Et puis elle a dit : « Moi j’aime bien Dijon. C’est comme la moutarde. » Elle avait dit ça avec son accent colombien, et c’était évident : Dijon. Alors ce fut Dijon, comme la moutarde - une des seules villes de France avec Paris, Nice, Le Mans et Bordeaux, à être connue dans le monde entier. On est partis pour Dijon.
Sur la route, dans la froide nuit d’hiver, il y avait plein d’étoiles : elle n’en avait jamais vu autant, m’a-t-elle dit ; chez elle, on n’en voit pas tant dans le ciel. Moi, je ne me souvenais pas : là-bas, je n’avais pas beaucoup observé les étoiles. Ce soir-là, on pouvait les contempler par le toit panoramique de la Twingo ; j’ai essayé moi aussi, en conduisant ; c’était un peu dangereux mais la route était vide, ou presque. Un peu plus tard, je lui ai demandé ce que ça lui faisait d’être sur une route de France, quelque part en Bourgogne (« Borgoña »), entre Auxerre et Vézelay, mais elle s’était endormie. J’ai essayé de le penser à sa place, mais je ne suis arrivé à rien de bon. En somme, il n’y avait rien d’étonnant à rouler sur une autoroute, même à neuf mille kilomètres de chez soi ; ce qui me paraissait étrange, c’était cette histoire d’étoiles dans le ciel. Ne trouvant aucune explication, je me suis dit que c’était la nuit très sombre, et sans lune, cette fois-ci, qui multipliait les étoiles. Nous sommes arrivés à Dijon très tard, vers une heure du matin. L’hôtel avait été modernisé dans un style curieux et coloré, et la décoration évoquait la vocation viticole de la Côte-d’Or. Notre chambre avait hérité du pépin de raisin, qui occupait, stylisé, le mur au-dessus du lit.
Les couleurs de Dijon : jaune, safran, terreux, ocre et triste ; il faisait très froid le lendemain matin mais il n’avait pas neigé. À l’hôtel, les trois immenses téléviseurs de la grande salle à manger diffusaient trois programmes différents en même temps et avec le son, ce qui donnait un mélange de tubes des années 80, de « nos troupes au Mali » et de lasagnes à la viande de cheval ; il n’y avait plus de café. J’ai donc proposé de quitter Dijon au plus vite : tant pis pour la moutarde, d’ailleurs c’est dimanche et tout est fermé, allons sur la côte, celle de Nuits, où nous trouverons un bar ouvert et boirons du vin. Oui, m’a-t-elle dit, enthousiaste, et on est partis sans même voir le palais ducal ou quoi que ce soit de ce genre, par la départementale 974 qui quitte la ville par le sud en direction de Beaune, parallèle à l’autoroute qui descend jusqu’à Lyon. Nous avons longé des supermarchés discount, des magasins et entrepôts de toutes sortes : des « marchés aux affaires », des « top des prix », des « prix bas tous les jours ! », des marchands de pneus, des concessionnaires automobiles, des centres de contrôle technique, des spécialistes de la location de matériel utilitaire, des hôtels premier prix, un constructeur de piscines, un pizza-bowling-grill, des restaurants chinois, des marchands de meubles, des aménageurs de cuisines, des marchands de remorques, des magasins de literie, des supermarchés de surgelés. Un seul de ces vastes hangars m’indiquait qu’on était bien quelque part dans l’est de la France : un hypermarché Cora. C’était dimanche, c’était laid, et cela n’annonçait rien de bon.
Dijon a fini par s’arrêter et on a vu, à notre droite, le début de la côte d’Or, la ligne de crêtes qui a donné son nom au département. Elle s’étend, sur une cinquantaine de kilomètres, de Dijon à Beaune et un peu plus loin. Au nord, de Dijon à Nuits-Saint-Georges, c’est la côte de Nuits ; au sud, c’est la côte de Beaune. À l’est, l’autoroute ; à l’ouest, le haut de l’escarpement. Entre les deux, sur la pente : la vigne. Et des villages qui ont des noms de vins : Marsannay, Fixin, Gevrey-Chambertin, Morey-Saint-Denis, Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges. On roulait là-dedans, entre les vignes glacées par l’hiver, sous le ciel bas et blanc. C’était beau. À Gevrey-Chambertin, on a aperçu un bar qui avait l’air de convenir, et j’ai dit : « Un truc comme ça, ce serait bien », mais je ne me suis pas arrêté. Je me disais que j’allais trouver mieux. La « route des grands crus » sillonnait le paysage et c’était comme une caricature de la France, tellement c’était français, avec des calvaires au coin des routes, des maisons à tourelles et des vieux murs qui dégueulaient leurs pierres et leurs mousses sur le bas de la chaussée, et les Bourguignons qui avaient planté de la vigne partout, partout, même entre deux murs effondrés, entre deux maisons, la terre était si bonne qu’ils ne voulaient pas perdre un mètre carré, et je pensais qu’ils auraient même pu raser les maisons et aller vivre dans les petits pavillons aux toits de tuiles marron de la zone industrielle de Dijon pour élever encore plus de vignes, et vendre plus de vin. Je pensais au vieux vigneron qu’on voit dans Mondovino, le film de Jonathan Nossiter qui montre les assauts du capitalisme viticole contre les tenants des terroirs. C’était un peu Sur les falaises de marbre, ce documentaire, avec des vieux paladins-bibliothécaires suffoqués par la brutalité du Grand Forestier ; et cet Hubert de Montille, c’était un des dernier paladins, avec sa fille qui lui ressemblait et son fils qui dissemblait. Plus tard, chez moi, je me suis demandé si j’aurais pu le croiser : mais non, ils sont à Volnay, en côte de Beaune. En tout cas, il n’est pas mort, il figure même en héros bourguignon sur le site Internet de la famille.
Sur la route, la vigne en rangs défilait, avec les noms des domaines aristocratiques sur les petits portails de pierre. Les villages étaient déserts. Personne. J’ai dit : « À Nuits-Saint-Georges il y aura forcément quelque chose. » Arrivés à Nuits-Saint-Georges : rien. Rien d’ouvert, ou rien qui convienne : un bar-tabac, un restaurant gastronomique. Le reste était fermé, morte saison. Je m’inquiétais un peu. Le réservoir était vide. À la pompe, la Twingo qui précédait la nôtre ne voulait pas redémarrer. « C’est la première fois que ça m’arrive », a dit la jeune femme. Je lui ai dit que c’était la batterie, le froid, je ne sais quoi, à moi ça m’était déjà arrivé, et j’ai poussé la Twingo, aidé du jeune homme qui accompagnait la conductrice. La voiture a démarré. Je m’inquiétais vraiment : j’allais écrire la chronique de mon échec, ou : comment je suis allé pousser une voiture sur un parking de Nuits-Saint-Georges.
À ce moment, elle a dit : « Pourquoi on ne retournerait pas dans le premier village, là où tu avais dit : «Un truc comme ça, ce serait bien ?» » La matinée avançait. C’était une bonne idée. Demi-tour vers Gevrey-Chambertin, le « vin préféré de l’Empereur », qui le buvait coupé d’eau. Quand on cherche « vin préféré de Napoléon » sur Google, on tombe sur des articles tous identiques, évoquant les Chinois : c’est en effet qu’un « investisseur » asiatique mystérieux a racheté le château du lieu, en août 2012, et ses deux hectares de vigne. Le patrimoine fout le camp, dit la dépêche AFP, « Gevrey-Chambertin vendu à un Chinois », dit Le Figaro. Arrivant près de l’objectif, pas de trace des Chinois, mais un curieux homme barbu nous aborde : « Excusez-moi, vous ne sauriez pas où manger, par hasard ? » Eh non. Peut-être là ? Il y a marqué « brasserie ». « Peut-être, peut-être... Sinon il y a le restau du frère de Rebsamen, mais attention... c’est cher, c’est un gastro... c’est cinquante euro par tête... Bon... Après j’irai me promener dans les vignes, je crois que c’est par là », dit-il en montrant la colline, derrière la rue, où s’étendent les vignes des premiers crus. Il entre avec nous dans le Bar à Vins, rue Richebourg. On nous arrête au seuil. « Ah non désolée vous êtes trois, et moi je fais pas à manger le dimanche, voilà, désolée ! » dit la patronne, tonitruante, blonde, colorée. Il y a pourtant du monde. « Et si l’on est que deux ? - C’est pareil, je ne fais pas à manger ! - Et si on veut juste boire un verre ?... - Ah, mais pourquoi vous ne l’avez pas dit tout de suite ! Asseyez-vous ! » On se met près de la fenêtre, à l’écart. On a l’impression d’interrompre une réunion familiale. Visiblement, tout le monde se connaît, là-dedans. Au comptoir, un type avec un bouc me semble musicien, je ne sais pas pourquoi. Il part en même temps qu’on arrive. Les discussions : des grivoiseries de dimanche midi, « Et alors la blonde, là, comment elle va ? - Oh fais attention hein. » Des enfants blonds incontrôlables courent et s’agrippent aux tabourets, et la patronne, à la coiffure extraordinaire (une couche brune, une couche rousse, une couche blonde) fait une leçon de morale au plus âgé, devant la salle ébahie, alors qu’il a fait mine de la frapper. « Oooooh, il n’est pas né, celui qui lèvera la main sur moi ! Je ne te conseille pas d’essayer, mais si tu le fais, je te préviens tout de suite que ce sera fini de ton amitié avec Tata Gâteau. Réfléchis bien, jeune homme ! » Le gamin, cinq ans, l’air hébété, réfléchit. Il est vaincu. Je me demande qui sont ces gens - le cliché voudrait qu’ils soient vignerons, bien sûr, d’ailleurs, l’Insee me dit qu’ici, 27% des actifs travaillent dans l’agriculture. Je n’en sais rien, si ce n’est que ce ne sont pas des bourgeois, pas des profiteurs des largesses des Chinois. Plus tard, la conversation roule sur George Clooney : est-il plus beau aujourd’hui que du temps qu’il jouait dans la série Urgences ? Et qu’est-ce que la séduction ? Doit-elle toujours être synonyme d’une histoire de cul ? se demandent-ils. Moi, je ne sais pas, je pense que non, je suis d’accord avec la fille de la patronne, qui dit que non, et que séduire, c’est « plaire pour le plaisir de plaire ».
Aux murs, il y a de tout, des tableaux (à vendre) modernito-traditionnels autour du thème du vin ; sur des étagères, toutes sortes de poules, sculptées, peintes, en terre, en verre. Tout cela me rappelle d’autres lieux, des lieux factices à la décoration minable ; bizarrement, ici, c’est à sa place, et cela fait vrai. C’est un sentiment étrange. La fille de la patronne vient nous servir : cheveux courts, blonds, texturés ; tee-shirt rouge « Harley », piercings et boucles d’oreille, maquillage soutenu. Je lui suggère de choisir pour nous, elle répond : « Ça va pas être facile : j’aime tout. » Elle finit par nous apporter un bourgogne 2009. Il y a dans cet endroit une étonnante énergie, comme si le flux vital de la côte de Nuits était concentré là, dans ce petit bar familial de Gevrey, ce qui expliquerait pourquoi, tout autour, c’était vide et morne - la vie a été aspirée ici. « Oh vous savez, le dimanche c’est plein, ils resteraient toute l’après-midi si je ne les empêchais pas, mais la semaine, y a personne », me dit la patronne. Elle engueule sa fille, qui ne veut pas me resservir, parce qu’il faut fermer à treize heures et qu’il en est déjà quatorze. « Mais le monsieur, je lui ai dit oui, déjà ! Ce que je ne veux pas, c’est des nouveaux clients, mais le monsieur c’est bon ! Tiens, encaisse-le... Combien ça fait, seize quatre-vingts ? Allez, seize. » La musique retentit par intermittence. Gangnam Style retentit, ici aussi, et le petit blond se met à se trémousser. Il porte un maillot du Barça, jaune fluo, avec le sponsor : Qatar Foundation ; et dans le journal local barré en une du titre « Un enfant de huit ans retrouvé pendu », on peut lire, en pages 2 et 3, une grande enquête consacrée aux royalistes de Côte-d’Or, qui, paraît-il, se portent bien, et étaient une trentaine à commémorer la mort du roi-martyr. Le petit blond me regarde avec un drôle d’air. À la table, elle lui sourit : elle avait prévu de s’ennuyer, alors elle lit Cien años de soledad.
Nous quittons le Bar à Vins vers quatorze heures, parce que ça ferme. Il ne reste autour de la patronne que le noyau dur des fidèles et l’on se sent un peu de trop. On nous salue dignement, comme si nous avions passé l’épreuve. Sur le trajet du retour, on voit la neige tomber sur les collines de Bourgogne.