


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


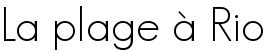
 |
|
|
Publié dans le
numéro 003 (Mars 2011)
|
[Photos : Maïda Chandeze-Avakian]
Dans nos souvenirs enfantins, les plaisirs simples de plage s’associaient à des tunnels creusés sous le sable, des glacières regorgeant de sandwichs jambon-beurre, quelques barbotages en famille ; puis avachi(e)s sur une longue serviette, les premières visions de torses et tétons nubiles rendus saillants par une mer plus ou moins froide, le tout dans un cadre temporel délimité par le calendrier scolaire et/ou l’impénitent salariat. Une expérience par définition sympathique. Il existe pourtant, loin de nos côtes policées, un monde où la plage se décline dans une expérience sociale extrême. Multiculturalisme ou multiculturisme ? Bienvenue dans la folie de la Zona Sul de Rio de Janeiro.
Lorsque l’on aborde le sujet de la plage à Rio, affirmons d’emblée qu’il s’agit de plages « urbaines ». Elles sont en apparence la marge d’une agglomération de onze millions d’habitants, qui tutoie le royaume de Poséidon, la demeure de Yémanja et le domaine de Petrobras. Au milieu du tumulte des rues, des boutiques et des bus apparaît soudain une ouverture, un axe qui, inexplicablement, ne vient buter que sur le scintillement de l’océan et l’azur immaculé. Loin d’être une simple limite architecturale, la plage est, à Rio, perçue comme un espace fondamental, central, et oserons-nous dire, vital ; une « Zone » (rappelant celle de Tarkovski) vécue dans des pratiques fondamentalement différentes de celles que nous connaissons.

Pour y accéder, il faut d’abord traverser le calçadão [1], sorte de promenade balnéaire servant de dernière frontière entre la ville et le rivage. Car la plage, c’est bien le lieu de la rencontre entre la mer et la terre, la roche désagrégée par l’action inlassablement répétée de la houle et des vagues. Mais si l’on a tendance à restreindre la plage à l’estran - partie du littoral recouverte par les marées -, elle comprend aussi l’avant-plage. À Rio, cet espace préliminaire, c’est un trottoir garni de bars et de restaurants, une voie routière, puis la promenade, un sol pavé, à la portugaise. À Copacabana, le dessin de ces pavés - de blanches et noires sinusoïdes - symbolise la laborieuse rencontre des eaux, très distinctes l’une de l’autre, des fleuves Negro et Solimões, pour former, plusieurs kilomètres en aval, l’Amazone.
Tous les dimanches, le calçadão s’épanche. La foule se répand sur l’avenue tout entière, les moyens de locomotion les plus divers y déambulent : des joggeurs, des cyclistes, des skateurs, des patineurs, les chiens y bavent allègrement, les Cariocas (habitants de Rio) courent, marchent, promènent leurs enfants, c’est le bal des ambulants. C’est déjà ça, la plage : un espace viscéralement piéton. Jusque-là, convenons-en, l’expérience n’a rien d’unique ; on trouve cela ailleurs. Elle n’a rien encore d’irréversible : on peut encore replonger, plus ou moins intègre, dans les artères de la cité. Cette avant-plage est un espace encore urbain, simplement altéré, comme décontracté, par les effluves et embruns venus du large.
Car
au-delà, en effet, il y a la mer. En France, c’est avant tout pour
elle que nous allons à la plage : pour s’y baigner, y nager,
y faire de la planche à voile, etc. À
Rio, la mer est hostile. Sur les plages de Flamengo et de
Botafogo, donnant sur
l’intérieur de la baie [2],
la mer n’est guère baignable, trop polluée. Sur les plages
océaniques (Copacabana et Ipanema), la houle est puissante,
déversant sans relâche des vagues féroces qui font le plaisir des
seuls surfeurs, regroupés en essaims sur les spots
les plus favorables. Le reste des plagistes, l’immense majorité,
se contente donc de se tremper dans la déferlante. Rares sont ceux
qui s’aventurent au-delà de la barre. Ainsi nage-t-on peu dans la
mer à Rio. On se contente de s’y trempoter, le temps de batifoler,
de discuter, de s’embrasser ou de s’y soulager. L’eau étant
« froide » -
dixit les Cariocas
![]() et mouvementée, on a tôt fait d’en sortir, une fois le corps
rafraîchi. À
Rio, la mer est un mensonge ; elle ne permet pas de faire la
distinction entre le cru et le cuit.
et mouvementée, on a tôt fait d’en sortir, une fois le corps
rafraîchi. À
Rio, la mer est un mensonge ; elle ne permet pas de faire la
distinction entre le cru et le cuit.
Lorsque l’on sort de l’eau, c’est pour rejoindre l’espace central de cette frange littorale, cette étendue de sable parfois recouverte par les marées ; la plage proprement dite. La Zone est une étendue de sable fin en forme de demi-lune étirée sur plusieurs kilomètres, grouillant chaque fin de semaine de centaines de milliers d’individus. Première remarque : nul besoin d’équipement particulier. Tous les cinquante mètres, une barraca est plantée, prête à vous offrir ces services. Lorsque l’on arrive du calçadão, plusieurs rabatteurs s’ébrouent, rivalisant de promptitude à vous proposer abri, sièges, boissons, et cela pour une durée indéterminée. Slalomant dans le bazar des plagistes déjà installés, l’on repère une indiscernable clairière et y installe un bivouac minimaliste et confortable : l’indispensable parasol, éventuellement quelques chaises.
Seuls quelques touristes européens, français en particulier, persistent à s’installer orgueilleusement hors de toute barraca, étalant avec appétit leur bonne vieille serviette, certains - sans le savoir ? - de regagner leur hôtel écarlates et salés comme des langoustes rances. Pour un Carioca pourtant, tout le plaisir consiste justement non pas tant à se baigner, point davantage à se sécher laborieusement, mais au contraire à s’allonger nonchalamment jusqu’à laisser le soleil aspirer, une à une, les gouttelettes perlant sa peau mordorée. Non, ici, point de serviettes, de cabas, ni de paravents. On vient à la plage muni, selon les stances de Brassens, du « strict né-ces-saire [3] ». Tout au plus un « tissu de plage » : la canga. La menace supposée des « princes [...] de la cambriole » oblige ainsi à une première démarche de dépossession. Pas d’objet de valeur sur la plage. Une fusion socialement intégrée de la propriété et du vol. La plage à Rio est, en première instance, un espace bakouninien.
Ensuite, pour tenir le coup, on boit. De l’eau certes, mais surtout de la bière, blonde et très fraîche. Beaucoup de bières même, presque congelées si possible. On mange, on grignote aussi. C’est là que l’on s’aperçoit que les plages de la ville forment un interlope réseau de services à la personne, animé par des colporteurs ambulants prêts à combler en permanence les besoins primaires des plagistes.
Un cortège incessant de vendeurs parcourt l’estran, en long et en large, zigzaguant parmi les corps affalés, les cangas, chaises et parasols : « Açaiiiii ! », « Matte limão, Matte limão ! »,« Camarão Camarão Camarão ! », « Queijo coaaaaaalho ! » Açaí, thé citron, crevettes, fromages fondu... Eau, bière, guarana, jus de coco, brochettes de crevettes et de fromage, pastèque, pâtisseries libanaises, chips, sodas... sans parler des vendeurs de lunettes, de bijoux, de cangas, de maillots, de tatouages au henné, de massages, etc. Ces hommes et femmes habitent souvent la banlieue, arpentent la plage du matin jusqu’au soir, portant bombonnes et glacières pesant jusqu’à 40kg lorsqu’elles sont pleines. Les plagistes, eux, sont couchés sur leur canga. Il suffit de lever le petit doigt pour que la demande rencontre l’offre. En cela, la plage à Rio est un espace smithien.
Allongé sur sa canga, engloutissant une bière à grandes gorgées, l’expérience in situ commence. Devant soi, des corps, à l’infini, (presque) nus, partout, qui déambulent, gigotent, marchent, se contorsionnent, se touchent, se plissent ou se cambrent. De la chair comme aucun autre endroit au monde n’en concentre dans un espace public. Une fois le corps à peu près sec, hommes et femmes se lubrifient méticuleusement les membres. Non pas de crème solaire, mais d’huile bronzante. Il ne s’agit pas de préserver son épiderme des rayons de l’astre suprême, mais bien au contraire de le lui donner en offrande, de prier pour qu’il daigne le darder à souhait ; chaque petit flacon d’huile rougeâtre devenant un ex-voto au puissant Hélios.
Pourtant, comme tout bon cliché, le culte du corps carioca est à la fois incontestablement présent et faux-semblant. Si la plage est bien un lieu de défilé, de parade, l’on s’y montre à moitié nu dans un mélange sidérant de mise en valeur et d’insouciance. La jeune femme mince rajuste les bretelles de son bikini griffé derrière les larges verres teints de ses lunettes D&G. Mais la femme la plus grosse porte aussi son string carmin, se plante au beau milieu de l’arène et étale ses bourrelets sans regrets. Hommes sculptés ou ventripotents se côtoient sans complexes. Le corps semble être délesté, dans cet espace, de toute dimension morale ; il est exposé, hic et nunc, dans sa forme la plus brute, sans détours ni atours, à travers une présence si forte, si concentrée, qu’il en devient presque invisible et en tout cas banal.
À mesure que le temps passe, que les canettes vides disparaissent dans le sac des catadores [4], le spectacle ne cesse pas un instant. L’on est condamné à une vision perpétuelle de corps en chaleur, humides, salés, transpirants ou huilés, de membres turgescents, de rondeurs en mouvement, de muscles tendus, de tissus moulants, de cheveux flottants, de chairs épilées, d’épidermes choyés. Une seule limite, toujours respectée, celle du sein qui ne saurait être exposé. Un même monde « topless » ne deviendrait-il pas la manifestation insoutenable d’un univers dans lequel le mystère, ou toute forme de suggestion auraient été à jamais bannis ?
En dépit de cet interdit, la tension érotique qui règne a de quoi affoler le baromètre de la pudibonderie des non-Cariocas. Ainsi, cette jeune demoiselle, à la blonde chevelure, débarquant sur la plage d’Ipanema, un dimanche en fin de matinée, seins et lèvres ostensiblement refaits par quelque chirurgien du quartier. Elle pose sa canga sur le sable. Laisse choir son petit short. Puis s’ingénie à enfiler son haut de maillot de bain sans retirer son maigre débardeur blanc-translucide. Elle ôte d’abord son « soutien [5] » et le laisse négligemment tomber sur sa canga. Puis elle enfile habilement son petit haut strié noir et blanc, et l’ajuste conformément au galbe généreux de ses seins, debout au milieu de la plage, aspirant vers elle les regards exorbités des hommes environnants. Elle s’assoit enfin, sur sa chaise, dos à la mer, face au soleil incandescent. Ferme les yeux et ignore ce beau monde haletant.
Difficile, ici, de ne pas convier Alan Pauls, le voisin argentin, pour formuler la consternation que suscite chez le nouveau-venu cette expérience des limites, charnelle et torride : « Comment [est-il] possible que cet amas de corps à peine couverts, luisants de crème, de sueur ou d’eau, chauffés sans retenue par le soleil [...] et par une proximité franchement équivoque, intolérable dans tout autre contexte, ne débouche fatalement sur une explosion sexuelle collective, une partouze sauvage généralisée, une bouffée de violence mortelle ? [6] » Un monde dans lequel le désir d’exposition est contagieux : mimétique, la plage à Rio est un espace girardien.

Si la plage ne sombre pas dans une frénésie sexuelle dionysiaque, c’est peut-être parce qu’elle est l’arène de son plus puissant ersatz : le jeu. À Rio, celui-ci n’est nullement l’apanage des enfants. Les adultes s’y livrent avec une ferveur et une attention démentielles. Toute l’énergie contenue dans ces corps exhibés, excités, massés à longueur de journée, semble devoir trouver un déversoir dans des pratiques ludiques : raquettes, foot, volley, futvolei, altinha [7]...
La frontière entre jeu et sport s’estompe très rapidement devant le perfectionnisme avec lequel chacun et chacune s’adonne à ces activités. À la fois autel et podium de sa propre réussite, le terrain où se pratique le jeu est le lieu central du culte de la plage carioca. Visages concentrés, corps huilés et glabres, shorts échancrés, ces couples d’amis sexagénaires jouent au volley en plein cagnard depuis trois heures sans répit. Les pieds dans l’eau, fines et élancées, six sylphides en cercle s’adonnent à l’altinha pendant des heures. La balle ne tombe pas. Jamais... Plus loin, ces deux amis jouent aux raquettes de plage avec une telle ardeur que leur amitié semble liée à leur capacité à frapper plus fort et plus juste. Le sable est bondé d’athlètes de tous âges perlés de sueur, toniques et bronzés, abhorrant la défaite et pour lesquels la plage est avant tout une expérience physique permanente, brute, rugueuse et amicale.
La plage, comme l’avant-plage, est constellée d’agrès pour la malhação, la musculation. Hommes, femmes, jeunes et vieux, s’ébrouent sur ces ustensiles en bois ou en métal, certains en forme d’abribus financés par la mairie. Il faut sculpter son corps, l’entretenir. Expurger toutes les bières bues, tous les trajets à pieds évités. À Rio, le climat incite à se dénuder pendant une bonne partie de l’année. Partant, peu importe les habits, les marques et les coupes : un slip et des tongs suffisent, pour peu que le corps soit musclé, entretenu, soigné. En semaine, en matinée ou en soirée, les plages sont arpentées par des joggeurs infatigables. Même en plein midi, en slip ou bikini, une main enfilée dans chaque Havaiana [8], les gens musclent leurs cuisses dans le sable, râlent et suent à la création sans cesse refaite d’une sorte d’Übermensch de plage. Par-delà le bien et le mal. La plage à Rio est un espace viscéralement nietzschéen.
Zone a priori démocratique, la plage à Rio n’en reflète pas moins les extrêmes inégalités sociales séculaires de la société brésilienne. Ceux qui ont les moyens d’habiter les beaux quartiers de la Zona Sul ont une pratique de la plage différente de ceux qui viennent de banlieue. Si ceux-là en ont un usage quotidien, en semaine, le matin avant de partir travailler, le soir pour courir ; ceux-ci viennent en expédition les jours fériés et les week-ends, ils viennent en groupe, tôt le matin et restent toute la journée.
Allongé sur le sable chaud, dans une demi-somnolence, l’on peut même se livrer à une petite sociologie de la plage carioca. Si celle-ci est, par essence, gratuite, chaque posto (poste de secouristes et toilettes), définit, à chaque kilomètre, une ambiance, une faune. Tout au nord de Copacabana, Leme, la première des plages baignables, un peu excentrée, est fréquentée par des personnes âgées, des familles. Copacabana, la plus célèbre, la plus longue (4,5 km) est parcourue par les riverains, les banlieusards et les touristes car, outre qu’elle est considérée comme la plus belle, c’est aussi la plus accessible. Entre Copacabana et Ipanema, quelques morros [9] et favelas, dont celle de Cantagalo, qui s’élève très abruptement derrière Copacabana.
À partir d’Ipanema, c’en est fini de la plèbe : les corps soigneusement préparés, le public plus « blanc » et l’esthétique très soignée manifestent l’appartenance à une « élite de plage » : lunettes de soleil de marque, attitudes arrogantes, maillots de bain griffés, même maquillage et la fameuse chirurgie esthétique donnant aux atouts féminins un aspect peu naturellement antigravitationnel. Au nord d’Ipanema, Arpoador : le spot des surfeurs, aussi fréquenté la nuit pour les nombreux concerts organisés au pied du morro. Puis, sur Ipanema, le posto oito (8), repère de la communauté gay. Le posto nove (9), squat branché de la jeunesse dorée. Ce coin, toujours bondé, se remplit souvent d’effluves illicites. Au posto dez (10), c’est les mêmes, dix ans après, un peu plus calmes, mais toujours fiers et mutins. Enfin la plage de Leblon, le lieu des artistes, des intellos, des familles. Les joints y sont malvenus. Derrière Ipanema, les quartiers riches, de grands immeubles avec barrières de sécurité et vigiles, de somptueuses maisons à flanc de colline. Un peu plus loin, sur la corniche, le Sheraton se dresse fièrement au pied de la favela do Vidigal qui grimpe à flanc du morro dos Dois Irmãos, face à l’océan resplendissant.
La plage est aussi le lieu, à Rio de Janeiro, des grands rassemblements : lors du réveillon, pour le carnaval, à l’occasion d’événements sportifs ou de concerts exceptionnels (Roberto Carlos, Madonna, les Rolling Stones, Black Eyed Peas...). Ainsi apparaît-elle comme un espace commun, paradoxal : segmenté certes, mais ouvert à tous et reflétant la diversité sociale et culturelle. Dans un pays où les espaces publics sont souvent dégradés, peu entretenus, peu considérés et où les lieux de récréation sont souvent des lieux privés (bars, boîtes, centres commerciaux...), la plage devient ainsi un espace public incontournable, l’agora brasileira.
Le week-end, quand la plage est bondée, l’on s’y trouve proche de toutes sortes d’autres gens, assis, debout, allongés dans la plus grande promiscuité. L’on y délimite un micro-périmètre avec les chaises, le parasol et les cangas, on s’installe et on ne bouge plus de la journée. Alors, on y délaisse son intimité fondamentale, comme si on était chez soi, dans un quartier ultra-densément peuplé, sans parois pour séparer les foyers. L’on y parle fort, on hèle les amis, on réprimande les gamins, on dort, on crie, on rigole, on pleure, on parle de sa belle-mère, de ses dernières menstruations ou de ses mycoses. De parfaits inconnus gisent à quelques centimètres à peine de soi. Qu’importe, on les ignore, on les salue, on plaisante avec eux, a vontade [10]... ! Il n’y a plus d’individus à la plage. On y est dissous, malgré soi, dans une expérience fusionnelle de groupe. Après plusieurs heures d’immersion dans cette fournaise sexy, hurlante et sympathique, le Moi - et ses références, rassurantes par leur austérité, à Adam Smith, Friedrich Nietzsche, René Girard, Andreï Tarkovsky - se désintègre dans ce chaud remous d’écume, de mousse, de vie, de chair, de voix et d’alcool, dans cette sorte de « Lebens-Rhum » insatiable, à la limite du supportable.
Et c’est à peine si l’on aperçoit, en fin d’après-midi, ce gringo ventripotent et incongru, se promener au bord de l’eau en baskets et chaussettes, accompagné d’une grande femme métisse aux formes voluptueuses. Cette femme a l’air refaite. Ses épaules ne sont pourtant pas très larges, mais ses hanches plutôt fines. Dans les irisations de la chaleur qui retombe, le regard torve du plagiste devine vaguement la pomme d’adam, saillante, de cette escorte et son bas de bikini un peu trop rebondi. Il y a quelque chose qui cloche... ou qui cliche ? S’agirait-il d’un ... ? Notre ami sait-il... ?
Au beau milieu des tergiversations vaseuses de ce cerveau engourdi, alors que s’apprête à s’enliser dans l’océan un soleil aussi rougeaud que le corps de ce gringo, un bruit sourd au loin. Cette pulsation retentit crescendo. De plus en plus fort, de plus en plus près. Surgit alors, au ras des vagues pailletées, un hélicoptère de la police militaire. Deux hommes, arme au poing, sont harnachés sur le rebord, le visage dur et fier, revenant des dernières opérations de « nettoyage » antinarcotrafiquant dans les quartiers de la Zona Norte. Eux aussi en cette fin de journée réclament leur part d’exhibition de plage dans un remake où João Gilberto aurait remplacé Richard Wagner.
Derrière, les luxueuses résidences surveillées de Leblon. En face, surplombant l’océan, l’immense favela do Vidigal. Au milieu ? La plage.
[1] Calçadão : littéralement « la grosse chaussée »
[2] Cette baie découverte le 1er janvier (Janeiro) 1502 par des navigateurs portugais et que ceux-ci prirent pour l'embouchure d'un fleuve (Rio) vu son immensité.
[3] Stances à un cambrioleur, Georges Brassens, 1972.
[4] Catadores : nom des récupérateurs informels brésiliens.
[5] Soutien : mot brésilien pour soutien-gorge.
[6] Alan Pauls, La Vie pieds nus, Christian Bourgois, 2007.
[7] Altinha : Jeu collectif consistant à faire des jongles avec un ballon de foot, en cercle, en évitant que la balle ne tombe à terre.
[8] Havaianas : marque de tongs brésilienne bien connue
[9] Morros : abruptes collines de granit, habitées ou non, qui jalonnent la ville.
[10] A vontade : expression idiomatique signifiant « à l'aise ».