


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


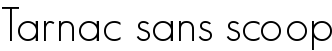
David Dufresne a été journaliste à Libération de 1994 à 2002, itélé de 2002 à 2006, Mediapart de 2008 à 2009. Il est notamment l’auteur d’un livre sur le Maintien de l’ordre (Hachette Littératures, 2007), et d’un webdocumentaire sur les prisons américaines, Prison Valley (2010).
Je
l’ai
rencontré
pour
la
première
fois
début
2009,
pour
parler
avec
lui
de
l’affaire
dite
de
Tarnac,
sur
laquelle
Le
Tigre
avait
publié
un
dossier,
fin
2008.
Dossier
qui
revenait
sur
la
construction
médiatique
autour
des
évènements
ayant
suivi
d’une
part
les
quelques
sabotages
de
lignes
SNCF,
et
d’autre
part
les
arrestations,
gardes
à
vue,
mises
en
examen
et
détentions
provisoires
du
« groupe
de
Tarnac ».
Davduf,
comme
je
continue
à
l’appeler
– c’est
le
nom
de
son
site
ou
de
son
compte
Twitter
– avait
déjà
pris
la
décision
d’écrire
un
livre
sur
ces
évènements.
Nous
avons
souvent
parlé
ensemble
de
ce
livre – tout
en
développant
des
relations
amicales.
En
mars
2012, il a publié
Tarnac,
magasin
général
(Calmann–Lévy).
Un
gros
livre
où
l’auteur
se
met
en
scène,
s’interroge
sur
le
sens
du
métier
de
journaliste,
et
construit
son
récit
autour
des
dizaines
de
personnes
qu’il
rencontre :
les
mis
en
examen,
les
policiers
de
« base »
de
la
DCRI,
les
autorités
politiques
et
judiciaires,
etc.
Un
livre
qui
donne
aussi
à
lire
beaucoup
de
matière
brute,
que
ce
soit
les
textes
militants
(L’Appel,
L’Insurrection
qui
vient),
les
rapports
de
la
police,
et
les
procès–verbaux
permettant
d’assister,
de
l’intérieur,
aux
mécanismes
de
l’enquête
judiciaire.
Après
trois
ans
de
discussions
ensemble
sur
le
sujet,
il
était
temps
de
dialoguer
en
public :
entretien
réalisé
dans
les
bureaux
du
Tigre,
le
lundi
5
mars
2012.

Raphaël Meltz – La promo de ton livre a commencé avec la une du Monde des Livres : un article très élogieux, mais où Ariane Chemin écrit que ce livre est ton « testament ». Est–ce ça ne t’a pas fait bizarre ?
David Dufresne – C’est très drôle, parce que c’est une formule que j’utilise dans le manuscrit, et que je retire à la dernière minute, donc qui n’est pas dans le livre. Et Ariane Chemin m’appelle juste avant la parution de son article, pour une vérification, et elle me dit ça : « Je l’ai lu comme un testament. » Et moi : « oui, je pense qu’on peut le lire comme ça »... Et je lui ai demandé si le cercueil serait bien. Ce qu’il y a de sûr, c’est que c’est l’aboutissement de vingt ans d’errances dans le journalisme, et c’est le deuil de certaines pratiques.
R.M. – C’est deux choses très différentes : le testament, ça veut dire que c’est fini, alors que le deuil, c’est le deuil de tes illusions, j’ai vieilli, j’ai mûri...
D.D. – Ou plutôt : je n’ai pas vieilli sur certains trucs. En réalité, je ne sais plus le métier que je fais.
R.M. – Et, la même semaine, il y a un article dans Télérama sur le journalisme d’investigation où tu fais une métaphore sur les cow–boys, et tu dis que tu es « descendu du cheval ».
D.D. – La journaliste de Télérama n’a gardé que la formule que je lui avais sorti sur les cow–boys...
R.M. – Tu découvres que les journalistes déforment les propos !
D.D. – Je ne le découvre pas du tout, parce que, avant de venir au journalisme, mon travail faisait l’objet d’articles, dans le rock, quand je sortais des disques. Donc je sais ce que c’est que la violence d’un article sur son travail, et j’ai toujours ça en tête. Quelle que soit la personne dont je parle, a fortiori quand je fais un bouquin, j’ai toujours ça en tête.
R.M. – Est–ce que tu sens une différence entre ce livre–ci et le précédent (Maintien de l’ordre) ?
D.D. – Ah oui. Dans Maintien de l’ordre, on comprend que Malik Oussékine, j’y étais. On comprend. Ensuite, dans Prison Valley, je dis « nous », parce que je suis avec Philippe Brault. Et maintenant, je dis : « je ». Il m’a fallu trois étapes... Pour retourner à ma source, le fanzinat. Et dire : la respectabilité, l’objectivité, la notabilité du journalisme, fuck.
R.M. – C’est drôle, parce que j’attaque toujours les écoles de journalisme, en disant que c’est elles qui imposent une écriture stéréotypée, mais toi tu n’es pas passé par ce moule, tu es issu du fanzinat et donc de la liberté totale dans l’expression, et finalement, petit à petit tu es rentré dans un moule journalistique...
D.D. – Malgré tout, j’étais toujours sur le bord du moule... Bizarrement, le moment où mon écriture devient de plus en plus conforme, c’est à Mediapart. Où je me mets écrire « comme nous vous le révélions », « comme Mediapart l’avait annoncé »... Des trucs de vente. Parce que, à ce moment–là, c’est un pari fou, personne n’y croit, à part les quinze clampins de la rédaction, qui pensent que le payant sur le net va pouvoir marcher, et il y a cette idée de...
R.M. – De survendre un peu l’information.
D.D. – De survendre, c’est ça. Sur le moment, je n’étais pas malheureux de faire ça, c’est après coup que je me dis : je suis passé par là. Mais avant j’étais chroniqueur judiciaire : ce n’est pas pour rien que ceux qui aiment écrire font des procès... Dans les procès, dans les faits–divers, le point de vue de l’auteur est plus présent, parce que tu es dans un truc de pâte humaine. Ce n’est pas juste : il s’est passé ça. Il s’est passé ça, d’accord, mais c’est le contexte qui compte.
R.M. – Tu faisais des compte–rendus de procès, à Libé, dans les années 1990 ?
D.D. – Oui. Par exemple j’ai suivi le procès de Jean–Claude Romand, tu peux retrouver ça sur mon site. Il y avait Emmanuel Carrère qui était avec nous, et qui ne comprenait pas grand chose à ce qui se passait. Et qui a publié son livre sur l’affaire, L’adversaire, six mois après. Il ne savait pas comment la justice fonctionnait. C’est quoi un procureur, pourquoi on se lève, etc. Les chroniqueurs judiciaires, c’est une petite bande qui finit toujours au resto, il y a des paris : « il est coupable, il va prendre 20 ans »... Il faisait partie de notre bande. Et puis, il sort son bouquin, et, à l’époque, je me dis : « mais c’est n’importe quoi ». Et, en fait, c’est lui qui a raison.
R.M. – Quand le livre sort, tu le lis comme un journaliste ?
D.D. – Voilà. Je me dis : pourquoi plaquer une analyse alors que les faits eux–mêmes sont extraordinaires ? Ils suffisent par eux–mêmes.
R.M. – J’ai lu récemment un texte de Carrère où il parle de De Sang–froid, de Truman Capote, qui est manifestement une influence pour ton livre. Et Carrère explique : dans De Sang–froid, tout subjectif que soit le livre, Capote ne dit jamais « je ». Et après la sortie du livre, Capote a pété les plombs, il est devenu réellement fou – bon, il y a aussi qu’il est tombé amoureux d’un des deux assassins, qu’il a assisté à sa pendaison – et il n’a jamais rien pu faire ensuite. Et Carrère dit : au début, j’ai voulu ne pas mettre de « je », et je me suis rendu compte que j’allais devenir fou comme Truman Capote, à essayer d’être dans cet entre–deux, dans cette fictionnalisation du réel, c’est–à–dire comme un roman, sans intervention de l’auteur, mais ça crame tellement la tête, c’est tellement angoissant de se mettre dans la tête du tueur, que je me suis mis en scène, et finalement ça m’a sauvé.
D.D. – Moi, pour le mien, je pense que ça m’a cramé la tête.
R.M. – Oui, mais toi c’est le contraire. Tu venais de l’école où tu dois ne pas te mettre en scène.
D.D. – Non, parce que dans mes premiers papiers sur le rock, Public Enemy, Nirvana, je me mets en scène, je n’ai aucun souci avec ça. C’est plus les directeurs de rédaction qui ont un souci avec ça. Enfin, à Actuel, évidemment, Bizot n’avait pas de souci avec ça, au contraire, il encourageait. Pareil Michel Butel, à L’Autre journal. Là, l’utilisation du « je » dans le livre, c’est d’abord parce que c’est une affaire personnelle, et c’est aussi une façon de dire à tous mes interlocuteurs, quels qu’ils soient : je vous mets en danger, mais je me mets moi aussi en danger. Je ne suis pas au–dessus de la mêlée. Squarcini, je suis avec toi, dans ton bureau, là, à Levallois ; untel, je suis avec toi à l’épicerie de Tarnac. S’il y a bien quelque chose qui n’a pas posé question, c’est que je savais dès le début qu’il y aurait le « je ».
[D.D. regarde l’enregisteur.]
D.D. – Ça enregistre ?
R.M. – Oui, tu vois le petit voyant rouge.
D.D. – C’est comme la télé, en fait, Le Tigre.
R.M. – Justement, j’avais une question à ce propos. À un moment tu décris comment tu fais pour la prise de notes. Tu racontes qu’une amie journaliste à Libé va aux toilettes, note tout ce qui vient de se dire, puis revient. Et toi, tu utilises un système de mots–clés.
D.D. – Des mots–clés, des phrases–clés, des phrases entières. Et en fait, c’est très éprouvant. Parce qu’en même temps, il faut maintenir la discussion. Je dirais que c’est une influence directe du finder du Macintosh. Cette idée de classement et de multitâches. Mais je ne le fais pas à chaque fois. Je le fais au début, parce qu’au premier entretien je ne peux pas sortir le calepin.
R.M. – La conséquence, c’est que c’est toi qui retranscrits les dialogues, et que quel que soit ton talent, quel que soit le talent de Truman Capote qui disait « je me souviens de 98% de ce qui a été dit », la reconstitution d’un dialogue ce n’est pas du tout la même chose qu’un vrai dialogue.
D.D. – Alors, attention. Je pourrais te montrer mes calepins : je note en dialogue.
R.M. – D’accord. Mais quand tu notes un dialogue, quelle que soit la qualité de ta mémoire, tu ne peux pas garder la syntaxe de quelqu’un, Son obsession sur tel mot, ses répétitions, ses accélérations, ses ralentissements...Prendre en notes quelqu’un, ce n’est pas la même chose qu’avoir sa voix dans l’oreille... Et j’ai trouvé que, dans le livre, il y avait une unification des façons de parler des personnages.
D.D. – Là, tu tombes mal, parce que la plupart, la majorité des dialogues restitués sont enregistrés, en vidéo, ou en audio. Et puis, des gens qui ont une construction verbale, une oralité propre, il n’y a en a pas tant que ça. C’est tout bête : quand tu passes des heures avec des flics, il y a un discours flic, un vocabulaire flic, une syntaxe flic.
R.M. – Mais les Tarnacois...
D.D. – Les Tarnacois ne s’expriment pas de la même manière, dans le livre, que les flics.
R.M. – Je ne l’ai pas assez senti dans le livre...
D.D. – C’est marrant que tu dises ça, parce que j’ai pris la précaution de citer Gabriel Garcia Marquez là–dessus.
« Au temps où il oscillait entre le journalisme et le roman, Marquez avait déclaré possible de mener des interviews de la même manière que l’on écrit un roman ou une poésie. Il ne signifiait pas que le journalisme pouvait être dans la fiction ; ça voulait simplement dire que les ressorts de l’une pouvaient servir à l’autre. Ça signifiait qu’un regard, une tangente, une phrase inachevée, toutes ces choses gommées par l’info rapide, pouvaient être autrement précieuses que les déclarations toutes faites, prémâchées. » [p.326]
D.D. – En gros, parce que j’ai la parole enregistrée, je ne prends plus de notes sur le regard tout à coup de l’interlocuteur, le geste qu’il fait, le silence tu l’as mais tu ne le restitues pas dans l’interview. Or, ça, je trouve que quand tu as le stylo en main, c’est beaucoup plus fort.
R.M. – Mais les deux peuvent aller de pair.
D.D. – Oui... Mais je fais partie d’une génération où on n’enregistrait pas. Les cassettes, c’était pas courant. Quand j’ai commencé, les journalistes prenaient plus de notes qu’ils n’enregistraient.
R.M. – Tu n’es quand même pas vieux au point de ne pas avoir connu les cassettes... Dès les années 1980, il y avait des petits magnétos...
D.D. – C’est vrai, mais quand tu arrivais avec un magnéto, ça faisait de l’effet aux gens : « ah bon, vous enregistrez ? » Parce que la génération d’avant ne le faisait pas. Nous, on est nés avec ça, et ça ne nous dérange pas... Par ailleurs, ça peut être un truc bloquant, le magnéto. Dès lors que tu es avec des gens qui risquent beaucoup, le magnéto, c’est... Devant un flic de la DCRI (Direction centrale du renseignement intérieur) ou de la SDAT (Sous–direction anti–terroriste), qui risquent vraiment des problèmes à me parler...
R.M. – On est d’accord, parfois tu ne peux techniquement pas...
D.D. – Enfin, « techniquement »... Maintenant on peut faire ce qu’on appelle, je l’ai appris récemment, des « entretiens sonorisés ». Comme les journalistes sont suivis, écoutés, ils se disent : « nous aussi on va sonoriser », enregistrer sans le dire, les rencontres avec des flics... Je trouve ça assez drôle, d’ailleurs. Enfin, je trouve ça drôle comme ça en plaisantant, mais il y a quand même un côté un peu lâche. Personnellement, j’avance toujours à visage découvert.
R.M. – Une des choses les plus intéressantes du livre, c’est que tu dis : il n’y aura aucun scoop, dans ce livre, et en même temps vous allez apprendre mille choses, mais je ne suis pas là pour vous dire si, oui ou non, les gens de Tarnac sont impliqués dans cette histoire, est–ce qu’ils ont posé ces fers à béton ou non, ce n’est pas ça qui est important. Évidemment, pour nous au Tigre, tu prêches des convaincus, puisqu’on a toujours pensé que ce n’était pas le vent de l’actualité qui comptait, mais ce que tu peux raconter par derrière, les arrière–boutiques. Ton livre fonctionne comme ça, tu évacues la question du scoop. Et pourtant, tu navigues entre les extrêmes : d’un côté, ce que tu appelles les invisibles, qui ne sont finalement pas si invisibles que ça, et de l’autre côté, le pouvoir qui est d’ailleurs souvent aussi invisible, et qui t’ouvre les portes. Par exemple, le bureau de Squarcini...
D.D. – Exact.
R.M. – Alors, justement, sur Squarcini : un mois avant ton livre, il y a eu celui sur L’Espion du président [1] : Squarcini, le patron de la DCRI. Apparemment, vous vous êtes échangés des informations. Puisqu’il y a dans leur livre une anecdote qui est aussi dans le tien. Aucun des trois auteurs n’est entré dans le bureau de Squarcini, mais toi oui.
D.D. – Bon... Puisque Le Tigre veut faire de l’information maintenant, voici un scoop. Didier Hassoux, un des trois auteurs du livre sur Squarcini, et qui fait aussi l’objet d’un chapitre dans mon livre, est un ancien de Libération, un ami de longue date. Pendant des mois, on a eu une adresse mail commune, hassduf@gmail.com, comme Hassoux–Dufresne. J’avais expliqué à Didier : on ne s’envoie pas de mails, on n’écrit que des brouillons, et chacun va lire les brouillons de l’autre. L’important, c’est que ça ne transite pas sur ton ordinateur : du coup, c’est difficilement détectable. Ça ne passe pas par les flux : personne ne peut remonter à la boîte avec ton adresse IP. Tous les gauchos savent ça, les flics aussi, bon, pas de souci. Et donc pendant des mois, on s’est échangé des informations. Donc il m’a envoyé son passage sur Tarnac, et moi je lui ai envoyé mon chapitre sur Squarcini. Où je décris le bureau. Donc ils ont utilisé cette description. Et je raconte l’histoire du geste que me fait Squarcini, lors d’un rendez–vous...
R.M. – Où il te met la main sur la nuque, comme un flingue.
D.D. – Voilà, mais un flingue, comme un pistolet à eau, c’est un peu une blague, c’est pour rire, franchement je n’ai pas été menacé de mort. Mais. À la limite, on peut dire que c’est du pré–quelque chose... Puisque lui aime beaucoup les histoires des pré–terrorisme. Bref. Didier a réutilisé ça, c’est même pas donnant–donnant, c’est un truc de potes. À ce moment–là, on est à 6.000 kilomètres de distance [2]...
R.M. – Et évidemment vous ne pouvez pas vous parler par téléphone...
D.D. – Non. Et Didier et ses amis vivent des choses très dures, qu’ils racontent dans leur bouquin, ils ont été siphonnés, les disques durs, on leur pique leur portable en gare de Marseille, etc. Tu ne peux pas être tout seul dans ces cas–là. Si je signe le livre tout seul, en réalité il y a plein de gens qui ont souffert avec moi, dont Didier. Mais il n’y a aucune tractation. Pendant trois ans, quand j’étais normand, et maintenant canadien, à chaque fois que je venais à Paris, j’allais voir Didier, et on parlait énormément. On se confessait mutuellement.
R.M. – Du debrief, comme les agents secrets.
D.D. – C’est ça, exactement !
R.M. – Leur livre est un livre très classique, très journalistique, en revanche, c’est bourré d’informations.
D.D. – Voilà. Il y a plus d’une information par page.
R.M. – C’est l’opposé du tien. On est dans du scoop très inédit, il y a énormément de choses qu’on n’a jamais lu, mais ça rappelle beaucoup le journalisme de flux...
D.D. – C’est deux logiques d’écriture qui n’ont rien à voir... mais ils ont fait un boulot de dingue.
R.M. – Ce qui est amusant, c’est que ce fameux épisode du rendez–vous avec Squarcini est plus dramatique dans leur livre que dans le tien.
[L’espion du président] : « Lorsque le journaliste David Dufresne, qui prépare un livre d’enquête sur les dessous de l’affaire [de Tarnac], le rencontre à Levallois, à la fin de l’entretien, Squarcini le raccompagne et mime le geste de lui appuyer un pistolet sur la nuque – pour rire bien évidemment. »
[Tarnac, magasin général] : « C’était notre troisième et dernier rendez–vous. Cette fois, au moment de se saluer, il y eut un geste de plus, un drôle de geste, un geste de flic, deux doigts s’enfonçant, tel un canon imaginaire, à l’endroit même où on ne sait plus si c’est le dos qui s’arrête ou la nuque qui commence. Un geste pour dire que tout ça, c’était du jeu. Ce geste n’était ni une menace, ni même un avertissement, tout juste, peut–être, un message. C’était du spectacle, un truc entre hommes. De la nébuleuse policière, à prendre avec humour, ou à laisser. » [p.343]
R.M. – Quand je l’ai lu dans leur livre, je me suis dit « trash, les rapports Squarcini–Dufresne », et quand je l’ai lu dans le tien, je me suis dit, non, en fait...
D.D. – Peut–être que c’est Didier qui a raison, peut–être que Squarcini, au rang qui est le sien, ne devrait pas faire ce geste. Moi, je m’en fous complètement. Enfin, si je m’en foutais complètement, je n’en parlerais pas. Je trouve que ça fait partie du personnage, que ça fait partie de la fanfaronnade. Je trouve que c’est beaucoup plus grave ce que ses services ont fait dans cette affaire que ce que lui me fait.
R.M. – J’ai une question sur la notion d’anonymat. Le principe du livre, c’est que chaque personne est nommée, y compris des gens très connus, que ce soit le patron des RG, le patron de la DCRI, tout ça. Là, en l’occurence, c’est quelqu’un de Tarnac, que tu anonymises.
« Assis sur la banquette arrière, son copain restait silencieux [...]. Bien plus tard, je compris que l’inconnu en question était toujours comme ça : une tombe. C’était sa nature, il n’y avait pas à paranoïser. » [pp.77–78]
D.D. – Alors, il faut préciser : c’est donc quelqu’un qui est à l’arrière de la voiture, la première fois que je fais une interview de Benjamin Rosoux. Une personne que je revois très souvent, quand je vais dans le village. Comment dire ? Là, c’est ténu... Il y a un côté littéraire, en fait : la police m’a fait croire que ce type en question faisait partie de l’appareil militaire, que c’était un type mystérieux, qu’il faisait des arts martiaux, lalala. Et je joue avec ce truc–là. Ce mec, c’est un joueur de football ; alors, probablement que c’est un activiste, un radical, il ne s’agit pas de dire que c’est oui–oui–land, mais il n’a pas eu de problèmes avec la justice, je n’ai pas envie de lui en donner. Au bout du compte, c’est ça. Pour chaque protagoniste qui est dans le bouquin, tu n’imagines pas les jours, et les nuits, à me demander : qu’est–ce que j’en fais ? Qu’est–ce que je dis ?
R.M. – Je me souviens très bien que tu m’avais dit, dès le début : tu ne te rends pas compte que, selon ce que je vais écrire, il y a des gens qui peuvent aller en prison. Ça m’avait toujours paru exagéré, et ça me le semble encore plus après lecture du bouquin, où tu démontres combien judiciairement le dossier est fragile.
D.D. – C’est facile pour toi de ne pas avoir peur pour eux. Mais il faut se mettre à leur place. Malgré tout, il y a vingt ans de prison possibles pour Coupat, huit ans pour les autres.
R.M. – Mais est–ce que cette façon de se faire peur ce n’est pas faire le jeu de la police, c’est–à–dire de feindre d’accepter qu’on croit à cette menace–là, alors qu’il est évident que ça ne tiendrait pas au procès, ou, qu’au pire, ça finirait par sauter auprès de la Cour européenne, parce c’est tellement démesuré le fossé entre l’action visée (la pose de quelques fers à béton) et le terrorisme. On n’a pas du tout l’impression que le dossier tienne d’un point de vue de terrorisme. Même le juge Fragnoli, on n’a pas l’impression qu’il y croit vraiment.
D.D. – Ah si, il y croit.
R.M. – Bon, il y croit...
D.D. – Et il faut savoir que, dans cette affaire, il y a un truc qui est assez symptomatique de l’époque, c’est que, dans le dossier d’instruction, tu retrouves beaucoup d’interviews, notamment de Gérard Coupat, le père de Julien Coupat, ou d’Eric Hazan, l’éditeur de L’Insurrection qui vient.
R.M. – Oui, les fameuses interviews où ils disent explicitement que Julien Coupat a écrit L’Insurrection qui vient, avant de se rétracter évidemment, puisque c’est ce que la justice cherche à prouver...
D.D. – Donc, quand tu passes tes journées à lire le dossier d’instruction, tu te dis : « je dois faire très attention ». Il y a tellement de mauvaises interprétations qui ont été faites, que ce n’est pas la peine d’en rajouter. Ce n’est pas la peine de donner des billes. Moi, je ne suis pas auxiliaire de justice.
R.M. – De la même façon, tu t’en prends aux journalistes et aux commentateurs serviles dont le discours est d’une part « facile d’être révolutionnaire quand on est riche », à propos de Julien Coupat, et d’autre part, « ils se disaient révolutionnaires mais finalement ils s’appuient sur les structures traditionnelles de défense ». Et ce discours–là, c’est aussi celui d’autonomes, ou peu importe comment on les appelle, en tout cas de gauchistes qui attaquent le groupe de Tarnac par la gauche. Là, il y a un papier qui vient de sortir sur le web, sur ce thème, à propos de la sortie de ton livre.
D.D. – Oui. « La peoplisation de la subversion ». Confondant de connerie.
[Sur paris.indymedia.org] « Dans toutes les librairies de gauche, le livre de David Dufresne, « TARNAC, MAGASIN GÉNÉRAL ». Exploration journalistique au cœur de la subversion française du XXIème siècle. Pleine de mystère la rencontre n’en est que plus significative : nous conspirons contre l’Empire (et contre le méchant Sarkozy), mais n’en dites rien. Qu’on se le dise, nous prenons des décisions importantes. Clins d’yeux. Amitié. Complicité. Le monde va changer de base... »
R.M. – C’est une thématique qu’on ne peut pas balayer d’un revers de main.
D.D. – Il y a en effet des gens qui sont plus royalistes que le roi, qui attaquent ce qu’on appelle l’innocentisme, en disant : « c’est pas bien de dire «on est innocents» ». C’est des débats que j’ai tellement connus il y a vingt ans ; je trouve ça confondant de bêtise. Ce qui est extraordinaire, c’est que les mecs de la SDAT ont exactement le même discours ! C’est la même façon de rester un peu bas de plafond, d’être dans un monde manichéen. Ce que je trouve intéressant, c’est que cette affaire, elle dure et elle emmerde l’État parce que les gens n’ont pas forcément tenu le rôle qui était prévu. C’est ce que Rosoux m’explique la dernière fois que je le vois.
« [B.Rosoux :] «Tu es sommé d’argumenter contre cette figure qui t’échappe, cette figure de l’ennemi, et que la question se pose de savoir de quelle manière tu t’y colles ou tu t’en détaches. Voilà l’enjeu dans ce dispositif antiterroriste. Soit tu colles et tu dis, effectivement, oui, il y a des méchants, oui, on veut abattre l’État, oui, vous ne nous aurez jamais, le peuple vaincra, tra–la–la, et tu entres dans des formes de radicalisation, radicalisation dans le sens où tu réponds positivement au défi qui t’est lancé, quitte à incarner des formes de martyrologie. Ou alors tu fais tout pour échapper à cette forme d’identification, de répression, qui isole un sujet, en n’acceptant jamais d’être ce sujet.» » [p.390]
R.M. – Tu veux dire que, même sans être dans une logique totalement complotiste, mais au moins dans une logique un peu fantasmée du pouvoir qui se dit « ces mecs sont des gauchistes ultimes, donc on va créer une espèce de tension, et eux vont se draper dans une posture jusqu’au–boutiste », et finalement c’est pas ça qu’ils font. Et du coup le scénario ne se déroule pas comme prévu...
D.D. – Bien sûr ! C’est un des moments où la machine est grippée. Maurice Leblanc, un informateur anonyme qui m’a contacté à la toute fin de l’écriture du livre, c’est en gros ce qu’il me dit : ceux qui ont allumé le feu au sommet de l’État, en fait l’incendie s’est retourné contre eux. Et je trouve que c’est tellement plus intéressant que les discours sur « est–ce qu’il faut parler aux journalistes ou pas »...
R.M. – Mais lorsque tu écris un texte comme L’Appel, qui est un très beau texte, mais très violent...
D.D. – Oui, très beau texte.
R.M. – ...c’est difficile derrière de dire : « bon, Noël Mamère va me rendre visite en prison »...
D.D. – Tu as une vision... Comment dire... Figée... Il faut imaginer déjà une affaire comme ça qui te tombe dessus, la violence de ce truc–là. Très difficile de réagir... Moi je trouve que globalement ils ont bien réagi...
R.M. – C’est une espèce de contrepied assez subtil, ce que tu dis là. Qui consiste à dire : pour des gens qui se réclament de l’invisibilité, la façon de niquer le pouvoir, c’est de dire : je deviens visible ! Alors on peut trouver ça drôle, c’est Guy Debord sortant de sa tombe et disant « on va prendre le pouvoir à contrepied », mais c’est quand même un peu bizarre...
D.D. – Soyons très clairs : je ne suis pas leur porte–parole, et si je m’auto–proclamais tel, je serais massacré dans la minute. Mais... Dans L’Insurrection qui vient, et j’ai essayé d’en parler avec Eric Hazan, un des passages qui me passionnent le plus, c’est ce moment de lucidité où les auteurs disent : à un moment il faudra sortir de l’anonymat.
[L’Insurrection qui vient] « La visibilité est à fuir. Mais une force qui s’agrège dans l’ombre ne peut l’esquiver à jamais. Il s’agit de repousser notre apparition en tant que force jusqu’au moment opportun. Car plus tard la visibilité nous trouve, plus forts elle nous trouve. »
D.D. – Moi je pense que ce moment aurait pu être cette affaire. Ma déception, à la limite, elle est là. Si ce sont les auteurs de L’Insurrection qui vient – moi je n’en sais rien – j’aurais voulu qu’ils sortent là de l’anonymat, parce que c’était l’occasion rêvée. Mais moi j’ai pas envie de donner des leçons. Comme des gens qui s’abritent derrière leur numéro IP, et qui me balancent leur fiel par mail.
R.M. – Dans le livre, tu critiques souvent les journalistes, en expliquant qu’ils veulent une vérité, qu’ils sont pressés, par exemple dans ce passage, à propos d’un journaliste dont tu précises bien qu’il n’a jamais rencontré les intéressés :
« Il parlait comme un flic, et ne s’en rendait pas compte. Je tâchais de lui expliquer que ce métier valait le coup pour son lot de rencontres durables bien plus que par son lot de révélations temporaires, il s’en cognait. [...] Il ne voyait que le devant de la scène ; les coulisses ne lui disaient rien. Je bataillais à lui faire entendre que, sur le théâtre des opérations, pourtant, tout comptait : la scène comme les coulisses, les loges comme la billeterie, le balcon comme les machines, l’escalier comme le rideau, les acteurs comme les fils des marionnettes. Il était pressé. » [p.39]
R.M. – La question centrale, qui est évidemment irrésolvable, mais dont j’aurais aimé que tu l’abordes plus directement, c’est : quelle est ma propre limite dans ce que je vais raconter, qu’est–ce qui détermine que je vais raconter ça plutôt que ça ? Que le réel, c’est ça, plutôt que ça. Que les faits, c’est ça plutôt que ça. Que les gens, c’est untel plutôt qu’untel. Dès lors que tu fais le choix d’écrire le réel, et non pas de la fiction... On en avait parlé, de cette question de la fiction, je t’avais dit que la solution pour ton livre, c’était peut–être d’écrire de la fiction, parce que là tu es dans la liberté absolue. À partir du moment où tu refuses cette facilité, tous les choix que tu vas faire, à chaque moment, il faudrait être capable de les justifier, de les discuter, y compris même dans le livre.
D.D. – Il me semble que j’évoque beaucoup ces questions–là, quand ça me semble important. Pas à chaque paragraphe en effet...
R.M. – Oui, mais j’ai l’impression que tu les évoques du point de vue du curé défroqué. Tu les évoques en regardant les autres journalistes, et en disant les journalistes ils sont comme ça. Comme si, pour la première fois, tu acceptais de critiquer les journalistes.
D.D. – Alors, là, déjà, c’est faux. J’ai passé deux ans à Libération à faire une chronique télé, mon travail était de dégommer la télévision...
R.M. – La télé, oui, mais dans le livre tu parles peu de la télé, c’est plutôt la presse écrite.
D.D. – Je n’ai jamais été corporatiste. Et ça m’a été suffisamment reproché. La seule chose, c’est que le jour où tout le monde est devant la prison de la Santé, pour la libération de Julien Coupat, il se trouve que, moi, je suis à Tarnac...
R.M. – D’accord, mais dans le livre tu racontes cette sortie de prison comme personne ne l’a jamais racontée...
D.D. – C’est–à–dire ?
R.M. – C’est–à–dire que tu dis des trucs que personne n’avait jamais dit.
D.D. – J’espère.
« Depuis le matin, les chaînes d’info en continu étaient en direct, à attendre, à mouliner, à brasser. Les copains de Coupat avaient sorti les grands moyens pour les y aider.[...] Camouflé dans le coffre de la voiture, sous une couverture et quelques livres, Julien Coupat attendait de l’autre côté de la prison. Il avait enfilé foulard et sweat. Le foulard arborait un sourire, le pull était marqué Guerre au spectacle au dos et La lumière du spectacle obscurcit tout devant ; au cas où cette dernière viendrait à se braquer sur lui. » [p.323]
R.M. – À la fois ça t’exaspère de voir tous ces mecs qui attendent en direct, mais, finalement, le récit de la sortie de prison te plaît aussi, et ce récit, il est romanesque. Évidemment qu’eux, les journalistes, ils sont un peu cons, et ils n’ont pas ton recul ; mais tu as, et on a tous, la même attirance... C’est la question du voyeurisme...
[Sonnerie de téléphone.]
D.D. – C’est moi, ça ? Ah, c’est mon éditrice. [au téléphone] Allô ? Oui ? Ah, ici la police, oui ? Fais gaffe, parce qu’au Tigre, ils enregistrent tout, et ils me font boire, putain ! Et je viens de dire « c’est mon éditrice », et tu dis « allô, c’est la police », donc, à mon avis, ça va se retrouver... Donc, elle s’appelle Mireille Paolini, elle est Corse.
R.M. – Comme Squarcini...
D.D. – [au téléphone] Oui, oui... C’est–à–dire que c’est un monologue de la part de l’intervieweur... Donc, je dis oui, ou non, mais c’est tout. Non, non, c’est un plaisir... Oui ? Pour France Info, c’est ça ? Oui... Tu écouteras, j’espère... Non, non, ça n’arrivera pas, t’inquiète... Allez, je t’embrasse, ciao. [Il raccroche.] Attends, il faut que je puisse répondre, à propos du journaliste–flic qui brandis son carnet. Alors je raconte cette scène, mais en fait je la minimise un peu. Je crois que c’est à ce moment–là que je comprends que ça ne va plus du tout. Que je ne suis plus fait pour ce métier. Je ne supporte plus. Alors, curé défroqué, c’est une expression qui est assez redoutable. Je comprends que tu dises ça. Mais... Comment dire... Je crois... Honnêtement, avec ce livre, j’ai plus perdu que je n’ai gagné.
R.M. – Le curé défroqué, ce n’est pas forcément négatif.
D.D. – Le curé, c’est plutôt négatif, pour moi.
R.M. – Mais s’il est défroqué, c’est mieux...
D.D. – La réalité, telle que je l’ai vécue, c’est cette notion de schnorrer.
« Gabrielle évoqua un personnage de la mythologie juive, le schnorrer, mi–mendiant mi–messager qui va de village en village. Le schnorrer apporte les nouvelles et on lui sert la soupe en échange. Elle me voyait comme ça : un schnorrer de l’information judiciaire qui irait d’un mis en examen à l’autre. » [p.41]
D.D. – Il y a des mots qui sont arrivés sur les questions que je me posais depuis vingt ans, tu le sais, on s’est engueulés vingt fois là–dessus. Et cette affaire a résonné en moi... Mais ç’aurait pu être une autre, honnêtement. Ç’aurait pu être une guerre, ç’aurait pu être un truc en banlieue. Mais... Si tu veux, ce qui serait désagréable, ce serait que le fait d’avoir évoqué mes doutes se retourne contre moi. Je ne trouverais pas ça cool !
R.M. – C’est la force et la faiblesse de ce genre de texte : si tu ouvres la porte...
D.D. – ...la critique s’engouffre, c’est normal.
R.M. – Y compris la complexité des choses. Quand je lis L’Espion du président, c’est un bouquin tellement standard qu’il n’y a pas de mécanique derrière, pas de réflexion, donc on n’en a rien à en dire. C’est un livre qui va marcher parce que c’est un document choc, avec des révélations, et basta. C’est évident que toi, ton travail est différent, et il donne envie d’en débattre. Toujours à propos de l’anonymat, il y a ce passage sur une policière de la DCRI, que tu appelles Sportster :
« Décrire Sportster serait la trahir. Ne pas la décrire, c’est buter sur un paradoxe du journalisme : à la fois savoir et savoir qu’on ne peut pas tout dire ; à la fois chercher et feindre qu’on n’a pas trouvé ; ou alors jouer de sous–entendus ou de phrases toutes faites, d’insupportables mots–valises, d’expressions vides, jouer avec les lecteurs sur la base d’un contrat tacite, d’un contrat fait de petites notes en bas de pages, de sources–proches–de–l’enquête, d’entourage ou de premier–cercle ; un contrat mensonger, un contrat cliché. » [p.50]
R.M. – Et finalement, en fait, tu ne la décris pas... Tu es toujours sur cette ligne de crête, qui est vachement intéressante : jusqu’où je peux repousser les limites. Et là tu ne les repousses pas. Tu dis : si elle se fait identifier, bam !
D.D. – Si elle se fait identifier, c’est la fin de sa vie professionnelle. Donc, en gros, c’est une condamnation à mort économique. On parle de ça... Au fond, protéger nos sources, c’est la dernière chose qu’il nous reste.
R.M. – Tu protèges plus les niveaux inférieurs, les flics de base, que les niveaux supérieurs, les patrons.
D.D. – C’est mon côté marxiste. C’est mon côté lutte des classes.
R.M. – Donc ce n’est pas tes sources que tu protèges. C’est les gens dont tu considères qu’ils sont fragiles. Les gens importants, Squarcini, ou Bouchité, le patron des RG à l’époque, ça ne te dérange pas de les griller.
D.D. – Voilà. Enfin, ça me dérange pendant des mois et des mois, et je finis par le faire.
R.M. – Je me suis posé la question. Je me suis dit que c’est parce que tu es un mec gentil. Mais... Est–ce que tu as imaginé faire le bouquin comme un salopard, réellement comme un testament, c’est–à–dire : je grille tout le monde.
D.D. – Non. Jamais. Je n’y ai jamais pensé. En revanche, aujourd’hui encore, je m’interroge sur la figure du salaud, qui est celle de l’écrivain. Je pense que l’écrivain est un salaud. Au sens où il voit une scène, un repas de famille, une scène dans la rue, une interview, et quand il la restitue des mois plus tard, ou des années plus tard, dans quelle position il est ? J’ai buté sur cette question pendant trois ans. J’ai écrit des trucs sur le sujet qui étaient nuls, que je n’ai donc pas mis dans le bouquin. Mais c’est une question centrale. Je ne sais pas si je suis gentil ou pas, mais je n’ai pas envie de faire de peine. Je peux aller au combat, mais je n’ai pas envie de faire de peine. Ça ne m’intéresse pas de vexer pour un bon mot, je ne trouve pas ça intéressant. Cette fliquette, elle m’a fait confiance, je n’ai pas envie de la trahir. Et je ne vais pas la trahir parce qu’elle est fliquette. Autrement dit : se comporter en salaud avec les salauds, je ne suis pas d’accord avec cette histoire–là. À partir du moment où tu te comportes en salaud, tu deviens un salaud. Et puis c’est tout. Alors, le lecteur peut en effet se dire : « il n’a pas vraiment tout dit ! » Je dis 98%, il en manque 2.
R.M. – Il y a ce passage sur la conférence de presse de Jean–Claude Marin :
« Le décor se mettait en place dans une salle anonyme du palais de justice de Paris, trois jours après les arrestations à Tarnac. Les images de la conférence de presse de Jean–Claude Marin relançaient l’attention. Elles étaient parfaites, solennelles, dans le timing comme dans la forme. » [p.57]
R.M. – Là, le procédé est à la fois honnête et malhonnête. Honnête parce que tu cites tes sources à la fin du livre, chapitre par chapitre, comme dans le livre mexicain Des Os dans le désert [3]...
D.D. – Alors, parlons–en avant qu’on oublie. Il faut savoir que j’ai utilisé le logiciel d’aide à l’écriture de scénario que j’avais pour Prison Valley, qui s’appelle Scrivener : ça permet de mettre des notes, de construire énormément, de chapitrer. En fait le bouquin est extrêmement construit, enchevêtré. Parmi les notes que j’avais mises il y avait : « Questions auxquelles je dois répondre ». Et il y a ton mail du mois de juin 2009, avec les points que tu soulignais.
[Extraits du mail de R.M. à D.D., 24 juin 2009, pour un article ou une interview pour Le Tigre.]
« Voici quelques pistes de points qu’il me semblerait bien d’aborder :
– le fait que tu crées des liens de proximité avec certains protagonistes (Benjamin) la façon dont ça change ton rapport au truc
– le fait que tu sois obligé de faire preuve d’une certaine « neutralité » alors que des choses te donneraient envie de réagir en tant que David–Dufresne
– l’excitation du scoop, de l’info que personne n’a sortie (ex. l’ordonnance de Fragnoli sur le terrorisme) et la déception parce que ça fait un peu pschitt, redoublée à cause d’internet où il faut aller vite, très vite, au détriment d’un travail de fond
– le fait de devoir « enfermer » une énorme complexité dans des textes journalistiques, simples, rapides, qui, en plus, ont l’énorme désavantage d’être comparés à la prose brillante des gens dont tu parles
– le fait de voir des « collègues » péter les plombs et ne plus avoir aucun sens des limites de ce qui est permis de faire ou de ne pas faire (l’histoire du mariage). »
D.D. – Et, à peu près chaque semaine, je regardai où j’en étais par rapport à ces questions. Te voilà flatté ! Mais c’est la vérité. Et j’étais bien content l’autre jour quand tu m’as dit « en fait tu as à peu près répondu à tout ». Et c’est pour ça qu’à l’époque je t’avais dit « je ne peux pas répondre maintenant, parce que c’est pour le livre ». Et ça m’a fait chier ! Parce que je me suis dit, putain c’est les bonnes questions ! C’est les vraies questions ! C’est les questions littéraires. En fait il y a quatre personnes importantes pour l’écriture du livre : il y a évidemment l’éditrice, Mireille Paolini, il y a mon vieux pote Yannick Bourg, il y a toi, et il y a ma compagne, Emmanuelle Walter, qui m’a, à un moment donné, passé De beaux lendemains de Russel Banks, et ça a été le détonateur. Donc, pendant deux ans, j’ai ruminé sur ces questions d’écriture. Il y a eu des moments de doute, où j’étais parti pour faire un truc chronologique à la con... Donc, vas–y, Jean–Claude Marin ?
R.M. – Alors, ce dispositif de notes à la fin, est–ce que ça vient de Des os dans le désert ?
D.D. – Oui. J’ai acheté ce livre que tu m’avais conseillé. Et j’ai pris cette idée, qui est de dire tout ce qui pollue la lecture, tout ce qui fait journalisme, je le mets à la fin.
R.M. – Je le mets, mais comme un texte autonome. Et ça marche très bien, là. C’est aussi bien une citation toute bête qu’un éclaircissement. J’ai toujours défendu ce procédé, et je trouve que tu le fais très bien. Mais, dans le chapitre sur Jean–Claude Marin, quelqu’un qui ne lit pas les notes ne sait pas que tu n’assistes pas à cette scène, la conférence de presse. Et même dans les notes, ce n’est pas explicitement dit : je n’y suis pas. Je trouve qu’on est de nouveau dans les habitudes du métier : je vais vous raconter la scène, mais en fait je n’y étais pas.
D.D. – Non. Ton aveuglement anti–journalistique te perd... Je rigole, je rigole, tu mettras smiley, s’il te plaît. Non, je dis clairement « ce chapitre s’inspire de telle vidéo et de telle dépêche ». Je n’y suis pas...
R.M. – Tu pourrais écrire ça : « je n’y étais pas ».
D.D. – Bon, s’il y a une nouvelle édition, je le mettrais...
R.M. – C’est un détail, mais...
D.D. – D’accord, je le note.
R.M. – Ce qui est passionnant dans le livre, et c’est que disait Ariane Chemin dans Le Monde, c’est le truc sur la langue de tous les documents policiers et judiciaires. Quand Mediapart avait sorti le gros rapport de la SDAT, j’avais adoré parce que c’était la première fois qu’on lisait un gros rapport de police in extenso, et je me souviens que pour le dossier du Tigre je l’avais utilisé pour voir quels étaient les journalistes qui avaient eu le texte avant les autres, qui étaient directement informés par les flics.
D.D. – Alors, je m’en souviens, parce que j’ai relu ce dossier du Tigre, et c’était drôle et très malin de ta part de pointer quels journalistes avaient eu accès à l’information avant les autres. Moi, ce qui me gênait avec ce rapport c’est que, pour un Raphaël Meltz, beaucoup s’étaient précipités sur le texte, prenant pour argent comptant la prose policière... Et d’ailleurs, je pense même qu’il y a des proches des gens de Tarnac qui ont été ébranlés : « ah merde, ils ont fait ci, ils ont fait ça... » Et ce que j’essaie de faire dans le livre, c’est de pousser ça à l’absurde : ok, on va produire des pièces de justice, de police, et on va voir...
R.M. – Et c’est tellement n’importe quoi !
D.D. – C’est tellement hors–sol, c’est un prisme... Tantôt ça colle : une fois sur dix. Et neuf fois sur dix c’est n’importe quoi. Quand tu publies un rapport sur le net, et que tu ne vas pas au Goutailloux, à l’épicerie, tu restes sur la version policière. Et c’est ça mon problème. C’est pour ça que je dis, quand le journaliste me dit « les faits sont constitués », je dis « ça ne va pas... »
R.M. – Alors Davduf, il y a un problème, quand même. Ce rapport, il est sorti sur Mediapart, où tu travaillais à l’époque, et dans ton bouquin, tu dis :
« Les flics avaient planqué des mois durant, et photographié tout ce qui bougeait. Puis des journalistes avaient pris le relais en se mettant à fouiller leurs poubelles. Un site Internet d’informations avait omis de biffer leur adresse dans un fac–similé de rapport de police. » [p.259]
R.M. – « Un site internet », sans dire que c’est Mediapart, ça j’ai trouvé ça nul de ta part. Tous les gens qui s’intéressent à l’affaire savent où est sorti ce rapport, on se demande pourquoi tu as voulu protéger Mediapart, j’ai trouvé que c’était indigne de David Dufresne.
D.D. – C’est vraiment un micro–détail...
R.M. – Non, je ne suis pas d’accord. Tu bosses pour un journal qui fait un truc que tu récuses, et dans le livre tu dis : « je trouve ça nul qu’ils l’aient fait », sans dire que c’est les gens pour qui tu bosses. C’est pas un détail !
D.D. – Je pense que tu ne mesures pas, mais c’est normal parce que ce n’est pas le milieu dans lequel tu évolues, la charge... Ils s’en prennent déjà plein la figure, les journalistes d’investigation : quasiment à chaque page il y a une remise en cause. Dans une première version du manuscrit, je dis que c’est Mediapart. Et puis je me rends compte, trois ans après, que ça n’a pas beaucoup d’importance, et qu’heureusement, aujourd’hui, que Mediapart existe... Bon, écoute, tu sais quoi ? Je le remettrai pour la deuxième édition...
R.M. – Mais le diable est dans les détails !
D.D. – Non, justement, en ce qui concerne les dérives de la presse, je pense que ce n’est pas dans les détails que le diable se cache. C’est dans ce mouvement de masse, dans cette bizzarerie qui fait que plus il y a de médias, plus ils parlent de la même chose au même moment. Et ça, ça passe mal dans certaines rédactions. Mais c’est drôle que tu me reproches d’avoir enlevé cette précision, parce que, pour moi, c’est très journalistique.
R.M. – Nombriliste, tu veux dire ?
D.D. – Cette affaire me dépasse de très loin... Pour aller dans une direction vraiment tigresque, pour le coup : essayons de bâtir un propos...
R.M. – Mais, vue l’affaire, tu aurais gagné à être toujours dans une explicitation précise de là où tu en es toi. Je pense que dans cette affaire–là, les histoires très intimes qui t’arrivent ont à voir avec ce que tu as envie de raconter, à savoir l’époque, le journalisme, la visibilité...
D.D. – Il y a un problème, et là je pense que les lecteurs du Tigre auront décroché, auront arrêté de lire l’interview, le problème c’est que toi, tu es un lecteur plus qu’averti donc probablement que tu mets dans ce livre plus de choses qu’un lecteur classique.
R.M. – C’est certain. Mais, tu vois, tu m’avais dit que tu te mettais vachement à nu, j’ai trouvé que tu le faisais, mais de façon toujours un peu métaphorique, un peu générale.
D.D. – C’est ton point de vue. Quand j’écris, je dis de moi ce qui me semble important, mais ce que les lecteurs vont vouloir comprendre, ce sont les mécaniques à l’œuvre. Je ne suis pas un personnage central, je suis un personnage à la frontière, à la lisière, comme tu veux, sur la crête. J’ai déjà un rôle important, parce que je tiens la plume. Il n’y a pas besoin d’en rajouter. Pas besoin de faire du ton sur ton : il y a des moments où le non–dit, l’ellipse, sont beaucoup plus forts, quitte à laisser le lecteur dans la perplexité. Ce n’est pas de la fiction : il y a des ressorts de fiction, les dialogue, la construction, les cliffhangers, mais ce n’est pas de la fiction ! Et c’est pour ça qu’il y a cent pages de sources. Dans une des phrases de ton mail de 2009, probablement la plus cinglante, tu disais : « ça fait quoi d’écrire moins bien que les gens dont tu parles ? » Et, honnêtement, par modestie sincère – alors que par ailleurs je ne pense pas être un mec modeste – je pense que je suis un mec moins intéressant que les gens que je rencontre. Et donc j’ai une réserve : je dis ce qui me semble utile pour le récit. Peut–être que si j’étais romancier, je me mettrais à la place de Dieu. Je ne suis pas Dieu.
R.M. – D’accord.
D.D. – Quoi, « d’accord » ?
R.M. – Hé bien, c’est une réponse qui me convient : « je ne suis pas Dieu »...
[Pause pour aller acheter du vin.]

D.D. – Sur la gentillesse, c’est marrant, parce que je suis plutôt violent, tu le sais, à l’oral, dans les rapports humains, mais, au moment d’écrire, je trouve ça tellement grave... J’ai le souvenir, c’est très vieux, d’une interview de Serge Quadruppani, à l’époque où Daenincks accusait Gilles Perrault... Je me souviens d’une interview très dure, très difficile, avec Quadruppani, qui était accusé par Daenincks, et Quadruppani m’a dit quelque chose qui est ce qui m’a le plus déstabilisé, hormis ce que je raconte dans le livre, il m’a dit : « mais, c’est très désagréable, ce que vous me dites là ». Et ça m’est resté. C’est–à–dire que j’ai une vision romantique du journalisme, comme un contre–pouvoir, on est là pour emmerder, mais en même temps je ne suis pas là pour vexer les gens. En gros, je suis là pour faire ripper les machines, mais pas pour faire chier les individus. Et c’est vrai qu’au moment d’écrire, j’ai un peu cette retenue–là. Mais les choses sont dites.
R.M. – C’est la difficulté du dispositif. Soit tu fais le journaliste comme un crétin, sans aucun sens moral, quand tu harcèles les gens pour qu’ils te parlent, quand tu vas devant chez eux avec tes caméras, soit tu commences à te poser des questions, mais là est–ce que le simple fait de commencer à écrire sur quelqu’un, est–ce que ce n’est pas déjà être désagréable, comme tu le dis ?
D.D. – Si. J’aborde cette question notamment à travers le portrait de Jocelyne Coupat [la mère de Julien Coupat], c’est–à–dire que, à un moment donné, malgré tout ce que je viens de te dire, reste que, quand tu ouvres ton traitement de texte, tu n’écris pas pour les gens dont il est question. Tu écris pour les lecteurs. Et la morale, elle est là. Tu ne dors pas pendant des nuits, tu transpires, tu cauchemardes, ok ; mais le lendemain tu te lèves : il faut écrire ce chapitre. C’est toute l’ambiguïté du chapitre sur Julien Coupat : je me dis, enfin on se dit lui et moi, « ça serait quand même plus simple s’il n’y avait pas ce livre à écrire ». Ce livre empêche une relation qui aurait peut–être... alors je peux me tromper, qui aurait pu être possible. Mais je pense que cette histoire doit être racontée. Et le fait de le raconter, c’est probablement désagréable, pour les protagonistes, quels qu’ils soient.
R.M. – Je me souviens que tu m’avais raconté que...
D.D. – Eh ! Je te présente un disque, et toi tu veux les bonus–tracks !
R.M. – Quand tu étais allé à Tarnac, tu étais revenu en me disant : « quand même, ils sont sympas, mais il n’y a pas de douche, il faut dormir dans une tente, sans se laver », je me souviens très bien, on était dans ta cuisine extrêmement chaleureuse, et tu disais ça, et je me souviens que ça me faisait rire...
D.D. – Je le raconte ! Dans le premier chapitre.
R.M. – Franchement, pas du tout comme ça...
« Au plafond de la cuisine, les ampoules n’avaient pas d’habillage. Rien n’avait d’habillage. Tout était brut, épuré, un peu déglingue, totalement offert. Je me demandais ce que je foutais ici. Tout était en bordel, de la vaisselle partout, du linge dans la machine et personne pour la faire tourner. [...] Ce lieu qui n’avait aucune chance de devenir un modèle duplicable à toute une société, parce que trop dégagé de tout, parce que pas assez enviable. » [pp.34–35]
D.D. – Si un jour il y a une deuxième édition, je rallongerai... Mais, ce que je ressens sur le lieu, c’est ça : c’est pas assez enviable pour être duplicable. C’est mon point de vue.
R.M. – De bourgeois ! De mec devenu bourgeois, malgré lui... La tête que tu fais !
D.D. – Non, je réfléchis... Je me souviens très bien, quand j’avais vingt ans, dans le rock alternatif, on faisait des concerts dans les squats : je n’ai jamais considéré que c’était l’avenir du genre humain, le squat. D’ailleurs, si je lis bien L’Insurrection qui vient, ce n’est pas ce qui est dit non plus. Mais l’objet de mon livre, ce n’est pas de juger, c’est de raconter : de dire que ça ne correspond pas du tout à ce que les flics ont raconté à la presse, et à ce que la presse a raconté pendant des semaines.
R.M. – Alors, tout autre chose. Très souvent dans le livre, tu parles de ce que ça raconte de l’époque, de la « sarkozie ambiante », c’est même l’argu de ton éditeur.
« Ce que l’affaire disait de l’époque, du métier, des fantasmes des uns et des autres, était autrement plus cinglant que ses péripéties judiciaires. » [p.114]
R.M. – J’ai été troublé par ça. Autant dans le livre sur la DCRI, il est clair que la DCRI est la police politique de Sarkozy, autant dans le tien j’ai le sentiment que tu colles cette image du sarkozysme triomphant à quelque chose qui est immémorial, à savoir la presse qui suit le point de vue du pouvoir et le retransmets. La presse a toujours été majoritairement du côté du pouvoir...
D.D. – Je te rappelle que moi je viens à la presse par l’anti–presse, les fanzines, et pendant longtemps je crois que c’est ça la presse. J’ai vu des gens, à Libération, qui étaient très offensifs contre le pouvoir.
R.M. – D’accord, à quelque époque que ce soit, il y a des figures de journalistes qui s’opposent au pouvoir. Mais tu ne peux pas dire que c’est symptomatique de notre époque d’être servile avec le pouvoir !
D.D. – Ce qui est symptomatique de Sarkozy, c’est la DCRI. C’est lui qui décide de créer une police politique. Une police qui ait deux compétences : le renseignement et le judiciaire. Le 8 novembre 2008, le blocage des TGV fait les 20–Heures. Il faut que trois jours après, on puisse faire le contre–feux du 20–Heures, avec des arrestations. Ça, c’est du Sarkozy. Il y a aussi la notion de statistiques : à la DCRI, ils disent : « maintenant, on est notés sur le nombre de notes qu’on fournit ». Ça, c’est Sarkozy qui amène ça. Après, il ne faut pas, comme me le dit Mathieu Burnel, feindre chaque jour que tout est nouveau.
« [M.Burnel] «Ce qui est marrant dans l’esprit des journalistes, et on pourrait dire que c’est le propre de la fonction de journaliste, c’est de faire semblant tous les jours de redécouvrir les horreurs vues la veille, de toujours simuler une espèce d’étonnement.» » [p.113]
D.D. – La peur du rouge, c’est une peur de la vieille droite, et ce n’est pas pour rien que MAM l’incarne. La peur de l’ultra–gauche, etc. On ne pensait même pas que c’était imaginable que ça revienne, tellement c’est artificiel. Sarkozy permet ça : l’anti–terrorisme, ça permet de faire croire ça. Tu as oublié ça, tu ne t’es pas replongé dans les articles du 8, 9, 10 novembre, mais c’est hallucinant.
R.M. – D’accord, les statistiques, la confusion renseignement–judiciaire, tout ça d’accord. Mais il y a eu des barbouzeries à toutes les époques : les Irlandais de Vincennes, c’était le mitterandisme triomphant. Et sous Pompidou, l’assassinat du garde du corps, et ainsi de suite. Pour le coup, est–ce que tu n’es pas en train de survendre ton affaire, qui est très riche, et en effet tu racontes plein de choses sur la DCRI, tu démontes très bien leur façon de travailler, mais j’ai trouvé que tu construisais artificiellement l’idée que l’affaire était symptomatique du sarkozysme. Franchement, le pouvoir a toujours créé des ennemis imaginaires à balancer au 20–Heures.
D.D. – Oui. Sauf que la DCRI, c’est une volonté directe de Nicolas Sarkozy. Il nomme un de ses fidèles, Bernard Squarcini. Et il rapatrie à l’Élysée un autre de ses fidèles, Joël Bouchité, qui a œuvré, aux RG, sur cette affaire. C’est tout ce que je dis. Et aussi, combien la presse a épousé la thèse du pouvoir. Et, je ne te le cache pas, après avoir travaillé dix ou quinze ans à Libé, la une qu’ils font, « L’ultra–gauche déraille », j’y pense tous les jours. Tous les jours ! C’est ça, le symptôme de l’époque : croire que le terrorisme, c’est le danger n°1. Ce n’est pas le danger n°1, c’est ce que tous les flics qui travaillent là–dessus me racontent. Et Sarkozy nous fait croire que c’est un danger ! C’est cette blague que se racontent les mecs de la SDAT : « le terrorisme, il y a plus de gens qui en vivent que de gens qui en meurent ! ». Ou un mec qui me dit : « un week–end de chassés–croisés sur la route tue plus que quinze ans de terrorisme en France ». En attendant, dans les gare, il y a des mecs avec des mitraillettes depuis quinze ans : c’est Vigipirate ! Donc, quand je parle de l’époque, c’est aussi l’emballement : rapidité, précipitation, on balance des photos, on balance des noms. Et ça, malgré tout, pour avoir étudié les questions de police depuis longtemps, le grand communicant, c’est Sarkozy.
R.M. – J’ai noté qu’à un moment, tu cites un texte, un texte militant, et dans les notes tu dis que tu l’as trouvé sur le site ***. Or ce site, mais tu ne le dis pas, est l’émanation de ***, quand même !
D.D. – Monsieur Raphaël Meltz – et j’espère que ça sera retranscrit – il n’y a rien de plus désagréable qu’un magistrat ou un policier qui vous dit : « mais vous devriez travailler à la DCRI ! » Et ce que vous venez de faire, monsieur Meltz, me permet de vous dire cette phrase.
R.M. – Toi, on te l’a dit ?
D.D. – Cent fois ! Comment dire ça sous forme de litote... Je ne suis pas là pour donner à la police, ou à la justice, des armes, ou des arguments. Or ce que tu viens de dire, c’est du travail, qui n’a pas forcément été fait...
R.M. – Ils n’ont pas fait le simple whois pour savoir à qui appartient le site ?
D.D. – Et ce n’est pas à nous de le faire...
R.M. – La différence, c’est que comme tu as lu tout le dossier, tu sais ce qu’ils savent. Moi, je ne sais pas.
D.D. – Exactement. Mais tu vois, un jour, je publie sur Mediapart un article sur ce document tiré du site ***, et c’est un lecteur qui, dans les réactions, dit : « ce nom de domaine appartient à *** ». Mais ce n’est pas à moi de le dire !
R.M. – Donc ça y est, maintenant, ils le savent...
D.D. – Non, je ne suis pas sûr... Donc il ne faut pas le mettre... Mais c’est important d’expliquer ça. Par exemple, je me suis beaucoup interrogé sur le fait de parler de L’Appel, parce que L’Appel n’est quasiment pas dans le dossier d’instruction.
R.M. – Alors ils ne lisent pas Le Tigre, à la DCRI, je suis rassuré...
D.D. – Non, ça ne te rassure pas, ça te déçoit !
R.M. – C’est quoi, finalement, l’information, pour toi ? À la fin, quand tu arrives au portrait de Julien Coupat, tu refuses de le faire.
« Pendant des mois, j’avais accumulé des anecdotes à son sujet, plus ou moins aimables, avec des arrière–pensées plus ou moins avouables, en vue d’en tirer son portrait à mon tour. Mais au moment de le rédiger, je déclarais forfait. Tout cela était précisément le piège, l’abus de position dominante que la police avait offerte à la presse. » [p.363]
R.M. – C’est assez courageux, parce qu’on attend tous ce portrait, et au final tu nous niques tous, c’est assez insolent.
D.D. – Je suis content que tu dises ça, parce que ça a été une discussion avec l’éditrice...
R.M. – De son point de vue à elle, on peut comprendre qu’elle en ait envie, mais de ton point de vue à toi...
D.D. – Avoue que c’est pas mal.
R.M. – C’est très malin, mais c’est frustrant, aussi.
D.D. – C’est ce qu’elle m’a dit : c’est déceptif.
R.M. – Comme il y a beaucoup de procès–verbaux, il est très présent dans le livre par ailleurs... Donc, j’ai trouvé ça très bien, mais reste la question : jusqu’où ne pas aller ? Tu pourrais aussi ne pas du tout les rencontrer... C’est quoi l’information ?
D.D. – L’information, c’est comprendre le monde. Ça passe parfois par de la peinture, de la musique, de la littérature, du journalisme, parfois par un mélange des genres, parfois par des webdocumentaires – je sais que tu n’aimes pas... C’est ça l’information : comment, en tant qu’être humain, je me nourris de connaissances, de savoir. Moi, le 11 novembre 2008, je ne sais pas qui est Julien Coupat. Je ne sais plus qui a dit que le journalisme, c’est : « monsieur untel a tué madame untel, et la veille, tu ne savais pas qui était monsieur et madame untel ». En gros, c’est ça. Après, en termes de scoop, il y en a quelques–uns, dans le livre : notamment quand Joël Bouchité, me dit que les RG ont posé une balise sous la voiture de Coupat. Ça fait trois ans que les avocats veulent cette information : ils l’ont. À eux de faire le travail. Ok, les gars : moi, j’ai brisé le off, à vous... Alors, ma rencontre avec Coupat... Il m’a reçu parce que certains de ses amis ont considéré qu’il y avait moyen de discuter avec un journaliste. Il faut être à la hauteur de ça. C’est con, hein. Toute la méfiance contre les journalistes, elle est tellement justifiée... Être à la hauteur de la situation, c’est faire un anti–portrait de Coupat, et en même temps saluer l’intelligence du mec, même si, ce jour–là, il est fatiguant...
R.M. – Je reviens sur cette question des vingt ans de prison pour Coupat : est–ce que tu ne survalorises pas ton rôle, en te disant que tu as le destin juridique de ce mec entre les mains, alors que ce n’est pas vrai, tu n’es pas le seul...
D.D. – Bien sûr, il y a le risque de se survaloriser : quand Maurice Leblanc, l’informateur anonyme de la fin, me dit : « vous n’étiez pas une cible, initialement, dans les leurres », j’ai les boules !
R.M. – De même, tu es content quand tu vois ton numéro de portable qui apparaît dans les PV. Mais finalement, par rapport aux trois auteurs du livre sur la DCRI, tu es moins harcelé qu’eux. Tu es sans doute mis sur écoute à un moment, mais c’est tout...
D.D. – Ou alors je m’en suis moins rendu compte... Mais tu sais, sur la DCRI, je sors des choses que personnes n’a vues. Par exemple le manuel pour poser une balise.
R.M. – Qui est incroyable ! Très drôle. Mais justement, tu vois, ce manuel, avant, il y a quelques années, tu l’aurais sorti : « énorme scoop ! », alors que là c’est une partie de l’histoire. Et c’est assez beau parce qu’on est très contents de lire ça, on comprend bien que ce n’est pas un truc que tu vas trouver à la librairie d’en bas, mais c’est beau que tu ne le survendes pas. J’ai beaucoup aimé cette dé–scoopisation du monde...
D.D. – Il faut savoir qu’à la toute fin de l’écriture du livre, j’ai eu énormément de pressions. Par exemple de magistrats, me disant : « tu devrais différer la sortie du livre, tu n’as pas toute l’histoire ». Et, juste avant la sortie : « il va y avoir des surprises ». Et, fin février, en effet, juste avant la sortie du livre, il y a une garde à vue d’un ferronnier, à Rouen. Je me dis : « ils ont décidé de torpiller la sortie du livre ». C’est pour ça qu’à la fin, j’étais complètement parano... Je me disais : s’ils sortent quelque chose d’énorme, qui remet en question toute mon enquête, le livre est foutu. Tu as passé trois ans de ta vie pour rien... Et, finalement, rien ne se passe !
R.M. – Alors, ma dernière question, et après on coupe le magnéto, c’est...
D.D. – Qui est coupable ?
R.M. – Ah non ! Tu plaisantes ? Pas moi... Non, ma dernière question, c’est : est–ce qu’un livre c’est pas mieux qu’un webdoc ? Est–ce que tu n’as pas l’impression d’avoir fait un truc plus riche, plus intense, que dans tes putains de webdoc ?
D.D. – Le plus beau compliment que j’ai eu, c’est Alexandre Brachet, le producteur de Prison Valley, qui a regardé le livre, et qui a dit : « mais c’est un webdoc ! » Et, effectivement, c’est un webdoc... Le côté fragmentaire...
R.M. – Mais c’est l’histoire de la littérature, ça...
D.D. – Peut–être, peut–être... Le côté document, je te donne une piste, tu peux aller ailleurs...
R.M. – Tous les romans picaresques marchent comme ça...
D.D. – Personne n’a l’outrecuidance de dire qu’il a tout inventé...
R.M. – Mais la forme du livre, dans ce qu’elle a de grotesquement close, juste du papier et des mots écrits dessus, est–ce que tu ne sens pas qu’elle te donne en fait une grande liberté ?
D.D. – En réalité, à un moment j’ai pensé faire un webdoc, et puis il ne s’est pas monté. Mais, je suis moins... Comment dire ? Je ne pouvais faire ça qu’en livre. C’est une histoire intime. Et l’écriture, c’est l’intimité. C’est ce que tu voulais entendre ?