


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


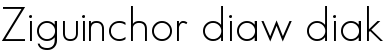
Diaw diak : Vas-y bien ; vas-y tranquille. C’est ce qu’on dit en diola aux cyclistes. C’est ce que me souffle Mathias, le voisin, comme j’enfourche ma monture chinoise flambant neuve, achetée le matin même au marché Boucotte, alias Saint-Maur-des-Fossés (jumelage oblige). Sur le cadran bleu roi il y a écrit : DLC DELUXE. Le fer-blanc brille, la sonnette tinte, les pare-chocs en feuille d’alu flambent. Il y avait même un rétro que j’ai dévissé, me disant : on n’est pas à Dakar ni à Shanghai, ho. Diaw diak, m’a dit Mathias le doyen, du bord de la rue en travaux où il reste vissé avec ses compères Papis et Mammadi, assis tous trois sous les bougainvilliers à boire le thé, en gros fais-toi plaisir, savoure, diaw diak et ma bécane glisse toute seule dans le sable, les pneus sont juste dégonflés ce qu’il faut, le sable crisse mollement, les manguiers défilent, les bosses me bercent, Ziguinchor est à moi. Le câble de freins casse à la première pression, cinq cents mètres plus loin. Diaw diak c’est vrai : Ziguinchor à vélo c’est bon. J’avais repéré que c’était pas du costaud. Freins ou pas de toute façon je m’en fous, je pédale si doux et les obstacles sont si rares qu’avant de percuter quoi que ce soit il faudrait que je ferme les yeux une bonne minute.
Ziguinchor, ou comment faire aller paisible une ville de 150 000 habitants. C’est peut-être l’absence d’immeubles et d’étages. La rareté des voitures, deux fois sur trois un taxi à la carrosserie défoncée par les nids de poule. Le feuillage immobile des neems qui bordent les routes. Le sable mou des rues sous les pneus - parfois au point que le guidon se tord et qu’il faut s’arrêter pour pousser. Le spectacle des charrettes tirées par des ânes qui livrent ici un frigo consciencieusement posé à la verticale, là une pile de chaises soudées par un « menuisier métallique » comme la ville en compte des dizaines. La douceur des cours ombragées de manguiers qui s’ouvrent sur la rue, découvrant les jeux des enfants sous les arbres, la station des femmes sur les nattes ou au bord des puits. Le pas pépère des poules, des cochons, des moutons jusqu’à la minute précédant leur métamorphose en ragoût et grillades de Tabaski.
Toujours assis devant la porte à mon retour (la nuit est tombée entre temps, la rue en travaux est noire, le thé a laissé place au lait chaud à la menthe dans les petits verres, la silhouette des trois acolytes ne se devine plus qu’à peine sous les bougainvilliers), le même Mathias me souffle en montrant les étoiles et le calme environnant : « C’est pas en ville qu’on aurait ça, hein. » Nous sommes en plein quartier Boucotte. À vingt mètres d’un des deux principaux goudrons de la ville, où passe de temps à autre une paire de phares égarés. À trois cents du grand marché.
Arrivée : le petit avion n’est plus qu’à quelques mètres du sol. En dessous, des cimes d’arbres, des rizières, de fines digues sur lesquelles vont et viennent des silhouettes colorées. La ville ? les bidonvilles d’ordinaire poussés au voisinage des aéroports ? l’habituelle zone industrielle périurbaine ? Rien de tout cela. Jusqu’à l’atterrissage, la même forêt de palmiers et de fromagers, les mêmes bras de mangrove, les mêmes rectangles de riz repiqué. La piste apparaît les dernières secondes, bordée d’herbes hautes entre lesquelles se montre par endroits un militaire brandissant un Famas ou une automitrailleuse écrasée de soleil. Trois voitures garées devant l’aéroport, des bagages qu’on récupère au pied des marches en bavardant avec les agents qui connaissent chaque nouvel arrivant. Ziguinchor. Une rue déserte vient mourir là entre les arbres : c’est la grande artère de la ville. Le lycée Djignabo, principal établissement scolaire, est à trois cents mètres. De rares taxis jaune et noir se risquent à tout hasard jusque là ; la plupart font demi-tour avant le cul-de-sac et repartent nonchalamment vers la ville en quête d’un client. Trois ou quatre goudrons nord-sud. Pour le reste, un damier de rues de sable s’étendant dans toutes les directions, jusque loin (à défaut d’être dense ni haut, Ziguinchor est vaste), Tilène, Kandé, Goumelle, Grand Dakar, Niéfoulène. En filant droit devant c’est Nema, Kadior - et tout au bout du goudron, au bout de la ville, par-delà le marché Saint-Maur (mais un guide touristique choisirait probablement de décrire Ziguinchor en sens inverse, en partant du fleuve et du débarcadère pour ensuite seulement descendre plein sud le long du goudron), l’Escale, ancien quartier colonial par lequel la ville touche au fleuve. Du pont vers la Gambie déjà, Ziguinchor n’est plus qu’un gros village : l’usine Sonacos a beau rutiler de toutes ses tuyauteries, ce qu’on voit surtout ce sont les pirogues immobilisées dans le courant presque nul (ancrées de façon que les filets suspendus à leurs balanciers se remplissent sans effort de crevettes), c’est le fleuve immense et lent, ce sont les palétuviers à perte de vue sur la rive d’en face dépourvue de la moindre construction.
Premiers temps (septembre) : la pluie. Énorme. Assourdissante. Bombardant les feuilles des manguiers et des neems. Ruisselant des toits de tôle. Noyant les rues. Barrant parfois le passage sur des centaines de mètres. Première nuit : il a plu vingt-quatre heures, les rues sont inondées, les caniveaux débordent. Même les baye fall, disciples mourides qui bercent chaque soir de leurs chants le quartier, sont coulés : leurs clameurs au départ vaillantes, tambours, « la ilaha illa lah » repris en boucle malgré les seaux d’eau, finissent par s’éteindre, englouties comme le reste de la ville.
Le lendemain éclaircie. Carrefours submergés. Je veux sauter dans un taxi pour voir des quartiers que je ne connais pas encore, Colobane, Lindiane. Non, répondent les chauffeurs en faisant demi-tour sans même chercher à discuter : trop d’eau. Je marche. Trois minutes plus loin une rue changée en lac m’arrête. Je m’apprête à rebrousser chemin quand un vieil homme se présente à son tour face à l’obstacle. Il se déchausse, retrousse le bas de son pantalon, prend ses sandales à la main, entre dans l’eau jusqu’aux mollets. De l’autre côté il remet ses chaussures, poursuit son chemin sans se retourner.
Un mois plus tard (octobre) : la pluie n’est plus qu’un lointain souvenir. Fini jusqu’en juin. Plus une goutte. Partout un sable moelleux, chaud, dans lequel s’enfoncent les sandales. Après les inondations de l’hivernage : la pénurie. Plus d’eau. Plus surtout d’électricité. Ou plutôt : de l’électricité une heure et demie par jour, sans prévenir, le plus souvent la nuit ou à l’aube. Puis plus rien jusqu’au lendemain. Vingt-deux heures de coupure par jour. On n’a jamais vu ça, c’est la première fois, rassurent les gens. Vraies fausses rumeurs chaque jour, bonnes ou mauvaises. Les groupes de la centrale régionale n’ont pas été changés depuis les années 1980. Les groupes seront bientôt réparés. Les groupes sont foutus. Il y aura la semaine prochaine un nouveau groupe. Il n’y en aura pas avant mi-décembre. Il y avait la semaine dernière un groupe qui venait d’arriver, mais en le branchant à l’envers ils l’ont grillé. Ils choisissent les quartiers qu’ils alimentent - c’est pour ça qu’à Goumelle où habitent beaucoup d’employés de la Senelec ils sont moins coupés. Ils ne choisissent rien, ils font ce qu’ils peuvent. Ça va s’arranger vite. Ça pourrait ne pas s’arranger avant très, très longtemps.
Accès de colère. Trois enfants en couveuse meurent à l’hôpital un soir où le stade, mystérieusement épargné depuis le début des coupures, reste allumé toute la nuit - il faut dire que s’y succèdent chaque soir de 1dix-neuf heures à trois heures du matin les matches de navétanes, championnat de foot inter-quartiers dont la popularité auprès des Ziguinchorois surpasse à peu près tout, à l’exception peut-être des apparitions du Real Madrid en Ligue des Champions et des grands chocs de lutte - Yékini vs. Bombardier « le B52 de Mbour », Modou Lô vs. Balla Gaye 2 « le lion de Guédiawaye ». Des locaux de la Senelec sont caillassés, un ingénieur de la compagnie dont la maison restait inexplicablement alimentée pendant les coupures se fait rudoyer. Le calme revient à peu près. C’est qu’on finirait presque par s’habituer. Certains se plaignent de la patience des Casamançais, qui devraient râler une bonne fois, comme dans le reste du pays où l’électricité commence à revenir, comme à Kabrousse où on raconte que les villageois ont débranché les compteurs et juré au contrôleur qu’ils le boufferaient cru s’il revenait avant la fin des coupures. D’autres répondent que les Casamançais sont fatigués de se battre ; qu’ils craignent une répression plus forte qu’ailleurs à cause de la rébellion. Qu’après tout, en Guinée-Bissau, c’est deux heures de courant par mois qu’ils ont.
Deux fois la durée de la desserte se rallonge spectaculairement. La première au lendemain de la nomination du fils du président au ministère de l’Énergie - trois jours de courant d’affilée, du jamais-vu, censé illustrer la prise en main de la situation par l’homme providentiel, mais dont l’effet est surtout d’attiser la colère générale (ils avaient donc les moyens de tout arranger depuis le début ! voire : ils ont aggravé la situation ces derniers jours pour mieux préparer l’arrivée triomphale du dauphin !). La seconde à l’annonce d’une grande marche de protestation dans les rues de Ziguinchor, de l’hôpital régional où sont morts les trois nourrissons jusqu’à la gouvernance. Quarante-huit heures avant, le courant revient. Habile, très habile. Le jour de la manif chacun a beau s’être promis d’être tout colère : rien à faire, l’électricité est là depuis vingt-quatre heures, l’ire n’y est plus vraiment. Au passage de la manif, qu’on annonçait terrible, je ne peux m’empêcher d’éprouver de la déception. Les tenues noires de deuil et les poings levés n’y font rien : l’ambiance est presque bon enfant.
Les autorités ont promis que tout serait arrangé pour la fête de Tabaski, le 17 novembre. Cette fois c’est pour de bon : le courant revient, un peu plus chaque jour. Les groupes sont là, on le dit ; on l’avait déjà dit à plusieurs reprises mais cette fois on le dit plus encore, et même les journaux l’écrivent. La Senelec, qui sait son crédit entamé et le peu de chances de voir la moindre de ses annonces prise au sérieux avant longtemps, a mis en place un système de bus gratuits pour permettre aux incrédules de venir se rendre compte de leurs propres yeux. « Les groupes sont là, je les ai vus », disent babas ceux qui reviennent de la centrale de Boutoute. Les réverbères de Lindiane en restent allumés toute la journée. Lumière. Eau chaude. Musique. Internet qui remarche. Ça fait tout drôle : fête et pincement bizarre à la fois. On finissait par s’y faire. Ah bon fini les bougies. Ah bon fini les couchers de bonne heure, épuisé de se tuer les yeux à lire à la lampe à pétrole. Bon, bon.
Sorties de la ville. Omniprésence des éléments : fromagers aux troncs torturés de grandes rides, fourrés inextricables, lianes, oiseaux dans les rizières, odeur des feux de brousse, rouge des pistes, fine poussière qui dore l’air quand on lève les yeux pour observer au loin les silhouettes d’enfants, de cyclistes, de coureurs, de vendeuses de charbon.
Stop : moi qui me suis souvent déplacé par la grâce d’automobilistes hospitaliers, me voilà pour la première fois au volant, à pouvoir rendre la pareille. Le long de la route qui va de Ziguinchor à la côte, à soixante-dix kilomètres de là, puis sur la piste défoncée qui continue jusqu’à Diembereng, rencontres le temps d’un trajet, petits pans de la carte qui s’incarnent et prennent vie chaque fois : Marie, du village d’Essaout à la frontière de la Guinée-Bissau, Firmin, instituteur de l’île d’Ourong, Fatou et sa fille Maïmouna qui descendent au village de Dioher. Charme désuet des prénoms catholiques, Joséphine, Arsène, Ignace, Rosalie, Adèle, qui pourraient être au choix du début du XXe siècle ou d’une crèche du Xe arrondissement parisien.
Et puis un soir c’est fête : après trente et un ans sans titre, le Casa Sports, club de foot de Ziguinchor, vient de remporter la Coupe de la Ligue contre le Jaraaf de Dakar. Malgré le budget du club plusieurs fois inférieur à celui de tous ses adversaires. Malgré les salaires des joueurs dont pas un ne dépasse cent cinquante euros par mois. Malgré les douze heures de route aller, douze heures de route retour qu’abat chaque semaine l’équipe pour aller affronter les autres clubs du championnat, tous de l’agglomération dakaroise. Le moustique a terrassé le lion ! Le Nord a plié sous les assauts casamançais ! Le Sud perpétuellement défavorisé par l’arbitrage a eu raison du club de la capitale ! Partout les habitants se préparent à l’accueil des héros. Le maire de Ziguinchor voulait offrir à l’équipe un retour en avion. « Ce n’est pas l’équipe de Ziguinchor, c’est l’équipe de toute la Casamance », ont clamé les habitants des villages environnants, et ils ont exigé que les joueurs rentrent par la route – un car qui arrivera par la Gambie et traversera tout le nord de la région, y compris les villages bordant la zone des Palmiers, associée dans tous les esprits à la rébellion et à ce qu’il reste de maquisards du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance.
Un cortège d’accueil s’organise, auquel je me joins (les supporters à convoyer sont nombreux et tous les renforts de véhicules sont les bienvenus). Peut-être par mesure de sécurité, plus certainement pour voler à la rencontre du bus déjà entré sur le territoire, les voitures de tête filent à toute blinde, tellement que je peine à les suivre, peu habitué à slalomer à cent à l’heure entre les nids de poule. À mes côtés sont montés deux supporters et deux journalistes radio ; nous parlons beaucoup au début, puis de moins en moins à mesure que se creuse l’écart avec la voiture qui précède. Est-ce la vitesse à laquelle nous roulons qui les inquiète ? l’éventualité de nous retrouver coupés des autres véhicules ? Je parviens à recoller mais quelques kilomètres plus loin il me faut de toute façon m’arrêter pour faire de l’essence à Bignona - le décrochage du cortège nous semble à tous préférable à une panne en pleine brousse.
Une demi-heure plus tard nous retrouvons les autres voitures, et juste avant la frontière gambienne le bus : un car défraîchi, rangé sur le bas-côté au milieu de nulle part, sans escorte, sans même une bannière aux couleurs du club. Par les vitres, des jeunes aux yeux fatigués regardent s’amasser les voitures en travers de la route, donner de la voix les supporters dont les cris leurs parviennent sans doute affaiblis derrière le verre. Certains lèvent gentiment le pouce pour ne pas décevoir. Ils ont l’air un peu ahuris. Nous sommes au milieu des fourrés, à plusieurs minutes du premier village ; après les quatre-vingt kilomètres à tombeau ouvert, le silence environnant donne un côté hystérique à nos cris. Les klaxons s’interrompent, les supporters remontent en voiture, tout le monde fait demi-tour. Un pick-up prend la tête du convoi, entraîneur et capitaine sur la plate-forme arrière, parés à brandir le trophée ; le bus se range derrière, suivi d’un essaim de voitures qui se disputent les premières loges. « Serre, serre ! vite ! me crie Khady, la journaliste de la RTS montée à mes côtés. Dis que c’est la presse, vas-y, serre, c’est à nous de passer ! » Je force le passage comme un chacal. Khady exulte : nous ne sommes qu’à une voiture du bus. Elle ouvre son portable : « Allô Demba tu me donnes l’antenne ? »
Le premier village arrive : cette fois l’euphorie est bien là. Youyous, tambours, rameaux de manguiers que toutes les mains agitent au passage du cortège. Sept heures durant, le bus va rouler à dix à l’heure, arrêté tous les kilomètres par des barricades posées en travers de la route pour obliger les joueurs à descendre danser et faire la fête avec les villageois. Sept heures durant, à chaque arrivée dans un nouveau hameau (Mahmouda, Dinyaki, Baila, Kaparan, secteurs où plus aucun gouverneur n’a mis le pied depuis des années), les directs radio vont se succéder dans la voiture, relayant la liesse ambiante, Khady en français, Yaya en diola, élevant tous deux la voix, rivalisant d’enthousiasme et de superlatifs, tendant leur téléphone par la vitre ouverte pour faire entendre les percussions et les chants, n’hésitant pas à parler de paix retrouvée, de communion rétablie, finissant à la cinquième heure et au vingtième hameau par s’épuiser comme tout le monde, Khady prise de migraine, Yaya ne demandant plus l’antenne qu’à l’entrée des principaux villages.
Les semaines passent, la vie va. Hier parlant de l’avancée des travaux dans sa maison, Bodian disait en wolof : « Ndanka, ndanka. Doucement, doucement. C’est comme ça aussi que Dieu a fait le monde. » Interrogation : lisant Jean-Loup Amselle, L’Art de la friche (l’Afrique, l’Afriche, hum hum, le jeu de mots me désole un peu, en dehors de ça le bouquin me plaît), je me découvre peut-être coupable d’une maladie honteuse : le fantasme de l’« Afrique régénérante ». L’Afrique comme refuge de liberté et d’aventure ; l’Afrique (avec un grand A, d’un bloc) comme réserve d’imaginaire, de débrouille, d’inventivité, de fraîcheur, de spontanéité, de vigueur, d’innocence au meilleur sens du terme - des rapports humains, du rapport à la nature, de l’imagination. Est-ce vraiment l’idée que je m’en fais ? Davantage sans doute que celle, inverse et presque universellement répandue, d’un continent ravagé de guerres et d’épidémies, à demi-mort de faim, impaludé, surpeuplé, avec lequel le seul rapport envisageable (odieux) serait d’assistance, de secours, de commisération. Seulement voilà, pour Amselle les deux représentations ne font qu’une et relèvent d’un même préjugé : l’assignation à l’Afrique d’une pureté originelle, « primitive », que l’occident aurait dépassée ou perdue. Et là ça me rassure ; car si fascinantes soient les histoires de fétiches et d’empoisonnements qui abondent en Casamance, si magnifiques les monographies qui décrivent l’art de la riziculture dans le Bandial ou le rite d’initiation du boukout à Elubalir, ce n’est pas tant cette Afrique intemporelle qui m’attire - existe-t-elle seulement d’ailleurs ? - que la façon dont le monde la travaille. Enregistrements sauvages du dernier boukout au téléphone portable, scandale des ventes de DVD pirates montrant une femme accusée de sorcellerie frôler le lynchage... Le même Bodian que je découvre un matin ancien de la marine ayant roulé sa bosse dans tous les ports, de Moscou à Cuba et aux Canaries où il croisa jadis Fidel Castro, pas encore lider maximo ; la troupe du grand metteur en scène Omar Ndao jouant La Cruche cassée de Kleist moitié en wolof moitié en français et réussissant à en faire un texte absolument sénégalais ; inversement l’Europe et le monde continuant de puiser à une Afrique rêvée, de photographier les sapeurs, de vibrer (à raison) à l’écoute de tubes du Super Mama Djombo ou d’autres orchestres mythiques des années 1970. Ce qu’il faudrait réussir à dire : l’infinie variété des allers-retours imaginaires, des emprunts en tout sens ; la multitude des détournements opérés partout ; la façon singulière dont chacun, à Paris, à Londres, à Kinshasa, utilise son portable (en Casamance le répondeur n’existe presque pas), adule Drogba, va à vélo chinois.