


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


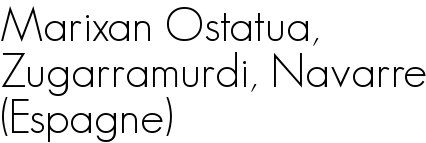
 |
|
|
Publié dans le
numéro 028 (avril 2013)
|
Episode 6 : Marixan Ostatua, Zugarramurdi, Navarre (Espagne)
En arrivant devant le bar, j’ai bien cru que c’était fermé. Personne sur la terrasse, et personne à l’intérieur. La place était vide, l’église fermée. À l’auberge d’en face, on ne voyait pas beaucoup de clients non plus. En réalité, je n’en voyais aucun, juste quelqu’un qui remettait des couverts en place. J’étais embêté parce que j’avais fait un long chemin pour venir là, et j’aurais été déçu. Il y avait toujours, un peu plus loin, Graxiana, « l’auberge des sorcières », dont je savais qu’elle servait d’énormes bocadillos de lomo et de poivrons grillés jusqu’à une heure avancée - quatre heures, au moins - et qu’un ami téléviseur y diffusait toujours un match de football, une partie de pelote ou n’importe quoi de sportif du moment qu’un Basque y était impliqué. C’était une auberge de jeunesse, avec une terrasse où il était doux, l’été, de se soûler lentement en bonne compagnie ; en hiver, ça ne risquait pas d’arriver. J’ai monté les marches de la petite maisonnette, je me suis un peu baissé pour regarder à travers les carreaux, et j’ai vu qu’elle était là. Donc j’ai poussé la porte : Margari, seule, en son bar.
Le lecteur exigeant dira que j’ai triché. Le rédacteur en chef pointilleux dira que je me moque de lui. Zugarramurdi n’est pas en France, mais en Espagne, et moi mon contrat, c’est d’aller dans des bars de France. Mais c’est parce qu’ils ne sont pas allés à Zugarramurdi. Pour aller à Zugarramurdi en provenance de Ciboure (Ziburu, en basque), on peut traverser la Nivelle (Ugarana), et passer par Saint-Jean-de-Luz (Donibane Lohizune) pour prendre la route d’Ascain (Azkain). Ou alors, comme je l’ai fait, on prend la route qui monte directement vers le col d’Ibardin - c’est un peu plus long, mais c’est plus joli. La départementale fait le tour de la montagne de Larrun (nom que les Français ont étrangement transcrit en « la Rhune ») et on arrive alors à Sare (Sara) par une route virageuse. Au-dessus, les sommets de Larrun et ceux alentour étaient couverts de neige, car il avait neigé, ces jours-là de la toute fin de l’hiver. Ensuite, pour aller à Zugarramurdi, il faut dépasser Sare et quitter la route principale - il faut faire attention, c’est sur la gauche. On suit le panneau de la Benta Berrouet (c’est un petit supermarché, une « venta », diraient les Espagnols), et on arrive, après quelques virages encore et en évitant le chien qui dort imprudent, on arrive, en haut, à Zugarramurdi, ses deux cents habitants, son clocher, sa demi-douzaine de cafés et restaurants. Et je dis, moi, que je n’ai pas triché : il n’y a rien qui sépare Sare, qui est en France, de Zugarramurdi, qui est en Espagne, si ce n’est six ou sept kilomètres d’une route uniforme ; à aucun moment ne se matérialise une quelconque frontière, il n’y a pas au bord de la route le moindre panneau bleu. Et même, il n’y a aucune raison valable d’avoir mis une frontière à cet endroit-là, alors que Zugarramurdi est du même côté de la montagne que Sare et qu’il faut monter, encore, pour arriver au col et là, seulement, apercevoir la Navarre ; bref : la frontière, on s’en fiche. On la traverse sans y penser.
(Par la suite, j’ai appris des choses intéressantes sur la frontière franco-espagnole à Zugarramurdi : ainsi, formellement, le petit village n’est pas sur la frontière. Il existe, entre lui et celle-ci, de minuscules enclaves relevant d’autres communes navarraises, certaines assez éloignées, et qui leur furent accordées par privilège, il y a très longtemps, afin de bénéficier de l’économie frontalière, c’est-à-dire des divers trafics légaux et illégaux qui s’y trament et aujourd’hui se manifestent par la présence des supérettes et des stations-service - c’est un ami basque qui me l’a dit, et c’est vrai : il suffit de chercher Zugarramurdi sur Google et l’on voit qu’il ne touche pas la frontière. Il est encerclé. Mon ami connaît beaucoup de choses : il m’a dit aussi que le Premier ministre Gladstone était déjà venu à Sare, le village d’en dessous, ce qui paraît bizarre : c’est qu’en fait, là-bas vivait le célèbre pasteur anglican Wentworth Webster, qui était aussi philologue et folkloriste, et qui collecta de nombreuses légendes basques, et comme il était célèbre, cet Anglais, et érudit, il recevait des visites, donc celle de Gladstone, et même celle du roi d’Angleterre, empereur des Indes et souverain d’autres contrées, Édouard VII, qui vint à Sare assister à une partie de pelote et rencontrer Webster, qui mourut le mois suivant, en avril 1907.)
Je suis donc arrivé là-haut en début d’après-midi et j’avais faim : il y avait sur le comptoir un présentoir contenant des sandwichs farcis d’omelette, de petites saucisses (chistorra), de morceaux de boudin, de grosses tranches de jambon - le lomo. Le pain : le gros pain industriel de rigueur en Espagne, avec le petit quadrillage sur le ventre. C’était drôle : malgré l’absence décelable de la frontière, j’étais bien de l’autre côté, comme en témoignait la présence de ces choses inexistantes « au nord » ; toute artificielle qu’elle paraisse, c’est bien la frontière qui gouverne les lignes d’approvisionnement et les habitudes culinaires : le tracé imaginaire modifie subtilement les modes de vie de personnes formant, à bien d’autres égards, une même communauté. À Margari j’ai donc baragouiné (du breton bara, le pain, et gwin, le vin, le mot « baragouin » ayant été formé à la fin du Moyen Âge pour désigner les Bretons qui commandaient, dans les auberges, « du pain et du vin ») dans mon mauvais espagnol que je voulais un sandwich avec de l’omelette. C’était maladroit : Margari m’a immédiatement répondu en français. Elle m’a demandé si je voulais qu’elle le réchauffe : oui, oui, s’il vous plaît. Je me sentais bête. Quand Margari est partie réchauffer mon machin, j’ai pu regarder un peu autour de moi. Je n’étais jamais entré avant : je m’étais contenté de boire des petits apéritifs de raisin en terrasse, l’apéritif des enfants dont j’ai oublié le nom, avec le même ami, celui qui connaît toutes les légendes basques de Wentworth Webster. À l’intérieur, c’était montagnard : des chaises en bois, du lambris sur les murs, des affiches punaisées, des cartes postales du monde entier. Un peu rustique-chalet, on était bien. Accroché derrière le bar, un petit drapeau breton (le Gwen ha Du, « blanc et noir », ses couleurs) confirmait la théorie (folklore moderne) selon laquelle on trouvera toujours, où qu’on soit, un Gwen ha Du accroché, flottant, arboré. Colportée par des Bretons que cela emplit de fierté, la légende s’entretient d’elle-même grâce à d’autres Bretons - à moins que ce ne soient les mêmes - qui se chargent de la rendre vraie, d’autant plus ici, au Pays basque - et là je me souvenais de mon autre grand-père, Breton bretonnant, mais communiste, et qui n’aimait pas beaucoup ceux qu’il appelait avec mépris les Breizh Atao, les « Bretagne d’abord », parce qu’ils étaient de l’autre côté pendant la guerre, et donc il se moquait des T-shirts des militants de la « cause » au festival de Lorient dans les années soixante-dix, et qui disaient ceci, plus ou moins : « Bretons, Basques, Kurdes, Kabyles (la liste était variable), même combat ! » Mais cela ne m’a pas empêché de vouloir faire un peu le malin, alors j’ai dit à Margari qui revenait avec mon sandwich : ah, vous avez un drapeau breton ! « Eh oui, a-t-elle répondu. Il y a beaucoup de Bretons qui viennent ici. »
Margari est assez petite, la cinquantaine, elle a les cheveux châtain clair. Elle mâche beaucoup de chewing-gum parce qu’elle a arrêté de fumer il y a quelques années, alors elle compense. Quand je suis arrivé, je l’ai interrompue dans la lecture d’un livre qu’elle a posé sur le tabouret du bar. Le livre, c’était La Historia del amor, de Nicole Krauss. Nicole Krauss, c’est la femme de Jonathan Safran Foer, qui est un écrivain étatsunien à la mode. Elle aussi, un peu. Du livre, son éditeur français dit ceci : « À New York, la jeune Alma ne sait comment surmonter la mort de son père. Elle croit trouver la solution dans un livre que sa mère traduit de l’espagnol, et dont l’héroïne porte le même prénom qu’elle. Non loin de là, un très vieil homme se remet à écrire, ressuscitant la Pologne de sa jeunesse, son amour perdu, le fils qui a grandi sans lui. Et au Chili, bien des années plus tôt, un exilé compose un roman. Trois solitaires qu’unit pourtant, à leur insu, le plus intime des liens : un livre unique, L’Histoire de l’amour, dont ils vont devoir, chacun à sa manière, écrire la fin. » Relisant plusieurs fois ce synopsis, je ne l’ai toujours pas bien compris, si ce n’est ceci : c’est une histoire de langues.
Je suis tout seul dans le bar, pendant très longtemps, alors j’essaie de discuter. En fait, Margari, elle n’a pas très envie de causer. Je le vois bien. Elle regarde par la fenêtre, elle attend que ça passe - que je passe, peut-être. La radio diffuse EiTB, la grande radio basque. Ils passent Morrissey et de la pop des années quatre-vingt-dix, et des nouveautés, et c’est bien, c’est comme une bande-son de dimanche après-midi. En attendant, il faut quand même bien que je la fasse un peu parler, Margari, alors je lui dis que je suis déjà venu chez elle, que je connais des gens du village, qui habitent en haut, là, mais ça ne l’impressionne pas beaucoup, alors j’enchaîne un peu : il n’y a personne, hein ? « Non, en ce moment, pas beaucoup. C’est parce qu’il fait froid, les gens ne montent pas. » Les gens ? « Les Français. Les touristes. Les gens de Sare. Heureusement qu’on a les gens de Sare qui viennent ici : ils y a deux mille habitants, à Sare, ici deux cents, alors les gens de Sare montent pour venir ici, c’est un peu moins cher. C’est pour ça qu’il y a tant de restaurants ici, c’est beaucoup pour un petit village comme Zugarramurdi. » Il y a les fêtes aussi, non ? « Oui, au mois de juin mais c’est une petite fête... Parce qu’on arrêté la fête des sorcières. C’était devenu fou. » La fête des sorcières : organisée en souvenir des « sorcières » de Zugarramurdi, accusées par l’Inquisition de Logroño, en 1610, de sabbats infernaux dans les grottes du village, et brûlées vives (ou brûlés vifs, car il y avait aussi des sorciers). Organisée dans la grotte et dans le village, « on l’a arrêtée depuis 2005, c’était trop de travail. La dernière année on avait eu dix mille personnes, ici. » Ah oui, quand même. « Il y a un musée, maintenant. Le musée des sorcières. C’est plus tranquille. »
Je lis le Diario de Navarra, laissé sur le comptoir. Il fait sa une sur la Korrika, qui vient de commencer. Oh, et elle passe ici ? demandé-je. « Oui, ce soir, à trois heures du matin. On a acheté le bout de route. » Le journal m’informe qu’elle finira, cette année, à Bayonne. Moi, ça me rappelle des souvenirs, parce que je l’ai déjà courue, la Korrika. C’est une course qui fait le tour du Pays basque pour promouvoir la pratique du basque, et qui ne s’arrête jamais : les gens se relaient, et courent, tout le jour et toute la nuit. Une fois donc, j’étais à Bilbao, chez mon ami basque qui lit Wentworth Webster. « Tiens, mets un short, on va aller courir la Korrika. » La quoi ? « Tu vas voir. » Et donc on avait mis un short, et on avait pris deux canettes de San Miguel (« la bière des sportifs ») et on avait couru dans les rues de Bilbao avec quelques milliers d’autres, dix minutes, avant de laisser repartir la Korrika, ses mégaphones qui incitaient la foule à reprendre en chœur « Ttipi ttapa ttipi ttapa, Korrika ! », avec succès. J’imaginais la chose ici, la nuit, dans la montagne, comme une autre et nouvelle forme de sabbat.
Margari a des choses à faire, alors elle va faire un tour dans sa cuisine. Moi je bois un café. Avec la bière et le sandwich, ça fait trois euros quatre-vingts. Je continue de lire le journal : il y a un article sur des gens qui confondent Lorka en Navarre et Lorca dans la province de Murcie. Il y en aurait plusieurs dizaines chaque année, des touristes qui réservent des hôtels, se donnent rendez-vous, et se retrouvent à huit cents kilomètres de l’endroit où ils croyaient aller.
Les clients qui viennent à l’Ostatua : des gens du village, qui parlent en basque, saluent Margari, et moi. Trois gamins viennent acheter des chips et du chocolat, parce que Margari a aussi quelques produits à vendre : ils transportent des raquettes, un ballon, et je me demande bien comment c’est, d’être un gamin de la campagne, de la montagne - je me souviens de mon ami qui me disait, l’air de ne pas rigoler : « Vous, vous avez un rapport romantique avec la montagne, vous ne pouvez pas comprendre. Moi c’est différent : moi, j’y vis. » Nous, on éclatait de rire parce qu’on pensait à ses histoires de types qui cachaient des boîtes de pâté sous les rochers pour les retrouver la prochaine fois qu’ils passeraient par là. Mais bon : finalement, il avait raison. Et je me disais aussi (en fait je me le dis maintenant, en l’écrivant, parce que sur la terrasse battue par le vent frais avec ma deuxième bière je ne pensais pas beaucoup), je me disais qu’un étrange peuple vivait là, frontalier qui fait semblant de ne pas croire à la frontière, alors qu’il suffit de passer d’Irun à Hendaye, de traverser la petite Bidassoa, pour passer de ce vieux pays gothique où l’on déjeune à quatre heures et dîne à vingt-deux, où des mamies en blouse discutent sur des bancs, où l’on crache les noyaux d’olive sur le sol des bars déjà jonché de petites serviettes grasses en regardant des matches de foot, où des gamins à la nuque longue jouent au ballon comme des déments, à un pays propret, aux maisons réglementairement blanches-rouges-vertes, aux menus à quinze euros et aux rues désertées. Si bien que pour choisir un bar, j’avais visé la langue, en en cherchant un où l’on parlerait basque, assurance, du côté nord, qu’au moins j’y entendrais de nouvelles chansons. Et puis j’étais monté à Zugarramurdi.
Quand je repars, il fait vraiment froid. Deux clients arrivent : ils sont en T-shirt. Un gros et un barbu. On se salue - eux me disent « bonjour » en français (parce que c’est écrit sur ma tête, que je ne peux pas être d’ici, et si je ne suis pas d’ici, c’est que je suis du nord), puis reprennent en basque. Leur chien les attend sur la terrasse. En quittant le village pour redescendre, je vois les trois gamins qui jouent, sur le parking presque vide du grand restaurant à côté du fronton où l’on joue à la pelote, l’été, et moi je m’arrête pour prendre une photo de Larrun enneigée.