


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


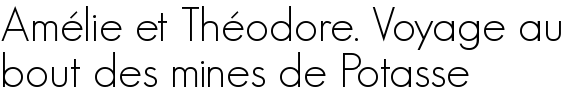
 |
|
|
Publié dans le
numéro 026 (Février 2013)
|
C’est un film muet de propagande de 1927 ; on y voit en noir et blanc une petite mère excitée pousser une carriole, sa « fruiterie à roulettes » comme elle l’appelle, remplie de vieux choux fripés qu’elle ramène du marché sans en avoir vendu un seul. Une scène de ménage plus tard, la voilà qui repart sur les routes de l’entre-deux-guerres en quête de « beaux légumes bien sains, de bel aspect, de belle conservation » ; les hommes qu’elle croise sont en bretelles et béret ; ils ressemblent à Raimu. Et puis voilà-t’y-pas qu’apparaissent sur la bobine et en plein champ des navets magnifiques « qui feront prime sur le marché », de sublimes oignons, asperges, artichauts, radis. « Mais qu’est-ce que vous y faites donc à vos légumes pour qu’ils soient si beaux ? » demande au maraîcher Mme Amédée. Celui-ci d’expliquer alors son secret : la potasse d’Alsace. « Si j’en avais j’en donnerais bien à mon mari qui est plutôt chétif et mal venu. » Clap de fin et éclat de rire. Presque un siècle plus tard, la potasse est désormais importée de la province du Saskatchewan, dans l’Ouest canadien. Les mines domaniales de potasse d’Alsace (MDPA) ont fermé en 2002. Aujourd’hui, partie des chambres sont le tombeau de quarante mille tonnes de déchets ultimes que l’on a cru malin de descendre là, entre 1998 et 2002. Et on rit moins.
Décembre. C’est une heure à croiser une biche. Je traverse une forêt de frênes et de pénombre, la ligne bleu nuit des Vosges dans mon dos n’est encore qu’imaginaire, Radio Cigogne tout doux dans les baffles de l’autoradio, le flash info annonce que Florange ne sera pas nationalisée, que M. Mittal tiendra ses promesses. Gare ma voiture sur le parking, au pied du chevalement Else ; chevalement, d’où vient le nom ? Grande balançoire à aube, petite tour Eiffel utilitaire, regardez la photo.
Les chevalements sont à la surface des choses, du monde, la matérialité du puits qui dans les entrailles de la terre s’y enfonce, sa pointe émergée, six cents mètres plus bas, vers la potasse, laquelle on n’exploite donc plus en Alsace depuis 2002 - mais on l’a exploitée durant les cent années qui ont précédé, quatre cent millions de tonnes au total, elle fut un large pan de la France industrielle fantasmée ou singée d’Arnaud Montebourg. Et si moins glamour que les gueules noires des charbonnières du Nord, les mineurs de potasse de Haute-Alsace, qui n’eurent pas l’heur d’avoir leur Zola - ou même, leur Bachelet -, sont tout aussi héros.
Une fois par mois est organisée, dans l’un des deux puits encore en service sur les vingt-quatre au total ayant été foncés, une visite du fond, à destination des familles des anciens mineurs, des chercheurs, des curieux. Et, donc, d’un auteur du Tigre. Quelques minutes après mon arrivée, je reçois mon paquetage : bleu de travail, casque et lampe frontale, glisse stylo et carnet dans une poche peut-être découpée pour recevoir autrefois le grisoumètre... La porte de métal se ferme, la cage s’ébroue en grinçant dans le noir, les craquements de la roche remplacent la musique d’ascenseur, c’est sommaire et efficace, tout autant que l’est le système de communication entre le fond et le jour, archaïque à l’âge de Skype, mais universel et en fait rassurant par sa simplicité : on utilisait le même en Lorraine, ou au Chili, à Copiapó, où trente-trois mineurs sont restés bloqués sous terre durant soixante-neuf jours en 2010. Halte : un coup. Puits libre : trois plus trois. Cordée avec explosifs : huit coups (tu m’étonnes). Une fois lancés, on plonge à dix mètres-seconde vers le centre de la terre.
En bas, nous nous dirigeons vers le « petit magasin », qui n’est pas d’alimentation générale, plutôt comme un petit troquet : l’antre des mineurs ; on s’installe, fait couler une cafetière. Les deux délégués mineurs qui nous font la visite, cégétistes, sont les derniers du genre, un côté Mohican, derniers poilus. Puisque on ne have plus la roche, leur présence est presque superflue. Le vaste plan social qui fut négocié au tournant du siècle mit en retraite anticipée pour la plupart, sur le carreau du chômage pour quelques-uns, trois milliers de mineurs. Depuis lors, Thierry et Francis ont été mandatés par la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) pour superviser, garants de la sécurité, les opérations de fermeture de la mine. Ils descendent dix fois par mois, font des rapports, dont les recommandations sont imparfaitement mises en œuvre par une équipe de mineurs polonais recrutés par appel d’offres international pour assurer la maintenance courante du site, avant la liquidation définitive de la mine. Offre de marché au moins disant ; classique, un boulevard pour l’Europe de l’Est. Dans la salle de commandes ou les vestiaires, les notes de service à l’attention du personnel sont en français et en polonais.
Au « petit magasin », les portes des frigos sont scotchées de posters érotiques ; on y lit encore L’Huma et Bilto, on y coche six cents mètres sous terre des grilles de tiercé, on croit deviner le lieu de camaraderie qu’il fut tantôt, et qu’il continue à être, mais pour moins nombreux. Au plus fort de l’activité, ce furent plusieurs centaines de personnes qui descendirent quotidiennement par le puits de Joseph ; aujourd’hui une petite vingtaine. Fin du petit déjeuner. L’inspection des lieux commence. Dès qu’on a quitté le couloir principal, où la température flirte avec celle du dehors, pour des voies secondaires, on ressent alors la chaleur de la lithosphère, son climat saharien. Le fond de l’air est salin. 35°C ; on est dans la couche de sel gemme, parfois veinée de charbon. Quand on se lèche les babines, c’est comme si on léchait le fond d’un plat de frites. Pas comme d’être au bord de la mer, ça ne sent pas l’iode, on ne pense pas huîtres-vin blanc ; on pense, je ne sais pas. Labeur, poussière.
Montons dans un véhicule de TP (pour « transport de personnes ») : pas de bougies d’allumage, pour éviter l’étincelle qui ferait tout embraser ; pas de moteur Diesel pour préserver les travailleurs du fond des vapeurs d’échappement ; mais combustion hydraulique et allumage antidéflagrant, qui font un boucan du diable. Sel gemme, couche blanche. Puis on arrive dans le rouge. On est dans le vrai. Plusieurs rouges pour la potasse. On me raconte les postes de travail de sept heures, les deux cents litres d’huile utilisés par les mineurs continus Jeffrey et leurs petits couteaux en tungstène qui grignotent la roche et qu’il faut changer à chaque poste, les tailles où la température atteint les 40, 45°C, où tout le monde travaille torse nu, et les deux seaux d’eau que l’on boit à quelques-uns, en peu de temps, puis la bière après. Mais plutôt à l’imparfait. Les tambours des haveuses ont dessiné sur la paroi d’étranges motifs, d’inspiration quasi rupestre. Je pense à Différence et Répétition, de Deleuze, que je n’ai jamais lu. Des câbles gainés courent partout, téléphone, électricité, alimentation en eau, dans des galeries voûtées comme des petites cathédrales. Et enfin, les voilà : fûts et big bags, déchets soi-disant inertes barrés de code-barres pour en assurer la traçabilité, descendus là il y a dix ans par une entreprise, StocaMine, au nom bien connu dans la région, comme en d’autres, et toutes proportions gardées, Cargill, AZF, BP. Synonyme du capitalisme fin de race, fric qui macule et pourrit, de la cave au grenier. Un incendie se déclara en septembre 2002 un demi-kilomètre sous terre. On mit plus de deux mois à l’éteindre. L’incendie coïncida avec l’arrêt de StocaMine, mais aussi, prématuré de plusieurs mois, de l’exploitation de la potasse. J’y reviendrai.
Avant de refaire surface, je croise une petite statuette (céramique ?) à l’effigie de sainte Barbe, protectrice des artilleurs, des mineurs, des pompiers. Sous cloche. On m’explique que, par superstition, quand une mine ferme, on remonte toujours la sainte Barbe. Je mets quelques secondes à comprendre le sens de la phrase. Quand une mine ferme, on laisse sinon, et à part la petite sainte, absolument tout au fond : matériel roulant, outillage. Bric-à-brac. Le sel et les années se chargeront d’avaler tout de la ferraille, de la fossiliser. Sainte Barbe. Sans remettre en cause sa bonne volonté, elle ne tint son rôle qu’avec intermittence. Huit cent vingt-sept mineurs sont morts au fond en moins d’un siècle d’exploitation, lourd tribut de la société des hommes à l’épandage des champs, à la terre nourricière et fertile.
Le jour qui suit ma visite, on inaugure justement un mémorial dédié aux morts de la mine devant le chevalement Théodore, à Wittenheim. C’est un jour important, cela fait des années que des associations se battent pour cela : restaurer le patrimoine architectural minier, prendre soin de la mémoire. Les noms des huit cent vingt-sept ont été gravés dans des blocs de grès rose des Vosges ; les patronymes à consonance alsacienne (Zenner, Siffert, Nussbaum) y côtoient les très nombreux morts polonais, Nowacki, Krzyzanski - ils furent nombreux à émigrer pour exploiter la mine après la Grande Guerre. Il fait froid, les gens fument comme des hauts-fourneaux. Par petits groupes plus ou moins recueillis, ils se succèdent sur le chemin de la mémoire. « Ah, voilà Fernand ! » entends-je d’un côté, pendant que d’autres : « Mais il en manque, il faudra le signaler. » Un vieux monsieur compte le nombre de décès à la date du 23 juillet 1940. Viaråzwanzig. Vingt-quatre. Et dans une phrase en alsacien viennent s’intercaler trois mots français pour lesquels la traduction probablement manque : coup de grisou. C’est émouvant ; à la tribune, sous un chapiteau chauffé dressé pour l’occasion, les discours se succèdent. On pointe les obstacles administratifs et financiers qu’il a fallu dépasser (« L’Alsace aurait-elle honte de sa mémoire ? »), contourner, sauter à pieds joints pour sauvegarder le chevalement Théodore (alors que presque tous les autres furent ferraillés) et concevoir ce lieu ; on regrette l’absence de médias nationaux de la part desquels « cet événement aurait mérité une couverture ». La présence du Tigre vaudrait-elle consolation, je ne m’annonce pas. Dans le public, assise à côté de moi, une dame élégante et sympathique, qui vote à droite mais s’est toujours bien entendue avec les communistes, m’explique qu’elle a travaillé quarante-deux ans à la mine, mais « au jour », comme on dit. À la préparation des salaires. « Il aurait fallu que chaque femme de mineur y descendît au moins une fois », dit-elle. Elle me présente ceux qui se suivent devant le microphone, leurs orientations politiques. Maire, député, sénateur, sous-préfète, les orateurs ont pris distance de leurs notes pour laisser parler le cœur. Deux Alsaciennes coiffées et en tenue folklorique entourent l’estrade. L’un des édiles cite un poème de mineur : « Vous tous pauvres corps nus brisés ; disloqués écrasés explosés ; remontés d’une nuit ou au petit matin par vos camarades ; quitter un trou pour en rejoindre un autre. » Quand on parle de la mine, on est comme dans une vieille chanson triste de Brassens ou de Brel ; Fernand, seul devant, ou pauvre Martin creusant lui-même sa tombe. L’un d’eux dit : « Il ne faudrait pas que l’Alsace ne soit que vignobles et colombages. » Puis montent les chœurs de l’harmonie des mines, puis le verre de l’amitié, gewurztraminer-kougelhof. Le lendemain encore, j’assiste à la messe donnée en l’église Sainte-Barbe, de la cité minière Sainte-Barbe, en l’honneur de sainte Barbe, fêtée le 4 décembre.
Les cités minières. Elles ont été construites par les MDPA dans les années 20, essentiellement pour héberger la main-d’œuvre venue de loin, en adoptant comme contre-modèle les hébergements de corons, habitat en bandes de petites maisons identiques construites à la chaîne. Ici, il y a vraiment de l’espace, et de la diversité ; les plans types font subtilement varier la disposition des pièces, les maisons sont plus ou moins reculées sur l’alignement de la rue, afin de rompre la monotonie d’un urbanisme alloti. Sur dix ans, de 1919 à 1929, sortent ainsi de terre 45 maisons d’ingénieurs, 252 logements d’employés, 2959 logements d’ouvriers mariés, 542 places d’ouvriers célibataires, 8 coopératives, 7 restaurants, 12 écoles, 4 salles des fêtes, 2 églises ; il y a pour chacun de la lumière et de l’air, il s’agit tant de prévenir les petits contentieux de voisinage que la propagation des virus. Les pentes des toits sont rapides, les poutres porteuses apparentes ; les encadrements de portes et fenêtres dans des teintes bariolées tranchent avec la blancheur des façades. Le sol de la cuisine est revêtu de carreaux de céramique de Marseille ; il y a même une petite étable pour élever des cochons, un poulailler. Dans l’ensemble, tout le monde l’admet, c’est une réussite. Chaque année, un concours, doté de prix en nature, récompense les maisons les plus fleuries. À cette époque, les mines créent également une ferme modèle, destinée à alimenter en lait frais les cités ouvrières. Capitalisme paternaliste. On connaît. Certains détails apparaissent cependant plus insolites. Ainsi les bains de « soleil » donnés aux enfants (yeux bandés marchant en rond reprenant les incantations d’une sœur sous une lampe de quartz) ; ou les cours de cuisine, « et c’est touchant de voir la joie des Polonaises habituées à nourrir toute leur famille avec de la charcuterie ou du fromage, lorsqu’on leur apprend à faire un riz au lait ou un bon pot-au-feu ». Autant d’informations provenant d’une étude d’Eugène Roux, conseiller d’État et président du conseil d’administration des mines, parue dans les années 30. J’aime les cités minières, m’y promener. Les noms de leurs rues sont mignons ou bucoliques. Dans celle-ci des noms de plantes, dans celle-là des noms d’oiseaux. Et dans la cité Rossalmend, des noms de contes de fée. Les parents de mon amie Valérie habitent rue de la Bonne-Aventure, à Staffelfelden, à l’intersection de la rue des Fées et de la rue Cadet-Roussel.
L’église Sainte-Barbe, pour y revenir, est l’une des deux églises à avoir été construite dans les années 1920. Sur l’autel, un bloc de potasse, une lampe de mineur, au fond de l’église, un chariot. Entourant le prêtre, des pompiers, et six mineurs, chemisés et cravatés sous le bleu de travail, les casques blancs débarrassés des autocollants d’appartenance syndicale, puisque le pouvoir spirituel est incompétent pour les revendications salariales, écoutent l’homélie, chantent timidement le kyrie eleison, l’alléluia. La voûte est en bois, les murs en béton, la nef magnifiquement décorée d’une peinture qui a un peu vieilli ; Sangta Barbara, peut-on y lire. Après la célébration, je vais allumer un cierge. Sur le parvis, et alors que s’est organisée une cérémonie de remise de médaille aux pompiers méritants, et que les cuivres du corps ouvrent le ban, quelques flocons de neige. Il neige souvent pour la Sainte-Barbe, me dit-on.
L’histoire des mines de potasse d’Alsace est composite de milliers de vies minuscules et souterraines de mineurs, s’imbriquant les unes aux autres comme des poupées gigognes pour former la grande, celle qui mériterait peut-être la capitale, si ce n’était tordre un peu les règles typographiques. On aurait envie de les connaître toutes, de les dire et de n’oublier personne ; puisqu’on ne peut, prenons la première qui nous soit tombée entre les mains, celle d’Henri Keller, consignée majestueusement dans la prose rustique d’un petit livre d’une centaine de pages : Amélie I. Les mines d’Alsace portent des prénoms comme en portaient les points d’appui du camp retranché de Diên Biên Phu, Béatrice, Huguette, Claudine, et dont on dit qu’elles étaient les amantes du général de Castries. Les mines ont davantage respecté la parité ; aux côtés d’Amélie et de Marie-Louise, Fernand et Théodore. Amélie I, le livre d’Henri Keller, est paru aux éditions Gallimard en 1976, précédé d’une belle histoire. En 1975, Henri lit Qu’est-ce que la littérature ? de Jean-Paul Sartre. C’est un déclic, ou une révélation : il a quitté la mine voilà plusieurs années, et il lui faut maintenant raconter cette période de sa vie. Son récit achevé, il l’envoie à Sartre lui demandant qu’il le publie. Lequel accepte, ce sera la collection « La France sauvage », créée deux années plus tôt par Sartre et Leiris ; Beauvoir signera la préface. L’histoire que raconte Keller, la sienne, est celle d’un jeune type, un « bleu-bite », et qui n’est pas fils de mineur, mais qui, fasciné par la mine, embauche quand même, « homme cloporte qui gratte du sel à neuf cents mètres de fond ». Le récit n’est tendre ni avec lui-même, ni avec ses semblables, ni et surtout pas avec ses supérieurs, les « porions » comme on les appelait, tous coiffés de sobriquets plus ou moins seyants, habillés pour l’hiver : Nid-de-cigogne, Jünger, l’Épicier ; mais il est généreux comme un puits d’entrée d’air, et il donne à voir, à travers la description d’une musette contenant une mandarine et une tartine de mettwurst, le souvenir de kilomètres avalés à vélo dans le vent mauvais et contraire du matin pour se rendre au carreau de la mine, le parfum du quotidien, l’évocation des mains qui tremblent, de fatigue, ou de froid, de peur, de manque d’alcool, ou de chaud, 50°C au front de taille, et parfois moins 20 l’hiver, dans le conduit du puits. Il raconte la rapine du temps, parfois, les postes contre la montre, la petite montre à gousset dans le bocal de cornichon à côté des commandes du haveur, le jeu du moulin avec neuf morceaux de potasse pour les pions noirs et neuf morceaux de schiste pour les pions blancs, le matin avant l’embauche, la chamaille, le jet-lag perpétuel des mineurs de nuit, qui partent comme au front avec la lune quand les femmes se lovent sous les couettes, se couchent avant les poules, expropriés de leur rythme biologique, le sang, la sueur et les larmes versés pour les morts, foudroyés, écrasés sous un éboulis, mais surtout, l’odeur de poudre qui suit les volées de roche qu’on a fait exploser à la mèche, la chaleur et la poussière, qui fait qu’on suffoque, mouchoir humide au début plaqué sur le nez et les yeux, et puis on s’habitue, le sel rongera les parois sinusales. Les bons moments, aussi, la douche chaude, toujours, et ce camarade mineur chez qui on s’arrête un soir pour y voir les clapiers à lapins dont il vient de terminer l’assemblage, et qui, sur la table de la cuisine, a sorti la terrine, la moutarde, et la bouteille de vin blanc bu à la goulée. Un travail finalement dur et pénible, auquel on risquait sa peau, mais qui gagnait bien. Au fond.
Cette grande histoire minière, elle a une fin, triste, triste surtout de n’être point tragique ou grandiose, mais boutiquière, fait-diversière. On ne peut ici décrire en détail la décroissance de l’exploitation de la potasse sur les trente dernières années, chacun comprendra, elle coïncide avec la mondialisation de l’économie, le choc pétrolier, les Vingt Piteuses, la Chine, le Crédit Lyonnais, le changement climatique, les coutures du tissu industriel qui craquent d’un peu partout ; si le climax est atteint dans les années 50, avec quatorze mille mineurs, ensuite les effectifs chutent, les premiers puits commencent à fermer, la potasse d’Alsace perd de la compétitivité face à la sylvinite canadienne forée, elle, à même la surface, dans le plus grand gisement du monde. Les cours mondiaux s’effondrent à la fin des années 60. Mais l’histoire sociale, tel le réflexe rotulien, continue de tendre les relations entre mineurs et patronat. La grande manifestation de 1967 réunit à Mulhouse cinq mille personnes ; en 1972, une grève pour l’obtention d’une mutuelle dure cinq semaines ; en 1976 on cesse le travail pour demander (puis obtenir) la prime de chauffage. 1979 : grève pour rien, juste un discours du délégué mineur d’alors, Henri Tschirhart, celui qu’on surnommait le commissaire du peuple, Krivine, ou parfois Dieu. Il le raconte dans un des entretiens donnés à la presse locale, en septembre 2003 : « J’ai pris la parole un matin sur un banc de vestiaire, j’ai parlé de la vie, de la mort, le sens de la vie. À la fin de mon discours, personne n’a applaudi, personne ne s’est levé. Ils sont restés assis. Ce jour-là, personne n’est allé au travail. »
La dernière grande grève date de 1997, elle est tournante, par puits, dure trois mois, concerne la négociation du plan social de fin d’exploitation. Voilà donc que l’accord est cependant signé le 22 mai 1997, prévoyant une descente en charge de l’activité en douceur, comme sur une piste bleue, jusqu’à l’arrêt final au printemps 2003. Le personnel est scindé en cinq catégories de salariés, plus ou moins bien lotis par le droit du travail, du fait de la multitude des statuts, des régimes spéciaux, de l’ancienneté ; il y a les « article 130 », les « décret Laniel », les « capital temps », les « CAA », les « 45-25 ». Et huit cent sept salariés n’entrant dans aucune catégorie : ce sont les « reconvertibles » ; il en restait dix-sept au moment de l’arrêt de l’activité, en septembre 2002. De l’incendie du bloc 15.
StocaMine. Deux enquêtes publiques, un combat d’experts, quinze années de débats, d’affrontements, de polémiques enflées comme des œdèmes de Quincke, entre pro et anti, anciens et modernes, a-t-on voulu faire croire. Un gouffre financier. Devant moi s’étend une documentation abondante, plusieurs kilos de coupures de presse, tracts syndicaux, brochures, que de diligents greffiers ont, depuis la genèse, patiemment compilés, archivés - comme pressentant la déliquescente fin et qu’il faudrait alors pouvoir remonter aux origines pour valider a posteriori les arguments des contempteurs du projet, dire que l’on savait. Les premières allusions à un projet d’enfouissement de déchets dans le bassin potassique remontent à 1992, et à la promulgation de la loi-cadre Barnier, qui prévoyait pour chaque région l’obligation d’assurer l’élimination de ses déchets endémiques « dans des conditions propres à éviter les effets nocifs ». Je retrouve une invitation à l’expo-forum du 27 avril au 24 mai 1996 destinée à vulgariser et promouvoir le projet auprès de la population locale, où la rhétorique experte et pompière faisait encore écran de fumée : « Les nombreuses études menées par des organismes indépendants démontrent l’absence de tout risque de pollution de l’environnement et en particulier de la nappe phréatique. » Dont acte. « Une mine au service de l’environnement », annonce la première page du livret présentant StocaMine. C’est vieux ; le numéro de téléphone du secrétariat ne commence pas encore par l’indicatif « 03 », mais par « 89 ».
L’Idée, sur le papier glacé, pouvait cependant séduire - autant que faire froid dans le dos. Puisqu’on ne savait que faire en surface des déchets ultimes, pourquoi ne pas les envoyer par le fond ? On utiliserait le savoir-faire mineur pour creuser des galeries dans les couches de sel gemme, au-dessus des couches de sylvinite déjà exploitées. Là, dans des cavités, on entreposerait en fûts, en barils, en big bags, les déchets ultimes, le sel (viscoplasticité, imperméabilité aux gaz) ayant la propriété étonnante de pouvoir les « encapsuler », « s’auto-cicatriser » ; de quoi faire des roches salines de véritables sarcophages. Le sel extrait servirait quant à lui à déneiger les routes verglacées de la sibérienne Alsace. L’Idée, du reste, allait dans le sens de nombreux intérêts bien compris, économiques et politiques ; il s’agissait à la fois d’assurer aux communes du bassin potassique des ressources fiscales dont la fermeture des mines allait les priver, de recycler une partie du personnel ; elle était à considérer dans un vaste projet de requalification du territoire - création d’un pôle de recherche, d’un parc d’entreprises -, de reconversion à froid du bassin. Une fiction séduisante. Les Allemands faisaient déjà ça depuis 1972 dans les mines de sel de la Hesse, à Herfa Neurode, première décharge souterraine au monde, souvent citée en exemple. Les Allemands, quand même, c’était pas rien.
Mais déjà des associations s’élèvent contre le projet, sans forcément toujours savoir pourquoi, sinon guidées par l’intuitive conviction que des déchets n’ont pas grand-chose à faire six cents mètres sous terre ; la même année éclate le scandale de la vache folle, l’histoire d’herbivores malades d’avoir été gavés de farines animales. StocaMine questionne le même rapport au vivant, à la nature, à nous-mêmes. Les associations s’organisent, organisent des tables rondes, font signer des pétitions. Une conférence de presse est donnée le 13 mai 1996 par un collectif conduit par Alsace Nature. Y sont pointées du doigt les conditions de sécurité du futur stockage : instabilité des couches de sel, risque de coup de grisou, risques sismiques, et à long terme, menaces sur la nappe phréatique rhénane, en cas d’ennoyage de la mine. Y sont dénoncés des erreurs de calcul, des approximations, des conflits d’intérêt. Dans une lettre au maire de Cernay, en date du 4 mai 1996, le président d’une association, dénonçant les incohérences de StocaMine, dans son emballement écrit : « Comme vous pourrez le constater, il y a toujours autant de contrariétés dans ce projet. » Contrariétés pour contradictions. Mais c’est une colère saine.
Je retrouve également un beau texte daté du 29 mai 1996, tapé à la machine, contribution d’un ancien mineur, Étienne Chamik, à la seconde enquête publique, et adressée à « Messieurs les commissaires enquêteurs ». Il est parsemé de croquis à la main représentant en coupe des galeries, des toits, des parements, des dégagements de grisou, abondant l’argumentaire. On y lit ceci : « StocaMine est établi à partir de calculs théoriques, d’hypothèses et d’expériences de laboratoire où les risques réels du contenant n’existent pas. » Puis : « En mon âme et conscience d’ancien maître mineur, et de citoyen de la ville de Wittelsheim, le plus grand centre de population minière, je m’oppose à la réalisation de StocaMine sur le site de Joseph-Else et j’en appelle à la responsabilité de celui qui décidera d’implanter ce lieu de stockage dans un sol sur lequel jamais il ne viendra vivre, ni lui ni ses enfants. »
Et puis il y a la question de la réversibilité ; elle est centrale pour comprendre le dossier. La loi du 13 juillet 1992 a en effet imposé que, dans le cas d’un enfouissement, on réserve durant une période de vingt-cinq années la possibilité de ressortir les déchets. Cette clause de la réversibilité est avancée comme un argument en faveur du projet, sur le mode : si ça déconne, on fera marche arrière. Mais pour les opposants, elle apparaît déjà comme un leurre : on ne parle pas encore de la dette, mais on pressent déjà que personne ne sera prêt à investir les sommes astronomiques nécessaires pour remettre au jour des déchets en hibernation. C’est de bon sens. En Allemagne, en vingt ans, sur 2 400 000 tonnes enfouies, 5 600 ont été remontées en surface, soit 0,23%...
Autant d’arguments écartés d’un revers de la main par les partisans du projet, qui reçoit l’assentiment large des mineurs, des hommes politiques, des syndicats. L’enquête publique dont le tampon indique « reçue à la préfecture le 9 novembre 1996 » a statué. Avis favorable. La direction de StocaMine se targue d’en faire le « site de stockage de déchets ultimes le plus sûr de France ». L’arrêté préfectoral autorisant le stockage souterrain est délivré le 3 février 1997. StocaMine démarre son activité aux premiers jours de 1999, avec un actionnariat majoritairement public : EMC (Entreprise minière et chimique) et les MDPA détiennent chacun 34% des parts, Tredi, société spécialisée dans le traitement des déchets, complétant l’actionnariat. Les premiers déchets descendus sont des déchets ultimes, dits de classe 0 : sels de trempe d’aciérie, amiante, arsenic, cyanure, déchets biomédicaux, déchets mercuriels. Un sacré cabinet de curiosités. Mais dès après le démarrage de l’activité, les résultats sont décevants. StocaMine connaît des difficultés financières, la taxe générale sur les activités polluantes plombant le résultat, le marché des déchets de classe 0 ayant été surestimé. Bientôt, Séché Environnement, un mastodonte du secteur, rachète les actions de Tredi. StocaMine passe dans les mains du privé. Le rythme d’enfouissement s’accroît alors de manière surprenante. Et on ne sait plus très bien ce qui descend par le puits de Joseph-Else. En juillet 2001, sur injonction préfectorale, la direction de StocaMine doit faire remonter un stockage illicite de cinquante tonnes de déchets souillés au pyralène. Il faudra sept mois et demi pour y parvenir, après avoir déplacé six cents tonnes d’autres déchets qui en gênaient l’accès. C’est un premier avertissement. Il n’y en aura pas d’autres.
« L’impossible incendie », titre L’Alsace du 11 septembre 2002. La veille, vers quatre heures du matin, les mineurs de l’interposte de nuit d’Amélie I, dont les galeries communiquent avec celles de StocaMine, sentent une odeur de brûlé, donnent l’alerte. On descend voir ce qui se passe. On mettra quelques heures à découvrir que ce sont les big bags du bloc 15 qui flambent. Le feu s’est déclaré à cinq cent trente-cinq mètres de profondeur, où sont entreposés mille huit cents tonnes de déchets. À treize heures, la dizaine de sapeurs-pompiers des MDPA remonte après avoir arrosé le foyer, remplacée par une équipe de spécialistes venus des houillères de Lorraine. À vingt et une heures, le feu est prétendu circonscrit. Le lendemain, il a redémarré de plus belle, s’est étendu. Décision est prise de procéder à un confinement du bloc 15. Des barrages sont mis en place pour réduire l’apport d’air. On suit la propagation du feu par caméra thermique à infrarouge. Mais impossible de le maîtriser. Le 23 octobre, plus d’un mois après le départ des flammes, le feu, de combustion lente, couve toujours, trente mille mètres cubes de gaz inerte d’azote sont injectés dans les puits. L’incendie est finalement déclaré éteint le 21 novembre.
C’est l’heure du premier bilan. Soixante-douze mineurs ont été intoxiqués. Ceux qui sont descendus pour éteindre le feu souffrent d’irritations cutanées, de vomissements. Une plainte contre X est déposée, une information judiciaire ouverte. Les mineurs demandent à ce que soient analysés les bleus de travail pour que l’on découvre la composition exacte des fumées inhalées, le juge d’instruction refuse d’abord, puis accepte. Dans les plis des vêtements, on retrouvera : dioxine, chrome, baryum, zinc. Par ailleurs, plus aucun mineur n’est descendu depuis le 10 septembre et l’incendie. Ils sont encore six cent quatre-vingt-huit salariés des MDPA. Chaque jour qui passe complique la reprise des travaux de forage, une mine à l’abandon est comme une forêt vierge, elle reprend vite ses droits. Là ce ne sont pas les racines qui se déploient ou la canopée qui fait l’ombre, mais les parois qui se délitent, les parements qu’on fragilise. Et le 7 janvier 2003, alors que l’arrêt de l’activité minière était prévue initialement en mars, qu’on avait envisagé une grande fête associant la population riveraine, deux mois de portes ouvertes, une mort douce et qu’on espérait belle, en tout cas digne, assumée, comme une euthanasie dans une clinique suisse, un accord d’entreprise signe la fin de l’exploitation. Les mineurs sont comme des clowns tristes ; on les envoie faire leur numéro ailleurs : peintres pour certains pour rénover les habitations des cités, guides à l’écomusée où ils assurent la restauration du matériel minier, alors que d’autres encore démontent les rails du réseau ferré MDPA pour dessiner de futures pistes cyclables - les comédiens rangeant eux-mêmes leur décor. Il y a un immense sentiment d’amertume, de gâchis. Plus grand-monde pour défendre StocaMine, dont l’incendie a tout autant sonné le glas. Le député UMP de la circonscription dépose le 17 juin 2003 un amendement opportuniste stipulant que « si le stockage n’a pas été alimenté pendant un an, le délai de vingt-cinq ans avant confinement peut être réduit à un an ». Pendant ce temps-là, la commission d’enquête sur les causes de l’incendie est au travail. Le 19 septembre 2003, elle rend ses conclusions, invoque un acte de malveillance : colère des mineurs. Pendant des mois, on réclame la vérité, on sait les négligences. Un an plus tard, le 9 septembre 2004, deuxième rapport d’enquête : l’hypothèse du mégot de cigarette est balayée, des manquements graves à la réglementation ont été identifiés. Dans le collimateur, des big bags frappés d’un A, pour « amiante », de ce fait interdits de contrôle à la réception, apportés d’Indre-et-Loire par la société Solupack, spécialisée dans la production de produits phytosanitaires, elle-même victime d’un incendie de son entrepôt le 23 mars 2002. Le 31 décembre 2004 sont décrétées simultanément les dissolutions des MDPA et d’EMC.
Reste StocaMine. Fin novembre 2007, quand s’ouvre le procès, au tribunal correctionnel de Mulhouse, les brûlures sont encore vives. « Sous les cendres la colère », titrent Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Du côté des parties civiles, soixante-quatorze mineurs ; sur le banc des accusés, seul le directeur à l’époque des faits, Patrice Dadaux. Les experts se succèdent à la barre, le procès, très technique, permet d’en apprendre davantage sur les circonstances du départ de flammes : des sacs d’engrais, de bouillie bordelaise, de soufre, contaminés par la chute du toit amianté de l’entrepôt lors de l’incendie de Solupack, conditionnés en big bags, descendus par StocaMine, puis qui auraient fermentés, se seraient auto-échauffés, jusqu’à atteindre 400°C, où le méthane dégagé aurait alors pris feu de lui-même, dans un phénomène d’auto-ignition. Des déchets ultimes donc, du fait de la présence d’amiante, mais pas inertes, ce qui était contraire au cahier des charges. Le procès révèle aussi que les déchets incriminés étaient dès leur arrivée apparus suspects aux yeux des mineurs et des salariés de StocaMine, humides et dégageant une odeur pestilentielle ; que des mises en garde avaient été adressées à la direction d’alors, dont celle-ci ne tiendra pas compte. L’ancien patron de StocaMine essaie de renvoyer à d’autres la patate chaude, de diluer les responsabilités, incrimine ses anciens collaborateurs. Cette phrase brillante : « Je n’étais peut-être pas bon, mais je n’étais pas le seul. » Le procureur dénoncera la gestion calamiteuse de la catastrophe, autant qu’une course effrénée à la rentabilité y ayant droit conduit. Dadaux sera condamné à quatre mois avec sursis. En appel, la peine sera ramenée à cinq mille euros d’amende. La commune de Wittelsheim essaiera d’obtenir réparation pour le préjudice d’image subi, mais sera déboutée en cassation. Fin de l’épisode judiciaire. Quarante millions de kilos de déchets sont encore en bas, sans que l’on sache très bien, maintenant, qu’en faire. C’est un peu encombrant.
Épilogue. Quatre scénarios de fermeture sont successivement envisagés. Le confinement de durée illimitée de tous les déchets ; le retrait du mercure sans manipulation de déchets amiantés ; le retrait de la quasi-totalité du mercure ; le déstockage de tous les déchets, hors bloc 15, inaccessible.
Le temps presse. En dépit des travaux menés par l’entreprise polonaise sous-payée - il en coûte cependant au contribuable quelque cinq millions d’euros d’entretien courant chaque année -, les conditions de sécurité du stockage vont se dégradant. Des opérations de soutènement des galeries doivent régulièrement être entreprises. Des parois s’effondrent. En somme, c’est un peu le Titanic sans les violons.
La direction de StocaMine, sans surprise, préconise le confinement de durée illimitée de tous les déchets, écrivant sans rire dans sa présentation PowerPoint à la Commission locale d’information et de surveillance (Clis), le 17 décembre 2012 : « Cette solution a été identifiée comme la moins pénalisante pour l’homme et l’environnement, à court et à long termes. » Pour la première fois depuis deux ans sont réunis autour de la même table tous les acteurs du dossier : entreprise, collectif d’associations, pouvoirs publics, sous la présidence du préfet du Haut-Rhin, lequel laisse le soin à la sénatrice socialiste, Patricia Schillinger, de relayer la bonne parole ministérielle, d’annoncer la décision qui vient d’être prise par Delphine Batho et Arnaud Montebourg, co-tutélaires du dossier : le déstockage ciblé de sept mille tonnes de déchets mercuriels, puis le confinement définitif des autres, et finalement la fermeture de la mine, d’ici à 2015. Décision qui ne satisfait personne, sauf la direction de StocaMine. Cent millions d’euros sont provisionnés pour cela dans la loi de finances 2013. On croit déjà deviner que ce ne sera pas suffisant.
Voilà l’histoire de StocaMine, petite et tue-l’amour, queue de comète de la très grande histoire des mines.