


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


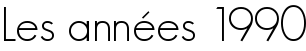
 |
|
|
Publié dans le
numéro 007 (juillet-août 2011)
|
[Voir l’introduction : Tentative de description des années 1990.]
Illustrations d’Isabelle Boinot.
5 avril
1994 : Kurt Cobain est mort
Ils sont « grunge ».
Crades. Pour faire chier leurs parents et les débiles du lycée, ils
mettent des vieux t-shirts, des jeans dégueulasses, troués, ils ne
se lavent plus les cheveux. Ça ne loupe pas : ils passent pour
des tarés. Ils se font virer de chez eux. Ça ne les dérange pas,
ils vivent à Seattle, enfin dans la banlieue, il pleut tout le
temps. C’est déprimant, la banlieue de Seattle. Ils sont un peu
paumés, ils prennent de l’héro. Ils font de la musique aussi :
une musique comme eux, violente, assourdissante, un peu branlante
aussi, on dirait qu’ils veulent déclencher l’apocalypse à
chaque concert, mais ils ne savent pas encore comment faire. Ils
choisissent de s’appeler « Nirvana », comme le paradis
des junkies et des hindous. Il y a d’autres groupes comme eux, à
Seattle, à Olympia, dans le coin, mais eux, ils ont lui, le
chanteur. Il a une voix incroyable. Certaines fois, on dirait qu’il
va se trouer le bide, et la fois d’après il chante une berceuse.
Et surtout, il est beau, très beau. On les remarque, forcément. Ils
commencent à vendre des disques, plein de disques : 30
millions. Ça ne les arrange pas, de devenir riches à crever. Lui,
il est toujours aussi dépressif, il prend toujours de l’héroïne.
Il trouve que le succès, c’est d’être aimé par des cons, des
types qui ne comprennent rien à ce qu’il chante. Une fois il a
fait une OD juste avant un concert, il a joué quand même. Quand ça
n’a vraiment plus rien voulu dire, le 5 avril 1994, il est rentré
chez lui, près de Seattle, et il s’est tiré une balle dans la
tête, avec son fusil. Bientôt, on va dire que c’est sa femme qui
l’a assassiné - n’importe quoi. Bientôt, on se coupera les
cheveux ; bientôt, on n’osera plus venir sur MTV en pyjama.
On portera des jeans troués pendant quelques années, en hommage
fétichiste au nouveau membre du « 27 Club », le club des
rockers morts six ans avant l’âge du Christ.

26 mai
1993 : L’Olympique de Marseille remporte la Coupe
d’Europe.
Cette fois-ci, Basile Boli n’a pas pleuré. Il
fait le geste, devant la caméra, à la fin du match : « Je
pleure pas ! Je pleure pas ! Je pleure pas ! »
La fois d’avant, en 1991, il avait pleuré, pourtant, des grosses
larmes, comme un grand garçon qui a cassé son jouet. Perdre en
finale, c’est toujours bête, mais perdre aux tirs au but contre
une équipe yougoslave alors que la Yougoslavie n’existe même
plus, franchement ? L’Étoile Rouge... Cette fois, c’est
Basile qui l’a mis, le but, et pas contre n’importe qui : le
Milan AC, le club du Cavaliere Berlusconi, le club d’Arrigo
Sacchi, le meilleur club du monde. C’est l’apogée de l’OM.
C’est aussi l’apogée de son président, Bernard Tapie, qui l’a
racheté en 1986. Il en a fait un « grand d’Europe »,
en faisant venir des joueurs à coups de millions, les millions qu’il
a gagnés en restructurant, revendant des entreprises, en magouillant
un peu, aussi, peut-être, mais bon, ça on n’en parle pas :
il a fait venir Papin, Francescoli, Mozer, Boli, Deschamps, Desailly,
Völler, Boksic, Waddle, et même Beckenbauer ! On ne peut pas
se plaindre. Pourtant, l’apogée, c’est le début du déclin, on
ne parle déjà plus que de « l’affaire ». Quatre jours
avant la finale de Munich, des joueurs de Valenciennes ont reçu de
l’argent pour perdre contre Marseille. Un couperet impitoyable va
tomber sur l’OM, la justice des jaloux, diront ses supporters :
privé de Coupe d’Europe, rétrogradé en 2e division.
Pour Tapie aussi, c’est le début de la chute. D’autres affaires
vont le rattraper : finie, la carrière politique de météore
mitterrandien, fini, le golden boy à la française. En 1996, Tapie
fait faillite et dort à la Santé.

1er
mai 1997 : les travaillistes remportent les élections générales
au Royaume-Uni.
Raz-de-marée travailliste en Grande-Bretagne.
Le New Labour de Tony Blair a 418 sièges aux Communes, 179 de
plus que les Tories, chassés du pouvoir après dix-huit ans.
En juin, en France, la « gauche plurielle » remporte les
élections législatives anticipées et joue un bon tour à Jacques
Chirac, contraint de nommer Jospin Premier ministre. En octobre 1998,
Blair et Jospin sont rejoints par Gerhard Schröder, dont le SPD a
battu la CDU de Helmut Kohl. La gauche domine l’Europe. Mais c’est
un trompe-l’œil. En Angleterre, The Sun, le quotidien de
Murdoch, a soutenu Blair. Cinq ans avant, il était farouchement
pro-Thatcher et se moquait de Neil Kinnock, ce socialiste à
l’ancienne. C’est que Blair a fait du New Labour une
grosse machine, une machine de com’ : son seul apport
conceptuel à la pensée politique contemporaine, c’est la « Cool
Britannia », dont le jeune Premier ministre se veut
l’incarnation. Il ne risque pas de déranger les financiers de la
City, lui qui déclare en 1998 à Paris, devant l’Assemblée
nationale, que « la gestion de l’économie n’est ni de
gauche, ni de droite : elle est bonne ou mauvaise »,
déclenchant des applaudissements sur les bancs du RPR. En France,
Jospin est moins cool : il y a même des communistes au
gouvernement. Cela ne l’empêchera pas de déclarer, cinq ans plus
tard, que son projet présidentiel « n’est pas
socialiste ». Et en Allemagne, Lafontaine, le « gauchiste »
du SPD, quitte le ministère de l’Économie dès mars 1999,
refusant d’avaliser l’énorme compression des salaires que le
chancelier Schröder s’apprête à mettre en œuvre. À la fin des
années 1990, la gauche européenne s’est « modernisée » :
elle a abandonné toute référence au socialisme et toute
interrogation sur l’économie de marché.
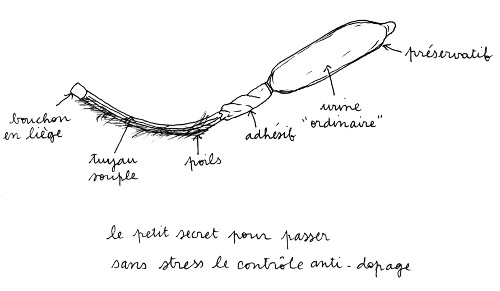
18 juillet
1998 : l’équipe Festina est exclue du Tour de France.
Le
18 juillet 1998
signe la mort du Tour de France. Quelques jours auparavant, la police
a intercepté à la frontière belge une voiture de l’équipe
Festina, dans laquelle elle a trouvé des centaines de doses de
divers produits interdits -
testostérone, hormones de croissance, érythropoïétine (EPO), etc.
Le soigneur, qui conduisait la voiture, a avoué l’existence d’un
réseau de dopage organisé, et accusé les coureurs d’y participer
sciemment. L’affaire fait entrer le cyclisme dans l’ère du
soupçon, et fait sortir le sport professionnel de la bulle où il
croyait pouvoir se maintenir. Le Tour s’arrête, le 30 juillet :
les coureurs ont mis pied à terre pour protester contre les
perquisitions de la police. Mais rien n’y fait, et le public, qui
soupçonnait bien que les gars soient « chargés »,
découvre que ce dopage « médicalisé » modifie en
profondeur les capacités physiologiques des sportifs. Toutes les
performances depuis le début des années 1990, celles d’Indurain
inclues, sont mises en doute, et plus jamais le Tour n’aura de
vainqueur incontestable, ni ne pourra prétendre à son statut
d’épopée nationale. Jamais on n’écrira à propos de Virenque,
ni d’aucun autre, des phrases comme pouvait en écrire Roland
Barthes à propos de Charly Gaul, en 1957 : « Charly
Gaul, bénéficiaire prestigieux de la grâce, est précisément le
spécialiste du jump
; il reçoit son électricité d’un commerce intermittent avec les
dieux ; parfois les dieux l’habitent et il émerveille ; parfois les
dieux l’abandonnent, le jump
est tari. Charly ne peut plus rien de bon. »
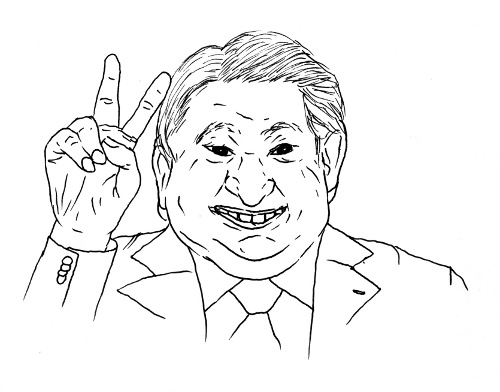
12 juin
1991 : Boris Eltsine est élu président de la Russie.
Boris
Eltsine, premier président démocratiquement élu de l’histoire de
la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Boris
Eltsine dictant sa loi à un Gorbatchev soudain démonétisé, ramené
au rang de représentant du Parti. Boris Eltsine juché sur un char,
sauvant la Russie du coup d’Etat des généraux conservateurs.
Boris Eltsine fossoyeur de l’URSS, en décembre 1991. Puis Eltsine
fait bombarder la Maison blanche - celle de Moscou, le bâtiment du
parlement. Eltsine envoie l’armée en Tchétchénie. Eltsine est le
pantin des « nouveaux Russes », des « oligarques »,
incapable de mener à bien la thérapie de choc des privatisations.
Eltsine fait éclater Bill Clinton de rire sur le perron de la Maison
blanche - celle de Washington. Eltsine est alcoolique ?
Eltsine subit triomphalement un quintuple pontage coronarien. Eltsine
pince les fesses de ses secrétaires devant les caméras. Eltsine est
malade, comme son pays, où l’on fait du troc en 1998, faute de
roubles. 1999, Eltsine démissionne : Eltsine demande pardon au
peuple russe. Vladimir Poutine prend sa place. Depuis, on ne rigole
plus en Russie.

21 juin
1995 : TF1 diffuse l’autopsie de l’extraterrestre de
Roswell.
Ce 21 juin 1995, Jacques Pradel tient un scoop
mondial, « peut-être la découverte la plus bouleversante
de tous les temps ». Pour le premier numéro de L’Odyssée
de l’étrange, émission consacrée aux phénomènes
surnaturels, l’animateur-star de TF1 a décidé de diffuser des
extraits d’un film-choc : l’autopsie d’une créature
supposément extraterrestre, dont l’engin spatial se serait crashé
à Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Le samedi 26, il diffuse le
film en entier ; entre-temps, l’hebdomadaire VSD fait
sa une sur « La 1re photo d’un
extraterrestre » et assure la promotion de l’émission.
Le film, en noir et blanc granuleux, montre un corps vaguement
humanoïde, à six doigts et sans nombril, charcuté par des
pseudo-chirurgiens en blouse blanche. Pour une émission diffusée à
20h50, c’est étonnamment dégoûtant. Le 23 octobre, polémique
oblige, Pradel rediffuse le film, entouré cette fois de diverses
cautions scientifiques (un « chirurgien international »)
et morales (monseigneur Di Falco). Bien sûr, Pradel se ridiculise,
son émission est arrêtée par TF1, et on apprendra, bien plus tard
(en 2006) que le film était un faux, habilement vendu aux
télévisions par deux escrocs. L’épisode traduit pourtant bien le
goût de l’époque pour le « paranormal », comme on dit
alors, et comme en témoignent le succès de l’émission Mystères,
toujours sur TF1, ou celui de X-Files. Ce goût de l’étrange,
du bizarre, du fantastique aussi, traverse toute la décennie, du
Dracula de Coppola (1992) au Sleepy Hollow de Tim
Burton (1999). Par-delà le comique pradélien, les années 1990 sont
aussi les dernières années gothiques.
20
septembre 1992 : le traité de Maastricht est approuvé par
référendum.
Un « petit oui » : 51,04 %, bien loin du
large assentiment espéré par François Mitterrand quand il choisit
de faire ratifier par référendum le traité de Maastricht, signé
par les chefs d’États européens en février 1992. La campagne
électorale décape les couches politiques superficielles, révélant
à l’air libre de vieilles strates oubliées. La coupe ne se fait
pas entre gauche et droite, entre socialistes et gaullistes :
elle traverse les partis. Si le PS fait bloc, tant bien que mal,
derrière le oui voulu par Mitterrand, le RPR se scinde entre les
« ouistes » (Chirac et la direction du parti) et les
« nonistes » dont Philippe Séguin, qui prononce
« masse-trique », devient le héraut. Il s’arc-boute
sur la défense de la souveraineté du peuple et de la nation,
déclarant devant l’Assemblée nationale, au cours d’un discours
de deux heures le 5 mai, que « 1992 est l’anti-1789 ».
Le non fédère une large partie de l’opinion, hostile à la fois
aux abandons de souveraineté et à l’horizon libéral fixé par
le traité. En face, le oui se veut moderne et consensuel, prônant
l’ouverture, la paix (alors que Sarajevo est assiégée), l’« Union »
européenne, que Maastricht substitue à la « Communauté » : la
position politique est faible, et le non est donné gagnant au mois
d’août. Le oui finit par l’emporter, Mitterrand s’engageant de
tout son poids dans le débat, et les médias dominants faisant tous
campagne en faveur de la ratification. Mais la scène est en place,
déjà, et se rejouera quasiment à l’identique en 2005 : les
battus, cette fois-là, feront semblant d’être surpris.
12 juillet
1998 : l’équipe de France de football remporte la Coupe du
monde.
Le 13 juillet 1998, L’Equipe
barre sa une d’un énorme « Pour
l’éternité », surmontant
une étrange photo où l’on peut voir Emmanuel Petit en
arrière-plan, les bras en croix, Youri Djorkaeff assis sur la
pelouse du Stade de France, en extase, les poings fermés, rejoint
par Zinédine Zidane, de dos, à genoux. Les
jours qui suivent sont propices à de nombreux et brutaux
retournements. Jusque-là, l’opinion moquait Aimé Jacquet, réputé
incapable, voire idiot : « un brave type qui émet des
soupirs », écrivait le quotidien sportif, donnant le
« la » à tous les médias nationaux. L’équipe de
France elle-même était généralement tenue pour « nulle »,
en tout cas incapable de gagner la Coupe du monde. En 1996,
Jean-Marie Le Pen pouvait encore dénoncer une équipe composée
d’« étrangers naturalisés » ; deux ans plus
tard, la communion est totale autour de la France
« black-blanc-beur ». Jacquet devient une sorte de roi
thaumaturge, capable de guérir les lépreux par imposition des
mains ; même l’arrogante Équipe doit faire
acte de contrition. Subitement, le football accède en France à un
statut qu’il n’avait jamais eu, celui de religion nationale. Tout
cela, bien sûr, est éphémère et récupéré par des politiciens
et des publicitaires avides de profiter de la ferveur populaire. Le
football, toutefois, devient une chose importante : les hautes
sphères le découvrent et cherchent à le comprendre, puisqu’il le
faut.
23 août
1996 : la police expulse les sans-papiers de l’église
Saint-Bernard.
Crrac, crrrac, crrrrrac : coups de hache
dans la porte de l’église. C’est l’aube, les mille cinq cents
gendarmes mobiles et CRS s’ouvrent la voie avec « humanité
et cœur », comme l’avait promis le ministre de
l’Intérieur, Jean-Louis Debré. Ils mettent vingt minutes pour
traverser la foule de militants qui campe devant l’église, dans le
XVIIIe arrondissement de Paris, avant de pouvoir y
pénétrer. À l’intérieur, environ trois cents étrangers,
Sénégalais et Maliens pour la plupart, dont dix font la grève de
la faim depuis cinquante jours, pour obtenir la régularisation de
leur situation administrative. Ce jour-là, il y a des caméras
partout, y compris dans l’église. Elles filment les CRS renversant
la dérisoire barricade de chaises érigée par les occupants du
lieu. C’est que la lutte des « clandestins » est
devenue un objet d’intérêt télévisuel, depuis que quelques
personnalités (on ne dit pas encore « people »)
soutiennent leur cause : Léon Schwartzenberg, l’évêque
Jacques Gaillot, et surtout Emmanuelle Béart, arrêtée aussi par la
police, vite relâchée. Les sans-papiers sont conduits au centre de
rétention de Vincennes. C’est la fin d’un triste feuilleton qui
les a menés de l’église Saint-Ambroise à Saint-Bernard en
passant par le gymnase Japy, la Cartoucherie de Vincennes, des
entrepôts de la SNCF. L’occupation des églises était un moyen de
manifester la dignité des sans-papiers sur un autre terrain que
celui de la grève# : à l’époque des lois Pasqua, puis de
leur durcissement par Debré en 1997 (qui autorisa la confiscation
des passeports des étrangers en situation illégale), Henri Coindé,
le curé de Saint-Bernard, n’a que ses yeux pour pleurer.
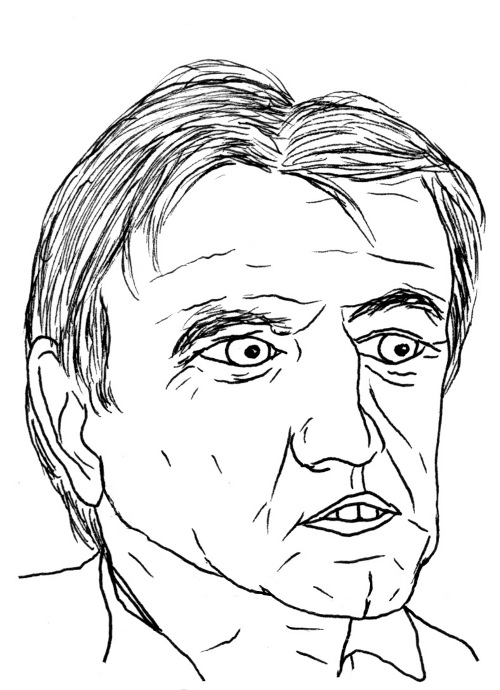
20 octobre
1992 : lancement de l’opération « Du riz pour la
Somalie ».
Triomphe des bons sentiments. Les petits
enfants de France viennent en aide à leurs frères somaliens :
l’opération, organisée dans toutes les écoles primaires, permet
de récolter 9300 tonnes de riz, rapidement acheminées vers la
Somalie en guerre, même si l’inaccessibilité du port de
Mogadiscio oblige les navires français à décharger leur cargaison
sur la plage. Le 4 novembre, les enfants de France sont remerciés
par un message de MM. Kouchner et Lang, respectivement ministre de la
Santé et de l’Action humanitaire et ministre de l’Éducation
nationale. Le 24 novembre, des écoliers des écoles primaires de la
rue Pyat et de la Major, à Marseille, assistent au chargement du riz
sur des navires en partance pour la Corne de l’Afrique : ils
peuvent suivre l’acheminement de leurs dons par Minitel. Bernard
Kouchner déclare : « Nous essayons de prendre le monde
sur nos épaules, mais c’est difficile. » En effet :
la guerre civile rend l’acheminement des vivres sur place, confié
à des ONG humanitaires, extrêmement problématique. Le 9 décembre,
les États-Unis lancent l’opération « Restaure Hope »,
sous mandat de l’ONU : 25 000 soldats débarquent. Le
succès initial est superficiel, l’opération se termine en fiasco,
les Américains évacuent la Somalie fin 1993, la guerre civile
continue, la famine aussi, et les enfants de France ne seront plus
appelés à « prendre le monde sur leurs épaules ».
8 juin
1993 : René Bousquet est assassiné à son domicile.
À
9h30, Christian Didier a sonné à la porte de René Bousquet, qui
lui a ouvert, au 34 avenue Raphaël, dans le XVIe
arrondissement. Il a sorti un revolver de son sac de sport et lui a
tiré quatre balles à bout portant. Bousquet est mort, il ne sera
pas jugé, éternellement présumé innocent des crimes dont on
l’accusait, lui qui avait dirigé la police française d’avril
1942 à décembre 1943, prenant ses ordres chez Heydrich et Himmler.
L’assassin est un type perdu, écrivain raté, à qui Dieu a
demandé de venger les juifs#.
On se demandait, justement, comment le juger, ce Bousquet, déjà
condamné en 1949 à la dégradation nationale mais amnistié en
1958 : faudrait-il rétablir la Haute Cour de la Libération ?
La cour d’assises suffirait-elle ? On n’aura pas besoin de
trancher. En 1994, la « jeunesse française » de
Mitterrand, telle que la raconte Pierre Péan, achève de faire
remonter la vieille vase puante de Vichy à la surface : et la
francisque, monsieur le président, lui demande Elkabbach ? Et vos
amitiés, douteuses, avec Bousquet ? On feint de découvrir,
avec quarante ans de retard, que l’histoire est complexe et pleine
de compromis honteux. Le 17 juillet 1995, Chirac à peine élu
reconnaît le rôle de l’État français dans la déportation des
juifs. En 1998, Maurice Papon, secrétaire général de la préfecture
de la Gironde en 1943, est condamné à dix ans pour crimes contre
l’humanité. En 1943, Bousquet, clope à la main et col de
fourrure, rigole en regardant l’objectif sous le regard goguenard
du SS-Sturmbannführer.
28
juin 1992 : François Mitterrand visite Sarajevo assiégée.
Le
voyage était tenu secret. La capitale bosniaque était assiégée
depuis le 5 avril par l’armée des Serbes de Bosnie, qui commencent
alors à la bombarder sans relâche. Le président de la République
a atterri à Split, en Croatie, et a poursuivi le voyage en
hélicoptère. Il est accompagné de son ministre de l’Action
humanitaire, Bernard Kouchner, et non de Roland Dumas, ministre des
Affaires étrangères. Il ne s’agit pas, pour la France, de
s’engager dans le soutien aux Musulmans de Bosnie, comme voudrait
l’y pousser un BHL qui les compare à des résistants face aux
« fascistes » serbes. Non, la France ne veut prendre
parti pour aucun des « belligérants », comme on dit au
Quai d’Orsay. Elle se contente de protéger les populations en
envoyant des casques bleus. Ce 28 juin, jour anniversaire de
l’assassinat de l’archiduc d’Autriche à Sarajevo en 1914,
Mitterrand rend visite à ceux qui contrôlent l’aéroport. L’année
suivante, il déclare, cohérent : « Il ne faut pas ajouter
la guerre à la guerre. » Le siège continue : le 22 juillet
1993, 3 777 obus tombent sur la ville. En 1994, BHL lance une « Liste
Sarajevo » pour les élections européennes, avec Léon
Schwartzenberg, Romain Goupil, Pascal Bruckner, André Glucksmann,
Michel Polac : Mitterrand est content, ça embête Rocard.

31 août
1997 : la princesse Diana meurt dans un accident à Paris.
Au bras du
prince Charles, Diana, dix-neuf ans, vierge protestante d’extraction
aristocratique, déploie la traîne de sa fastueuse robe blanche sur
7,6 mètres aux marches de la cathédrale Saint-Paul, sous les yeux
de 35 000 invités et de 600 millions de téléspectateurs. Quelques
années plus tard, Diana est sur le plongeoir d’un yacht, seule
au-dessus d’un océan, les jambes dans le vide, la tête un peu
penchée, son air de faon mélancolique. Le 30 août 1997, peu après
minuit, la Mercedes-Benz S 280 immatriculée 688 LTV 75 de Diana et
Dodi Al-Fayed, poursuivie par les paparazzi et lancée à 120
kilomètres-heure, va s’encastrer dans le treizième pilier du
tunnel de la voie Georges-Pompidou, sous la place de l’Alma. Le 6
septembre 1997, jour des funérailles de Diana, trois milliards de
téléspectateurs regardent Elton John chanter Candle in the Wind
à l’abbaye de Westminster. Un million de bouquets sont déposés
devant sa maison de Kensington Palace, et la police interdit l’accès
à son domaine familial d’Althorp, dans le Northamptonshire, car
les fleurs qui s’entassent sur les routes des alentours barrent la
circulation et menacent la sécurité publique. Dans les quinze jours
qui suivent, en Angleterre, le taux de suicide augmente de 17% par
rapport à la moyenne des années précédentes, et de 45% chez les
femmes de 25 à 44 ans. Le 6 janvier 2004, à la demande de Mohamed
Al-Fayed, une enquête judiciaire est ouverte à Londres sous le nom
d’Opération Paget, sur les accusations de complot exécuté par le
Secret Intelligent Service et impliquant le prince Philip, duc
d’Edimbourg. Avec un coût de quatre millions d’euros, c’est
l’enquête la plus coûteuse de l’histoire britannique. À ce
jour, Son Altesse Royale la princesse de Galles et comtesse de
Chester, duchesse de Cornouailles, duchesse de Rothesay, comtesse de
Carrick, baronne de Renfrew, Dame des Îles, princesse d’Écosse,
plus communément appelée Lady Di, reste la femme la plus
photographiée au monde.
22 juin
1994 : la France intervient militairement au Rwanda.
Le
21 juin 1994, Edouard Balladur, Premier ministre, écrit au président
de la République, François Mitterrand. « Nous sommes
tombés d’accord pour considérer que la France ne pouvait rester
passive devant le drame au Rwanda, parce qu’il s’agit de
l’Afrique, parce qu’il s’agit d’un pays francophone, parce
qu’il s’agit d’un devoir de morale. » Le « drame » ?
Le génocide a commencé depuis le mois d’avril. Les extrémistes
hutus au pouvoir organisent le massacre des Tutsis : il y a 10
000 morts par jour, tués à la grenade, à la machette, à coups de
gourdin. Balladur précise : il faut « limiter les
opérations à des actions humanitaires (mettre à l’abri des
enfants, des malades, des populations terrorisées) et ne pas nous
laisser aller à ce qui serait considéré comme une action coloniale
au cœur du territoire du Rwanda. » L’opération
« Turquoise » commence le lendemain : 2 500 soldats
entrent au Rwanda à partir du Zaïre voisin, pour sécuriser une
partie du territoire et protéger la population. Mais refusant de
s’engager dans la guerre civile (le FPR, l’armée des Tutsis en
exil, est entrée au Rwanda et va chasser les Hutus du pouvoir),
l’armée française protège, de fait, les génocidaires - elle a
toujours soutenu le régime du président Habyarimana, dont
l’assassinat a servi de déclencheur au massacre. Dans la « zone
de sécurité » française où le FPR n’a pas accès, le
génocide durera plus longtemps que dans le reste du pays.
25 juillet
1995 : un attentat fait huit morts à la station Saint-Michel à
Paris.
En décembre 1994, un avion d’Air France est détourné
par un commando du GIA (Groupe islamique armé) qui sème la terreur
en Algérie. Les quatre terroristes sont tués lors de l’assaut du
GIGN, après avoir exécuté trois passagers. En 1995, pendant
plusieurs mois de juillet à octobre, une série de huit attentats
fait huit morts et deux cents blessés en France. Sur les bouteilles
de gaz utilisées à la station Saint-Michel et sur la ligne TGV
Paris-Lyon, qui n’a pas explosé, la police trouve les empreintes
d’un certain Khaled Kelkal : un Algérien de vingt-quatre ans
qui a vécu toute sa jeunesse à Vaulx-en-Velin. Mauvais choix,
mauvaise vie, Kelkal vole des voitures, ou s’en sert pour des
braquages. En 1990, il a été condamné à quatre ans de prison
pendant lesquels il apprend l’arabe et l’islamisme. Lui ne sera
pas jugé, à la différence des « Algériens », Boualem
Bensaïd ou Rachid Ramda, qui a financé la campagne. Kelkal est en
cavale, la police le traque et la gendarmerie l’abat le 29
septembre 1995, près de Lyon. La fusillade est filmée par les
caméras de la télévision. On vend au public l’histoire d’un
enfant perdu de l’islamisme radical, mais c’est la guerre civile
algérienne qui s’est exportée brièvement en France cette
année-là, alors que l’Algérie sombre dans la « sale
guerre ». L’année suivante, les moines français de
Tibhirine, près de Médéa, sont retrouvés morts, sans qu’on
sache si c’est là l’œuvre du GIA, ou bien celle de l’armée
algérienne. Pour les attentats de 1995, le doute est identique.
27 juin
1997 : Philippe Gildas anime Nulle Part Ailleurs
pour la dernière fois.
Lancée en 1987 par Canal +, elle-même
créée quatre ans plus tôt, « NPA » fait figure pendant
quelques années de sommet de l’impertinence à la télévision et
marque le triomphe de « l’esprit Canal » auprès du
grand public. La formule est directement inspirée des talks-shows
américains, et si Canal + n’est pas la première à tenter
l’importation, NPA est plus réussie que ses concurrentes des
grandes chaînes généralistes. L’animateur, régulièrement moqué
par ses chroniqueurs, est un maître en autodérision doublé d’un
expert en passage de plats. L’émission mêle en effet séquences
de débats classiques, avec écrivain/acteur/chanteur/etc. en
promotion, et sketches plus ou moins loufoques interprétés par les
Nuls, Antoine de Caunes (dans les rôles restés célèbres de
Ouin-Ouin, dit « Pine d’Huître », ou Didier
l’Embrouille), les Deschiens ou les Guignols de l’Info. En 1994,
on y trouve même une des rares critiques frontales du régime
balladurien : le Zérorama, dans lequel Karl Zéro traite
l’actualité politique dans la forme, le ton et l’esprit de la
propagande vichyste. Après le départ de ses principaux
protagonistes, l’émission tourne à vide. L’« humour
Canal », fondé sur le principe de la mise en abyme de la
nullité des auteurs, devient sa triste caricature avec la troupe des
Robins des Bois, et une valse de formules et d’animateurs venus des
généralistes ne parvient pas à enrayer la chute d’audience du
NPA nouveau (Guillaume Durand, Nagui). L’émission est arrêtée
par Canal + en juin 2001.
23
juillet 1993 : organisation du premier teknival français à
Bresles, près de Beauvais.
Comme le tennis et le bœuf à la
sauce à la menthe, les teknivals et autres free parties
viennent d’Angleterre. Les premiers sounds systems à
« poser du son » en plein air, et non plus dans les
clubs, sont londoniens : le collectif Spiral Tribe, dès octobre
1990. En mai 1992, ils attirent entre 20000 et 40000 fêtards à
Castlemorton. La police, jusque-là plutôt tolérante, commence à
interdire ces rassemblements : la drogue sert de prétexte et
effraie l’opinion. Les Anglais passent alors de l’autre côté de
la Manche et font de la France la terre d’élection des premières
parties continentales. Événements musicaux qui voient
l’explosion et la démocratisation de la musique électronique, les
free parties, à la différence des raves (payantes et
encadrées), sont autant de tentatives de création de « zones
autonomes temporaires », où règnent la gratuité et l’esprit
communautaire. Sans Internet et avant la généralisation du
téléphone portable, les organisateurs laissent des messages sur des
boîtes vocales, distribuent des tracts afin de garder secrets les
lieux de rassemblement. Le mur de son était une école de la
clandestinité et de la liberté.
17 juillet 1993 : sortie de Debut, de Björk
Debut est un
faux début car Björk a déjà sorti Björk, son premier
album solo, à 11 ans – aboutissement d’années d’études de
chant, de piano, de flûte à bec et d’électroacoustique de
Stockhausen, et gros succès en Islande. N’empêche : Debut,
c’est la claque. Les popeux (fans de Blur, Suede, Pulp, et leurs
ancêtres les Smiths et les Charlatans) sont sidérés par la voix
rocailleuse et les synthés cristallins de Venus as a boy ;
les adeptes de techno, secoués par le bit house tonique de Violently
Happy. On croise alors dans les rues des grandes villes des
jeunes filles en robes de geishas punks, avec des paillettes aux
coins des paupières, comme dans le clip de Human Behaviour.
Seuls les nostalgiques de rock alternatif bien de chez nous (Noir
Désir, Mano Negra, Bérurier Noir) nient en bloc, comme la Lolita de
Tostaky. Björk, c’est une voix unique, un son inédit, un
choc esthétique. Suivront d’autres disques, Post en 1995,
Homogenic en 1997, et d’autres collaborations (avec Tricky
et le maestro de la musique électronique Howie B., avec l’orchestre
symphonique d’Islande et Raimundo Amador, le virtuose de la guitare
flamenca, avec Thom Yorke de Radiohead). La diva inuit est en
perpétuelle mutation, vêtue de papier mâché fushia puis de
kimonos futuristes, elle devient androïde, puis femme-oiseau…
Jusqu’à sa métamorphose en cygne pour l’album Vespertine.
Elle rafle la Palme d’or à Cannes pour son rôle dans Dancer in
the Dark de Lars von Trier, elle épouse un artiste conceptuel
américain, et les Guignols de l’info la contrefont désormais en
ogresse rugissante, ou Yoko Ono délirante. Nous sommes à l’orée
des années 2000, et Björk ne fait plus danser personne.

1er mai 1993 : Pierre Bérégovoy se suicide.
Le 1er mai 1993, un ancien ouvrier,
diplômé d’un CAP d’ajusteur et d’un autre de dessinateur
industriel, se donne la mort. Il venait de perdre son poste de
premier ministre. Le suicide de Pierre Bérégovoy marque le terme
définitif des années Mitterrand autant qu’il résume ses
impasses. La méritocratie triomphante d’un ouvrier devenu premier
ministre est ternie sur le tard par des affaires d’argent : un
prêt consenti par Roger-Patrice Pelat, un ami de Mitterrand, ainsi
que des aides directes ou indirectes. Mais cet épisode final
(l’affaire ne sortant dans la presse qu’en février 1993, peu
avant les élections législatives que les socialistes vont perdre),
s’il est sans doute à l’origine du geste désespéré de
Bérégovoy, n’est qu’un épiphénomène par rapport à ce
qu’aura représenté l’orthodoxie du « franc fort »
dans la désaffection des Français. En liant le franc au deutsche
mark, alors que l’Allemagne avaient des taux d’intérêt très
élevés pour cause de réunification, Bérégovoy, ministre des
finances depuis 1988, a privilégié une logique monétariste à la
possibilité d’une reprise par l’activité. Un peu comme si
Milton Friedman était de gauche, et Keynes un libéral... Si la
classe politique fut, à raison, traumatisée par la mort
spectaculaire de Bérégovoy, il n’était pas besoin de convoquer
les « chiens » comme le fit Mitterrand, qui aurait été
plus inspiré de passer un peu plus de temps avec son ancien premier
ministre après la défaite du PS.
18 mai 2000 : Boo.com fait faillite.
Ce 18 mai 2000, les 120 millions de dollars investis par des gens a priori sérieux (Bernard Arnault, Alessandro Benetton, ou la banque JPMorgan) sont perdus à tout jamais : boo.com, qui vend des habits sur internet, vient de faire faillite. Cet échec retentissant marque le début de l’explosion de la bulle internet, qui avait gonflé de manière démesurée pendant les cinq années précédentes. Durant ces glorieuses années, on ne jure que par les start-up, ces jeunes entreprises qui lèvent des capitaux gigantesques grâce à deux ou trois graphiques démontrant que les NTIC (nouvelles technologies de l’information) vont rapporter gros. Or elles rapporteront gros, mais pas aussi vite que prévu. À la fin des années 1990, la connexion à internet se fait encore par téléphone, avec un modem : c’est lent. Les navigateurs internet ne sont que moyennement stantardisés. Ce qu’on voit sur l’ordinateur du graphiste (plein de superbes animations qui se chargent très vite) n’a rien à voir avec ce qui s’affiche chez les gens. Chez Boo.com, on a beau avoir 400 salariés, on fait un site qui ne marche pas sur Mac, et dont les pages mettent un temps fou à charger sur PC. On a beau avoir 7 langues possibles, 18 pays couverts, on a beau avoir fait une gigantesque campagne de communication, on a beau avoir choisi un nom avec un plein de « o » comme la doxa de l’époque le dicte, on attend en vain les clients. Au bureau londonien, trois personnes sont là pour prendre les commandes au téléphone : il y en a 15 par jour... Au bout de quelques mois d’activité, boo.com n’aura réalisé que 1,3 millions de dollars de recettes (1% de son investissement). Licenciements en série et réduction des coûts viennent trop tard : boo.com ferme boutique. Tous les perdants de cette époque diront plus tard : on avait eu raison trop tôt. Ce n’est qu’à moitié vrai : en 1998, en même temps que boo.com, une autre petite start-up est fondée, qui sera toujours là treize ans plus tard. Elle s’appelle Google.

15 décembre 1995 : Alain Juppé retire sa réforme des retraites de la fonction publique.
Il y a déjà un président pour
expliquer qu’il fallait choisir « la voie des réformes ».
Un premier ministre attaché à la réduction des déficits. Un
ministre expliquant que si on ne fait rien, le régime de retraite
sera « en faillite ». Mais, à la différence de 2003 et
de 2010, en 1995 la victoire va être du côté des grévistes. D’un
point de vue stratégique, d’abord : le 15 décembre, après
trois semaines de grève massive, notamment dans les transports,
Alain Juppé retire sa réforme de la retraite des régimes spéciaux
(RATP, SNCF) et de la fonction publique. D’un point symbolique,
surtout : depuis 1968, on n’avait pas connu mouvement si vaste
donnant au pays une autre allure, un autre rythme. Dans les villes,
les gens sont forcés de se parler, de s’organiser. On fait du stop
dans Paris, et on est pris ! Une sorte d’état d’esprit
convivial donne à l’ensemble une allure joyeuse, même si les
habituelles « élites » libérales médiatiques
(Giesbert, Minc, Duhamel) pestent contre le « racket social »,
le « goût du spasme » ou la « grande fièvre
collective ». D’un point de vue politique, enfin, cet épisode
parviendra à affaiblir durement le gouvernement Juppé, qui ne s’en
relèvera jamais, poussant finalement Chirac à la dissolution de
1997. Un Chirac qui, plus que toute autre, aura vécu l’année 1995
comme une période d’intense girouette : élu grâce à
l’évocation de la fracture sociale, acceptant au bout de quelques
mois de faire du Balladur, et faisant finalement machine arrière.
Humour de corrézien, sans doute...