


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


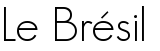
 |
|
|
Publié dans le
numéro 026 (Février 2013)
|
Quatrième épisode d’une série sur les bars, qui emmènera l’auteur sur les routes de France : le récit, qui s’appuie sur une journée complète passée sur place, obéit à dix contraintes cachées, répétées d’épisode en épisode, et qui seront dévoilées à la fin.
Episode 4.
12, avenue de Penhoët, Saint-Nazaire, Loire-Atlantique
En arrivant à Saint-Nazaire, je ne me suis pas installé tout de suite au Brésil. J’ai d’abord fait le tour du port en voiture. J’ai vu la base des sous-marins construite en 1941 par les Allemands ; j’ai vu l’énorme statue construite en l’honneur des Américains de 1917, et j’ai stoppé devant le monument du commando anglais de 1942. Les cafés donnant sur la mer s’accordaient quelques jours de vacances en plus ; il y avait juste quelques vieux qui prenaient la lumière, assis sur des bancs. Je suis remonté dans ma voiture et j’ai continué autour du bassin de Saint-Nazaire, qui est le premier bassin du port, avant celui de Penhoët ; entre les deux il y a la forme-écluse Joubert qui est une des plus grandes cales sèches du monde et qui fut construite pour le Normandie au début des années 1930. Je suis passé devant les écluses vertes et bleues, devant les citernes en jaune mal lavé, devant de grandes affiches où l’on voit Tintin et le capitaine Haddock dans Les Sept Boules de cristal, venus à Saint-Nazaire enquêter sur l’enlèvement du professeur Tournesol, disparu après s’être paré du bracelet de la momie de Rascar Capac. Le capitaine était déçu de son voyage à Saint-Nazaire : « Tout compte fait, nous ne sommes guère beaucoup plus avancés », disait-il sur l’affiche. Mais moi, ça allait bien : alors je suis reparti vers le bassin de Penhoët, et après un ou deux kilomètres j’ai fini par arriver devant l’entrée des Chantiers de l’Atlantique, qui s’appellent maintenant STX France parce qu’ils ont été rachetés à Alstom par Aker Yards, une entreprise norvégienne, en 2006, et Aker Yards par STX, une entreprise coréenne, en 2008. Sur l’immense portique au-dessus de la grande forme de construction, qui peut déplacer des pièces de 750 tonnes, on lit simplement « STX ». C’est moins majestueux que le « Chantiers de l’Atlantique » qui y figurait avant et qu’on pouvait voir en contrebas de l’immense pont qui survole l’estuaire de la Loire. Ce jour-là, le 2 janvier 2013, ce n’était pas l’activité des grands jours aux Chantiers : les parkings étaient un peu vides. Je me suis arrêté quelque temps devant un bateau en cours d’armement dans le bassin de Penhoët (au fait, on prononce « pin - wèt ») : l’Europa 2. Des gens venaient le voir et le prendre en photo ; on voyait à l’intérieur travailler quelques ouvriers casqués. Plus tard, j’ai appris que l’Europa 2 a été mis à flot le 5 juillet 2012, qu’il fait 225 mètres de long, 26,7 mètres de large, qu’il présente une jauge de 39 500 tonneaux, et qu’il sera livré en mai 2013 à son commanditaire, la compagnie allemande Hapag-Lloyd Cruises, qui veut en faire « une référence pour la croisière de luxe ». L’Europa 2 bien observé, j’ai terminé ma promenade en me garant devant le Brésil, que j’avais déjà remarqué. La concurrence était maigre : le Lafayette était fermé et à vendre, de même que le Norway (je me dis que le propriétaire de ce bar-là devait être bien ironique pour appeler ainsi son établissement, mais peut-être était-ce une simple marque d’affection et de fidélité au grand navire qu’on avait construit là, quel que soit son nom dont on se fiche bien, finalement c’était toujours le même bateau) ; le Ralliement était en congé, et seul le Rugby-Bar aurait pu me détourner du Brésil, avec son air de ne pas avoir été refait depuis 1976 et son enseigne indiquant qu’on y servait de la 33 Record (il faudrait cartographier les bars servant de cette bière lourde, assommante, et on verrait peut-être apparaître une belle constellation des quartiers populaires et/ou interlopes de la France des années 1970). Mais non : j’avais décidé que je ne trouverais jamais mieux qu’un café avec un nom pareil, avec sa devanture aux couleurs bleu, vert, jaune, éclatantes, presque devant l’entrée des Chantiers, attendant les premiers travailleurs de l’année 2013. La viande à kebab rôtissait déjà lentement.
J’entre au Brésil vers dix heures. C’est tout simple : à gauche, il y a une grande salle au décor minimal - des affiches de navires récemment construits à Saint-Nazaire, deux grands miroirs. Les chaises et tabourets sont métalliques, rouge sombre, avec une assise molletonnée. Il n’y a pas de musique, pas de radio, seulement, quand ils seront là, le bruit des hommes qui discutent. Le bar est peint en gris et en rouge, c’est tout neuf : les habitués découvrent tour à tour le nouvel habillage, et s’ils ne le remarquent pas d’eux-mêmes, c’est Chantal, la patronne, qui le leur fait remarquer. À droite, il y a une petite cuisine, qui donne sur le bar et sur la rue. Comme ça, le Brésil est à la fois une petite brasserie et une sandwicherie où l’on peut venir chercher son kebab ou son américain. Yvan, non pas le patron mais le « mari de la patronne », est le maître de l’office. Deux petits avis scotchés au-dessus de son entrée confirment les deux qualités d’Yvan : on lit sur le premier « INTERDIT de me faire chier » ; et sur le second « CHANTAL s’en charge déjà ». Les grandes fenêtres donnent sur une terrasse au-dessus de laquelle l’auvent bleu a été déployé, parce qu’il fait très beau ce matin-là sur Saint-Nazaire, un beau soleil d’hiver qui fait de grandes ombres aux bâtiments et aux gens ainsi qu’à deux chiens qui jouent sur le parking désert, pendant que leur maître, un colosse chauve, tire sur sa cigarette. De la terrasse on pourrait sans doute voir tout le bassin de Penhoët et son kilomètre de long, si un blockhaus laissé là par la Kriegsmarine n’obstruait le panorama ; à gauche, un navire de la Marine nationale est en travaux dans la forme de radoub numéro un. (Sur sa coque, le code « A753 ». Le site Internet de la Marine me dit qu’il s’agit du Chacal, un bâtiment-école de la classe Léopard, sauf qu’il ne ressemble pas du tout au navire que j’ai vu à Saint-Nazaire. Ça doit en être un autre.) Un peu plus loin, les hangars bleu et blanc des Chantiers. Aux extrémités de la terrasse, le drapeau peint du Brésil est surmonté de la mention « Grillades - Brasserie ». À l’intérieur je commande un café que je bois dehors. Nous sommes quatre : il y a un autre client (un monsieur moustachu à l’air doux qui lit Ouest-France, journal dans lequel j’apprends, plus tard, qu’un couple venu de Roumanie va ouvrir une pizzeria tout près d’ici, rue de Trignac, et qu’on y trouvera même des spécialités de leur pays), et puis il y a Chantal et Yvan.
Vers dix heures trente, la camionnette blanche d’une entreprise de plomberie, chauffage et électricité se gare devant le Brésil. « Ça alors Sylvain, tu travailles aujourd’hui, toi ? » En sortant de son véhicule Sylvain salue tout le monde d’une poigne ferme, moi y compris, en nous adressant ses meilleurs vœux. Non, il ne travaille pas aujourd’hui, il est encore en vacances. C’est un peu la même chose aux Chantiers, et sur le port en général. Mais « j’ai fait du café ce matin, c’est bon signe », dit Chantal, signe que les travailleurs sont là, et vont revenir demain, pour ceux qui traînent encore. Et puis, surtout : « Ça va aller, 2013, avec le bateau, là. Les gens vont reprendre le moral. » Cinq jours avant, le 28 décembre, la direction de STX France a annoncé une nouvelle extraordinaire : un navire de 360 mètres de long et 60 de large, un monstre de la classe Oasis dont il sera le troisième exemplaire lorsqu’il sera livré en 2016, a été commandé aux Chantiers par la Royal Caribbean Cruise Line. Ce sera le quatrième plus gros paquebot du monde construit à Saint-Nazaire après le Normandie, en 1935, le France, en 1962, et le Queen Mary 2, en 2003. Alors ça va bien, oui, et tout le monde en parle, comme d’un bon augure et d’un réconfort mérité après plusieurs années inquiètes, sans rien à construire ou pas assez en tout cas pour embaucher les intérimaires et ne pas réduire la charge de travail. Alors, ça va bien, vraiment bien, on continue de se donner des meilleurs vœux, et comme dit l’un des deux jeunes gars en tenue de travail qui viennent vers onze heures commander leur kebab : « Santé, prospérité », mais surtout : « Du cul, du pognon ! » ajoute l’autre. « Soixante-six mètres de large il va faire le nouveau ! Ils vont devoir changer le portique, même ! » (Un portique plus grand, et pouvant lever 1 250 tonnes, m’apprend Mer et Marine.) « En tout cas, dès que les travaux commenceront sur le bateau, hop ! licenciement à l’amiable et je vais à la boîte d’intérim toucher mes 2500 net. Ho ! »
Un autre client, plus âgé :
- Salut !
- Déjà là ?
- Ouais. Le mec qui démarre toujours à fond. Comme a dit Hollande : je regarde vers l’avenir. Bon, vous êtes contents, vous, vous allez avoir un beau rafiot ? Allez, un kebab. Ouais ouais, c’est ça, le régime du début de l’année.
À midi, les hommes sont là. En combinaison pour la plupart, arborant les écussons des entreprises qui les emploient : MAN (propulsion navale), Idea (prestataire en logistique industrielle). Sur la veste, ils ont leur nom, pas leur prénom. Les hommes des Chantiers ne sont pas là, eux : c’est parce que STX dispose d’une cantine ; j’aurais dû venir le vendredi pour les voir, parce que leur cantine est fermée le vendredi, me dit Chantal. Ici, c’est le règne de l’industrie. Une camaraderie masculine au sein de laquelle tous se tutoient, bien sûr : j’ai signé mon étrangeté dès le début en vouvoyant le patron qui ne m’en a pas voulu, je crois, bien que Chantal m’ait dit qu’il s’était demandé ce que pouvait bien faire là ce type avec son bloc-notes. J’ai dû me dévoiler pour ne pas sembler trop étrange et surtout pour me sentir plus à l’aise au milieu des hommes qui mangeaient leur américain à la sauce samouraï et qui me faisaient de l’humour, un gars de chez Idea avec l’accent de Marseille discutant avec moi puisque j’étais là, au bar. Il y a aussi un mec musclé, râblé, chauve, à l’air dur, un tatoué, et il me fait penser à mon grand-père, le père de mon père, un tatoué lui aussi. À vrai dire, j’y aurais pensé sans le tatoué, à mon grand-père que je n’ai pas connu parce qu’il est mort vingt-trois ans avant que je naisse. En venant à Saint-Nazaire, je fantasmais les cafés où mon grand-père filait tout droit en sortant de l’arsenal de Lorient où il travaillait comme menuisier-charpentier dans les années 1950 et 1960, « l’Arsouille », comme on disait du temps que la ville grouillait de marins et d’ouvriers des arsenaux de la Marine. En ce temps-là, les patrons des cafés de Lorient préparaient la sortie des ouvriers en alignant sur le comptoir des fillettes de vin rouge et des galopins de bière, tout prêts à étancher la soif des travailleurs, dont celle de mon grand-père qui, paraît-il, avait souvent très soif. Mais après tout c’était bien dans leur hymne, aux « apprentis des constructions navales / Nous aimons l’amour et le bon vin ! », un hymne dont je connais la moitié du refrain, parce que mon père le fredonnait, et le fredonne toujours (Google me rappelle la suite : « Et le bon vin sans détester les femmes / Voilà l’refrain, des apprentis du vin ! »). C’était donc à Lorient que je voulais aller, moi, et non à Saint-Nazaire, avant que je ne réalise qu’à Lorient tout cela était mort et que je n’y trouverais rien. La nouvelle du 28 décembre - la commande du grand paquebot - me fit penser que, si je voulais rencontrer les successeurs de mon grand-père, c’est-à-dire des ouvriers de l’industrie navale, c’était à Saint-Nazaire et presque nulle part ailleurs en France que je les trouverais. C’était un peu illusoire, comme idée, et même un peu bête ; ces hommes-ci n’ont pas grand-chose à voir avec celui auquel je pensais, si ce n’est d’avoir en commun un métier dont ils sont visiblement fiers, ou peut-être plutôt, celui d’être heureux d’avoir un métier dont le résultat concret, des grands navires qu’on lâche dans l’océan, rend fiers leur femme, leur famille et leurs enfants, un truc dont mon père m’a parlé, lui qui se souvient encore aujourd’hui être monté aux bras de mon grand-père dans un paquebot qui s’appelait le Ville de Tunis, qui fut lancé en mars 1952, aux chantiers de Lorient, et c’est émouvant que Wikipédia confirme et précise les souvenirs ressassés de mon père qui était alors un enfant de quatre ans. Au Brésil, je devine quelque chose comme ça dans les conversations qui, quand on ne se fout pas tout simplement des collègues qui ne se remettent pas de leur gueule de bois de la veille, roulent immanquablement sur le « rafiot », le « paquebot », ou plus simplement le « bateau ». Dehors, tout seul, il y a un ouvrier à l’air indien qui a posé son casque sur la table et qui mange, en silence ; il regarde, de temps à autre, à l’intérieur du café où nous sommes. Je me demande quelle vie il a, s’il est étranger et parle mal français, s’il est seul ici, ou solitaire aujourd’hui, s’il a mal aux cheveux, lui aussi, mais son regard ne me renseigne pas.
À Chantal, la vraie patronne (le bar est à son nom), je me suis donc un peu révélé : j’écris des articles sur les bars de France. Ou la France des bars, comme vous voulez. Ça m’a permis de lui poser quelques questions, et d’abord : c’est un joli nom, le Brésil, pourquoi votre café s’appelle-t-il le Brésil ? Elle m’a répondu, et Yvan un peu plus tard, qu’il s’était toujours appelé comme ça, et même trente ans avant, il s’appelait déjà comme ça. Eux ils avaient repris le café en mai. En fait, me dit Yvan, ça grouillait de Brésiliens ici. Ah bon ? Eh oui : le port de Saint-Nazaire, c’était la tête de ligne de la Compagnie générale transatlantique vers les Antilles, le Mexique, le Brésil et Panama. Les paquebots et les cargos déchargeaient là, dans les entrepôts du bassin de Penhoët, aménagé en 1881, et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale qui interrompit définitivement les lignes transatlantiques à Saint-Nazaire, leurs cargaisons de café, de cacao, de fruits et de tabac. Aujourd’hui, il n’y a plus de Brésiliens, me dit Yvan, mais il y a toutes les nationalités quand même : des Italiens en ce moment, pour le MSC Preziosa, un paquebot de 333 mètres de long et 140 000 tonneaux, et des Russes bientôt, pour les deux porte-hélicoptères que la France leur a vendus. Yvan me dit : « Y en a que ça dérange, que les Italiens et les Russes viennent sur le chantier... Il y a quatre cents Russes qui vont venir, cette année... Mais moi je trouve ça normal, non, c’est leurs navires, c’est eux qui payent... De toute façon, ce qu’il y a de bien, ici, c’est qu’il y a toutes sortes de gens. Des ouvriers, des routiers, des cadres, parfois des très hauts cadres qui viennent manger chez nous. C’est ça qui nous sauve, d’ailleurs, nous : de pas dépendre que des Chantiers. »
À quatorze heures, c’est déjà fini. Tous les ouvriers sont repartis - certains pas pour grand-chose, ce 2 janvier : « Oh, on a vingt minutes de boulot cet après-midi, après je sais pas ce qu’on va faire ! Se regarder rien foutre, je pense », me dit le gars de chez Idea. Il ne reste plus, à la terrasse, que les commerciaux de chez Thermoplast, en costume, du genre bien raide avec cravate violette, qui se racontent leur formation récente à Strasbourg. Ils tirent sur leur cigarette et commandent des cafés. Le prochain pic est à quinze heures, à l’heure de la « débauche », comme on dit ici. Mais aujourd’hui, il n’y aura pas grand-monde.
En repartant, je remercie mes hôtes pour l’accueil et je leur souhaite moi aussi une bonne année. Je longe la Loire et le port industriel. C’est une terre toute plate, humide, parsemée de marais entre lesquels paissent des vaches. Sur ma droite, il y a les réservoirs géants du terminal pétrolier, et plus loin, la grande raffinerie de Donges, qu’on voit illuminée la nuit quand on est en face, à Paimbœuf. En arrivant le matin, j’avais vu le Béluga, l’avion-cargo d’Airbus, décoller juste devant moi, tout blanc, énorme et disgracieux, de l’usine de Saint-Nazaire. Alors que je m’en vais, je vois un énorme essaim d’étourneaux posés sur la route ; ils s’envolent à chaque fois qu’un camion passe, et se reposent un peu plus loin. Ma Twingo légère ne les effraie pas plus, et ils me font un noir nuage d’adieu que je contemple par le toit ouvrant.