


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


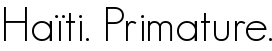
 |
|
|
Publié dans le
numéro 002 (Février 2011)
|
Il y a un peu moins d’un an, Nicolas Garrigue se rendait pour le compte de L’ONU en Haïti, à Port-au-Prince, peu de temps après le tremblement de terre. Voici son récit, écrit à l’époque.
28 mars 2010 Bureau du Premier ministre, Port-au-Prince
Je remonte péniblement les dernières marches qui mènent au parking. Le bureau annexe de la Primature dont je reviens - le seul qui soit utilisable aujourd’hui vu les dégâts occasionnés par le séisme au bâtiment principal -, une vaste et massive villa de style méditerranéen, se trouve au fond d’une ravine, dans un torrent de végétation luxuriante. J’aime bien y aller, juste pour le plaisir de prendre un bain de verdure et d’écouter le chant des oiseaux qui continuent, imperturbables, à couvrir le brouhaha de la ville meurtrie de leur pépiement extravagant. J’en profite doublement car le sort a voulu que je me retrouve, pour mon retour dans la galaxie onusienne, après dix-huit mois d’interruption et de lent détricotage du souvenir de Bagdad, de nouveau sur une base militaire poussiéreuse, torride, survolée d’hélicoptères, coupée de la ville et déshumanisée...
Aujourd’hui, l’interlocuteur du gouvernement que j’étais venu rencontrer, M. Borgès, homme haut en couleurs, intellectuel fantaisiste, portant allègrement chemise fleurie et barbe blanche de patriarche, au français impeccable et alambiqué, avait oublié notre rendez-vous. Il n’a pu me voir que cinq minutes, le Premier ministre l’attendant pour une réunion. J’ai donc fait demi-tour, repris l’ascension vers le parking, gravissant les marches une à une, lourdement, encore pris dans les limbes du sommeil, surtout après une nuit de touffeur dans ma tente sans air... Je passe en remontant le long escalier sous les lourdes frondaisons des manguiers, près d’une école improvisée : quelques gamins assis sur des grosses pierres ou à même le sol, un maître écrivant sur un tableau noir rescapé d’une des milliers d’écoles effondrées, et suspendu à un mur de pierre. Les enfants répètent à voix haute les mots écrits en grandes lettres déliées par le maître. Les manguiers leur fournissent une ombre salvatrice face à l’implacable soleil du matin. Sous les autres arbres du grand parc de la Primature, à quelques dizaines de mètres de là, une marée de tentes disparates, serrées les unes aux autres. Le parc a été converti en camp de déplacés du séisme, dans un signe inattendu de solidarité du pouvoir politique face au désarroi des petites gens ayant perdu leur habitation et leur source de subsistance, le 12 janvier 2010, à 16h59. Ce pouvoir qui en général ne les voyait pas, réfugié derrière ses ministères labyrinthiques et ses palais entourés de hautes grilles, le voilà qui a fait preuve d’une mansuétude peu courante. Peut-être le Premier ministre a-t-il été influencé en cela par le geste similaire de l’ambassadeur de France, à quelques encâblures, qui a laissé, durant quelques semaines, les errants camper sur les pelouses de sa résidence - elle-même rendue inhabitable. Malgré tout, et malgré mon sarcasme, c’est un geste important. Imaginons seulement un instant les jardins de Matignon ou de l’Élysée ouvert aux réfugiés d’une improbable catastrophe naturelle touchant Paris. Ceci dit, il pourrait tout aussi bien s’agir de laisser s’y installer les milliers de sans-logis qui se rappellent à notre bon souvenir chaque hiver...

Il me faut patienter sur le parking que mon chauffeur revienne, à l’heure initialement prévue. Il est reparti chercher de l’essence à l’autre bout de la ville, après m’avoir déposé pour mon rendez-vous qui n’en était pas un. Je n’ai pas son numéro de portable. Me voilà donc pris dans une attente impromptue, de celles qui donnent au temps une consistance charnue. Je m’assieds sur le rebord d’un muret qui sépare le parking - occupé de nombreux 4×4 portant un sigle d’organismes internationaux, d’ambassades, du gouvernement, vitres fumées et blindage de bon ton - du jardin envahi de tentes de fortune. J’essaie de garder une bonne composition, de laisser les minutes s’effilocher. Qu’importe que je perde deux heures à attendre ici alors que j’ai tant à faire au bureau. Que veut dire ce « tant » de toute façon, face au désarroi des milliers de gens tassés ici. Ces heures de travail n’auraient changé en rien la situation de cette masse humaine à la dérive sur les jardins de la Primature. Je suis censé travailler sur des solutions de long terme, comme le développement des villes de province pour absorber la croissance démographique et éviter la surpopulation de la métropole. Peu de gens y croient, car le temps jouera en la faveur d’un retour rapide de la surpopulation à Port-au-Prince, mais on joue quand même tous le jeu. On se dit que l’on travaille pour l’Haïti de 2030, les pieds dans les ruines fraîches de l’Haïti de 2010... Je saisis un livre traînant dans ma sacoche, Pays sans chapeau, de Dany Laferrière, écrivain haïtien superstar au Canada, son pays d’adoption, et ici aussi, en Haïti. Il y parle des retrouvailles avec son pays, après vingt ans d’exil. Je découvre, à travers son récit empreint d’émotions, de pudeur et de franchise, le monde grouillant des rues de Port-au-Prince que je vois défiler de l’autre côté des vitres des 4×4 blancs et rugissant de l’ONU qui me transportent à travers la ville. La sueur a cessé de perler sur mon front mais elle imbibe ma chemise blanche. À peine neuf heures du matin et il fait déjà plus de 30 °C.
Je fixe mon attention sur les mots qui défilent et sur les images qu’ils traînent dans leur sillage, pour faire abstraction des gouttes qui coulent le long de mes flancs et, au-delà, de la marée humaine entassée sur les pelouses à quelques pas de moi. J’allume une cigarette - façon comme une autre de faire passer le temps -, lève les yeux vers les frondaisons chargées, jette un coup d’œil sur mon portable et soupire en silence, comme si j’étais en train de jouer une pièce de théâtre, celle de l’homme d’affaires ou du haut-gradé onusien aux innombrables tâches en attente, à l’agenda rempli de rendez-vous cruciaux, qui ne peut que s’énerver de perdre ainsi son temps si rare. Je joue le rôle de celui que je ne suis pas mais qui sied à la représentation d’Épinal du Blanc venu rencontrer les pontes du gouvernement. Je me sais épié par des chauffeurs affalés contre leur voiture et par quelques déplacés rassemblés à quelques mètres de moi. L’étrangeté de tout cela me plaît, finalement. Je suis le dernier à être dupé. Parfois, j’aimerais que de telles parenthèses emplissent le temps jusqu’à le faire déborder.

C’est à ce moment qu’il s’approche de moi par une sorte de parcours détourné, comme un chat tournant autour de sa proie. Je l’observe du coin de l’œil. Il est immobile, un bras replié, une main soutenant son menton, comme s’il réfléchissait à quelque chose de grave. Soudain en deux grandes enjambées, le voici campé juste face à moi. Je baisse lentement mon livre et lève le regard. Il est jeune, efflanqué, grand, un large front, le visage creusé et une chemise blanche bien nette débordant de son pantalon trop large pour ses hanches étroites. La petite brise du matin s’en est allée ; le soleil tombe sur le parking comme une des plaies d’Égypte sur les hommes pécheurs. Après un moment d’hésitation pendant lequel je feins de regarder ailleurs, il se lance à l’eau. La voix est posée, légèrement anxieuse :
« Bonjour, que faites-vous ici ?
- J’attends mon chauffeur... Pourquoi ? Y a-t-il un problème ?
- Oui, il y a un problème, même beaucoup de problèmes. »
Il jette son regard vers le champ de tentes. Une troupe de femmes s’est agglunitée en bord du parking, des gamins crasseux jouent entre leurs jambes.
« Ah bon ? »
Regard fixe, je sens les mots qui s’agitent sous la peau de son grand front. Ses yeux sont inquiets, ses mains cherchent une posture qui lui donnerait plus d’aplomb.
« Vous voyez là ? »
Il tend sa main vers le camp et mon regard suit dans la même direction. J’imagine la fournaise sous les tarpaulins bleus qui recouvrent tout l’espace vital, maigre protection contre les averses quotidiennes de début de soirée ; je sens la boue qui colle aux pieds, l’âcreté des odeurs, la promiscuité, j’entends les cris la nuit des petits qui n’en peuvent plus et des grands qui revivent continuellement les trente-cinq secondes qui ont défait leur vie. Une femme accroupie sur un muret, les bras ballants, regarde le sol du parking dans le vide. Elle remet lentement en place une mèche de cheveux que la brise, dans un court accès de courage face au soleil, avait défaite. Ses gestes sont lents, elle a l’air épuisé. Elle pourrait s’écrouler morte à l’instant que personne ne serait vraiment étonné. Un enfant vient s’accrocher à son dos ; elle ne fait aucun geste envers lui, il lui dit deux mots, insiste en se penchant à son oreille, mais elle ne réagit pas. Dépité, l’enfant s’en va. La femme lève la tête et croise alors mon regard. Elle me dévisage et me dit une infinité de choses en quelques secondes. J’ai l’impression que toute l’histoire d’Haïti se déverse sur moi comme par le biais de fibres optiques invisibles. En conclusion, rien n’aurait jamais changé...
« Oui, je sais, c’est terrible, je ne sais comment tous ces gens peuvent supporter de telles conditions... »
En disant cela, je pense surtout que je serais incapable de supporter leur situation ne serait-ce que quelques heures mais que, eux, bon, c’est pas la même chose... On s’habituerait donc à la pauvreté... Les poncifs ont la vie dure.
« Vous faites quoi ici, vous ? »
Mon inquisiteur reprend le fil de sa pensée.
« Je vous l’ai dit, j’attends mon chauffeur. »
L’idée d’avoir un chauffeur, et qui plus est de l’attendre oisivement en lisant un roman, alors qu’une telle situation de détresse se déroule à quelques encablures, semble encore plus saugrenue.
« Non, ça je peux bien le voir que vous êtes en train d’attendre. Je vous demande ce que vous faites en Haïti, pourquoi vous êtes venu. »

Une pointe d’exaspération se fait sentir. C’est donc ça, un examen de conscience. Je suis toujours maladroit dans ce genre d’exercice, ne sachant sur quel pied danser, me livrant là où je devrais me préserver et parlant la langue de bois quand on espère de moi la sincérité. Mon interlocuteur attend une réponse, ses yeux ne me lâchent pas.
« Je suis déjà venu auparavant en Haïti... J’aime bien ce pays...
- Non, je ne demande pas ça ! »
Le ton est irrité. Un officier de sécurité de la Primature qui nous regardait déjà depuis un moment s’approche pour faire éloigner le jeune. Je lui fais signe de ne pas s’en mêler.
« Je veux savoir quel est votre travail », reprend-il un peu plus calme.
Il parle en détachant chaque mot, comme s’il m’administrait une leçon de français. Je ne peux plus y couper, je dois avouer ma faute :
« Je travaille pour les Nations Unies.
- Il faut leur dire qu’on a faim et qu’on ne reçoit plus de distribution de nourriture. »
Je regarde à nouveau du côté du camp et trouve maintenant tout un groupe de femmes, les bras croisés, nous regardant, comme si le jeune homme venu me parler était envoyé en représentant de tout le camp. Me voici au pilori, Blanc et travaillant pour les Nations Unies en prime, je ne peux donc pas repartir d’ici sans avoir apporté une solution à ce problème. Et moi de tenter d’expliquer que, oui, je travaille bien à l’ONU, mais dans une branche différente, je ne m’occupe pas de distribution de nourriture mais... de décentralisation ! Mais oui, je te l’assure, c’est important la décentralisation pour Haïti, bon, ça va pas vous nourrir un homme dans l’immédiat mais, disons d’ici à dix, vingt ans si tout va bien (en aparté, pourquoi tout irait bien soudain, vu que c’est la chute libre dans ce pays depuis des décennies), vous en tirerez des bénéfices. Voilà, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et j’espère que mon chauffeur va surgir à l’instant à l’entrée du parking.
« Si vous travaillez pour l’ONU, vous devez leur dire et résoudre ce problème. Demandez aussi à nos hommes politiques pourquoi ils ne veulent plus que l’on reste ici. Nous, on sait. Le Premier ministre a ordonné au PAM [Programme Alimentaire Mondial] d’arrêter les distributions de nourriture pour nous affamer et nous faire partir. Dans les autres camps, ils continuent à recevoir à manger. »
Je réitère mon étonnement que les distributions soient arrêtées, à voir les myriades de travailleurs humanitaires et d’organismes gorgés de fonds de la solidarité récoltés après le séisme qui s’agitent et encombrent les rues défoncées de la capitale. Serait-il possible que les dirigeants politiques aient demandé de cesser les distributions ici pour libérer la pelouse qui sied mieux au bureau d’un Premier ministre qu’un camp de réfugiés ? L’impuissance me tombe dessus, comme le soleil qui a tourné et m’atteint en plein visage. Je n’ose remettre mes lunettes noires, pour ne pas créer plus de distance entre nous deux, une nouvelle barrière qui s’ajouterait aux milliers de barrières invisibles qui nous envoient déjà à des lieues l’un de l’autre. Je suis comme paralysé, regarde à nouveau les femmes au bord du camp, content, au fond de moi-même, de me trouver à une distance convenable de cette détresse-là.
« Vous leur direz donc ? Il faut que l’ONU nous aide, sinon pourquoi vous êtes ici ? »
On essaie, on essaie, crois-moi, mais l’ONU est en effet un grand machin, une hydre à mille têtes. Je suis un petit tentacule parmi d’autres. Et je m’agite comme les autres, parfois en vain, parfois pour faire avancer le grand machin. Une chose est sûre, cependant, je n’ai plus l’illusion de soulager ces souffrances-là.
Au milieu d’un silence trop lourd pour être innocent, mon chauffeur finit par arriver. Je me lève prestement, serre la main de mon interlocuteur, promets à nouveau de voir qui je peux prévenir au sein de la galaxie onusienne, sachant bien que je ne trouverai pas la bonne personne et que je serais de toute façon englouti à nouveau par une spirale de tâches en attente à peine rentré au bureau, là-bas, près de l’aéroport, dans la poussière et le bruit. Et puis j’ai malgré tout des doutes sur la vérité de cette histoire : je crois plus simplement que les résidents du camp espèrent peut-être recevoir plus ou qu’ils n’en peuvent plus de l’attente de jours meilleurs. Dans une telle situation, tout Blanc passant à leur portée, qui plus est, un Blanc de l’ONU, est une opportunité à saisir. Cela paraît incroyablement cynique, mais c’est bien la réelle situation engendrée par l’aide humanitaire, porte-drapeau implacable de la domination du Sud par le Nord, siphon de la bonne conscience occidentale et cercle vicieux de la dépendance. Je comprends mieux le sens de certains graffitis lus sur les murs de la ville - mode de communication politique privilégié ici : ONG dehors, Haïti aux Haïtiens... Et puis, il a tout ceux qui vous disent, l’air résigné, que Bill Clinton devrait être nommé gouverneur du pays à la dérive, et tous les politiciens haïtiens jetés à la mer pour être dévorés par des requins plus gros qu’eux.
La voiture fait demi-tour sur le parking. Je retrouve avec un plaisir coupable et un haut-le-cœur son habitacle réfrigéré. La vitre est levée, les portes verrouillées. Je suis dans un autre monde, je peux retourner à mes occupations. Bientôt, la Primature ne sera qu’un souvenir parmi tant d’autres, de ces moments où je vacille entre deux routes, celle qui m’entraînerait vers une équation dont je suis la principale inconnue, et une autre dévalant des territoires toujours plus peuplés de questions sur le grand monde qui s’agite et auxquelles je suis de plus en plus en mal de répondre - mais qui ont quand même le mérite de brouiller la dite équation...
Juste avant de passer le portail de sortie, je jette à nouveau mon regard vers le camp. Les femmes de tout à l’heure sont serrées les unes contre les autres, tenant leurs enfants près d’elle. Elle me font comme une haie d’honneur. Leur jeune porte-parole dégingandé (dont je n’ai même pas demandé le nom), trône au milieu. Leur regard n’est pas amical. Il n’y a ni haine ni jalousie non plus, juste un grand vide, une incompréhension formidable. J’ai l’impression de fuir un naufrage sur le seul canot de sauvetage à disposition. Je ferme les yeux un instant, fredonne un air dans ma tête, ouvre mon livre à la page où je l’avais laissé et me laisse entraîner par les mots de Dany Laferrière dans les bas-fonds de Port-au-Prince que, de toute façon, je ne pourrais jamais pénétrer. On y lit un monde de courage et de déchéance, d’humanité et de pourriture. Sous les gravas, la vie, coûte que coûte.