


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


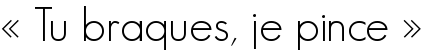
 |
|
|
|
Publié dans le
numéro 005 (Mai 2011)
|
Entretien avec Charles, 63 ans, ancien policier à la BRB.
Comment êtes-vous entré dans la police ?
J’étais assez indéterminé sur ce que j’allais faire de ma vie. J’avais le bac, j’habitais une petite ville de province, Brest, où tout le monde était habitué à partir, ou allait dans la Marine. Moi, je savais que j’allais partir. En revenant de mon service militaire, j’ai lu dans L’Équipe que la Préfecture de Police de PARIS recrutait des policiers sur titre. J’y suis allé et très rapidement j’ai été recruté comme OPAC (Officier de Police adjoint contractuel). Ensuite j’ai passé le concours externe d’inspecteur (niveau Deug Droit), puis celui d’inspecteur principal, puis j’ai été nommé inspecteur divisionnaire et commandant de police. À l’époque, les concours étaient assez sélectifs, on en prenait un sur dix. Par la suite, le concours de passage entre inspecteur et inspecteur principal a été supprimé, et l’avancement banalisé. Mais moi je trouve que la sélection, c’était pas mal. La preuve, certains collègues qui ont échoué au concours d’Inspecteur Principal sont devenus Préfets...
Il y avait beaucoup d’embauches à cette période ?
Je suis rentré dans la police en 1970. Il y avait en effet beaucoup d’embauches. Ça correspond à la période où les gens qui avaient participé à la guerre de 39-45 partaient à la retraite. C’était une période un peu charnière, parce qu’avec nous il y avait des gens qui avaient participé à la seconde guerre. Et la police, à cette période-là...
Vous avez connu des gens qui avaient été dans la police de Vichy ?
Tout à fait. C’était un moment de découverte pour moi. Je suis né en 1948. La période de Vichy, on n’en n’avait pas trop entendu parler. C’est assez fou ce que la police a pu faire à cette époque... Alors certains policiers ont été résistants, mais d’autres ont été collabos, et certains sont même allés plus loin. Moi, je viens de ma province, j’arrive à Paris, je discute avec ces gens-là qui me parlent de rafles de juifs, de choses comme ça. Ils me disent : « oui mais nous, la veille, on allait mettre un papier dans l’escalier en disant tel jour, à telle heure, on viendra arrêter telle personne. Et à l’heure dite, les gens étaient là avec leur valise, ils attendaient d’être arrêtés. » Il y a eu une forme de soumission à l’ordre très surprenante, et pour les policiers en fonction à cette époque-là, c’était une sorte de défaut de culpabilité, le fait d’avoir mis une convocation : « on vous avait prévenus, et nous on ne faisait qu’exécuter les ordres de notre hiérarchie ». J’ai été confronté à ces gens-là. C’était parfois un peu difficile de discuter, parce qu’ils avaient participé ou connu des choses inavouables, une manière de fonctionner qui était sans doute inavouable aussi, le marché noir, le racket... Je suis rentré dans la police à un moment où ces méthodes-là, qui avaient continué à exister dans les années 1950, s’étaient atténuées dans les années 1960, et à partir des années 1970 la police est devenue plus ouverte, plus clean.
Est-ce que pour devenir policier, il faut être un peu fasciné par les gangsters ?
Non, je n’avais pas de fascination pour les gangsters ; je n’avais pas non plus de fascination spéciale pour le métier de policier. C’était quelque chose qui ne me déplaisait pas, mais je ne mettais pas d’idéologie ou de sentiment là-dedans. C’était surtout un métier d’aventures, un métier qui me permettait d’arrêter des voleurs. Je me mettais peut-être du côté de l’ordre et pas du désordre... Mais il n’y avait pas d’idéologie derrière.
Et les autres, autour de vous ?
On est à une époque spéciale : en 1970, il y a eu 68 avant, et tous les gens qui sont là sont sursitaires, ils ont des diplômes universitaires ou autres, ils ont du recul sur la fonction, ils ne sont pas du tout fachos. J’ai rencontré des gens avec qui je m’accordais totalement sur mes idées du fonctionnement de la société, de démocratie, de République, de citoyenneté. Et tous les gens que j’ai côtoyés à cette époque-là ont toujours eu cet esprit. J’ai eu des collègues qui avaient participé à des manifs à Paris en 68, qui avaient affronté les CRS dans les facs... Ce n’est pas toujours un métier qu’on fait par idéologie.
Que faisiez-vous à vos débuts dans le métier ?
J’ai d’abord été affecté dans un service qui s’appelait les contraintes par corps. On s’occupait de collecter les fonds des amendes de la prostitution. Les prostituées avaient des contraventions pour racolage, mais elles ne payaient jamais. Donc la police en tenue faisait du « ramassage ». Par exemple rue Saint-Denis, et nous les amenait à notre bureau. Comme la plupart devaient de l’argent à l’État à cause de ces contraventions, et qu’elles avaient de l’argent sur elles, elles payaient. C’est une contrainte par corps, l’exécution d’un jugement du tribunal de police : soit on paie l’amende, soit la peine est appliquée, par exemple 15 jours de prison. Elles préféraient payer, parce que 15 jours sans salaire, pour elles, c’était énorme... On avait notre bureau quai des Orfèvres, on recevait des prostituées de tout Paris. Elles étaient arrêtées la nuit, gardées, et le matin on faisait notre travail.
Les policiers n’étaient pas enclins à être coulants, en échange de backchichs ?
Tout peut arriver. Quelques années après mon départ, il y a eu un inspecteur qui a dérivé un peu... Il mettait l’argent qu’il récoltait dans sa poche, il avait certainement une comptabilité double. Dans tous les métiers où l’on manipule beaucoup d’argent, tout est possible. L’argent, c’est de la dynamite.
Comment êtes-vous entré à la Brigade de répression du banditisme (BRB) ?
J’étais très sportif. Je faisais du judo, j’étais assez bon footballeur à l’époque. Comme je voulais jouer, j’ai intégré l’équipe de foot de la PPPJ (Préfecture de Police, Police Judiciaire). On avait une équipe de niveau division 3, on jouait pas mal. Tous les ans, il y a un grand tournoi entre la Mondaine, la Crim’, la BRB, la BRI, ... Les types de la BRB m’ont vu jouer, c’est comme ça que j’ai connu des gens qui m’ont coopté pour venir dans un groupe de la brigade de répression du banditisme. Je suis donc rentré à la BRB par le foot... Après, j’avais bien sûr d’autres qualités qui collaient au besoin du recrutement de ce service. C’était un an après mon entrée dans la police, en 1971. J’ai intégré les groupes de flagrant délit de la BRB, et j’y suis resté 15 ans. La BRB s’occupait des braqueurs, des casseurs, des affaires de grand banditisme....
Des « casseurs » ?
Un braqueur, c’est quelqu’un qui prend une arme et qui braque. Un casseur, c’est quelqu’un qui va casser le mur d’une bijouterie pour faire un vol. C’est un métier qui demande beaucoup de travail. Le gang des égoûts, en 1985, à Paris et à Nice, les mecs sont partis des égoûts, ils ont percé des tunnels pour aboutir à des salles de coffres... Ils ont fait un sacré boulot ! Un boulot physique, parce qu’il fallait creuser les tunnels. Un boulot ingénieux, aussi. Ils avaient des niveaux à bulle pour savoir à quelle hauteur creuser. Je me souviens qu’une fois, on arrivait pas à savoir par où ils étaient sortis : ils avaient percé les parois d’un parking, ils étaient sortis par là et ils avaient rebouché avec du béton, ils avaient même vieilli le béton... C’était vraiment de la délinquance haut-de-gamme.
Comment s’organisait votre travail au quotidien ?
La BRB faisait un travail de police judiciaire où la gestion du temps n’est pas la même que dans l’ordre public. L’ordre public, c’est une gestion ponctuelle du temps. Nous, on pouvait rester 6 mois derrière des gens, des braqueurs, des grands bandits... Notre devise, c’était « Nuit et jour, jour et nuit, nous planquons ». Il fallait une disponibilité totale. On logeait [1]les types, et parfois on les accompagnait au braquage. Comme on les avait logés, qu’on les connaissait bien, qu’on connaissait tous leurs points de contacts et leurs points de chute, on n’intervenait jamais en flagrant délit. On les laissait rentrer chez eux et quand ils ressortaient, là on les arrêtait. Le point de départ, ça peut être un café. Par exemple, là, rue des Petites Écuries, à l’époque il y avait un café où venaient des voyous, des braqueurs. On le savait, donc s’il y avait une nouvelle tête qui venait discuter avec un braqueur, on le prenait en filature. Après on logeait les types et on reconstituait les équipes.
Vous entriez dans le café ?
Non, non. On restait à l’extérieur, dans des voitures. On avait du matériel de planque. Un fourgon avec des cageots de fruits et légumes, à l’intérieur on mettait nos appareils photo, on prenait les mecs, clac, on les identifiait. Ça peut durer longtemps, ça. Je me rappelle être resté six mois planqué au même endroit, personne n’a jamais su ce qu’on faisait ni qui on était. Des fois, on réussissait à avoir un « tonton » : un mec qui nous donnait des informations.
L’informateur, vous le payiez ?
Non. Généralement c’était des proxénètes. Ils nous donnaient quelques informations pour se mettre à l’abri, c’était un peu donnant-donnant. Leur intérêt c’était souvent de défendre leur territoire. Ou alors ils anticipaient les problèmes qu’ils pourraient avoir dans le futur. Mais attention, dans ces milieux-là, c’est extrêmement cloisonné. Souvent, le mec il savait juste qu’untel était un braqueur, qu’il préparait quelque chose, mais il ne savait pas où ni quand.
Ces indics, ils savaient où vous trouver ?
On était dans la rue tous les jours. Ils ne connaissaient pas nos dispositifs, mais ils savaient où nous rencontrer.
Si eux vous connaissaient, les gars que vous suiviez pouvaient vous connaître aussi ?
Non, non. Là aussi, c’était très cloisonné.
Mais les braqueurs, pourquoi ils ne cherchaient pas à vous identifier ?
Ils le faisaient. Tous les gros voyous font ce travail-là. Ils allaient au Quai des Orfèvres relever nos numéros de voitures. C’était aussi leur travail. Faire une filature, c’est pas quelque chose de simple. Il y a toutes les techniques de filature. Au rond-point, on fait 2 ou 3 tours et on voit tout de suite si on est suivi. Nous on avait des dispositifs qui nous permettaient de faire ce travail comme il fallait. Mais c’était pas facile... Moi, je partais à 7 heures du matin et je ne savais pas à quelle heure je rentrerais. Parfois on ne rentrait pas du tout. Une fois on est parti à 7 heures, on a suivi des voyous jusqu’à la frontière belge, ils ont continué en Belgique, ils ont braqué une banque, on a attendu leur retour à la frontière, on les a repris en filature, on est revenus à Paris et on les a arrêtés ! Je suis rentré chez moi 48h après mon départ...
Pourquoi vous ne les arrêtiez pas pendant le braquage ?
C’est une gestion du risque qui avait été prise à l’époque. Arrêter des gens en flagrant délit, c’est extrêmement dangereux. Les gens qui montent au braquage sont particulièrement déterminés. Les policiers qui sont là sont aussi extrêmement déterminés. Et quand ça braque, que vous êtes devant la banque, vous voyez les mecs à l’intérieur, le cœur il fait toum-toum-toum. Les patrons de nos brigades avaient pris le parti de ne pas intervenir. On avait fait un travail avant, on savait où ils allaient revenir. Donc on mettait en place un système de filature, ils rentraient chez eux et on les reprenait derrière. Généralement, ça se passait bien.
Ça pouvait vous arriver d’attendre un gros coup qui n’arrivait jamais ?
Mes vieux collègues me disaient, à propos des gros voyous : si tu te débrouilles bien, avec cinq ou six voyous, tu fais ta carrière... Il faut miser sur le bon cheval ! Le mec, il sort de prison, vous le prenez, vous voyez qui il fréquente, et si vous avez cinq ou six beaux mecs comme ça, vous avez un noyau de gros voyous, et à partir de là vous pouvez fonctionner. C’est comme un fond de commerce. Bon, c’est pas la méthode « batonnite » de Sarkozy. En police judiciaire, le policier est un artisan : chaque jour, il crée son travail. Il faut qu’il trouve la matière, le moyen. Aujourd’hui, il y a des choses comme les écoutes téléphoniques. C’est peut-être plus facile dans un sens, plus difficile dans un autre parce qu’il y a une moins bonne connaissance du terrain. Peut-être aussi moins de disponibilité chez les policiers, qui ne veulent plus faire ce travail de surveillance.
C’est quoi, un bon flic de la BRB ?
Pour devenir opérationnel, il faut quatre ou cinq ans. C’est une formation. Une manière de fonctionner que tous les policiers n’ont pas. On reconnaît assez facilement un policier qui a toujours été dans un bureau par rapport à un policier qui a le sens du terrain. Tous les gens qui étaient à l’époque à la BRB avaient une fibre policière particulière. C’est-à-dire que vous mettez ce mec-là dans la rue, le nez au vent, il va voir quelque chose que les autres ne verront pas. Ceux qui ont fait de la voie publique sentent ce genre de truc. Parce qu’on a un sens, on voit ce qui se passe dans la rue... J’ai eu des collègues qui, en partant de chez eux le matin, ont levé une équipe de braqueurs. Moi, je vois toujours un tas de choses. Parce que j’ai cette fibre-là : je regarde. Souvent, les gens ne regardent pas. Un mec qui a un comportement un peu bizarre, il m’arrive de m’arrêter et de regarder ce qu’il fait pendant cinq minutes. C’est le comportement des gens dans la rue qui me fait tilter. On a arrêté des gros braqueurs, des gros receleurs parce qu’on avait l’œil, le flair.
On oppose souvent les gangsters flamboyants des années 1970 à ceux d’aujourd’hui qui seraient sans foi ni loi, beaucoup plus violents.
Dans les années 1970-85, les voyous, c’étaient pas des enfants de chœur. Moi, j’ai sept collègues qui ont été tués. Des voyous nous ont tiré dessus, le risque existait toujours. Je ne pense pas que les gros voyous de l’époque étaient plus respectueux de la vie humaine. Action Directe ou des gens comme ça, s’ils pouvaient vous tirer dessus, ils le faisaient. Mais la médiatisation est actuellement beaucoup plus importante qu’à l’époque. Je ne sais pas si les agressions par armes à feu contre les policiers sont supérieures aujourd’hui. Mais je dirais en revanche que le ressenti, pour les policiers, est beaucoup plus violent qu’il ne l’était à l’époque. Déjà à l’époque, quand je rentrais chez moi, je faisais aussi un tour de sécurité sur le rond-point pour voir si j’étais suivi.... Je n’étais pas tranquille. J’ai des collègues qui ont eu le pétard sur la tête, alors qu’ils étaient avec femme et enfants à la terrasse d’un café. Moi je n’ai jamais dit à mes voisins ce que je faisais. Pourtant, quasiment tous les soirs, je rentrais avec une voiture différente ! Un jour je me suis fait cambrioler et mon voisin m’avait dit : « je connais bien les policiers, si vous allez déposer plainte recommandez-vous de moi ».
Vous avez vécu l’époque Mesrine...
Pour Mesrine, la BRB faisait des filatures, travaillait sur des planques, des surveillances, et la brigade anti-gang travaillait sur un autre pan. Chacun avait des compétences, des points de travail. Ça a été un travail titanesque. Nous, on a beaucoup travaillé sur la fille de Mesrine. On a planqué pendant des semaines, on faisait les trois huit, on était une quinzaine... Comme on n’arrivait pas à loger Mesrine, il fallait bien essayer de remonter vers lui par tous les points qui étaient possibles.
Il n’y a pas de lassitude, à attendre quelque chose pendant des semaines ?
Dans un travail de planque, on peut effectivement en avoir ras-le-bol... Mais ce n’était pas n’importe qui ! Il y avait des écoutes qui tournaient, on savait que la fille avait des contacts avec son père, elle aurait pu nous mener à lui. Au bout de plusieurs semaines, on n’avait toujours rien eu, on est allé planquer sur autre chose. On connaissait les bars qu’il fréquentait à Paris. Dans le XVIIIè, il y avait le bar Des Cheminées, vers la porte de Saint-Ouen. On savait que Mesrine et ses complices venaient, alors on a planqué là. Mais la localisation du domicile de Mesrine, c’est pas nous qui l’avons faite, c’est une équipe de la brigade anti-gang, après que tout un travail d’équipe ait permis d’éliminer certaines hypothèses. Resserrer, resserrer, resserrer... Jusqu’au moment où Mesrine a été logé.
Ce doit être dur de lutter contre l’ennui, non ?
Oh je peux vous dire que si vous êtes seul la nuit dans un sous-marin [2], et que Mesrine peut arriver, vous ne vous endormez pas ! Moi, j’ai été dans le sous-marin quand il y avait des équipes de braqueurs, des solides, qui montaient au braquage. J’ai vu des types avec un pistolet-mitrailleur dans un sac faire le tour du sous-marin, eh bien ça cogne [geste du cœur qui bat]. Ça cogne, parce que vous vous demandez s’il ne va pas ouvrir la porte. Et si vous commencez à banaliser ce genre de choses, il faut faire attention, il vaut mieux changer de service. Moi, il y a eu un moment où ça ne me faisait plus rien. C’était devenu une habitude. Alors j’ai fait autre chose. Mais le côté flag, après, il m’a toujours manqué quand même... Tous les jours, il y avait cette montée d’adrénaline. C’est un métier passionnant. Mais c’est un métier à part. Parce que vous pouvez pas dire à votre femme qu’aujourd’hui vous allez accompagner des mecs qui vont monter au braquage. C’est un métier extrêmement dangereux, et c’est pas facile d’échanger là-dessus avec sa famille. Nous, on n’avait pas de cellule psychologique, on parlait avec les collègues, c’est pour ça qu’il existe des liens très, très forts entre nous. Il n’y avait qu’avec eux qu’on pouvait parler. Parce qu’il y a un moment où il faut bien que ça sorte. Mais on avait quand même un mental particulier... Aller arrêter les mecs à la sortie de la banque, c’est pas simple, faut y aller quand même !
Quel est votre gros coups de filet, l’enquête qui vous marqué ?
Il y avait une équipe de Belges qui avaient des faux papiers français et qui venaient braquer sur des coups très précis que des gens leur indiquaient. On les avait logés, on avait des écoutes, il ne se passait rien. Et un jour ils sont revenus à Paris, on était là, on les a repris en filature. Ils ont loué une mobylette, ils sont allés voir une banque dans le XVIIè, ils ont descendu la mobylette dans le parking, là il y avait des voitures qu’on a identifiées : c’était des voitures volées, des voitures relais. On les a pris en filature de 6h du matin à minuit-1h, tous les jours. Jusqu’à un matin où ils sont partis à 7 heures, ils sont allés à la banque, ils ont braqué la banque, et nous on avait mis un dispositif au deuxième sous-sol parce qu’ils devaient descendre mettre le butin dans la voiture-relais. Moi, j’étais dans un véhicule de planque face à leur voiture, au deuxième sous-sol. Quand ils sont descendus, j’ai essayé de me cacher un peu derrière le tableau de bord et, sans faire exprès, j’ai actionné le klaxon ! Je me rappelle la tête des mecs... Ils ont tout mis dans la voiture, ils ont filé, et comme on avait un dispositif en haut on les a arrêtés. Ça, c’est un travail d’enquête totale, on est resté 4 ou 5 mois sur l’affaire et on a arrêté les braqueurs. Mais l’histoire du klaxon, ça m’avait fait très, très peur... Et dans les enquêtes que j’ai bien aimé, aussi, il y a eu celle où la brigade anti-gang de Broussard avait arrêté des mecs qui saucissonnaient… C’était des gros braqueurs.
« Saucissonner », ça veut dire qu’on va chez les gens, on les attache et on les vole ?
Voilà voilà, saucissonnage on appelle ça. Et en fait la brigade anti-gang avait pas réussi à la accrocher sur une procédure, les mecs avaient été relâchés. À l’époque j’avais un collègue qu’on appelait « le Vicomte », c’était un flic, mais il était vraiment Vicomte... Il était spécialisé dans les miniatures du XVIIè-XVIIIè siècles. Et un jour on était à côté du Louvre des antiquaires, nez au vent, et le Vicomte voit dans un magasin une miniature. Le Vicomte avait une mémoire visuelle extraordinaire et là il reconnaît la miniature, il me dit « ça, ça vient de tel saucissonnage » : il y avait une diffusion de toutes les affaires de braquage, saucissonnage, de tous les objets volés. Là on va voir l’antiquaire et on lui demande qui lui a vendu ça. Ça venait de la salle Drouot, en fait, alors on va voir le commissaire priseur qui avait vendu le truc et on s’aperçoit qu’il avait reçu des objets provenant d’une quinzaine de saucissonnages par l’équipe qui avait été relâchée par la brigade anti-gang... Les mecs, ils utilisaient la salle Drouot pour écouler la marchandise volée, donc ils avaient dû donner leurs pièces d’identité. Et nous on a remonté la filière intégralement comme ça... Le mec, on lui a mis quinze braquages sur le dos et il a été accroché, il a dû faire quinze ans.
Vous avez un côté assez gentil, souriant, on n’imagine pas un mec de la BRB comme ça !
Et alors ? On peut être flic et pas bourrin !
Mais vous n’avez pas l’air hargneux...
Vous vous méprenez : je suis une tête de con terrible et quand je suis déterminé, je suis déterminé. Vous me donnez un os, je le ronge jusqu’au bout.
Et ce qu’on voit dans les films, défoncer une porte à coups de pied et braquer les gars, vous avez fait ce genre de choses ?
Oui oui, bien sûr. C’était vous ou eux. Si vous allez arrêter un braqueur en flagrant délit, ça se joue en trente secondes : le mec vous lui sautez dessus et boum, c’est terminé. Faut pas que ça dure une minute, sinon ça peut se retourner contre vous. Vous avez des gens qui sont armés, il faut que l’équipe soit soudée et que vous sachiez exactement ce que va faire votre collègue.
Vous faisiez des répétitions ?
Mais non, c’était notre métier ! « Tu braques, je pince », on disait (il rit). Les mecs, le plus souvent, on les choppait dans la rue. On planquait, on les laissait ressortir et on les chopait. Les braqueurs qui sont allés en Belgique dont je vous ai parlé, on les a laissé rentrer chez eux, on a planqué toute la nuit, ils sont ressortis le lendemain matin pour aller faire un tiercé. Ils étaient au comptoir, nous on était trois derrière, on a attendu qu’ils sortent et là perquisition, tout ça. Parce qu’on avait des rapports de surveillance, on avait une procédure étayée. C’était une technique de travail, l’inverse des BAC qu’on voit maintenant travailler sur du flagrant délit, des fois en prenant des risques énormes. Quand vous voyez des mecs et que vous pouvez identifier la voiture ben vous allez chez eux et ils vont arriver, hein, c’est pas la peine de les poursuivre à 150 à l’heure !
Vous ne commettiez jamais de grosses erreurs ?
Une fois, on a arrêté des gens de St Ouen, et quelques années après on les a réarrêtés quand ils revenaient d’un braquage. Mais sur le moment, les mecs, je ne savais pas qui c’étaient. Je savais pas... Après le braquage, les mecs ils sont revenus chez eux, on les a laissés rentrer, et puis ils sont ressortis, ils sont allés boire un coup dans un café. Donc ils étaient décontractés. Nous on a mis un dispositif en place. Et moi, je suis rentré dans le café. Les mecs ils m’ont vus et pfuit, ils ont filé. On avait un dispositif à la sortie, après on a bloqué leur voiture, etc. Mais l’un d’eux, je me disais « c’est bizarre, ce mec là je le connais, mais d’où ? » Je n’arrivais pas à l’identifier. Je me disais : « je l’ai pas vu au judo ? Au foot ? » La garde à vue a duré quarante-huit heures et c’est peut-être à la quarantième heure que j’ai dit « je sais qui tu es ! » : on l’avait arrêté au braquage quatre ans avant. Lui, il m’avait reconnu. Moi je l’avais pas reconnu. J’ai souvent repensé à ça après. Parce que ces mecs-là, ils étaient ressortis sans armes mais s’ils avaient été armés, ils m’en mettaient une. C’est la seule fois que ça m’est arrivé, de ne pas me souvenir de quelqu’un. C’est bizarre, comme quoi on banalise ce travail à un moment, on photographie mal les gens... Et je m’en suis voulu, parce que ça pouvait être extrêmement dangereux pour moi.
Et durant ces quinze années, vous avez vu des gens se faire tuer devant vous ?
Oui. Une fois à Bastille, y avait des mecs qui avaient fait sauter une voiture, on était revenus au Quai des orfèvres en rapportant des caisses dans lesquelles y avait des bouts de cadavres. Effectivement, c’est des actions violentes. Une autre fois, quand je vous disais tout à l’heure qu’on partait le nez au vent, j’ai un copain qui en sortant de chez lui voit une équipe de mecs avec un comportement assez spécial. Il nous appelle, je crois que notre indicatif radio c’était 152 à l’époque, donc on vient et ces types-là arrivent dans le IXè arrondissement ; ils s’arrêtent devant un diamantaire. À un moment, on voit un mec sortir de la boutique avec une mallette à la main accrochée par une menotte. Le diamantaire va à la poste, les types le suivent, visiblement ils veulent le braquer. Nous on avait un dispositif, mais à un moment les mecs nous voient et ils s’arrachent en voiture. On les suit, les mecs s’arrêtent, ils sortent un fusil et ils nous tirent dessus. Y a eu une poursuite qui a duré un moment dans Paris, et on a réussi à arrêter deux mecs, c’était des gens du gang des lyonnais à Paris, y en avait un il s’appelait Petite-Patte, je me rappelle, mais c’était un grand grand bandit. Et à ce moment, y en a un autre qui part en courant, il prend un passant en otage avec une grenade et il tire sur les policiers. J’ai un collègue qui tire, il lui met une balle dans l’aine et le bandit se trouve stoppé dans sa course, il a toujours son otage et la grenade. Qu’est-ce qu’on fait ? Et en fait mon collègue a réussi à reprendre une arme, parce que la sienne s’était enrayée, et boum il lui a collé une balle dans le genoux et là il a lâché sa grenade et son otage. Le mec, il s’appelait Camerini, c’était un Niçois, un gros voyou. Une tête de con, quoi. Et mon collègue, lui il a été tué quelques années plus tard par un voyou. Ça, c’était des actions extrêmement dangereuses.
On sent une certaine réticence à raconter ce que vous avez vécu. Mais c’est quand même au fond de vous, non ?
C’est très, très au fond de moi. J’en ai rêvé... J’ai fait un rêve, une fois... J’ai vu Mesrine dans un troquet. J’avais dans le coffre de ma voiture un fusil de chasse. J’ai coupé le canon, je suis rentré dans le bistrot : boum boum.
Vous l’avez tué ?
Ouais. C’est fou comme rêve, hein ? C’était longtemps après qu’il soit mort, mais c’était encore sur mon disque dur. J’ai longtemps fait des rêves violents comme ça.
Mesrine, pour revenir à lui, vous l’avez vu physiquement ?
Oui oui, je l’ai vu. Je crois qu’il est passé trois fois au Quai des Orfèvres, Mesrine. Je l’ai vu là. Et une fois je suis allé dans un bistrot dans le XVIIIè, j’ai eu un échange de regard avec un mec, j’ai toujours pensé que c’était lui. Il m’a regardé, je l’ai regardé, et je suis parti. Mais après, avec le recul, j’ai longtemps pensé que c’était lui.
Est-ce que vous faisiez une hiérarchie chez les grands bandits ?
Par exemple, François Besse [3], généralement il montait ses affaires, il partait sur des trucs construits, précis. Mais y avait des gens qui braquaient trois banques dans la journée ! Eux, c’était des gagne-petit. J’avais pas d’admiration pour les bandits, mais quand même une échelle des valeurs. Certains, on disait que c’était des « beaux mecs ».
Vous ne vous êtes jamais dit que si vous n’aviez pas été flic, vous auriez été bandit ?
Jamais. Moi j’ai pas cette fascination pour ce qui brille, le bling bling. Quand je suis arrivé à Paris, j’ai été surpris de voir certains policiers qui avaient le même salaire que moi et qui portaient des super costards... J’avais un collègue, à l’époque, qui tentait de racketter les frères Zemmour, les mecs qui tenaient tout le gratin à Paris. Il avait même fait sauter une de leur boîte de nuit à Nice : boum ! Lui, il était peut-être plus voyou que flic, il jouait sur les deux tableaux. Et en 1984, à la Brigade de répression du banditisme, il y a aussi eu tout un groupe, une équipe de cinq ou six mecs qui ont été arrêtés pour braquage.
Vous les connaissiez ?
Très bien. Au début, j’y ai pas cru.... Mais l’enquête a déterminé que c’était tout à fait possible. C’est complètement fou, ça ! Ceux qu’on pensait être des collègues avaient une double vie, c’était des voyous. C’est bizarre, hein ? Les mecs ils utilisaient les écoutes auxquelles ils avaient accès, ils entendaient qu’Untel recelait des bijoux ou telle somme d’argent, et ils passaient derrière pour les voler : ils braquaient les braqueurs. Au bout d’un moment il y a eu une enquête, et ils se sont fait arrêter un par un. Moi, j’étais assez copain avec l’un d’eux. Il est allé en prison, je lui ai écrit deux, trois fois... Chacun mène sa vie.
Avant l’entretien, vous nous disiez que vous connaissiez des gens qui avaient des postes importants... Vous pensiez à quel genre de poste, ou de gens ?
Des postes très important, oui. Je connais ces gens-là, mais je ne souhaite pas faire des critiques ouvertes sur la manière dont la police fonctionne, ce n’est pas mon rôle, je ne suis pas qualifié pour le faire.
Vous pensez à une sorte de dérive sarkozyste ?
Un peu, oui. À la manière dont Sarkozy a géré la police. Il a mis des écrans de fumée sur des fonctionnements en faisant de la bâtonnite, qui ne correspond pas à un fonctionnement normal de la police ni au besoin de sécurité de la population. Il a fait un peu le kake, je dirais.
Ceux qui sont restés et ont monté en grade, ils avaient un désir de pouvoir que vous n’aviez pas ?
J’ai réfléchi à ça parce que j’ai des amis qui ont fait des carrières très importantes. À l’époque, à la BRB, il y avait cinq ou six groupes de cinq ou six personnes. Comme le recrutement se faisait par cooptation, on pouvait choisir les groupes où on allait, donc c’était des personnes avec qui j’avais des rapports très forts. C’était ma bande... Et ce qui me semble bizarre c’est qu’à ce moment-là ils avaient peut-être déjà des ambitions que je n’ai pas décelées chez eux. Des fois je me dis, à tort ou à raison, qu’ils nous ont mangé la laine sur le dos. À tort, sans doute... Mais on faisait un travail d’équipe, et c’est toute l’équipe qui aurait dû être récompensée. Quand on voit maintenant que Sarkozy a instaurée des primes au mérite individuelles, comment est-ce que ça peut s’adapter à un travail d’équipe ? C’est une erreur. Mais que certains aient pu avoir des avancements, des promotions, ce n’est pas uniquement dû à la qualité de leur travail. Pour avoir ce type de carrière, à un moment il faut monter sur un cheval, soit le cheval politique, soit le cheval franc-maçonnique, soit un autre réseau. Presque tous les délégués syndicaux du 36 quai des Orfèvres sont passés commissaires en 1981 à l’élection de Mitterrand. Certains avaient même plusieurs cartes syndicales dans leur portefeuille.
Mais dans un groupe, il y a toujours des gens qui émergent, c’est normal, non ?
C’est un sentiment bizarre, en fait : on est une équipe, et c’est un peu comme au football, à un moment il y a des gens qui tirent plus leur épingle du jeu que d’autres. C’est lié à des ambitions. Moi à un certain moment j’ai choisi de vivre ailleurs, de ne pas avoir ce type d’ambition, pour ma femme, pour ma famille. Pour monter en grade, il fallait changer de ville, et je ne voulais plus changer de ville. Je ne voulais plus sacrifier ma famille. Noël, le jour de l’an, c’est là que les caisses des magasins sont pleines, vous ne pouvez pas dire « Tiens je vais prendre 15 jours de vacances ». Et je parle même pas de vacances, je parle du jour de Noël, du premier de l’an, c’est ces jours là qu’on avait des informations, nous on allait au boulot. Vous faites ça une fois, deux fois, dix fois, et à la fin vous vous dites « Mes enfants sont là, j’aimerais bien passer un peu de temps avec eux ».
Finalement, on a l’impression que vous êtes plus marqué par les revirements au sein de votre équipe que par la violence inouïe que vous avez dû côtoyer pendant toutes ces années
Oui... On a une équipe soudée, dans cette équipe il y a des carriéristes, et il peut aussi y avoir des braqueurs. Alors c’est un métier où au bout d’un moment on apprend à écouter, à ne pas trop parler, à être assez méfiant... On devient tordu, un petit peu. Mais ces années, ça correspond à une période de ma vie où il y avait une forme d’insouciance, ou j’étais vachement costaud mentalement. Même si, sur le « disque dur », j’ai beaucoup de violence. Ça reste en nous, je crois, on est marqués. Une fois, j’ai rêvé que c’était la guerre, Paris était occupé. Mon meilleur copain de cette époque, un mec que je considère toujours comme mon frère aujourd’hui, me téléphone et il me dit : il faut que tu viennes parce que mes enfants sont en danger, il faut que tu viennes les chercher. Je dis : j’arrive. Je peux pas lui dire non... Donc j’ai fait 500 kilomètres, je traverse la France occupée, en danger, et j’arrive à Paris. Je prends ses enfants, et je retourne, 500 kilomètres dans l’autre sens. Et en retournant, je tombe sur la milice. La milice, les fachos quoi. Et y a un mec qui me reconnaît, et moi je le reconnais aussi comme étant facho. Je sors une arme : boum, je le trucide. (Il rit) C’est fou, hein ?
Illustration : Martin Lebrun