


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


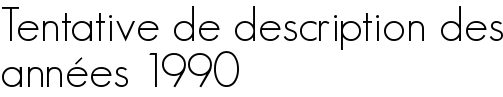
 |
|
|
Publié dans le
numéro 007 (juillet-août 2011)
|
[Introduction au dossier Les années 1990.]
Les années 1990 n’existent pas. Ou plutôt : les années 1990 ont oublié d’exister. Coincées entre deux moments phares, elles n’ont rien fait d’autre qu’attendre que leur tour soit passé. À l’image des gens qui s’excusent toujours de déranger, elles se sont contentées : d’être là. Et pourtant, elles ont joué un rôle - malgré elles, peut-être : elles nous ont laissé un peu de répit. Ça n’a pas duré. Les années 1990 sont comme une histoire d’amour tranquille entre deux passions.
Avant : les années 1980. Violemment étudiées [1] - peut-être aussi pour des raisons de génération : les baby-boomers étaient quadra dans les années 1980, au top de leurs carrières. Ils ne connurent plus jamais cet état de grâce - sans pour autant quitter leurs places. D’où la décennie suivante, molle mais pas nouvelle. Les années 1980, donc : Tapie, Séguéla, le fric, la pub, la coke, Mitterrand, Jean-Paul Goude, le renoncement du PS, la montée du FN, patatipatata.
Et après : le 11 septembre 2001, et sa conséquence, la « Global War on Terror ». Difficile d’ailleurs d’imaginer deux bornes plus visibles pour une décennie : 1989, la chute du mur ; 2001, celle des Twin Towers. Un régal, a priori, pour l’historien : une période bien définie est une période facile à évoquer. Sur le plan international, les années 1990 sont d’une limpidité exemplaire - sans pour autant avoir d’existence propre. Elles sont années de transition : la menace communiste vient de mourir. Les États-Unis, restés seule puissance en scène, se donnent le titre de gendarme du monde. L’ONU peut enfin un peu exister : c’est le temps des casques bleus, qui interviennent dans des conflits locaux (Yougoslavie, Rwanda), à l’opposé de la guerre mondiale dont la peur même finit par disparaître. On attend la menace suivante, on la cherche, on la pressent éventuellement (le premier attentat du World Trade Center en 1993, les attentats anti-américains de 1998 commandités, déjà, par Ben Laden), mais il faudra attendre le 11 septembre pour qu’elle soit claire : pour remplacer les Soviétiques, ce sera donc les islamistes, nouveaux ennemis de l’Occident. Durant cette décennie sans vrais méchants (en France, les attentats de 1995 sont le fruit des relations post-coloniales avec l’Algérie, autant dire que ça vient de loin), on s’ennuie un peu : d’ailleurs, il n’y aura aucune guerre en Irak entre 1991 et 2003, c’est un signe. Le monde aurait pu se concentrer sur une terrible menace millénariste... Ce sera le bug de l’an 2000 : on a vu pire, comme grande peur.
En France, il ne se passe pas grand-chose. Un Mitterrand mourant, un Balladur fantasme des élites, un Chirac revenu de tout mais n’allant nulle part. À l’automne 1995, les grandes grèves sont à la fois le seul épisode un peu vibrant de la période et le marqueur de la fin du septennat chiraquien (qui aura donc duré quelques mois). Puis ce sera les années Jospin, au début gentiment socialistes, avant d’être happées à nouveau par le glissement à droite. Bref, rien qui puisse donner une illusion similaire à la Bastille en 1981. Tout ça a une cause : les années 1990 voient le début de l’obsession sur les finances publiques. Les critères de Maastricht, préalables à l’introduction de l’euro, deviennent l’alpha et l’oméga de la vie politique française. « 3% de déficit » : c’est la formule magique des nineties, celle de Balladur, celle de la dissolution de 1997 censée préparer le pays à la rigueur budgétaire. On ne s’en est jamais remis, mais aujourd’hui on délègue la pression aux agences de notation.
La culture ? Guère probant : le nouveau roman se meurt et laisse place à ses enfants cyniques qui finiront par connaître le succès (prix Goncourt pour Echenoz en 1999), et Michel Houellebecq est considéré comme le seul écrivain capable de raconter le monde contemporain, ce qui en dit long. Au cinéma, la génération Femis (Desplechin, Ferrant, Bailly & Co) ne deviendra pas la nouvelle Nouvelle Vague espérée. À la télévision, Canal + n’est déjà plus vraiment impertinente (Bruno Carette, le plus « trash » des Nuls, est mort en 1989). Seule la musique n’a pas totalement renoncé à inventer. Le numérique n’a pas encore entamé son travail de démolition des positions acquises. Internet est encore virtuel : une notion qui gonfle puis qui explose (bulle spéculative crevée en 2000). Les téléphones portables ne se démocratisent qu’à la fin de la période, et le CD n’a pas encore été tué par le mp3.
Reste le sport : si le cyclisme (pourquoi lui seul ?) se prend les affaires de dopage en pleine figure, le foot sera, en France, l’acmé de la décennie avec ce moment magique de l’union black-blanc-beur de 1998. Magique ? Au sens où, lorsque l’illusion est terminée, il est temps de remballer ses rêves. En 2002, le parcours grotesque de l’équipe de France à la Coupe du monde ne suivra que de quelques semaines la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle.
Si les années 1990 n’ont pas de vie propre, pourquoi se pencher sur elles ? Pour cette raison justement, stupid. Par petites touches, tenter de dresser le portrait d’une période qu’on n’a pas vraiment vécue, puisqu’elle n’a pas vraiment existé.
[1] Notamment par François Cusset dans La Grande décennie, La Découverte, 2006.