


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


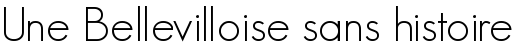
 |
|
|
Publié dans le
numéro 019 (Juillet-août 2012)
|
« Ménilmontant mais oui madame ; c’est là que j’ai laissé mon cœur... » Trenet a composé la chanson juste avant la guerre de 1939, pour célébrer le quartier de son enfance. Quatre-vingts ans plus tard, la « petite église » du premier couplet, Notre-Dame-de-la-Croix, surplombe toujours la colline. Mais l’ancienne gare, qui fut en service jusqu’en 1985 (« Où chaque train passait joyeux »), a été remplacée par une barre d’immeubles modernes, aux 7 et 11 rue de la Mare. La dépose des rails qui a suivi a donné naissance à la « coulée verte » ; les temps changent. Mais restons à Ménilmontant, donc, puisque c’est là que ça se passe, Ménilmuche, et remontons la rue en pente qui part de la station de métro homonyme. On dépasse là des bistrots où la pression mousse à deux euros au comptoir, et des traiteurs asiatiques ; XXe arrondissement, entre Belleville et l’Asie majeure. En haut de la bosse et en sueur, la rue Boyer dévoile sur sa droite, du 19 au 25, les édifices imposants, mais à la simplicité art déco manifeste, de feue la Bellevilloise : façades de briques et de béton armé, baies vitrées. Une plaque de la mairie de Paris rappelle que se déploya là l’une des plus belles aventures coopératives de la IIIe République : « Achat direct au producteur, vente directe au consommateur. » Dans le mur et en vis-à-vis se découpent en mosaïque les mots « Science » et « Travail », et puis : « La Bellevilloise, 1877-1927 ». Noces d’or de la coopérative avec le petit peuple parisien - justement la couleur des carreaux de faïence. Demeure l’air entêtant de Trenet : autre époque. Ou douce France.

Aujourd’hui, l’endroit est devenu « un lieu branché et arty » (Art actuel), « le dernier salon de gauche où l’on cause » (Les Influences), etc., 2000 m² à « l’ambiance berlinoise » (Elle) fragmentés en un loft, un club, un forum, un café-terrasse, dans une architecture de grands volumes et d’art brut, et qui ne laisse de séduire... autant le supplément « Sortir » de Télérama que les guides touristiques anglo-saxons ; autant d’avant-gardistes stylistes qui y organisent leurs défilés qu’Arnaud Montebourg qui y tint convention en octobre dernier pour y faire de la retape pour sa VIe République : comme si la Bellevilloise était devenue la dernière frontière. Un tel unanimisme cependant finit par interroger, et demande que l’on aille voir ce qu’il y a derrière la façade (décrite plus haut, mais en trompe-l’œil ?). Façade verbale d’abord. À la tête du lieu en effet, un « trio d’agitateurs issu du spectacle vivant, de la production et des médias » (ainsi qu’ils se présentent) qui manie assez bien la novlangue survitaminée de « My little Paris » : « workshop », « nouvelle cuisine bistro », « installations » - et bien sûr l’ineffable « jazz brunch » (deux sessions le dimanche : midi, puis 15h).
Je viens à la Bellevilloise un de mars où joue El Balcon, musiciens de tango, avec le projet d’écrire mon article in situ. À peine ai-je sorti mes cahiers et stylos, que des serveurs tout à fait dans le ton, tatouage et nuque longue, s’empressent de s’assurer que je compte bien dîner, que je n’ai pas l’intention de mobiliser une table toute la soirée pour mes gribouillis à jeun ; je les rassure en commandant un pichet de côtes-du-rhône et une entrée à base de poireaux braisés à la pomme et à la fourme d’Ambert : l’addition s’élève déjà à vingt euros. Attablé là, dans le brouhaha des couverts, légèrement enivré aussitôt par le vin et la voix entraînante d’une mujer porteña, le doute soudain me saisit : que suis-je venu écrire ? et puis, que suis-je, sinon un rabat-joie, un peine-à-jouir, avec pour seule compagnie moyennement sociale mes notes dactylographiées disposées devant moi, que je ne sais plus comment ordonnancer pour leur donner forme et éloquence ? Et vie. S’y côtoient anarchiquement le prix du cocktail Cosmopolite (Eristoff, Cointreau, citron, jus de cranberry, servi au bar, 9 euros), des extraits de discours que Jaurès prononça en ces lieux quelque cent années plus tôt, dans l’actuel loft, et le montant à l’actif de la société Oriza, gestionnaire de l’établissement (« Oriza a pour objet l’acquisition de lieux patrimoniaux ou historiques pour y développer des activités culturelles, événementielles, et de loisirs », indique, à l’onglet « raison sociale », le rapport du commissaire aux comptes que je téléchargerai par la suite sur le portail des Échos (8 euros), croyant reconnaître une machine à cash, mais en fait de mirifiques bénéfices, ne découvrant que des comptes à peine à l’équilibre, des fonds propres réduits à peau de chagrin, et cette mention légale : « Limite de crédit : zéro = entreprise en situation de défaillance et ayant un très fort risque de radiation » qui me fera envisager quelque société écran, quelque recette non déclarée, quelque système de maquillage des comptes - allégations que, sans preuve, je cache entre des parenthèses... Renaud Barillet, un des trois associés, que je rencontrerai quelques semaines plus tard, m’avouera qu’effectivement, il y a deux ans, quasi étranglée par un emprunt d’un million d’euros souscrit au moment de la réhabilitation du lieu [ou disons plutôt transformation - presque transformisme], la Bellevilloise ne fut pas loin de fermer ; que la recette d’un soir au bar, ce n’est pas un secret, ne dépasse pas 3500 euros ; qu’il y a soixante-dix postes salariés, peu de travail au noir ; et que non, la Bellevilloise n’est pas une vache à lait comme le sont assez rarement du reste les lieux de culture, à l’exception des boîtes de nuit du VIIIe arrondissement... [Il me confia cela alors que nous étions attablés à la terrasse du loft. Une gracile serveuse vint nous apporter, au cours de l’entretien, deux coupes d’un champagne qu’on était en train de déboucher pour une quelconque « privat’ », entendre privatisation, d’une partie du lieu : Coca-Cola, Danone, Thompson, et la moitié des entreprises du CAC ayant déjà fait se tenir leurs séminaires ou autres séances de team-building en la Bellevilloise. Pourquoi là plutôt que dans les salons d’un Sofitel que leurs profits pourraient autoriser ? Je pense : pour le plaisir de s’encanailler, de quitter les tours de la Défense pour les hauteurs du XXe arrondissement, le plus à gauche de Paris, pour le « social-washing ». On peut faire une demande de devis en ligne, sur le site de la Bellevilloise, et choisir ses options : vestiaire, mise en lumière. Ou open-bar.).

Le bar s’appelle La Halle aux Oliviers. Les arbres quelque peu empotés ne donnent pas de fruits. Mais c’est, il est vrai, un endroit original, voire magnifique (quoi qu’un peu fake), capable si vous n’y prenez garde, d’anesthésier tout esprit critique, le nom déjà s’inscrivant dans les tendances prescriptrices de l’époque - comme l’Occitane pour les soins de corps ou l’Olivier pour l’édition, une certaine idée de l’élégance et du bien-être... Des guirlandes lumineuses enroulées entre les baies d’un merisier du japon (en plastique ?), du vieux mobilier de brocante, des photophores rouges installés sur chaque table, et une charpente métallique qui rappelle que la Bellevilloise est un ancien haut-lieu, à la manière d’un haut-fourneau, de la culture ouvrière parisienne ; que s’y mena la lutte de classes ; qu’on y fit la guerre aux profiteurs. Le dos du menu plastifié, dressé sur chacune des tables, réécrit l’histoire des murs, avec un art consommé du story-telling : « Paris des libertés depuis 1877 », « forteresse culturelle » - aujourd’hui gardée par des videurs lors des soirées clubbing.
Il y a cinq mois, j’y étais allé, par un samedi soir polaire, rejoindre des amis que je n’ai jamais trouvés ; s’y donnait un concert de jazz manouche (un marqueur du lieu). Seul et ivre, j’ai eu le sentiment, auscultant le public euphorique, de ne voir que des cadres bancaires junior, des consultants en stratégie, ou des étudiants en beaux-arts. C’est de là que remonte ce projet d’article : d’un bonneteau musical, de maillots de corps et de sueur, du contentement de soi, et de rémunérations exprimées en kilo-euros, et de moi là-dedans, seul, et faisant sonner dans le vide les téléphones portables de mes amis restés dans les poches de paletots d’hiver aux vestiaires. Je suis sans, sans la Bellevilloise, et sans ses bourgeois-bohême, pensai-je alors, paraphrasant en esprit Aaron Pessefond. Un article qui aurait pour objet de raconter l’histoire d’un lieu, dans ses lignes de fuites, et contre le dithyrambe systématique, contre la filiation abusive, et, contre la spoliation de l’héritage, de demander la curatelle (ils ne savent pas ce qu’ils font). D’écrire un réquisitoire contre la Bellevilloise alors même que personne n’a porté plainte, et que la Bellevilloise est probablement innocente. Qui pouvant se revendiquer ayant-droits ?
L’histoire de la Bellevilloise est consignée dans un ouvrage universitaire corédigé sous la plume en surplomb de Jean-Jacques Meusy, épuisé, que je consulte sous les petits pots de lumière verte des salles de recherche de la BNF. Y est notamment reproduit in extenso une brochure, parue dans un vieux numéro de La Revue Socialiste (1912), qui solde l’héritage de la Bellevilloise première phase (1877-1910). Elle est signée par Louis Héliès, ancien ouvrier mécanicien lui même, devenu industriel, et qui sera député de l’Indre à partir de 1924. La plupart des références de cet article proviennent de ces deux sources.
La Bellevilloise est fondée en janvier 1877 par dix-huit ouvriers mécaniciens des maisons Cornély et Barriquand, et deux cordonniers, dans le XXe arrondissement. Elle est alors une coopérative parmi d’autres - s’inspirant des associations ayant fait florès sous le Second Empire, et qui entend permettre à ses membres de s’approvisionner à quasi coûtant en denrées de première nécessité. Le premier arrivage est rapidement écoulé : 2 pièces de vin rouge, 15 kg d’huile, 25 litres de lentilles, 25 litres de haricot, ½ caisse de macaroni, ½ caisse de vermicelles.
Forte de ce succès initial, la Bellevilloise étend rapidement sa base sociale - et commence à se forger une petite notoriété. Au 16 de la rue Henri-Chevreau, son premier siège, on loue maintenant aussi une écurie pour entreposer des vivres ; le loyer total s’élève à 400 francs. De semaine en semaine, les commandes vont augmentant : 3 briques de savon, 6 douzaines de saucisses, 3 kilos de saucisson de Lorraine, 4 kilos de riz, 2 vessies de saindoux, 2 jambons, 6 paquets de bougies. Il y a dans ces énumérations quelque chose de suranné – de rustique et de simple. Se laver, s’éclairer. Vivre. Le bouquin de Meusy était cité dans une émission de France Culture, La Fabrique de l’histoire, « Histoire de la nostalgie ». C’est exactement cela, les boules de naphtaline au fond de l’armoire coopérative d’un projet généreux et pas encore rongé par les mites. Un an et demi après les premières ventes, les recettes se montent à 333 francs par semaine. La répartition n’ouvre encore que le soir, deux fois par semaine. Les coopérateurs s’y relaient derrière la caisse après leurs journées de travail. Il n’y a d’abord pas de salariés, puis un, puis deux. Mais c’est encore l’époque des « carreaux brouillés » – les ventes ont lieu en fond de cour, dans une impasse zolienne, la marchandise nonchalamment achalandée.
On décide cependant de passer à la vitesse supérieure. D’acheter des livres de comptabilité, et d’établir les statuts de la société coopérative. Des épiceries de proximité, succursales de la Bellevilloise, essaiment au-delà même du XXe arrondissement. C’est l’heure des premiers grands choix d’orientation. Faut-il réserver tous les bénéfices résultant de l’activité coopérative à la « propagande politique » (sic), afin de conquérir des sièges électoraux, ou verser le trop-perçu aux sociétaires, dans une stratégie de fidélisation ? On opte finalement pour le trop-perçu.

Dans les archives en ligne de la BNF, je retrouve un exemplaire du journal de la coopérative : « publication semestrielle, organe de la Bellevilloise, société coopérative de consommation civile et anonyme, à capital et personnel variables », comme l’indique le bandeau. C’est le numéro 44, le seul à avoir été numérisé. Il est en date du 17 juin 1900. C’est aussi la date de l’assemblée générale annuelle qui vient de se tenir dans le gymnase municipal de la rue de la Bidassoa. La première page est en fait un fac-similé de la convocation adressée à l’ensemble des membres ; à l’époque, la participation aux réunions est obligatoire. Il y est fait mention que « sur ordre de M. le Préfet de la Seine, il est expressément défendu de fumer et de cracher dans l’enceinte du gymnase et ses dépendances ». La suite du bulletin est le procès-verbal de l’AG... sur près de 150000 signes, largement de quoi remplir un folio. En 1900, on ne plaisantait pas avec la gouvernance coopérative. Il fallait être patient pour le verre de l’amitié.
On est étonné à cette lecture de constater l’ambiance délétère dans son ensemble de la Belle, comme on commence à l’appeler. À l’ouverture de séance - premier incident -, on refuse l’entrée à des femmes qui se sont présentées avec le livret de leur mari. Quand le citoyen Dufaily monte à la tribune, sa voix est couverte par les huées de l’assemblée, accusé qu’il est de « fai[re] des bilans fictifs pour faire hausser le trop-perçu ». On lit tout ça avec gourmandise, c’est presque du voyeurisme, on regarde la scène à travers un oeil-de-boeuf qui mène vers les chapeaux de feutre, les pantalons à pince, et les moustaches grisonnantes. Rapport du contrôle : le citoyen Prothin parle de la qualité des vins « qui n’ont pas été bons cette année, et on a mis cela sur le compte des caves, qui ne sont pas bonnes ». Il y a aussi le rapport financier, le rapport de la commission d’enquête, le rapport de la commission des prêts, le rapport de la commission des fêtes, le rapport de la commission sur les accidents, le rapport de la commission sur la création d’un chantier aux charbons. Dans tous ces rapports, il est beaucoup fait référence à l’existence de pots-de-viniers, qui en sont vraiment ; Héliès raconte qu’à cette époque, lors des adjudications des marchés de vin, les dégustations étaient censées se faire à l’aveugle, les bouteilles n’ayant pas de signe distinctif, mais seul un numéro d’ordre, pour respecter des critères de transparence. Mais certains membres de la commission d’achat étaient notoirement corrompus : ceux-ci étaient initiés au choix des bouteilles à effectuer, par des complices... qui, discrètement, comptaient leurs boutons de manchette pour indiquer le bon numéro.
Cette préoccupation pour la vinasse (la qualité d’époque autorisant probablement le suffixe), est symptomatique et mérite une digression : dans un autre numéro de La Revue socialiste, je tombe par hasard sur un article au titre mystique : « L’alcoolisme et le parti Socialiste » (Georges Maurange). Le groupe socialiste à l’assemblée vient de voter contre le texte de loi proposé par le député dreyfusard Reinach, proposant une surtaxe des alcools. L’intègre Maurange, dont Google ne nous renseigne que très peu sur qui il fut, sinon homme politique du Libournais et candidat SFIO aux élections législatives de février 1921, s’insurge contre ce qu’il estime être une lâcheté de son camp : « L’alcoolisme est une conséquence du régime qui ne disparaîtra qu’avec le régime capitaliste lui-même. » Il écrit aussi qu’on peut avec des alcooliques faire des émeutes, qu’on ne fera jamais avec des alcooliques une révolution libératrice... Le caviste Nicolas a déjà à cette époque quatre dépôts (un dans le XXe, trois dans le XIXe).
Revenons en arrière. Le 9 septembre 1892, l’ouverture d’une panification au 23 de la rue Boyer a marqué la première implantation de la Bellevilloise dans ce qui deviendra son fief. Début 1897, la Bellevilloise achète le terrain, du 19 au 25, pour 70 000 francs. En mai de la même année, sur la parcelle du 21 ouvre une charcuterie en bordure de rue, avec derrière des aménagements pour la salaison, puis un an après, une buvette en rez-de-chaussé, au 19. On commence, au 17, la construction d’un long hangar, inauguré en 1901, qui fera office de dépôt de charbon... Et bientôt la Belle se lance dans une politique immobilière expansionniste, dont il fut écrit que sa finalité était d’en faire « un instrument de lutte de la classe ouvrière, capable d’aider les grévistes » (en 1906, la Bellevilloise donne en quelques mois en soutien à ses sociétaires grévistes 10000 kilos de pain et 2000 litres de lait), « les familles dans le besoin » (on distribuait des jouets aux enfants du quartier), et « de permettre aux ouvriers et aux gens modestes l’accès à l’éducation politique et à la culture » (des colonies de vacances prolétariennes sont organisées au « château d’automne » à Chambly). Un concours d’architecte est lancé en 1906 pour la création d’une Maison du peuple sur les terrains encore en partie nus de la rue Boyer. Le premier prix est décerné à un jeune architecte, Emmanuel Chaine, membre de l’école du béton armé. Son projet ambitieux, deux étages hauts de plafond (salle de répétition au premier, vaste salle des fêtes au second), a plu à la commission d’analyse des offres, qui s’inquiète seulement de ce que « les terrasses et combles avec clochetons [soient] peut-être superflus ». La première tranche (ciment armé, briques) est achevée en 1911, mais seulement du 19 au 21 et sur un étage - le projet en est à son tiers, et les coûts s’élèvent déjà à 350000 francs contre un budget initial pour l’ensemble de 195000 francs. Quand la guerre débute en 1914, la Bellevilloise est à son apogée, et compte près de dix mille membres.
Entre temps, au 25 de la rue Boyer, on a construit, en reprenant les idées maîtresses de Chaine : au premier étage, une bibliothèque populaire (la Semaille, 4000 ouvrages) ; au second, le théâtre Lénine (500 places avec balcons). Nous voilà au seuil des années 1920 : de très nombreuses œuvres sociales de la Bellevilloise sont basées rue Boyer (harmonie, esperanto, club scientifique ouvrier), les activités commerciales se limitant à la boutique de façade (vins, épicerie, charcuterie) et au vaste café contigu (au rez-de-chaussée, sur la gauche, La Choppe, dans lequel Maurice Thorez établira vingt ans plus tard son local de campagne, et dans lequel viendront se désaltérer ses colleurs d’affiche à bicyclette ; le café est orné d’un grand vitrail, une femme assise au pied d’un arbre, occupant toute la façade arrière. Il a depuis disparu, mais l’appellation de La Choppe est demeurée). Personne n’envisage encore de privatiser le lieu. Mais c’est déjà, un peu, le début de la fin.
Si la construction a coûté beaucoup plus cher que prévu, est-il écrit, c’est notamment en raison de l’instabilité du terrain - quand l’actuelle équipe reprendra le lieu, en 2003, l’Inspection générale des carrières lui demandera de fortifier les fondations, en injectant 700 mètres cubes de béton dans 38 puits à 36 mètres de profondeur. Le déficit est masqué un temps par des subterfuges d’écriture comptable du directeur de l’époque, dont je crus d’abord par erreur qu’il avait donné son nom de baptême à la rue, s’appelant Joseph Boyet. Après cinquante années d’existence, la Bellevilloise s’apprête à faire faillite. Mais tout le monde ne s’accorde pas sur l’origine des responsabilités. Sont-ce les « propos contre la coopérative adressés par le curé de Ménilmontant à ses ouailles » ?... Ou les communistes ?... En effet, en 1924, la Bellevilloise est passée chez les rouges ; elle participe en propre à une manifestation d’hommage à Lénine à Saint-Denis, et au moment de l’affaire Sacco et Vanzetti, un télégramme est envoyé à l’ambassade américaine au nom de la Bellevilloise - son cinquantième anniversaire est célébré dans les pages de L’Humanité du 27 novembre 1927. Mais l’explosion des coûts de construction, le fort endettement à la Banque ouvrière et paysanne, et puis, en lame de fond, la crise des années 1930 dans les quartiers prolétaires, font que, le prestige historique et le capital affectif demeurant difficilement monétisables, un jugement déclaratif de faillite est prononcé par le tribunal de commerce du 15 mai 1936 - ironie douce-amère, quinze jours après la victoire du Front populaire.
Il demeure des créances à rembourser, mais vu l’époque, le dossier reste longtemps en souffrance. La vente de l’immeuble de la rue Boyer, le dernier actif de la Belle, est réalisée au pire moment - durant l’Occupation. On rembourse comme on peut les petits prêteurs – beaucoup perdent de l’argent.
Ensuite chaque bâtiment, ressuscitant de sa belle mort, et loin des affres du projet coopératif, va connaître une existence autonome. Le 23 est touché par deux bombes alliées, le 21 avril 1944, à 0h15, puis 1h50 lors du bombardement de la gare de la Chapelle. Raymond Claude Labourrier le rachète en 1945, et en fait une fabrique de sacs et de serviettes d’écoliers (quarante ouvriers). En 1978, joli cadeau, il en fait donation à ses enfants, qui le louent à un café-théâtre, la Maroquinerie (nom choisi pour qu’on se souvienne de la précédente affectation des lieux), encore en activité. Du 25, je sais seulement qu’il accueillit la troupe-école de Niels Arestrup, puis une école de danse africaine. Quant aux numéros 19/21, ils demeurèrent siamois : rachetés d’abord par Louis-Charles Bourniac, puis, en 1963, par les Ets P. Chaumont confection, puis en 1966, par Organica (organisme de prévoyance des anciens combattants de l’Algérie), qui deviendra Cavicorg. Les bâtiments sont mis en vente en 2000. Des cartons d’archives au kilomètre, des monte-charge, des faux-plafonds, mais l’ossature est encore là. Et aussi : le génie des lieux.

Début du troisième millénaire : Renaud Barillet connaît depuis quelques années Michel Pintenet, devenu gérant de la Maroquinerie, et qui lui fait visiter les bâtiments abandonnés. Barillet, qui est déjà bien implanté dans le milieu des arts vivants, et souvent sur la route (Circus Baobab, année du Brésil en France, scénographie de L’Affaire Desombres, etc.) recherche un port d’attache. Initié et séduit par cet immeuble en friche, sans pétrole mais avec une idée forte (décloisonner), il part en quête de capitaux. En 2000, le premier tour de table est bouclé ; il y a notamment Rachid Taha, des personnes morales, et les associés actuels. Le montage un peu baroque finit en SCI. Il y a ce qu’on me raconte, et que je peux retranscrire, et le reste que je ne sais pas. Ce qu’on me dit : parmi ceux qui ont mis au pot, certains se sentent l’âme de marchands de biens, veulent allotir les espaces pour les vendre en un programme immobilier, où que le retour sur investissement est le plus prometteur. Émerge un trio séparatiste, et aux idées minoritaires. Qui finit par trouver la combine : un intermédiaire financier, Foncière immobilière, rachète le lieu pour le mettre à disposition sous couvert d’un bail commercial. Les investisseurs du départ ont été écartés. De 2003 à 2006, c’est l’heure des grands travaux. On loue à des tournages de cinéma (Ozon, par exemple) ces grands lieux qui se vident et s’aèrent, les recettes paient la rénovation, etc. Dès les débuts, il s’agit aussi de donner des gages à ceux qui craignent que, sous l’occupation d’une entreprise culturelle, la mémoire des lieux ne se dégrade - et pas seulement immatérielle. Une association des amis de la Bellevilloise est opportunément créée ; présidée par Arlette Alphaize-Furet (aujourd’hui directrice de salons chez Comexposium, n’a pas répondu à mes messages), avec Meusy en membre d’honneur et caution morale, loi 1901 comme un label. Mais c’est surtout l’occasion de signer une convention tripartite de rénovation avec la fondation du Patrimoine - (une association est requise, serait-elle coquille vide), et de lever des fonds publics (700000 euros). Ces deux dernières années, le programme (financé conjointement par le mécénat de Total, la Ville et la Région) a donc permis de redonner à l’immeuble partie de son cachet d’antan ; restauration des baies vitrées, des balcons, des mosaïques. Une marquise en verre et fer forgé doit être reconstruite dans les tons de l’époque. On pourra y lire, comme il y a un siècle : « Émancipation ».
Il y a quelques semaines, nous avons reçu au Tigre un dossier de presse de la Bellevilloise concernant un nouveau rendez-vous se tenant chaque samedi matin, mixant les activités, « du terroir urbain » à l’atelier des saveurs, en passant par des « impromptus créatifs » ou « l’échoppe des producteurs », offrant de rencontrer des cavistes, fromagers, apiculteurs, « défricheurs des dernières tendances de leur secteur d’activité ». La chargée de communication nous demandait de lui transmettre quelques exemplaires du Tigre pour sa table de lecture, dans l’optique d’une « pérennisation d’un partenariat entre [n]otre titre et [son] établissement », et contre l’assurance de nous voir offrir « un écrin optimisé qui concourra à une belle visibilité pour cette sélection presse des plus qualitatives ». Le Tigre n’a pas donné suite.
J’y suis allé cependant par curiosité un samedi du mois de mai. Il n’y avait pas grand-monde, j’ai acheté un saucisson auvergnat à cinq euros, une naturopathe attendait devant des petits pots de tartare d’algue frais tandis que son compagnon se proposait d’installer, au dos de mon téléphone mobile, un petit sticker ésotérique pour lutter contre les ondes électromagnétiques. J’ai vu sur le présentoir Technikart, Causette, Télérama. Au milieu de la halle, on pouvait déguster la sélection de la semaine de l’assiette du fromager, des petits carrés d’un persillé du beaujolais piqués sur cure-dent, d’une cave orléanaise, dont il était écrit que « pour un bleu, il était quand même doux, onctueux, fondant et ferme »...
On peut voir, je crois, la Bellevilloise, comme un concept store (mais pas tant de biens marchands que de services), dont le brunch dominical ou les Nuits Zébrées seraient les articles identitaires comme l’est le bar à eau de Colette. Bazar culturel chic, il y a naturellement à boire et à manger, mais aussi, à penser (Terra Nova y tient des débats mensuels), à danser (soirées Contradanza de tango), ou à acheter (foire d’art abordable). Tout finalement se dilue, se nivèle, s’agrège : le bétonneur Vinci et la semaine anticoloniale, la fondation Abbé Pierre et Valérie Pécresse, qui y tient aussi son club. (D’ailleurs, Fabrice Martinez, l’un des associés, le concède dans une interview donnée en mars à BFM Business : « Nous ne mettons pas la Bellevilloise au service de la gauche. Nous ne faisons pas de discriminations, la Bellevilloise est une entreprise privée. » Fabrice Martinez a un homonyme qui est un célèbre trompettiste. Lui a fait carrière dans le marketing ; passé d’abord chez Nike, puis Canal +.)
La Bellevilloise, je le crois, a surtout peur de la tristesse et de la mélancolie ; sa programmation est une injonction à se mouvoir et à sourire, dans une sorte d’hystérie sans fin. Les bals du dimanche à dix-huit heures doivent incarner cette « Bellevilloise qui ne souffre pas les angoisses de fin de semaine », dixit la programmation. Qui ne connaît pas non plus les bains du dimanche soir, les chemises qu’on repasse pour la semaine à venir, ou la paperasse qu’il faut bien un jour trier.
En 1938, c’est dans la Bellevilloise, choisie pour sa proximité avec le Père-Lachaise, mais déjà dissoute, que l’on célébra la veillée funéraire lors des obsèques de Virgilio Diaz, « secrétaire du Comité international d’aide à l’Espagne républicaine, assassiné lâchement par un sbire du fascisme international à la solde de Franco » (L’Humanité). À l’époque, les larmes étaient aussi permises - on savait qu’elles faisaient partie de la vie.
J’interroge Renaud Barillet sur ce qui me tient à cœur : le devenir du projet politique. Posant la question, je pense à ça : à cette grande fête prolétarienne de l’été 1905 à Chantilly durant laquelle la Bellevilloise fournit le pain pour le repas champêtre. À la politique de bas-prix. Aux consultations médicales gratuites. À ces enfants de la Semaille à qui l’on faisait crier « vive les Soviets ». À cette citation griffonnée : « À tous ceux qui ont sollicité leur entrée, on ne leur a pas demandé leur couleur, mais s’ils voulaient travailler à l’émancipation morale et matérielle du prolétariat »... À ce rayon de produits frais de mars 1927 à prix réduits dans lequel tous les chômeurs pouvaient se faire servir au vu de leur carte. À ces associations, les Joyeux Prolos du XXe, les Coquelicots du XXe, le Théâtre ouvrier de Marcel Thoreux, qui avaient pignon sur rue, à ce prestidigitateur qui tira un portrait de Lénine de son chapeau.
Ce qui se conçoit bien s’exprime clairement. L’éditorial du magazine bimestriel de la Bellevilloise est en cela édifiant. J’en ai lus trois, et je n’ai jamais compris quel était le propos. Pour le numéro de ce printemps, comme une invite à se rendre aux urnes, les fondateurs de la Bellevilloise écrivaient : « Pas de raison d’attendre sauf à stagner solitairement dans ce bain de luxe républicain qu’on croit acquis [...]. Se mobiliser contre ceux qui veulent nous restreindre à l’espace étriqué auquel nous assignent ceux qui craignent qu’on siphonne leur champagne tiède et qu’on jalouse leurs minables prérogatives. » C’est dans cette prose alambiquée qu’il faut essayer de décrypter un projet politique qui s’ignore, même s’il est régulièrement rappelé.
J’interroge donc Renaud Barillet. « L’histoire coopérative du lieu, un alibi ? Non, je ne crois pas, en toute franchise, mais oui bien sûr que cela participe d’un fonds de commerce ; on n’a jamais cherché à se cacher de ce qu’avait été le lieu avant nous, mais on n’a jamais dit non plus qu’on allait en faire une copie - en un siècle le monde a changé. Je suis admiratif bien sûr de la démarche culturelle, artistique, commerciale au sens noble du terme, des pionniers de la coopérative de 1877, de la création de cette bibliothèque populaire, de ce dispensaire qui offrait des soins gratuits aux plus démunis ; mais aujourd’hui, à la différence de 1877, il y a l’État-providence, la CMU, la puissance publique, qui se chargent de la délivrance des prestations médicales. Moi ce qui m’importe, à travers ce lieu, c’est aussi de rappeler aux jeunes générations qu’il existait déjà il y a un siècle à cet endroit un bar à vin - même s’il n’était pas référencé par À nous Paris. Les prix. Les prix. On me parle souvent des prix. Eh bien nous sommes au prix d’une brasserie d’un certain standing du quartier, comme le Gambetta Café par exemple, mais avec en plus un concert gratuit cinq soirs par semaine. »
N’empêche. Que. À la carte - dont un insert rappelle que c’est bien ici qu’on expérimenta l’idée de Proudhon du commerce équitable avant l’heure -, la première bouteille de blanc est à 24 euros : un côte-de-gascogne Domaine du Joy « L’esprit » bio 2010. En carton de six chez le viticulteur, la bouteille se vend à 4,95 euros. La culbute est de 500 %...
Il n’y a pas matière à beaucoup de reproches à la Bellevilloise, ou à ses trois directeurs. Gens charmants. Il y a tout juste de quoi raconter l’histoire d’un renoncement, qui est aussi celui d’une société, où l’on peut faire marketing d’une histoire qui dit exactement le contraire de ce qu’on prétend, où Jaurès devient une marque, où l’esprit coopératif peut parfaitement se dissoudre dans un pacte d’actionnaire, où Total et ses milliards de bénéfices, via sa Fondation, peuvent financer la réhabilitation de l’endroit en son jus, et une nouvelle marquise, et pourquoi pas une faucille et un marteau au besoin, où ce qui prime, c’est bien la faculté d’écrire un récit, où plus rien ne compte tant, comme projet politique, que le « vivre-ensemble », qui signifie souvent vivre entre soi, et que la société du spectacle a bien terrassé les « marchands de haricots », ainsi que les détracteurs de la Belle appelaient les coopérateurs il y a un siècle, pour les remettre à leur « juste » place. Le projet de la Bellevilloise est celui du caméléon (mobilité indépendante des yeux, langue protractile pour attraper les proies à distance, capacité à changer de couleur) plus que du gai rossignol.
C’était en avril 2012, à la Bellevilloise. Dans le Libé de jour - que sur une table à l’entrée, des hôtesses d’accueil distribuent à l’œil, comme si c’était un gratuit, en bradant des abonnements -, un encart en une annonce : « En mai 2012, choisissez le Roi. » En première page intérieure, la suite se déploie : « Votez Vico, le roi de la pomme de terre, votez futile. » Libé fut fondé par Sartre, July et la bande maoïste. La Bellevilloise par vingt ouvriers mécanos. Il reste de ces années rouges, dans les deux cas, un décor, une fragrance. On s’en vaporise à peine, et ça sent bon.