


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


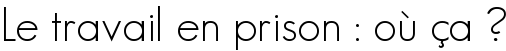
 |
|
|
Publié dans le
numéro 03 (13-26 mars 2010)
|
Assemblage de guirlandes électriques, pliage de couronnes des rois, conditionnement de cotillons, préparation de coffrets « spécial fête des Mères », packaging pour les offres promotionnelles, insertion de périodiques dans des sachets en plastique, emballage de Post-it... Autant de taches manuelles que certaines entreprises sous-traitent aux prisons ; des activités faiblement qualifiées pour la plupart, et qui nécessitent par intermittence un important volume de main d’oeuvre. L’imprimerie, la confection, la cosmétique, l’automobile et le marketing sont les secteurs qui font le plus souvent appel aux ateliers pénitentiaires. Les ouvriers incarcérés ne manquent pas d’atouts, ainsi que le rappelle la maison d’arrêt de Strasbourg dans un film publicitaire destiné à des entrepreneurs alsaciens : « Une main-d’oeuvre payée au rendement, travaillant douze mois sur douze, pas d’absentéisme, pas de conflits sociaux ». Autres avantages pour les « employeurs » : des ateliers mis à disposition gracieusement, un encadrement pris en charge par l’Administration Pénitentiaire dans la majorité des cas, et peu ou pas d’investissements à faire en matière de mises aux normes des locaux et des machines de production. Des avantages similaires à une délocalisation en Chine ou en Roumanie, le décalage horaire et les frais de transport en moins... En France, sur ce type d’emplois intérimaires très bon marché, seuls les Esat [1], où travaillent les salariés handicapés, peuvent rivaliser avec les prisons. L’absence de contrat de travail donne en outre presque tous les droits aux concessionnaires [2] présents dans 181 des 197 prisons françaises au 1er janvier 2010 : les entreprises gèrent leur production à flux tendu, interrompent et reprennent l’activité à leur guise, sans la moindre indemnité à verser. Comme le dit une brochure du Ministère de la Justice, qui parodie un jeu de Monopoly [cf. illustration] : « COMMANDE IMPREVUE | TRAVAUX URGENTS | BUDGET SERRE | EFFECTIFS INSUFFISANTS Rendez visite à la prison ; « Problèmes de planning pendant les mois chargés ? Pas de panique ! la prison vous accueille toute l’année ! »
Vendredi 20 mars 2009. Premier contact avec Claire G., directrice de la communication de Bic France. Affable et posée, prête à discuter quelques minutes de tout et de rien (« Vous êtes pigiste pour la presse économique par ailleurs ? Longtemps que vous travaillez sur ce sujet ? »), elle ne semble pas être surprise de la requête (« Bic fait-elle travailler des détenus dans des maisons d’arrêt ou/et des centres de détention ou maison centrales ? »), et promet de me rappeler. Ce qu’elle fait très rapidement puisque, sept minutes après notre premier échange, mon portable sonne. Claire G. est cette fois plus directive et concise : « Je vous rappelle car on ne fait plus travailler de détenus depuis 2005. Désolée, on ne va pas pouvoir vous aider, bon courage pour votre enquête ! » Comme elle s’apprête à raccrocher, je tente de la retenir :
- Oui, mais ce n’est pas grave, ce serait intéressant d’avoir votre retour d’expérience ; mon livre ne s’inscrit pas forcément dans l’actualité.
- Il faudrait trouver quelqu’un qui connaisse bien le sujet, c’était il y a quand même longtemps...
- Vous semblez avoir des personnes ressources en interne puisqu’en sept minutes vous avez été capable de me dire que Bic ne faisait plus travailler de détenus depuis 2005...
- Oui, bon, alors vous m’envoyez un mail, et je vois si c’est possible que vous rencontriez quelqu’un.
Une semaine plus tard, le 27 mars, la directrice de la communication de Bic rappelle, pressée, cette fois, de clore le dossier :
- On ne va pas pouvoir répondre à vos questions, les personnes qui s’occupaient de ça à l’époque ne sont plus là. J’aurais été ravie de pouvoir vous aider car, je vous parle honnêtement, cela n’aurait pas été inintéressant pour Bic de se retrouver dans une étude de ce type.
- Ces personnes sont-elles parties à la retraite ?
- Monsieur, je sais que vous essayez d’avoir des témoignages d’entreprises et que cela est difficile à obtenir, mais malheureusement, je ne vais pas avoir les gens ni la matière pour vous. A la limite, moi, à votre place, je ne mentionnerais pas la marque Bic dans votre livre puisque malheureusement, vous n’avez pas assez de détails à développer, à part dire « Bic était en prison, Bic l’a fait ». Alors oui, ce serait une petite anecdote de citer Bic parce que tout le monde connaît, mais c’est tout. Non, je serais vous, je citerais d’autres exemples d’entreprises.
Claire G. prend cette fois congé, non sans préciser qu’elle reste à ma disposition pour d’autres sujets, « pourquoi pas, par exemple, un sujet sur les sportifs qui représentent notre marque dans les campagnes de publicité ? ». Poursuivant l’enquête, j’appelle, peu de temps après , la responsable travail de Fleury-Mérogis, Madame Yanic Euranie [3], qui m’indique avoir vu, en 2009, des produits BIC en cours d’assemblage dans certains ateliers de la plus grande prison d’Europe. L’occasion est trop belle pour ne pas rappeler, sur le champ, Claire G., qui se montre hélas passablement excédée :
- On fabrique 24 millions d’articles de papeteries, 5 millions de briquets, 11 millions de rasoirs par jour. Alors, il se peut, je dis bien il se peut, qu’on ait fait emballer une petite promotion par une prison il y a quelques mois, c’est possible avec le nombre d’articles que l’on brasse tous les jours. En tous cas, le travail régulier qu’on donnait à l’époque en prison, on ne le fait plus.
- Une responsable travail d’un établissement pénitentiaire me dit que Bic est actuellement présent sur le site. Peut-être est-ce un de vos sous-traitants ?
- Je n’en sais rien mon pauvre, vous savez combien nous avons de références ? Sans parler des opérations promotionnelles ! Je vais vous écrire un texte pour vous expliquer.
Tenant parole, Bic envoie, le 19 mai 2009, un long mail dans lequel on apprend que l’entreprise « a sous-traité du travail en prison, notamment dans les prisons de Fleury-Mérogis et d’Osny, depuis la fin des années 1970 et jusqu’en février 2006, date à laquelle le groupe a transféré l’ensemble de ses activités de co-packing réalisées pour le marché européen, dans un centre européen dédié ». Et de préciser les tâches réalisés par les prisonniers : « Type de travail sous-traité : Articles d’écriture : Mise sous pochette de certains instruments d’écriture (stylos à bille BIC Cristal, BIC Orange et autres modèles) destinés à être commercialisés en France dans le circuit de la grande distribution. Briquets : Apposition d’étiquettes promotionnelles et mise en place des briquets dans des présentoirs promotionnels. Rasoirs : confection de lots promotionnels (type deux pochettes similaires dans une plus grande pochette) et montage/remplissage de présentoirs de rasoirs ». Un souci des détails qui honore la marque, laquelle, deux mois auparavant, se disait incapable de nous donner la moindre précision. Apprenant qu’elle serait cité dans notre ouvrage, la marque a sans doute préféré modifier quelque peu sa communication. Le mail envoyé ne se termine-t-il pas d’ailleurs par ce vibrant hommage aux ouvriers-détenus : « Bic a toujours été très satisfait de cette collaboration, en particulier de la qualité du travail effectué et de la réactivité » ?
Agnès b. dit n’avoir fait appel à la sous-traitance carcérale qu’une fois : « A priori, l’intervention des prisonniers sur les rouges à lèvres Agnès b. s’est passée antérieurement à 2003. C’était une action très ponctuelle, localisée et assez rare. Un sous-traitant qui avait pour mission de reconditionner des rouges à lèvres dans un fourreau ouvert, à la place du fourreau fermé dans lequel il étaient jusque là présentés. C’est le sous-traitant qui avait pris cette décision de son propre chef, la décision ne venait pas de chez nous », explique Catherine P. [4], responsable communication du Club des créateurs de Beauté, auquel appartient Agnès b.
- Savez-vous dans quelle prison cette activité a été réalisée ?
- Non malheureusement, je ne sais pas. Ce n’est pas de la mauvaise volonté. On ne l’a fait que pour UNE opération. Mon rôle ce n’est pas de vous mener en bateau ou de vous raconter des histoires...
- Avez-vous la possibilité de me mettre en relation avec le sous-traitant ?
- Le problème, c’est que le sous-traitant, on en a perdu la trace...
- Mais si vous avez retrouvé la trace de la facture dans vos archives papiers, vous devez bien avoir son nom...
- Attendez, attendez (elle parle à voix basse à un interlocuteur), on me dit que la personne qui s’occupait de ça est partie à la retraite. C’était Michel, qui est parti à la retraite il y a douze ans, non dix ans. (Une pause, elle parle toujours au même interlocuteur). Alors, alors, je vais être encore plus claire : on a eu vent de cette histoire car, déjà, vous nous en avez parlé, et puis aussi on a reçu en 2005 une lettre d’un détenu qui avait participé à cette opération et qui voulait savoir si on allait continuer parce qu’il avait aimé travailler pour nous, enfin... pour le sous-traitant.
- Un détenu nostalgique de cette activité qu’il aurait réalisé une seule fois en 2003, vous aurait donc écrit pour vous inciter à revenir en prison ? Je pourrais écrire cette anecdote dans mon livre, s’il vous plaît ?
- Ben oui, pourquoi pas.
- Avez-vous encore ladite lettre et puis-je en lire un extrait ?
- La lettre, on ne l’a plus, non, ce n’est que de la mémoire orale...
- Qui s’est souvenu alors de cette lettre chez vous ?
- C’est une personne qui l’a dit à untel, qui l’a dit à untel, et ainsi de suite. On n’a pas retrouvé cette lettre, qui a bel et bien existé, mais ce que nous en disons, c’est que ce n’est que de la mémoire transmise, il n’y a plus de trace aujourd’hui.
- Donc, si votre mémoire orale est défaillante, votre présence en prison a pu durer un peu plus longtemps... Une de nos sources nous indique avoir vu des produits Agnès B en 2006, soit trois ans après votre unique opération de fourreaux de rouge à lèvres...
- Non, je ne pense pas, quand même... On en aurait entendu parler...
Si certaines marques ou entreprises sont difficiles à débusquer, d’autres me sont spontanément citées par l’Administration pénitentiaire ou par d’anciens gardes des sceaux. C’est le cas pour Yves-Rocher qui, malgré la « recommandation » de l’Administration pénitentiaire, tarde à rentrer en contact avec nous ; je finis par pouvoir lui parler :
- Je vous rappelle concernant un livre sur le travail en prison...
- Oui, je me rappelle très bien, malheureusement, je n’ai personne qui pourrait vous aider là-dessus.
- Comment ça se fait ? ça se passe pourtant dans votre usine à Ploërmel...
- Oui, je sais très bien, mais ça se passe en local, et les personnes que j’ai contactées n’ont pas forcément envie de prendre la parole sur le sujet.
- Vous ne souhaitez pas communiquer là-dessus ?
- Enfin... Disons que nous n’avons rien de particulier à dire sur le sujet.
- Quand vous avez eu des salariés de l’usine de Ploërmel, quelles ont été leurs réactions ?
- Ils ont dit que oui, on faisait ça mais que voilà, ils ne voient pas ce qu’ils peuvent ajouter à ce qui est dit et ce qui est fait. Je n’arrive même pas à avoir une idée de chiffre, de quantité de ce qui est fait en prison, je n’ai aucune idée. Ça m’est compliqué d’obtenir ces informations depuis Paris [...] Bon, écoutez, je ne ferme pas la porte, je vais essayer de les relancer. Il y a eu un changement de direction sur le site de Ploërmel, je vais voir avec le nouveau directeur [5].
Deux jours après, Vannina B. me rappelle :
- J’ai réussi à faire un point sur ce que vous m’aviez demandé. Nous travaillons sur des activités très saisonnières, Noël, la Saint Valentin, etc. Il s’agit de mise en coffret de nos produits pour des offres promotionnelles. On fait travailler la prison de Lorient-Plomeur, mais aussi d’autres prisons de Bretagne. On sous-traite depuis longtemps en prison mais on a de plus en plus tendance, pour respecter l’obligation légale concernant les travailleurs handicapés, à privilégier les Esat, afin de tendre de plus en plus vers les 6%, ça se durcit [6]. A moyen et long terme, on risque de ne plus avoir de travail à donner aux prisons. Donc je ne sais pas si c’est intéressant pour vous de nous citer. Même si ça ne va pas totalement disparaître, ça risque de fortement diminuer.
- Vous êtes présents d’abord pour des raisons de coûts ?
- Pas forcément, parce que vu la petite part de cette activité, ce n’est pas non plus un gain de coût énorme. C’est aussi le fait de pouvoir faire travailler des gens. On va davantage le faire avec des personnes handicapées, ça reste en Bretagne et ça reste dans nos valeurs.
- Est-ce pour vos valeurs que vous avez choisi de faire travailler des détenus ?
- Oui, ça fait partie de nos valeurs mais, comme pour d’autres actions réalisées à petite échelle, on ne s’en vante pas. L’histoire de monsieur Yves Rocher s’est faite notamment autour de la volonté de créer des emplois dans sa ville natale de La Gacilly, qui était soumise à l’exode rural. La naissance du groupe vient de là. Fournir du travail et contribuer à la réinsertion de certaines personnes, ça fait partie de ses valeurs.
- L’absence de droit du travail, les rémunérations aux lances pierres, ce sont vos valeurs aussi ?
- J’y connais rien, Gonzague [7]. Ce n’est d’ailleurs pas le sujet, je crois. Vous êtes en train de me demander si le travail qu’on fait faire en prison respecte le droit du travail, or vous m’avez sollicité pour parler du genre de travail qu’on donnait en prison et me demander pourquoi on le donnait. Là, vous lancez une polémique, ça ne va pas.
Chez EADS, la réponse arrive plus vite. Nous sommes le 3 avril 2009 lorsque l’assistante de Pierre B., directeur de la communication, nous indique que « ça touche un fournisseur d’EADS, qui emploie des détenus pour faire un certain travail, ça ne touche pas EADS directement. C’est du côté de Toulouse, au centre de détention du Muret ». Plutôt que de nous passer Pierre B., « qui ne va pas vous dire autre chose que moi, je vous conseille d’appeler directement la direction de communication d’Airbus. Nous, on s’occupe de la communication corporate du groupe, l’image de notre président et les situations de crises. Les sous-traitants, on ne les gère pas ici, c’est Airbus qui gère ses propres sous-traitants ». Contacté par téléphone, Jacques Rocca, responsable des relations presse d’Airbus, dit effectivement avoir entendu parler de sous-traitance en prison, mais ne confirme pas qu’il s’agit d’un sous-traitant d’Airbus : c’est peut-être une autre entité d’EADS, « Toulouse ne signifie pas forcément Airbus ». Pour plus de précisions, il conseille de s’adresser à Frédéric Agenet, DRH d’EADS. L’assistante de ce dernier me transfère sur le poste de Sylvie Robin, laquelle m’invite à appeler... Jacques Rocca. Entre temps, je me rends au 10-12 rue du Renard, dans le IVe arrondissement de Paris, à la rencontre de Laurent Ridel, sous-directeur des personnes sous main de justice, numéro deux de l’Administration pénitentiaire, qui ne me donnera pas non plus le nom de ce fameux sous-traitant d’EADS, « étant tenu à la discrétion ». Au cours de cet entretien, Laurent Ridel précise que la crise économique a détruit « 458 emplois en 2008 », en raison notamment du départ « des sous-traitants automobiles, très présents dans les établissements du Nord de la France ».
Des sous-traitants automobiles ? Me voilà parti sur la piste de Renault. L’entreprise affirme n’avoir aucun lien avec le milieu pénitentiaire. « Nous n’avons pas trouvé de prestations de ce type, ni directement commandées par Renault, ni via des fournisseurs directs. Il y a peut-être des prestations ponctuelles par des sous-traitants de nos fournisseurs, mais c’est difficile à savoir pour nous car nous ne sommes pas en relation avec eux [8]. » Pourtant, d’anciens détenus et des personnels pénitentiaires citent spontanément la marque au losange lorsqu’ils donnent des exemples de grandes entreprises présentes dans les ateliers pénitentiaires. C’est le cas de Gepsa, filiale de GDF-Suez, co-gestionnaire de prisons et concessionnaires dans plusieurs prisons publiques [cf.encadré], qui confirme, dans sa plaquette promotionnelle numérique, que Renault compte bien – indirectement – parmi ses clients. Sur une des photos en effet, on voit très nettement un « opérateur détenu » coller une clef de voiture sur un dépliant publicitaire à l’effigie du constructeur automobile. Les jeux concours avec des « clefs gagnantes » distribués dans les stations services ? Un travail dont se souvient très bien Patrick [9], incarcéré cinq ans dans plusieurs établissements pénitentiaires entre 2005 et 2010, qui a également fabriqué des brosses de voiture non griffées. Assemblage de pare-brise, fabrication de tapis de voiture, d’amortisseurs en caoutchouc, mise sous plastique de notices, etc. Hormis durant la crise, il n’est pas rare que les fournisseurs automobiles, à l’instar de Faurecia et de Carbone Lorraine, sollicitent les détenus pour réduire leurs coûts.
Difficile également d’obtenir un récit de Redcats (groupe PPR), qui détient La Redoute et la Maison de Valérie, deux marques citées par plusieurs surveillants et présentées dans le rapport de Paul Loridant (cf. bibliographie) comme les premier et troisième clients des ateliers coordonnés par le Service de l’emploi pénitentiaire (SEP). Paul Loridant rapporte que les deux entreprises spécialisées dans la vente par correspondance se sont acquittées en 2000 de factures respectivement de 784 785€, l’autre de 589826€. Malgré les montants indiqués dans ce rapport, personne à La Redoute n’a jamais entendu parler de production en prison. Il faudra plusieurs relances pour entendre que « ce type d’activité a pu avoir lieu, mais alors il y a très, très longtemps. Aujourd’hui, toutes les personnes qui auraient pu apporter des précisions sont parties », regrette un collaborateur proche de la direction. Michel Wicquart, directeur du SEP, connaît visiblement mieux le dossier : « Nous travaillons pour Redcats, essentiellement pour La Maison de Valérie. On produit pour eux du petit mobilier, des tables de chevets ou des petites armoires, fabriqués par les prisonniers du centre de détention de Muret (Haute-Garonne). Nos produits sont ensuite proposés sur le catalogue de la Maison de Valérie », explique-t-il dans son bureau de Tulle (Corrèze) [10]
Et L’Oréal ? C’était le premier nom d’entreprise que m’avait cité Yanic Euranie, responsable travail de Fleury-Mérogis, dont les propos avaient été confirmés par de nombreuses sources. Sur une photographie mal floutée de la plaquette commerciale de la Gepsa, on devine aisément les logos Fa, Le Petit Marseillais, Elsève... Contacté à plusieurs reprises, le service communication de L‘Oréal joue la montre tout en assurant qu’il donnera, en temps et en heure, une réponse. Sans doute lassée de me dire que sa responsable « rappellera très bientôt », Sandrine Diagana, adjointe du service, décide un beau jour de faire les questions et les réponses : « Il y a eu trois réunions en interne sur votre sujet. Donc, est-ce qu’on avance sur votre demande, oui, est-ce qu’on a des infos, oui, est-ce que Ghislaine Mercier (la responsable du service communication, NDLR) va vous rappeler pour vous donner les infos, oui, en revanche, est-ce qu’on peut vous donner tout de suite les infos, non. » Deux mois plus tard, L’Oréal n’a toujours pas donné suite à mes demandes d’interviews. J’ai entre-temps rencontré Dominique Orsini [11], responsable du travail à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, qui confirme les propos de Yanic Euranie avec aplomb : « Pas de langue de bois : dans sa charte éthique, la société l’Oréal met en avant l’interdiction du travail des enfants et des prisonniers, or tous les échantillons de L’Oréal ou presque se font en prison ».
La liste pourrait s’allonger encore. Les multinationales et grandes entreprises sont-elles sincères lorsqu’elles disent ne pas être au courant de ce travail de l’ombre ? « Vu la manière dont elles pressurisent leurs sous-traitants pour obtenir les meilleurs prix, elles doivent forcément s’en douter », répond un concessionnaire. « Les grands groupes qui ont recours à des sous-traitants sont au courant que ces derniers sous-traitent en prison ou alors c’est qu’ils ne veulent pas le savoir », affirme quant à lui Paul Loridant [12]
Quelques-uns, très rares, assument le recours au travail en prison. Et la plupart s’en tiennent sans doute au discours que nous a tenu un directeur des achats d’une filliale de Colas (groupe Bouygues) : « Je n’ai pas très envie de connaître les rémunérations des détenus... Je préfère ne pas savoir... Lorsque je fais travailler des Esat, des prisons ou des pays low cost, si je commence à me poser des questions fondamentales, je ne fais plus mon métier. »
Ces questions, rares sont ceux qui essaient de les poser. Si le SMIC devenait la règle en prison, il y a fort à parier, en effet, que les entreprises se détourneraient des geôles françaises. « Si on instaure le Smic, il n’y aura plus de travail, c’est une certitude, affirme Paul Loridant. C’est exactement ce qui se passe en Italie, qui applique en prison le droit commun du travail et qui connaît un taux d’activité aux environs de 20 pour cent seulement... Certes, idéalement, il faudrait un Smic, mais pourquoi alors ne pas instaurer les conventions collectives de la métallurgie, de l’imprimerie, etc ? On n’en sortirait pas. » Cette démonstration, implacable dans l’économie de marché dominante, permet de maintenir en l’état les faibles rémunérations. Au-delà de l’argument économique, un autre principe rend difficile l’alignement des salaires, ainsi que l’a rapporté Robert Badinter lors de son audition à l’occasion de l’enquête parlementaire menée en 2000 : « Une loi d’airain pèse sur la prison. Je l’ai appelée « loi d’airain », car je ne l’ai jamais vue démentie : vous ne pouvez pas, dans une société démocratique déterminée – je ne parle pas des prisons totalitaires, car l’idée même de respect de la dignité humaine n’existe pas – porter le niveau de la prison au-dessus du niveau de vie du travailleur le moins bien payé de cette société. Le corps social ne supporte pas que les détenus vivent mieux que la catégorie sociale la plus défavorisée de la société. » Ce n’est pas en tout cas la dernière loi, votée en urgence au Sénat le 6 mars 2009, juste avant le départ de l’ancienne Garde des Sceaux Rachida Dati, puis adoptée par l’Assemblée Nationale, qui changera quoi que ce soit. Concernant le volet « travail », elle n’apporte aucune avancée significative : la zone de non-droit perdure.
POURQUOI LES DÉTENUS TRAVAILLENT
Une « zone de non-droit » : c’est l’expression
choisie par le très consensuel Conseil économique
et social dans un avis de 1987 pour qualifier
le travail en prison. L’article 713-3 du
Code de procédure pénal est la pierre angulaire
de l’organisation du travail en prison : il
dispose que « les relations de travail des personnes
incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat
de travail », hormis « pour les activités exercées à
l’extérieur des établissements pénitentiaires »
(dans le cadre d’un régime de semi-liberté par
exemple). En conservant cet article, le législateur
a réaffirmé, lors du vote de la loi pénitentiaire
du 13 octobre 2009, sa volonté de faire
perdurer cette « zone de non-droit » : pas d’indemnités
chômage, de maladie ou d’accident
du travail, pas de congés payés, pas de droit
syndical et peu ou pas de reconnaissance des
conditions délétères d’hygiène et de sécurité.
Depuis 1987, le travail n’est plus obligatoire
en prison. Il reste cependant une nécessité
pour la plupart des détenus. Car en prison,
contrairement aux idées reçues, il faut de
l’argent pour vivre : les prisonniers doivent
« cantiner » pourmieuxmanger et pour acheter
des produits de première nécessité (savon,
papier toilette, stylo, etc.), achats qui se
font à la « cantine », supérette locale aux prix
exorbitants. En refusant de travailler, les détenus
ne risquent plus aujourd’hui la suppression
du courrier ou la mise au mitard.
Ils hypothèquent néanmoins leur chance de
sortir plus tôt de prison. En effet, les remises
de peine supplémentaires sont entre autres
conditionnées par le fait de travailler ou
non : le travail carcéral permet de facto d’être
libéré plus vite.
L’administration pénitentiaire, qui dépend
du ministère de la Justice, communique sur
les vertus du travail et de la formation professionnelle,
« meilleurs outils de lutte contre
la récidive » censés « faciliter le retour des personnes
détenues à la vie active ». On notera
que les activités proposées (ensachage de
bonbons, tri d’oignons, paillage de chaises,
conditionnement de parfums, etc.) sont
très rarement qualifiées. Plus qu’un tremplin
vers la reprise d’une activité à l’extérieur,
le travail carcéral apparaît comme un
outil pour maintenir le calme en détention.
« Comme ils sont occupés la journée, les détenus
sont fatigués le soir et donc moins agités », explique
un surveillant rencontré au centre
de détention de Melun.LA PRIVATISATION DES PRISONS
Depuis la loi de 1987 dite « loi Chalandon »,
des établissements pénitentiaires sont gérés en
« gestion déléguée » : 46 sur 197 fonctionnent aujourd’hui
sur cemodèle, et « toute nouvelle structure
a vocation à fonctionner sur le modèle de la
gestion déléguée », explique Laurent Ridel, numéro
deux de l’administration pénitentiaire.
Le principe de la gestion mixte est simple : l’État
conserve ses fonctions régaliennes (direction,
surveillance, greffe) et concède tout le reste à
des entreprises privées, soit : la maintenance,
l’entretien, la fourniture de l’énergie, la restauration,
l’hôtellerie, la buanderie, la « cantine »,
le transport, l’accueil des familles, la formation
professionnelle et le travail des détenus. Le
dernier appel d’offres a principalement été
remporté par Sodexo, qui a signé un contrat
de près d’un milliard d’euros pour la gestion
de 27 prisons. Bouygues a quant à lui signé le
premier partenariat public-privé en 2008,
s’assurant le versement annuel d’un « loyer »
de 48 millions d’euros pendant 27 ans, au
terme desquels le ministère de la Justice deviendra
propriétaire des murs de la maison
d’arrêt de Nantes, des centres pénitentiaires
de Lille-Annoeullin et de Réau. Pour un lot de
six prisons, GDF Suez se contente d’un « petit »
contrat de 22,2 millions d’euros.
BIBLIOGRAPHIE
Gonzague Rambaud et Nathalie Rohmer, Le Travail en prison, enquête sur le business carcéral, éditions Autrement, 2010.
Paul Loridant, Prisons : Le travail à la peine, Rapport au Sénat, 2002.
Christine Martineau et Jean-Pierre Carasso, Le Travail dans les prisons, Ivrea, 1972.
Philippe Auvergnon et Caroline Guillemain, Le Travail pénitentiaire en question, La documentation française, 2006.
[1] Etablissement et service d'aide par le Travail, où sont employés des salariés handicapés, lesquels travaillaient auparavant pour des centres d'aide au travail (CAT), acronyme que le ministère du Travail a décidé de changer en 2005, ayant sans doute constaté à regret qu'une bonne partie de la population française avait réussi à intégrer ce sigle et les activités associées, prévues par un décret-loi de 1953.
[2] On appelle « concessionnaire » une entreprise qui a signé avec l'Administration pénitentiaire (AP) un contrat de concession de main-d'oeuvre : l'AP procure les atelier et la main-d'oeuvre (les détenus) aux entreprises ; les concessionaires fournissent du travail, et supervisent (en théorie) les ateliers - mais n'emploient pas directement les détenus, qui sont payés par l'AP. En 2008, on dénombrait 550 concessionaires.
[3] Entretien réalisé le 16 septembre 2008, complété par un entretien téléphonique le 3 avril 2009.
[4] Entretien téléphonique réalisé le 10 avril 2009.
[5] Entretien du 5 mai 2009
[6] Loi du 10 juillet 1987. Constatant que des entreprises préféraient payer des amendes plutôt que d'employer des handicapés, le ministère du Travail a décidé de créer une « sur-contribution » à l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (l'Agefiph), sur-contribution qui s'élève à 1500 fois le Smic horaire, multiplié par le nombre de bénéficiaires manquants - et ce, quelque soit l'effectif de l'entreprise.
[7] A l'instar de la directrice de la communication du Club des créateurs de Beauté, Vannina B*** m'a très vite appelé par mon prénom...
[8] Mail envoyé le 23 mars 2009 par l'attaché de presse chargé des questions sociales à la direction de la communication de Renault.
[9] Entretien réalisé par téléphone le 10 juin 2009.
[10] Entretien réalisé le 8 juin 2009.
[11] Entretien réalisé à la DISP de Paris, le 28 mai 2009.
[12] Entretien réalisé le 13 novembre 2008.