


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


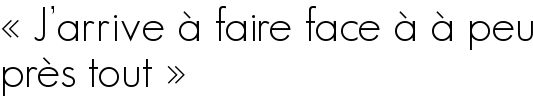
Entretien avec Ambroise Menou, 65 ans, docteur sur l’Île de Sein.
À côté d’autres îles bretonnes (Belle-Île, Ouessant, Groix, etc.), l’Île de Sein peut sembler moins attirante : les guides touristiques insistent sur sa toute petite taille (quelques kilomètres de longueur, quelques centaines de mètres de largeur), son altitude quasi-nulle, son absence d’arbres ou de grandes plages. En réalité, l’Île de Sein est tout à fait charmante, toute petite en effet mais avec un bourg assez compact pour qu’on se perde dans ses petites ruelles (minuscules pour bloquer le vent). Elle est surtout hors du temps : il n’y aucune voiture sur l’île (hormis la camionnette des pompiers, celle de l’hôtel Ar-Men, et le chariot élévateur qui sert à débarquer le bateau). Même si elle est très peu peuplée l’hiver (une centaine d’habitants, contre environ dix fois plus l’été), l’île a une école, une boulangerie, une épicerie, et... un docteur, installé ici depuis près de dix ans. Au printemps 2012, nous étions en vacances en famille et nous avons dû le consulter : de là est venu l’idée de cet entretien.
Ambroise Menou a soixante-cinq ans. Il habite dans un appartement situé au-dessus du cabinet médical, qui fait aussi pharmacie. Les locaux appartiennent au département du Finistère, qui soutient ainsi la présence d’un médecin sur l’île. C’est chez lui que je l’ai retrouvé, le 30 mai 2012. Il a tout de suite insisté pour qu’on se tutoie.
Ambroise Menou - Mon père est né à l’Île de Sein, le 25 octobre 1912. Mon grand-père est mort à la guerre, le 15 octobre 1916. Mon père était le deuxième de la famille, il avait une sœur de six ans, il avait quatre ans, et il avait un petit frère de deux ans. Ils ont été recueillis par le frère de mon grand-père, qui travaillait dans les chemins de fer, et qui habitait à Tours. Et ma grand-mère s’est remariée, donc avec son beau-frère, ça se faisait beaucoup à l’époque. Donc mon grand-père était d’ici. Mais ma grand-mère était de la Pointe du Raz, un village qui s’appelle Lestrivin.
Et il faisait quoi, ton grand-père ?
AM ― Il était marin-pêcheur. Il a été mobilisé, comme tout le monde : il avait trente-six ans, quand même. Chose terrible : mon père avait un souvenir... Son père était venu en permission, ici, et mon père était dans ses bras, et il le voyait pleurer. Mon père ne comprenait pas trop pourquoi... C’était début septembre, il a été tué en octobre. Mon arrière-grand-père, qui s’appelait aussi Ambroise Menou, avait eu cinq garçons. Une fille, qui est décédée assez jeune, et cinq garçons. Ils étaient tous marins-pêcheurs, sauf donc l’oncle de mon père, qui était malade en mer, et qui avait passé un concours d’électricien pour entrer dans les chemins de fer P.O., Paris-Orléans. Des quatre marins, l’un est mort pendant son service militaire quand il avait vingt ans, l’autre lors d’un accident de pêche, à trente ans, et puis mon grand-père à la guerre. Et le frère aîné, qui était le parrain de mon père, a eu une fille. Et mon grand-père a eu trois enfants, une fille et deux garçons, le troisième est mort à vingt ans, d’une tuberculose, à Tours. Et donc mon arrière-grand-père, qui avait eu cinq garçons, n’a eu que mon père comme petit-fils...
C’était une période où la vie était beaucoup plus fragile...
AM ― Les cinq garçons, à dix ans, ils étaient en mer. En partant au service militaire à vingt ans, ils avaient déjà dix ans de navigation derrière eux. Mon grand-père, il était matelot sur un navire de pêche, et, juste avant la guerre, ils étaient allés, avec ma grand-mère, avec un sac de pièces, commander un bateau à Camaret. Pour qu’il ait son propre bateau. Ma grand-mère disait : « on l’avait payé cash ». Après la guerre, coup de chance, elle a réussi à s’arranger avec le chantier, elle a pu récupérer l’argent.
Tu sais où habitaient tes grands-parents, sur l’île ?
AM ― Oui, c’est la maison qui est juste à côté de celle avec la bande noire, sur le quai des Paimpolais. Et d’ailleurs c’est un cousin qui l’a rachetée... Alors, donc, après la guerre, il restait deux enfants Menou, l’aîné, qui s’appelait aussi Ambroise - bon, il y en a un à chaque génération ― et Benoît, l’oncle à Tours qui a recueilli mon père. Donc Ambroise est resté vivre sur l’île jusqu’à sa mort, en 1951, et il avait eu une fille seulement. Coup de chance, elle s’est mariée avec un monsieur Menou, aussi, donc c’est resté Menou !
Mais un Menou même branche ?
AM ― Oui, un peu plus lointain, mais même branche... Donc ils ont eu trois enfants, dont l’un a eu un fils appelé aussi Ambroise, et c’est cet Ambroise Menou qui vient de racheter la maison.
Donc il y a deux Ambroise Menou sur l’île ?
AM ― Oui. Deux Ambroise Menou, deux Noël Milliner, quatre Joseph Fouquet... C’est terrible. Un jour, on était quatre en train de se parler : deux Ambroise Menou avec deux Noël Milliner. L’Ambroise Menou oncle de mon père, qui était son parrain, il était très connu ici, c’était un chef... Il était patron du canot de sauvetage, et on parle de lui avec grand respect. C’était « Tonton Ambross ».
Et toi aussi, tu es le chef du canot de sauvetage ?
AM ― Non, moi, je suis le président. Je réponds au téléphone... Je suis un peu comme l’armateur du bateau.
Et il y a un commandant ?
AM ― Oui, il y a un patron : c’est François Spinec, qui habite à côté. Et il y a des patrons suppléants.
Mais ce sont des gens qui ont une autre activité ?
AM ― Ils sont pêcheurs. François Spinec, il a soixante-six ans, il est retraité de la pêche ; il continue à pêcher, encore.
Je croyais qu’il n’y avait plus de pêcheurs, à Sein ?
AM ― Il n’y a plus de pêcheurs, non... C’est-à-dire qu’il y a François Spinec qui est à la retraite, et puis Paul-Yves Milliner. Et il y a le bateau L’avenir du Mousse, qui est à Douarnenez l’hiver, et qui est ici à partir de mi-mai, pour faire des crabes. Et puis il repart à la fin de l’été.
Revenons à ton itinéraire...
AM ― Mon père aurait sûrement été marin-pêcheur... Mais comme il était à Tours... Il est entré dans la marine marchande. Je suis né à Audierne : ma mère était d’Audierne. J’ai fait mes études de médecine à Brest. Et je me suis installé à Gouesnou, au-dessus de Brest. J’y ai passé presque vingt-sept ans, de 1975 à 2002...
Comment s’est passée ton arrivée ici ? Et quel était le système de santé sur l’île de Sein ?
AM ― Il y a toujours eu un médecin sur l’île. Autrefois, c’était des médecins de marine qui étaient nommés pour un, deux, ou six mois, dans des conditions qui n’étaient pas très faciles. Avec une notion, au départ, presque de... Samu social. La marine fournissait des médicaments, des choses pour les îliens...Après, ce sont des médecins « normaux » qui sont venus, pour des séjours plus ou moins longs. Et, en 1958-59, le dispensaire a été créé ici. Autrefois, ici, il y avait le cimetière, et, à côté, l’église. Qui a été abattue quand l’autre église a été construite, en 1902. Ici, c’est resté le cimetière, et, en 1958, ils ont construit ce bâtiment. Qui appartient au département, au Conseil général : la mairie l’a cédé au département, avec l’obligation de construire un dispensaire. Le département est très impliqué dans la santé. À Molène, il n’y a jamais eu de médecin : il y a deux infirmières, qui sont salariées du Conseil général, et c’est un médecin du Conquet qui y va une fois par semaine. Ici, c’est différent, je suis un médecin libéral, simplement je suis hébergé par le département. Alors, le premier médecin qui a habité dans ce bâtiment, il est resté six ou sept ans, il a la maison là-bas, il vient encore de temps en temps, il a quatre-vingt ans et quelques. Mais il y a eu pas mal de soucis, avec les médecins... C’est pas toujours facile, ici... Moi, j’ai la chance d’avoir eu de la famille ici... Je connaissais les gens, j’étais plus facile à accepter, à intégrer.
Il y en a eu pour qui ça a été difficile ?
AM ― Oui, oui. Il y en a eu un qui venait des Ardennes... Il faut regarder sur internet, les vidéos, « médecin, ile de sein ». Bon, il était un peu... alcoolique. Et sur une vidéo, le journaliste lui demande : « Mais, est-ce que vous buvez ? » « Oui... Je bois. J’aime ça. J’aime bien. » « Mais comment faites-vous pour travailler ? » « Quand je travaille, je ne bois pas. » Alors qu’en fait, si... Le gars avait les cheveux longs... Bon... Mais bizarrement, même pour des médecins qui ne sont pas opérationnels, il y a des gens qui sont pour eux, et d’autres qui sont contre. Ça m’a toujours surpris qu’un médecin puisse traverser la salle d’attente, ivre, une bouteille de whisky à la main, en disant « je vais chercher un verre », et les gens restent quand même dans la salle d’attente. C’est... Bon, moi, je fais attention. Au début, je me suis dit, je ne vais pas dans les bistrots. Les gens disaient : « il fait le monsieur, il ne se mélange pas ». Maintenant, c’est compris. Après le type des Ardennes, il y a eu un monsieur qui a fait douze ans. Et, en 2001, j’ai appris qu’il était malade, qu’il allait partir. Je venais ici en vacances, de temps en temps, donc je suivais ça. Il y a eu un premier médecin qui est venu le remplacer. Qui était un stomatologue de Nîmes. Il était un peu particulier... Il est resté deux ou trois mois. Après, il y a eu un Chilien, qui était sponsorisé par Kouchner : Kouchner avait téléphoné à la DDASS pour le soutenir. Quand il est arrivé, il faisait froid. Et sa femme aurait dit, en débarquant du bateau, dans son manteau de fourrure : « chéri, je ne resterai pas ici plus de quinze jours ». Il a tenu trois semaines, c’est quand même pas mal... Après, il y a eu un autre monsieur des Ardennes, qui a tenu sept ou huit mois. Ça a mal tourné... Il avait un gros chien, qui mordait les gens. Bon, moi, il y avait un a-priori favorable, ma famille était connue. Je me suis bien tenu. Et puis je suis accessible, à la disposition permanente.
Mais quand tu dis que plein n’ont pas tenu, c’est parce que c’est difficile, comme vie ?
AM ― Oui, c’est difficile... Moi, je me plais, je bouquine, je fais collection de cartes postales, de ci, de ça. J’ai de quoi m’occuper. J’ai même des cartons qui sont dans une armoire depuis dix ans, que je n’ai pas encore ouverts, de mon déménagement. J’ai des cartes postales à ranger, des tas de choses à faire, mais je n’ai pas le temps. J’étais venu ici en me disant ça va être coolos, j’aurais du temps... Maintenant, je me dis : je ferais ça l’hiver. Et l’hiver passe, et puis l’été arrive, et ça commence à chauffer, là ce n’est plus la peine de vouloir faire quoi que ce soit. Mais... Parfois j’ai des copains qui viennent ici, et quand ils repartent, il me disent : « bon courage ». Je réponds toujours : mais c’est vous qui devrez avoir du courage ce soir. Vrmm, feu rouge, feu vert, tout ça. Ici, on a quand même... c’est banal de dire une qualité de vie, un genre de vie, mais c’est vraiment... Je me répète ça souvent, que j’ai de la chance.
Mais est-ce qu’il n’y a pas un paradoxe à voir l’île qui se meurt, qui se vide de ses habitants permanents, et d’autre part de voir qu’un nouveau docteur n’est pas forcément accueilli à bras ouverts ?
AM ― Il y a quand même des drôles de numéros qui ont débarqué... Bon, ensuite, dire que l’île se meurt... Oui et non. Il y a dix ans que je suis là, et je trouve que, depuis trois ou quatre ans, c’est plutôt pas mal. Alors il paraît qu’il y a un arrêté royal qui dirait qu’il faut déménager les gens de l’île de Sein, que ça coûte trop cher : il faut les amener sur le continent, on leur construit des immeubles, on les met dedans, et puis on ferme l’île de Sein.
Je ne comprends pas : un arrêté royal ?
Ou préfectoral. C’est vieux, c’est vieux. Une décision comme quoi il faut déménager les gens d’ici. Ça ne sert à rien, ça coûte cher... Le bateau, des fois, l’hiver, il fait un tour pour rien. L’autre jour, j’ai entendu sur l’île quelqu’un répondre : « et les autoroutes, quand il n’y a personne dessus, hein ? » L’an dernier, il y a eu un colloque sur les îles, et les plus virulents pour dire que c’était ridicule de maintenir des gens sur les îles, en particulier l’île de Sein, c’était des jeunes étudiants d’histoire-géographie, à Brest. Ils disaient : c’est ridicule de payer pour le bateau, pour les digues. Donc : ça coûte cher, et puis c’est une zone à risque. On prétend que l’île de Sein va finir par être engloutie. Je n’y crois pas... Là, on est en train de réparer les digues. Mais... Faire partir les gens d’ici, ça ne marchera jamais.
Mais il y a un effet de vieillissement de la population ?
AM ― Oui, il y a un vieillissement de la population, bien sûr. Mais, quand je suis arrivé, il y avait une douzaine d’enfants scolarisés, bon, il y en a un petit peu plus maintenant... Il y a les épiciers qui sont venus avec trois enfants. Il y a deux enfants dont la mère tient un restaurant, et le père est dans la marine, ils repartaient sur le continent pour la classe. Et puis un jour, ils ont dit non, on ne veut plus aller sur le continent, on veut rester ici.
Donc ça se stabilise plutôt.
AM ― Oui, et il y a une nouvelle municipalité, c’est différent.
Mais tout ne tient que grâce au tourisme, tout de même ?
AM ― Tourisme, et retraités, oui.
Est-ce que ça ne raconte pas quelque chose comme le fait que l’île est devenue comme un musée ?
AM ― Pas complètement, je pense. Il y a quand même une petite activité. Bon, il y a les vrais insulaires, qui sont là tout le temps...
Ça c’est très peu.
AM ― C’est très peu, mais ça varie beaucoup. Il y a beaucoup de passages, et d’échanges. Il y a beaucoup de personnes âgées qui partent, fin d’été, ou après la Toussaint. Et qui reviennent à partir de février-mars. Mais il y a quand même un fond, un noyau dur. Il y a des gens qui ne sont pas allés sur le continent depuis un moment. Qui n’y vont pas, ou très peu. Il y a une dame, une parisienne, Raymonde (il le dit avec l’accent titi parisien), elle travaillait à la RATP, elle venait avec son mari en vacances, et puis ils ont fini par acheter une maison. Et à la retraite, ils se sont installés là. Son mari est décédé. Depuis, elle ne bouge pas. Je ne sais pas depuis combien de temps elle n’est pas allée sur le continent. Je crois qu’elle y est allée une fois l’année dernière, mais la fois d’avant c’était il y a quatre ou cinq ans. Elle ne bouge pas. Elle est trop bien ici. Parce qu’ici... J’ai inventé un nouveau terme. Quand les gens disent : vous êtes isolés. Moi je dis plutôt : on est à l’abri. On a quand même un sentiment que tout est un peu amorti... On est protégés des turbulences. En France, là-bas, les gens sont énervés. La dernière fois que je suis allé sur le continent, je venais de passer trois mois ici. C’était terrible. Bon, après, on y prend goût, c’est des vacances...
Mais est-ce que le côté petit village clos, ici, ce n’est pas pesant ?
AM ― Il faut voir que sur l’île, il y a des clans. Donc ce n’est pas le village clos, c’est plutôt les clans. Alors, un peu la religion, mais pas tellement : ceux qui vont à la messe, ceux qui n’y vont pas, en général la femme va à la messe, le mari n’y va pas, bref. Un autre truc, c’est les gens du nord et les gens du sud. Les gens du sud, c’est les quartiers... un peu dépréciés... Et les gens du nord, c’est les gens bien, quoi. Moi, par protection, je suis mis dans les gens du nord. La limite, c’est ici. C’est un truc un peu idiot, mais... La première année où j’étais là, il y avait monsieur qui pêchait les vieilles, là-bas, sur la côte. Un jour, je le vois : « on ne peut pas aller à la pêche aujourd’hui ? » « Ah non, le vent est du sud », donc ce n’est pas possible de jeter la ligne. Je lui dis : « si on allait au Kador ? » « Quoi ? Au Kador ? Dans le nord ? Il y a des années que je ne suis pas allé dans le nord, moi... » C’était plus pour me taquiner, hein... Et mon père me disait que dans les bandes de gamins, il y avait ceux de la côte et ceux de l’intérieur.
Alors qu’on parle de quelques rues voisines...
AM ― Oui. Après, il y a la politique. Pour la mairie ou contre la mairie. Il y a l’association Saint-Guénolé, qui dépend de l’église, qui fait bibliothèque, centre... [Interruption par le téléphone. Le docteur parle du vieux monsieur qui a été évacué sur le continent pour des raisons de santé et qui était encore très mobile sur l’île. « Il descend et remonte les escaliers tout seul, cinq-six fois par jour. » Il insiste pour qu’il ne perde pas cette habitude de se lever, de marcher. La personne au bout du fil propose qu’il ait deux ou trois semaines de kiné avant de revenir sur l’île. « Parfait, parfait. Donc, je suis disponible à ce numéro-là, n’hésitez pas à me rappeler s’il y la moindre ombre dans le dossier. Et puis, dites-lui bonsoir de ma part. (Articulant bien) « Bonsoir de la part d’Ambroise. » Bonsoir, merci. »]
Tu t’occupes à distance du monsieur qui a été évacué ?
AM ― Oui. Tu te souviens du décès d’Edouard Michelin ? [Qui s’était noyé avec un pêcheur près de l’île de Sein.] C’était il y a eu six ans dimanche. Le monsieur en question, c’était le beau-frère de Guillaume Normant, qui était sur le bateau.
J’ai le sentiment que, parce beaucoup de gens vont en mer, la notion de la mort est beaucoup plus présente ici qu’ailleurs.
AM ― Tu as trouvé ça comme ça ? [rire] J’en parlais justement ce matin. Ici, il y a une relation avec la mort qui est assez surprenante. Une sérénité qui est extraordinaire.
C’est lié à la mer ?
AM ― Je pense qu’il y a de ça. Il y a moins de noyades, ou de bateaux qui se perdent en mer, maintenant, mais il y a eu des moments où c’était... Pfff...
C’est aussi que la zone est dangereuse, donc on est confrontés à ça.
AM ― Tout à fait. L’autre jour, il y a un homme qui s’est perdu, dans son voilier... Son corps a été retrouvé près du port de Douarnenez. Bon, le canot de sauvetage [de Sein] a été sorti, c’est le Cross [Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage] qui m’a appelé pour demander de faire le tour du port, s’il n’y avait pas un bateau blanc avec une bande verte. Bon, il n’y avait pas. Après, ils ont vu le bateau près de Tevennec, c’est le sémaphore de la pointe du Raz qui avait vu dépasser le mât. Donc le canot de sauvetage est sorti à 11h30, ils sont rentrés à 19h, pour chercher à trouver le corps...
Le canot de sauvetage, ce sont toujours des missions qui sont dangereuses ou en rapport avec la mort.
AM ― Quelquefois, ça peut ne pas être méchant. Mais il y a quand même un danger, en général. Le dernier sauvetage important, c’est un chalutier belge, Marco, qui a coulé, le 5 août l’année dernière. Il revenait du sud, Pointe du Raz, île de Sein, et chaussée de Sein, ça fait barrage est-ouest. Il a talonné dans la chaussée, à une heure du matin, pas loin de la balise de Namouic, on la voit d’ici, la tourelle de Namouic. L’hélicoptère de la marine était sorti, ils n’ont pas pu être hélitreuillés, ils sont montés dans le canot de sauvetage et ils sont venus ici. Ils étaient crevés, après quinze jours de pêche... Et le bateau a coulé en une demi-heure, un chalutier de trente-six mètres. Ç’aurait pu être dramatique. Un des gros sauvetages qu’il y a eu ici, c’est l’Anne-Gaston, ça devait être en 1958, décembre 1958, il y a eu deux morts. Ça été filmé par Alain Kaminker, le frère de Simone Signoret, qui tournait La mer et les jours. Dans le film, on voit le naufrage, on voit un marin qui a la tête dans l’eau, le patron du bateau, image lugubre. Et au Musée du Sauvetage, sur l’île, on voit la photo des deux corps qui ont été récupérés : les corps ont été toilettés, habillés, et il reste une photo des corps qui sont raccompagnés par une procession pour rentrer sur le continent. C’est une tradition... Pour le pétrolier Boehlen, en 1976, les gars sont allés récupérer deux survivants, et treize corps...
Ça me rappelle un peu le Mexique dans la façon de montrer la mort, de ne pas avoir peur de la montrer. C’est quelque chose qui, en France, s’est complètement perdu...
AM ― C’est directement le centre funéraire. Quelqu’un il meurt chez lui, ffuit, il est emmené par les Pompes funèbres... Nous, on a eu une série de morts, là... Il y a encore un monsieur que j’avais vu ici, lundi, il est parti à Brest, et il est décédé. Il était pas âgé, soixante ans... On a eu quatre morts successifs... Jusqu’à présent, je n’en avais pas eu beaucoup... Le premier certificat de décès que j’avais fait, ça faisait déjà six ou sept ans que j’étais là. C’est pas pour ça que les gens ne mouraient pas, mais les gens étaient hospitalités, et ils mouraient à l’hôpital. Ou dans une maison de retraite. Mais là, ça fait quatre de suite...
C’est dur...
AM ― Oui... Bon, on en était au système des clans. Moi j’imaginais qu’ici les gens se tenaient les coudes, se serraient... Mais non : quand il y a cent personnes sur l’île, il y en a qui ne se parlent pas. Un des premiers matin où j’étais là, j’étais sur le quai, je rencontre un gars : « alors toubib, ça va ? » On discute un peu... Un autre monsieur arrive : « bonjour, ça va », il me serre la main, et il ne regarde pas l’autre. Je me dis : ils ont déjà dû se voir. Après je lui demande : « vous l’avez déjà vu, ce matin ? » « Moi, ce con-là ? Ça fait vingt ans que je lui parle pas, c’est pas aujourd’hui que je vais commencer... » Pourquoi ? Qu’est-ce que le grand-père a fait au grand-père... ? C’est pour dire qu’il y a des clans, qu’il y a des gens qui ne peuvent pas se voir, ne se supportent pas. Donc, ce n’est pas une seule famille, un seul groupe uni. Bon, après, si le type avait fait un malaise, l’autre m’aurait aidé à m’en occuper ; même un ennemi. C’est un peu une histoire de caractère, de tradition... Mais le fait qu’il y ait plusieurs clans, c’est un peu comme s’il y avait plusieurs villages. On peut passer de l’un à l’autre.
Surtout quelqu’un comme toi ?
AM ― Oui, je suis un peu privilégié... Parfois, on me dit : « toi, tu es bien avec tout le monde ! Tout le monde a besoin de toi. » C’est un peu vrai. Jusqu’à présent, ça se passe bien, bon... L’autre jour, ma télé ne fonctionnait pas, je voulais voir un match de foot. Je vais voir un voisin : toc toc. « Tu veux voir le match ? Reste voir. »
Quand j’étais venu en vacances en famille, à Pâques, il y a eu un jour où il n’y a pas eu de bateau, et je me suis dit : ah, c’est agréable, on est entre nous, les îliens... Donc j’imagine que pour vous, l’été, ça doit être terrible de voir tout le monde débarquer pour la journée...
AM ― Il y a des gens qui débarquent qui ont des comportements vraiment bizarres... Ils prennent la photo du mec du coin comme s’ils avaient trouvé un indigène... « Alors, grand-père, ça va pour toi ? C’est bien, ici ? » Ils prennent les gens pour des idiots... C’est un peu pesant. Des gens rentrent dans les jardins, cueillent des fleurs... Et puis il y pas mal de monde, donc... Je me rappelle une fois, ça faisait trois jours que je n’étais pas sorti de la maison, un été, et puis je descends, j’arrive au bas de la rue, le bateau venait juste d’arriver, et j’avais l’impression de me retrouver devant une sortie de métro. Les gens qui avançaient... Bam !
Les îliens qui sont là tout le temps, j’imagine qu’ils le vivent assez mal, non ?
AM ― Il y a aussi pas mal d’îliens qui vont passer l’hiver sur le continent. L’hiver, quand il y a 100-120 personnes, c’est... tranquille. Le bateau part à quatre heures, à quatre heures cinq il n’y a plus un chat. Le matin, le bateau arrive à 10h30, ça ne sert à rien de se lever à six heures... Après, quand le bateau ne vient pas, effectivement... Il y a des gens qui râlent : « qu’est-ce qu’on va devenir ? je n’ai plus ci, plus ça ». Moi, ce qui me manque le plus, c’est le courrier, quand il n’y a pas de bateau : les journaux... L’année dernière, il y a eu une mauvaise mer en décembre. Je prenais des vacances, le mardi : ma remplaçante devait venir le mardi. Pas de bateau le mardi. Pas de bateau le mercredi. Pas de bateau le jeudi. Pas de bateau le vendredi. Quatre jours de suite. Je devais partir pour rentrer le dimanche... Vendredi, j’ai dit à ma remplaçante : pas la peine de venir, hein. Venir pour deux jours... Bon. J’ai perdu mes vacances... Janvier, elle devait revenir. Mardi : pas de bateau ! Je me suis dit : ça y est, c’est reparti. Mais elle est venue le mercredi. Évidemment, c’est des conditions assez particulières. Alors, pour les rendez-vous pour les spécialistes, aussi... Il y avait un monsieur qui était très malade, mal en point, fatigué... Il était convoqué par la Sécu pour dix heures. J’ai téléphoné au médecin-conseil en disant : « monsieur Untel n’ira pas ». « Comment ça, il n’ira pas ? » « Vous vous rendez compte que vous le convoquez à dix heures à Audierne ? » « Oui, je me déplace de Lorient pour voir les gens ». Pour être à Audierne à dix heures un jeudi, il fallait qu’il parte le mercredi à onze heures, parce que l’hiver il n’y a pas de bateau le mercredi après-midi, qu’il passe une nuit, qu’il ait son rendez-vous, qu’il passe une autre nuit, et qu’il prenne le bateau le vendredi à dix heures. Bon, ça c’est arrangé, on est devenus copains avec ce médecin-conseil, il est venu me voir ici d’ailleurs. Donc, pour les rendez-vous avec les spécialistes, si on peut avoir un rendez-vous le mercredi après-midi, c’est bien. On prend le bateau le matin, rendez-vous, et on prend le bateau le lendemain. Ça fait quand même une nuit sur le continent.
Mais pourquoi est-ce que les horaires de bateau sont calés comme ça ? C’est pour que les touristes viennent passer une journée ?
AM ― Tu as tout compris. Oui, oui... Alors, il y a une autre chose : le bateau ne peut pas rester la nui ici, dit-on, parce qu’il n’y a pas de sécurité, y’a pas ci, y’a pas ça... Il y a certaines îles, dans le sud [Bretagne], qui ont un bateau qui part le matin de l’île, et qui revient le soir. Aller-retour. Quelqu’un qui habiterait ici et qui irait travailler à Audierne, ça lui fait une heure de trajet, c’est pas pire que quelqu’un à Paris qui a trois heures de train ou de métro... Mais c’est pas possible : il n’y a pas de bateau dans ce sens-là. Il était question, c’était une amélioration qu’on demandait, dans un premier temps d’avoir un bateau le vendredi soir. Assez tard le soir : ce qui permettrait aux lycéens de rentrer le soir, ce qui permettrait à ceux qui travaillent la semaine sur le continent de venir le week-end, et puis aussi pour les touristes ça ferait une nuitée de plus... Bon... Il paraît que c’est très difficile. Il paraît qu’il y a un coût qui est trop important...
Je reviens à ton activité de médecin : qu’est-ce que ça fait d’être sur le pont vingt-quatre heures sur vingt-quatre ?
AM ― C’est pas toujours facile, mais je m’y suis fait. C’est tellement varié, c’est pas comme sur le continent. Bon, après, c’est vrai que vingt-quatre heures sur vint-quatre ça peut être difficile... Au début surtout. Quand j’ai un remplaçant, c’est des jeunes surtout, il demande : « pour les urgences, comment on fait ? » C’est pas forcément plus difficile que sur le continent, sauf que sur le continent, quand il y a un problème important, les gens font le 15 rapidement, et le Samu vient... Au début, moi aussi j’étais un peu angoissé... Maintenant ça va mieux. Je ne vais pas dire que je sais tout faire, mais j’arrive à faire face à à peu près tout. Et je fais aussi un peu de prévention entre guillemets, je connais tous les gens. J’ai acquis une certaine sérénité. Ça m’angoisse certaines fois... Mais c’est aussi différent de sur le continent : sur le continent, on voit quelqu’un qui peut avoir un problème, et on ne le voit pas après. On se dit : tiens, il est allé voir un collègue. Ici, si je vois quelqu’un et que je ne suis pas sûr de moi, je n’hésite pas à y aller le soir : toc-toc-toc, comment ça va ? Ou même la nuit, ou le lendemain. S’il y a quelque chose qui me soucie. Le fait de ne pas arrêter, ça change : sur le continent, tu vois quelqu’un le vendredi, et le lundi tu te dis : qu’est-ce qu’il devient ? Ici, les gens sont là, on se connaît... Et puis j’essaie d’assumer : la présence, une disponibilité constante... Ce qui peut être un peu pesant au début, c’est que tout le monde sait tout sur tout le monde. « Je ne sais pas qui c’est le grand, là [il parle de moi], qui est rentré à cinq heures et demi, il est resté longtemps... Il devait pas être malade. » Voilà : parce qu’on t’a vu passer ici à cinq heures et demi. Par exemple. Alors ça peut être un peu pesant. Mais si tout le monde sait tout sur moi, moi je sais tout sur eux...
Il doit y avoir un côté : les rumeurs du village...
AM ― Oui, mais pas trop. Par rapport à Gouesnou : Gouesnou, c’était terrible. C’était plus dur. Ici, ma foi, à part le fait qu’on sait tout sur tout le monde... Ça ne pose pas vraiment de problèmes.
Et quand l’été arrive, ça doit tout changer, parce qu’il y a beaucoup de gens que tu ne connais pas.
AM ― Non... Il y a beaucoup de familles qui reviennent chaque été... Et puis des descendants de gens de l’île... L’été, je travaille beaucoup plus. Je peux arriver au même rythme que j’avais à Gouesnou : vingt à trente actes par jour... Des pathologies classiques du bord de mer : les gens qui tombent dans les rochers. Piqués par une méduse... Plus les pathologies courantes et les renouvellements pour les personnes âgées... Après, là où c’est différent du continent, c’est qu’il faut assumer plus : on ne peut pas appeler l’hélicoptère à trois heures du matin en disant « elle a truc ici, il faudrait faire une échographie... » À Gouesnou, il y avait la clinique à deux-trois kilomètres, dans la demi-heure qui suivait, on pouvait avoir une échographie, une radio.
Parce que ton rôle, c’est d’appeler l’hélicoptère s’il le faut...
AM ― Oui, décider une évacuation, en hélicoptère, en canot de sauvetage...
L’expérience, ça doit jouer beaucoup, non ?
AM ― Oui... Bon... L’expérience, je trouve ça un peu pompeux. L’expérience, c’est la somme des bêtises qu’on a fait dans sa vie.
Ça permet de ne pas les refaire, non ?
AM ― Oui, c’est vrai... Mais j’ai plus... Ça va paraître prétentieux... Le museau, quoi, on le sent le truc... C’est comme la mer : ça ne s’apprend pas. Les écoles de voile, c’est bien, mais bon, ça se sent d’abord. Par exemple, quand on est sur un bateau, pour abattre, pour prendre plus de vent, mettons : on tire la barre. Si tu mets la personne qui a fait l’école de voile de l’autre côté du bateau, c’est plus tirer qu’il faut, c’est pousser. Et ça, quelqu’un qui sent la voile, la navigation, il va tout de suite faire le bon geste. Je suis sans doute plutôt un intuitif... J’ai eu stagiaire il y a deux mois, qui était très bien... Il aime son métier, et il aime les malades... Il a une façon d’aborder les gens, ce n’est pas seulement poids, taille, c’est plus humain... Moi, je dis toujours : le patient, le patient !
Et quand tu as un stagiaire, il habite où ?
AM ― Ici.
Et quand tu es remplacé, tu laisses la place ?
AM ― Oui. J’ai fait des remplacements où j’avais accès à une seule pièce. J’ai même un collègue qui a fait un remplacement, il avait un lit de camp dans le cabinet, et l’accès à la cuisine, au salon, était fermé. Il allait au restaurant midi et soir... À la longue, ça a été terrible. Ici, moi, je laisse tout. Je ne ferme rien.
Et quand tu pars, tu es soulagé ou tu continues à y penser ?
AM ― Je continue... un jour, ou deux. Point de vue sommeil. Après, ça va. Là, ma remplaçante, c’est moi qui l’ai appelé, une fois ou deux, pour lui demander des résultats de prise de sang.
J’ai lu que tu disais qu’ici les enfants étaient très peu malades, parce qu’ils sont tout le temps les pieds dans l’eau, ils ont une vie hyper-saine...
AM ― Je me souviens, il y a sept ou huit ans, il y avait une dame, qui se promenait sur l’île, en cherchant manifestement quelque chose. Je lui demande quoi, et elle m’explique : « Les enfants, comment ils font, pour le sport ? Il n’y a pas de salle de sport, il n’y a que le petit terrain avec les buts, là-bas ? » Je dis oui. Et, juste à ce moment-là, il était cinq heures, cinq heures et demi, et un gamin passe avec sa combinaison et sa planche de surf... « Oh ! Je comprends... » Les enfants, ils n’ont pas besoin de liquide à l’eau de mer pour déboucher le nez Ça existe en bombe sur le continent, ici ils l’ont au naturel...
Et j’imagine qu’il y a moins de virus qui circulent...
AM ― Oui, sauf quand les vacanciers arrivent, ou le week-end, quand les gens vont sur le continent : ils passent quelques jours sur le continent, et ils reviennent avec un truc.
Tu es aussi capitaine des pompiers ?
AM ― Médecin-capitaine... Je ne le suis plus, officiellement je suis à la retraite, maintenant. J’avais 65 ans le lundi, on m’a téléphoné le vendredi : « euh, tu es au courant, tu es à la retraite ! » « Ah bon ? » Donc maintenant je suis le médecin des pompiers sans être officiellement le médecin des pompiers. Sur le continent, c’est un peu différent. Le médecin fait le 15, et le 15 diligente les secours appropriés. Ici, les gens n’appellent pas le 15. C’est arrivé deux fois, je crois : une fois des touristes avaient une fille qui toussait beaucoup, c’était une coqueluche, ils ont appelé le 15, à Brest, et le 15 m’a appelé moi pour me dire « il y a un problème, il faut aller voir ». Mais d’habitude les gens m’appellent directement. Et en fonction du problème qu’il y a, si par exemple il y a un danger vital, qu’il faut évacuer, là je fais le 15. Et le 15 appelle le 18, les pompiers viennent.
Les pompiers viennent en hélico ?
AM ― Non, les pompiers d’ici, de l’île de Sein. Alors, ça fait dix ans que je suis là, et j’ai tâché de rester crédible. Donc quand j’appelle le 15 et que je dis « Dépêchez-vous, dépêchez-vous », ils ne me disent pas « Ah bon ? Vous croyez ? ». À l’inverse, l’autre jour, dimanche, c’était urgent mais pas tant que ça, donc là on joue le jeu du protocole. La standardiste : « De qui s’agit-il ? Quel âge ? Quelle adresse ? » Tous les renseignements. Puis on passe au médecin régulateur. Mais quand c’est vraiment très urgent, pfuit ! Je chante ma chanson tout de suite.
Et alors, ça va vite ?
AM ― Ça va très vite. Une fois, un gars a fait un malaise. J’arrive sur place, il commençait à récupérer. Alain, le caporal-chef des pompiers était allé chercher l’ambulance, pour le mettre à l’abri. Et puis le mec était un peu pâlot. Je téléphone pour faire sortir officiellement l’ambulance, pour que le caporal n’ait pas de problème ensuite parce qu’il avait sorti l’ambulance...
On ne peut pas sortir l’ambulance sans passer par le 15 ?
AM ― Par le 18. C’est le protocole. J’appelle le 18, j’ai Maryvonne, je lui dit : « Bon, je t’appelle pour faire un faux appel, c’était urgent de sortir l’ambulance, donc il l’a fait, je le couvre entre guillemets ». « Ok, je te passe le 15 ». Le 15, c’était Delphine, une jeune femme que j’avais eu en stage moins de six mois avant. Je lui explique que je pense que c’est un malaise vagal, que le gars est dans l’ambulance, qu’il récupère, qu’on va le ramener chez lui. Et Delphine : « Alors, et l’île de Sein ? Comment elle va, madame Machin ? » On parle un peu de l’île, et tout à coup, le gars fait « Aaaaah », il hurle de douleur. Douleur thoracique terrible.
Ça, ça veut dire infarctus ?
AM ― Ça faisait infarctus... Dissection aortique. Delphine, très pro : « C’est le monsieur qui crie ? ― Oui. ― L’hélicoptère décolle tout de suite. » Il se trouve que l’hélicoptère du Samu de Brest venait de déposer un malade, ils sont repartis. Ils ont mis treize, quatorze minutes pour venir. Le gars hurlait comme tout. Tout à coup, paf, il fait un arrêt cardiaque. Alors, adrénaline, on le masse, et il revient. Il recommence à avoir mal. Dissection aortique, ça fait très mal. Ça dure dix minutes, l’hélicoptère arrive. Le médecin de l’hélico crie au pilote « on redécolle, on redécolle »... Bon, là, je fais le malin, mais sur le moment... Et donc treize minutes pour venir, dix minutes ici, et puis quinze minutes pour rentrer, ce qui fait que le gars était sur la table d’opération, à Brest, à l’hôpital, trente-cinq ou quarante minutes après le début de sa douleur. Alors c’est quand même pas mal... Bon, ils ont pompé les caillots, il y avait deux caillots, par une sonde par voie fémorale. C’était bien, mais le gars qui récupérait, sur son chariot, paf, arrêt encore. Il a fait six arrêts cardiaques ! Six chocs électriques ! Il a pris froid d’ailleurs, ce qui a retardé son retour ici. Et puis trois semaines après, il débarquait ici, sa petite valise à la main, comme s’il revenait de vacances. Il y a plusieurs leçons : on a de la chance d’avoir ici des pompiers qui sont nickel, impeccables, qui font un boulot...
C’est des pompiers volontaires ?
AM ― Oui, volontaires. Ici, c’est comme dans une caserne. C’est pareil pour le canot de sauvetage. Il y a François qui est à côté, les autres on les appelle, ils sont prêts à partir, comme dans une caserne. Les pompiers c’est pareil : je sors d’ici, il y a Stéphane qui habite à côté, s’il me voit passer, il vient. Il y avait un gars, qui était attablé dans un restaurant, qui a fait un malaise, j’ai commencé à lui faire une piqure, et Stéphane qui passait par là lui a fait un massage.
Ce sont des gens qui ont une formation ? Ils font quoi d’autre dans la vie ?
AM ― Oui, ils ont une sacrée formation. Le voisin, il fait de la boulangerie. Le caporal-chef, Alain, c’est le chef des services techniques à la commune, il y a sa fille, qui n’est pas là tout le temps, il y a l’épicier là-haut, et deux autres qui travaillent à la commune aussi.
Et ça passe par le portable, il n’y a plus de sirène ?
AM ― Non, plus de sirène. Ça passe par portable, et eux en plus ils ont un bip sur lequel est indiqué le degré d’urgence. Systématiquement, quand j’appelle le 15, et qu’il y a une évacuation, j’appelle aussi Alain, je lui dis : « Viens, mais ne te casse pas la jambe en venant, ne va pas écraser trente-six personnes en venant ». Ou alors : « Grouille-toi, grouille-toi ! » s’il faut être très rapide. Ils sont très réactifs, ils sont costauds.
Lorsque tu appelles le 15, tout le monde te connaît, ou pas ?
AM ― Non, pas forcément. Disons, plus ou moins. Avant, je connaissais bien le médecin-chef du Samu, c’était un copain de promo. Celui qui lui a succédé, je l’avais eu en stage à Gouesnou. Et le nouveau, c’est celui qui est venu pour l’évacuation... Connu, donc, plus ou moins... À l’inverse, s’ils se racontaient des histoires dans le service, « on a fait une évacuation à l’île de Sein, le médecin était bourré, c’était vraiment terrible, le patient n’avait rien du tout, le médecin aurait pu se débrouiller, mais il était cuit », ça va se transmettre très rapidement. De là à dire « le médecin de l’île de Sein il est super », non...
Mais par exemple, un type qui se casse la jambe, on l’évacue ou pas ?
AM ― Ça dépend du problème, de la personne... S’il se casse la jambe avec un anticoagulant, pfuit, vite fait. D’une façon générale, oui.
J’avais été frappé, ici, lorsqu’on était en vacances, notre fille s’est réveillée de sa sieste, elle avait de la fièvre, elle avait mal à l’oreille, bon, moins d’une heure après tu l’avais vue, elle avait une otite, on avait les médicaments, on était venu à pied... Ce n’est jamais aussi simple, d’habitude, quand on a un enfant malade... Donc ici, on doit se sentir très à l’aise, très protégé. Y compris en se disant : c’est lui qui saura s’il y a un truc grave ou pas, s’il faut évacuer.
AM ― Evidemment, c’est plus accessible ici. Je dis souvent : il vaut mieux se casser la jambe ici qu’à la Pointe du Raz. Parce qu’ici, je suis là, et tac, on te déposera à l’hôpital. Alors que sur la pointe du Raz, il faut attendre que les pompiers arrivent, je ne dis pas que c’est pas bien fait, mais c’est plus aléatoire. Alors, il y a des gens qui trouvent que c’est abusif, qu’il y ait un médecin ici, qu’il pourrait y avoir un médecin du continent qui serait de service régulièrement et qui, s’il juge que c’est important, prend l’hélicoptère et vient...
Et quand il y a beaucoup de vent, l’hélicoptère, il ne peut pas passer, si ?
AM ― Si, si. Depuis que je suis là, il n’y a eu que trois fois que l’hélicoptère a refusé de venir. Au début, je n’avais pas imaginé que ça pourrait arriver. L’hélicoptère, il y a du vent : il passe ! Trois fois il a refusé. Une fois, il y avait de l’orage, une autre le plafond était bas. On l’a entendu tourner au-dessus, et puis... La couche de nuage, le plafond était trop bas : il cherchait un trou, et il n’a pas trouvé. Et une autre fois, on voyait à peine le haut du phare. L’hélicoptère a commencé à tourner au-dessus de nous, c’était plus grave, ce coup-là, c’était un infarct’. C’était il y a moins d’un an : il m’a appelé pour me dire qu’il ne se posait pas. Puis finalement il a trouvé un trou, au niveau du phare du Guéveur. Le pilote m’a expliqué ensuite : « on ne peut pas se baser sur la mer, la mer c’est toujours pareil, il faut qu’on trouve un trou, qu’on voie un rocher, et là, c’est bon ». Donc il a plongé dans ce trou, et puis il est venu jusqu’à l’héliport.
Mais je ne comprends pas : il ne peut pas traverser les nuages ?
AM ― Si, mais on ne sait pas trop : peut-être que les nuages, c’est de la brume, peut-être qu’il va se cogner sur le sol. Il ne voit pas où est le sol. Et pour savoir à quelle hauteur on est, on ne peut pas se baser sur la mer. Quand il y avait de l’orage, on a fait l’évacuation en canot de sauvetage.
On peut évacuer en bateau, aussi ?
AM ― Oui, ça dépend du problème. Il y a un degré de plus, si vraiment c’est important et urgent, je fais appel à la Marine, aux hélicoptères de sauvetage en mer, ça c’est des chefs, ils viennent n’importe quand. Opération commando... Quand ils se posent, ils n’arrêtent pas leurs pales, il y a deux types qui sautent, et ils attrapent les sacs, c’est très impressionnant, ça fait vraiment débarquement. À trois heures du matin... Donc quand l’hélicoptère du Samu de Quimper ne vient pas, c’est la Marine nationale qui vient. C’est des Dauphins. Ils peuvent venir n’importe quand. Bon, celui de Quimper, il n’y a que l’orage qui peut l’empêcher de venir. Mais... ma femme est urgentiste, et donc elle m’a donné une notion nouvelle : il faut quand même faire attention, pour les évacuations, que, quand on appelle l’hélicoptère, on met en danger potentiel l’équipage : pilote, mécanicien, médecin, infirmier, donc quatre personnes. C’est pour ça : quelqu’un qui se casse le bout du doigt, même si c’est très dangereux, il ne faut pas appeler l’hélicoptère... Même sans problèmes de conditions atmosphériques, s’il y a un problème technique, ou une faute humaine et que l’hélicoptère se casse la figure, quatre morts... il faut tenir compte de ce paramètre. Et j’ai intégré ça, maintenant.
Une fois, je fais le 15. Bon, j’ai la standardiste, puis le médecin régulateur. Et on décide de tel mode d’évacuation. S’il y a évacuation, on appelle les pompiers ici. Les deux premières années où j’étais là, il n’y avait pas d’ambulance : on transportait les malades sur un petit chariot jusqu’à l’hélicoptère. Ça n’avait qu’un seul avantage : le malade prenait tout de suite l’hélicoptère, tandis que maintenant, ils débarquent, ils vont dans l’ambulance, et des fois, ça dure une heure, deux heures, pour médicaliser le truc. Bon, donc, ils appellent les pompiers, et ils appellent l’hélicoptère, qui part de Quimper, il se pose à Douarnenez pour prendre l’équipe du Smur, et puis il vient ici. Quand ils partent de Douarnenez, ils m’appellent : « Dix minutes, DZ ». DZ, c’est drop-zone, je ne savais pas ça non plus, au début. Mais quelquefois, c’est l’évacuation par canot de sauvetage. Et c’est marrant, parce que, il fut un temps où j’appelais le 15, qui appelait le 18, et le 18 m’appelait en tant que pompier. Et pour le canot de sauvetage, le 15 appelle le Cross Corcen, qui m’appelle, en tant que responsable du canot : « voilà, vous allez être sollicité par le 15, pour une évacuation. » Au début, je disais : « Oui, oui, je suis au courant ! » Mais maintenant, je ne dis plus rien, parce qu’il faut laisser le protocole en place. Si on coupe la parole aux gens, s’ils n’ont pas le temps de dire le truc, pour peu qu’ils aient quelque chose d’important à dire et qu’on n’écoute pas, on dira : tiens, il n’a pas écouté. Donc, moi je laisse tout se dérouler, c’est important la transmission, donc quand le Cross m’appelle, je ne lui dis pas que je suis le médecin et que c’est moi qui ai appelé le 15. Il m’appelle en tant que président de la SNSM [Société nationale de sauvetage en mer : le canot de sauvetage]. Donc les pompiers prennent le patient en charge, ils l’amènent sur la cale...
Avec toi ?
AM ― Pas nécessairement. Pas quand ce n’est pas médicalisé. Quasi-systématiquement, une évacuation en hélicoptère est médicalisée : médecin, infirmier. Le canot, c’est qu’il n’y a pas de risque important. Comme les agités, par exemple : il y avait un agité, l’autre jour. Un gars avec des dreadlocks, qui était un peu shooté, il avait bu aussi. Les gendarmes sont venus du continent, six gendarmes, ils l’ont enserré dans la coquille. Là je n’avais pas appelé l’hélicoptère.
Les gendarmes, ils étaient venus en bateau ?
AM ― Oui : la brigade nautique. La blanche. Les gendarmes mobiles, c’est la jaune. La brigade nautique, c’est comme une brigade de ville, elle est installée à Crozon, ils ont une petite vedette et ils circulent le long de la côte. Ils peuvent donc venir ici. Là, le gars, ça a été assez acrobatique, pour l’appréhender. Il a failli se noyer.
Et ce genre d’interventions, c’est déclenché comment ? Par un habitant, par le maire ?
AM ― Le maire, en tant qu’officier de police judiciaire, a des pouvoirs de police, des pouvoirs importants, et surtout des responsabilités importantes.
Il n’y a pas de présence policière permanente, sur l’île ?
AM ― L’été, quelquefois l’hiver aussi, il y a un ou deux gendarmes qui passent vingt-quatre ou quarante-huit heures. Avant, ils passaient les deux mois d’été, ils étaient logés au-dessus de la mairie. Maintenant, ils restent une nuit ou deux. C’est marrant, quand ils embarquent à Audierne, on nous prévient : « les gendarmes arrivent ! les gendarmes arrivent ! ». Comme si tout le monde ici était en infraction...
Mais ça ne sert pas à grand-chose, s’ils viennent un jour ou deux ?
AM ― Si, si. Ils surveillent un peu les choses, ils contrôlent. Ça calme un peu les gens. Quand il y a des fêtes de prévues, ça calme un peu. Il y a deux ans, il y en avait un, dont le truc était d’aller à l’arrivée du bateau : il regardait dans les yeux les gens qui descendaient de la coupée [passerelle du bateau]... Ça jetait un froid...
[La femme d’Ambroise passe, puis repart.]
On a une maison, là-bas... Pour la retraite. Ici, je suis occupant provisoire. Là-bas, c’est la résidence principale. Elle est restaurée, elle est habitable. De temps en temps, je vais en week-end là-bas. Sans blaguer... Je pense à ces pauvres Parisiens qui, pour sortir de Paris le vendredi, mettent trois heures... Moi, je ne pourrai pas. Ici, je prends mon vélo, et puis...
Tu fais partie des rares personnes qui ont droit au vélo... Parce que c’est interdit, ici...
AM ― Ce n’est pas que c’est interdit, c’est que ce n’est pas autorisé. Petite nuance... Et puis c’est seulement l’été. Mais, depuis qu’il y a eu des urgences un peu urgentes... notamment un monsieur qui s’est entaillé la jambe avec une tronçonneuse à métal, au bout, au phare : ils ont apprécié que j’arrive rapidement. Et donc je peux prendre mon vélo : je suis un peu considéré comme dérogataire. Mais, effectivement dans le bourg, il n’y a que le périph qui est autorisé aux vélos.
Périph, on dit ça ?
AM ― Moi, je dis ça : quai sud, quai nord, près de l’église... Pas les petites ruelles qui peuvent être dangereuses.
Pour revenir à l’idée de la maison, tu te dis que tu as envie de finir ta vie ici.
AM ― Oui. Je ne m’imagine pas repartir... Ça a commencé, ça faisait deux ans que j’étais là, je me trouvais bien, et... j’ai fait un cauchemar une nuit. J’étais sur le pas de la porte, et mon successeur était à l’intérieur, moi j’avais ma petite valise. Je devais me dépêcher, le bateau partait dans dix minutes. Et puis terminé, quoi. Alors, dès le lendemain, en consultation j’ai demandé aux gens : « vous ne connaissez pas quelqu’un qui ait une maison, ou un terrain à vendre ? ». J’ai d’abord acheté un terrain, constructible. Et puis ensuite j’ai appris qu’il y avait une maison à vendre. J’ai téléphoné, c’était un vendredi je crois, elle est venue ici le dimanche, j’ai visité la maison. « Ouais c’est pas mal », proposition, clac, c’était fait. [On frappe à la porte] Oui ? [Entrée d’un petit garçon qui dit « coucou »] Ah, salut Jean. Je suis occupé. Tu reviendras un peu plus tard.
Jean ― Oui... Je voulais te demander. Est-ce que je peux prendre les gravillons ?
AM ― Les gravillons ? Pour quoi faire ?
Jean ― Pour jouer aux Playmobil.
AM ― Vas-y, prends les gravillons.
Jean ― Ok, merci.
AM ― C’est le petit voisin, qui vient de temps en temps.
C’est le fils du boulanger ?
AM ― Oui. Il vient : « qu’est-ce que tu manges, aujourd’hui ? » Ou « je tousse, je veux du sirop ». Bon.
Tu t’es fixé une date, pour ta retraite ?
AM ― Eh ben... Après, il y a le problème du successeur. Qui n’est pas forcément évident. J’ai eu une remplaçante pendant sept ans, qui venait à chaque fois quand j’allais en vacances. Au bout de trois semaines, quand je revenais, elle me disait : « je ne sais pas comment tu fais... Il était temps que tu reviennes... Ce n’est pas facile. »
Mais toi, tu as envie d’arrêter ?
AM ― Il y a des jours oui, des jours non. La médecine est un métier extraordinaire : je m’éclate, malgré tout. Même si, certains jours, il faut que je me botte le derrière pour démarrer, le matin, ou quand je suis ici [dans l’appartement] et que j’écoute le Jeu des mille euros. Parce que maintenant je m’oblige, quand je travaille en bas, à remonter pour le Jeu des mille euros. Des fois, je commence à faire des trucs en bas, et puis à trois heures, je ne suis pas encore remonté. Alors je m’oblige, je m’intéresse au Jeu des mille euros, ça m’oblige à monter. Donc, arrêter ? J’ai soixante-cinq ans, je suis mis à la retraite des pompiers... Mais autrement. Le docteur qui a fait douze ans ici, il est arrivé à 63 ans, il est donc parti à 75 ans...
Donc aussi bien dans dix ans tu seras encore là ?
AM ― Je ne crois pas, quand même. Ma femme sera à la retraite... Mais, d’un autre côté, si je n’ai pas de successeur, ce ne sera pas vivable ici, la retraite. Il est évident que les gens viendront me voir...
Donc, il faut que tu aies un bon successeur. Parce que, s’il n’est pas bon, c’est pareil...
AM ― Si c’est un cornichon... c’est fichu. Quand je suis venu ici, je pensais que je resterais 5 ou 6 ans, et ça va faire dix ans en septembre... Ça passe vite. Parce que la médecine est un métier superbe. C’est extraordinaire. C’est très prenant. Ici, en plus, c’est varié. Les gens sont sympas... Bon, il y a des gens plus renfermés que d’autres. Mais ils font facilement des plaisanteries. C’est une ambiance pour travailler un peu plus cool, plus décontractée. Ici, à sept heures moins cinq, je ne suis pas en train de regarder ma montre en disant « il faut que j’aille chercher ma fille à la crèche ; je coupe le téléphone, je mets sur répondeur... » Bon, j’ai des horaires... Quand j’ai des copains qui viennent me voir, ils regardent le panneau « Consultations de 11h à 12h, et de 16h à 17h » : « Tu te foules pas, hein... » Sur le continent, le mec qui met ses horaires, après, c’est fermé. Bon, moi j’ai mis ça ici, c’est pour les jours d’hiver, quand il n’y a pas beaucoup de monde, pour que les gens s’efforcent de venir à cette heure-là. Et que je ne sois pas à attendre à huit heures du matin s’il n’y a personne. Et puis en fait les gens s’en foutent. Pas tous les jours, mais presque, on me fait le coup : « Faites voir... Ah, c’est de quatre à cinq ? J’étais persuadé que c’était de cinq à six... » Il y a des gens qui viennent à six heures et demi, sept heures, le matin : « Ah, j’ai vu de la lumière, tu peux me donner mes médicaments ? » C’est plus décontract’... Il fut un temps où je faisais les chimio, aussi. Pour des gens qui avaient un cancer, il fallait faire des perfusions. Il y avait une dame, en particulier, qui avait un cancer de l’intestin, et c’était trois jours de suite, les perfusions, mercredi, jeudi, vendredi, et on enlevait le samedi matin. Donc ça l’obligeait à partir le mardi soir, et revenir le dimanche matin. À l’inverse, elle venait ici, en début d’après-midi, je lui faisais son truc, et on écoutait de la musique, on mettait des CD. C’était il y a huit ans. Et il y a quelques temps, elle m’a dit : « Oh, c’était bien, quand il y avait la chimio, hein ? » Et puis elle se reprend : « Enfin, non, je veux dire la musique, c’était vraiment bien ». Elle va très bien, maintenant...