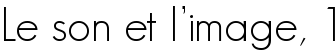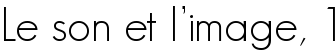
Mis en ligne le mardi 16 novembre 2010 ; mis à jour le vendredi 19 novembre 2010.
 |
|
|
|
Publié dans le
numéro 08 (22 mai-4 juin 2010)
|
Un piano à queue déposé en hélicoptère à 1650 mètres d’altitude ; un piano à queue jeté dans un lac depuis un hélicoptère. Deux Steinway en sens inverse dans le ciel. Deux gestes tape-à-l’oeil, illustrant de manière trop descriptible, photogénique, télégénique, les états d’âme de qui ne s’adresse, pourrait-on présumer à la va vite, qu’à nos oreilles : un pianiste. Ce pianiste s’appelle François-René Duchâble. A propos de François-René Duchâble, je pourrais déverser en guise d’A.O.C. ces lignes convenues où se suivent les mots prodigue, prix, lauréat, concours, suivi de noms de villes et de reines, et un argument d’autorité du genre « Arthur Rubinstein le remarque ». A quoi bon ? puisque tous les grands concertistes ont été remarqués par, ont gagné des.
Les 26 juillet 2003, une carcasse de piano (car c’était juste l’idée d’un piano : sa forme) sombre donc dans le lac du Mercantour. Nouveau piano noyé, un mois plus tard, dans le lac Léman. Les archéologues du futur croiront sans doute au naufrage d’un paquebot de luxe - comment penser au geste narquois d’un pianiste mettant fin à trente ans de carrière et s’expliquant ainsi à la presse : « Je veux me purifier du poids et des souillures de la carrière. Je veux que ce piano noir, ce piano de concert, celui de Carnegie Hall, celui de Horowitz, celui qu’on trouve dans toutes les salles, je veux qu’il devienne léger, qu’il devienne deltaplane... » (Nouvel Observateur, juin 2003).
Cinq ans plus tard, « Tout le monde est monté à pied, sauf le piano », dit la voix off de FR3 Rhône-Alpes. Je n’étais pas, ce jour-là de juin 2008, sur le massif de la Tournette. Mais je vais sur Youtube - comme on dit désormais pour dire je suis devant une image. Un concert en plein air, à 1650 mètres d’altitude. François-René Duchâble joue le troisième mouvement de la Sonate au clair de lune. Correspondance évidente entre le son et l’image : Beethoven et les montagnes, l’art et la nature, deux formes du sublime. Sauf que juste derrière Beethoven, ce n’est pas la montagne : ce sont des casquettes, des lunettes de soleil, un enfant en bob, une quinqua en marcel blanc au décolleté contrariant, les gros mollets d’une sexagénaire. Le Steinway, chapeauté d’un bouquet de fleurs sauvages, repose sur une couverture verte criarde, des fils électriques sous les pattes. Un labrador noir passe, débonnaire, un homme en bermuda bleu le flatte de la main. « Je ne veux plus jouer en intérieur, devant un public aligné en rang d’oignons comme des écoliers, des militaires ou des religieux. Je ne crois pas à ce rituel », avait dit François-René Duchâble. Qui a donc remplacé l’obscurité remplacée par la lumière, les queue-de-pie par un short. A ce jeu-là, ses chaussettes blanches à rayures vertes semblent avoir tort : le noir de la salle et du costume, en enlevant à voir, favorisent la concentration. Ici, même le soleil semble absurde. On ne peut croire que ce son-là jaillisse de cette image-là.
La danse et le théâtre sont des arts qui s’en tirent à bon compte : où corps il y a, parce que corps il doit y avoir. Les chaussettes rayées ne font que montrer l’absurdité du queue-de-pie : c’est le vêtement lui-même, c’est le corps qui est de trop - hormis les avant-bras, les doigts. Qui, lorsqu’un pianiste joue, paraissent comme détachés du corps. Voyant jouer le pianiste russe Boris Berezovsky en petit comité, je me souviens avoir eu un mouvement de surprise, pensant mais ses bras sont nus ! comme si les mains et avant-bras ne l’étaient pas en temps normal, comme s’il s’était délesté de quelque chose - mais quoi ? Rejoignant Michel Schneider qui, dans Glenn Gould piano solo, texte qui tourne autour de ces mêmes questions par d’autres chemins, dit, comme en passant : (Il faudrait bien parler de l’obscène de la musique, de cette chose solitaire qui égare, voile le regard, dans cette hébétude indifférente à tout ce qui n’est pas elle, cette chose que l’on fait avec les doigts, la bouche, le souffle).
L’artiste et son public - comme on dit son chien, son travail, son amant. Duchâble joue en haut de sa montagne, pour un public restreint - mais non choisi, intime, si ce n’est en tant que communauté de sportifs - le pianiste étant un grand marcheur. Toutes les questions sont là : le lieu de l’art, ce choix étrange que la technologie a fait naître : concert ou enregistrement, la démocratisation (« Ce qui m’intéresse, c’est la diffusion de la musique à coups de marteaux s’il le faut pour toucher le plus grand nombre de gens »), l’écoute du public (« Mon but, s’il est altruiste, ne l’est pas exclusivement car j’y trouve moi-même une communication plus profonde, plus vraie que dans les grandes salles de concert internationales »), le commerce. A François-René Duchâble, le journaliste du Nouvel Observateur avait dit : « Dans votre cas, c’est un imprésario qu’il fallait larguer symboliquement ». Ce à quoi le pianiste avait répondu « Non, je n’en veux pas aux imprésarios. Plutôt au système, abstraitement. Je m’entends très bien avec mon imprésario, amical, efficace, bien admis à l’étranger. Et puis je ne peux pas jeter un agent dans le lac ! Un être humain... », et le journaliste, moqueur : « Une carcasse d’agent, alors... » L’agent actuel ? c’est Jacques Thelen. Je prends rendez-vous.