


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


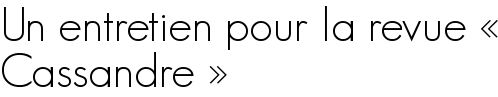
[Début 2013, Raphaël Meltz avait accordé un entretien à Antoine Tricot pour la revue Cassandre à propos du Tigre. Le voici.]
Pour commencer, donc, pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous préférez que je vous pose mes questions par mail plutôt qu’au cours d’un entretien oral ? Vous parliez d’expériences décevantes ce qui parait donc faire échos aux «mauvaises habitudes» des journalistes qui semble vous répugner (les habitudes, pas les journalistes).
Disons simplement que lorsque je réponds par écrit,
je suis certain de retrouver ma voix. Lorsque je parle à l’oral et
que quelqu’un retranscrit mes propos, il y a le risque d’un
glissement vers quelque chose de plus bref, de plus synthétique, de
plus efficace. Je sais que ça paraît prétentieux, ou
casse-couilles, mais plus le temps passe plus ça me perturbe de
m’entendre parler avec une autre voix que la mienne. Et puis, tout
simplement, il y a cette idée que, dans un entretien écrit, tout ce
que je dis est conservé (dès lors qu’on s’est mis d’accord au
début sur la longueur globale du texte). J’ai beau ne pas être né
de la dernière pluie, j’ai toujours été particulièrement agacé
les rares fois où j’ai répondu à des journalistes par téléphone
et où je lisais quelques mots chocs résumant les longues minutes
d’entretien. C’est ce que vous appelez les « expériences
décevantes » sur lesquelles il ne me semble pas passionnant de
revenir. J’ai de plus en plus de mal à admettre que le « jeu de la
promo » tourne en défaveur de celui qui s’exprime : le
journaliste qui vous interroge est (très) pressé, il a décidé de
vous mettre dans telle ou telle case, et ensuite il n’aura plus
qu’à reprendre de votre long bla-bla ce qui lui semble
correspondre à ce qui l’arrange. Quand on a vingt-cinq
ans et qu’on lance sa première revue, on subit cela en
serrant les dents ; douze ans plus tard, je courbe moins
l’échine.
Tout le paradoxe étant qu’au Tigre on
réalise systématiquement nos entretiens avec un magnétophone :
mais au Tigre, on fait très attention à la façon dont on
retranscrit les voix. La ponctuation, par exemple, est un outil dont
j’adore user à l’écrit : il me semble que dans une bonne
retranscription de l’oral elle doit jouer un rôle central.
Nous sommes beaucoup à nous être senti trahis en relisant nos propos déformés dans un article de journal. Mais le rôle du journaliste n’est-il pas de transmettre une information en la rendant compréhensible au groupe de lecteurs auquel il s’adresse ? Dans ces conditions, il semble inévitable qu’il reformule le message selon des critères qui lui sont propres : sélection subjective des passages les plus pertinents, réécriture des expressions non adaptées à l’écrit etc. Refuser cette déformation n’est-ce pas refuser ce qui est l’essence même du travail du journaliste : son rôle de médiateur ?
Je suis d’accord, et c’est ce qu’on fait nous-même, comme je le disais, dans nos entretiens. Mais toute la question est : qui est ce médiateur ? Comment travaille-t-il ? Quelle énergie fournit-il pour écrire son papier ? Quelle est sa sensibilité ? Mouille-t-il sa chemise à chaque entretien qu’il fait comme si du choix de chaque mot, de chaque virgule, dépendait la beauté du monde et son équilibre ? Ou alors est-il en train de tweeter sur la couleur du caleçon de François Hollande, de rigoler avec son collègue d’en face sur la coiffure de son chef de service, d’organiser ses prochaines vacances en Toscane, tout en retranscrivant vos propos ? Je prends deux exemples extrêmes volontairement – évidemment que la moyenne des journalistes ne fait ni l’un ni l’autre ; mais, tout de même je crains que nombre d’entre eux ne penchent plus vers le second cas que vers le premier. Et je suis toujours surpris, quand je rencontre des journalistes qui semblent faire le même métier que moi, dont j’ai l’idée qu’ils doivent avoir le même désir de profondeur, de sensibilité, je suis toujours surpris quand je vois ce qu’ils écrivent au final – comme si l’énorme gouffre entre nos papiers et les leurs ne leur sautait pas au visage, alors qu’il me fait mal aux yeux. Quand je dis « nos », je fais référence à tous les titres, plus ou moins minuscules, qui se battent pour proposer une autre façon d’écrire. (Et pardon si je donne l’impression de m’exprimer comme un vieux con sentencieux.)
Peut-être que le gouffre leur saute au visage, mais qu’ils considèrent le Tigre comme une revue de création littéraire et non pas comme un journal. La sensibilité, la profondeur, ça n’entre pas dans le cadre de ce qui est permis en journalisme. Ça ne correspond pas à la « forme journalistique » telle qu’on l’apprend dans la plupart des écoles de journalisme en recopiant ce qui se fait dans les médias plutôt qu’en inventant sa propre expression. En fin de compte, ce que vous reprochez à la grande majorité des journalistes français actuels n’est-ce pas un manque de créativité ? Ce pourrait être là que se fait la différence entre le Tigre et la presse classique – la volonté de faire du journal une œuvre artistique et pas seulement un objet de consommation courante. Mais à ce moment là, doit-on encore parler de journalisme plutôt que de création artistique ?
Michel Butel, le fondateur de L’Autre journal (et qui vient de relancer L’Impossible) défend cette idée d’un journal comme une « œuvre d’art » (œuvre qui serait réalisée à plusieurs, un peu comme un film). Je vois les choses un peu différemment : Le Tigre pour moi est un produit périssable, un objet qui a à voir avec l’immédiateté, avec une forme d’efficacité, avec des belles histoires où l’on prend le lecteur par la main, avec des images fortes qui le font voyager – bref, pour le dire simplement, qui est plus proche de Paris-Match que, je ne sais pas, d’un beau et grand roman. Le poids des mots, le choc des photos : est une formule qui me va très bien, et qui insiste sur le fait que ce qu’on donne a lire n’a pas exactement les mêmes strates de la complexité artistique, ni les mêmes points de départ que la création artistique au sens propre : on s’est d’ailleurs toujours refusé, au Tigre, à publier de la fiction ou de la poésie. Ceci étant posé, reste la question : pourquoi les journalistes ont-ils renoncé à la beauté et à la complexité que permet l’écriture ? Je prends un exemple tout bête : en juillet 2012, le BEA a sorti son rapport sur le crash du vol Rio-Paris de 2009. Tous les journaux en ont parlé. Dans Le Tigre (septembre 2012), Renaud Wattwiller a écrit un article dont la source unique est ce rapport : pour moi cet article est plus riche, plus riche d’informations au sens premier du terme, que tout ce que j’ai pu lire ailleurs, tous les papiers construits sur le modèle traditionnel 1° analyse du rapport, 2° parole donné aux experts, 3° réponse des familles. Ce crash, je ne l’avais pas éprouvé au sens propre du terme avant de lire ce papier. Pour moi, c’est du journalisme, et non pas de la création littéraire. Longtemps, j’ai cru que les journalistes manquaient de style, au sens propre : peu d’appétence pour la littérature, pour la beauté de la langue. Aujourd’hui, j’ai plutôt tendance à croire qu’ils souffrent d’un défaut de sensibilité : je préfère encore une langue maladroite mais qui exprime quelque chose, qu’une langue carrée qui ne fait que présenter les faits, ce que tout bon aspirant journaliste apprend à faire. Je pourrais dire : ils préfèrent présenter les faits plutôt que les représenter. Par ailleurs, c’est peut-être le moment que de rappeler que dans les quotidiens des années 1930, objets de consommation courante par excellence (ils se vendaient par millions d’exemplaires), on pouvait lire des reportages de Joseph Kessel, de Blaise Cendrars, d’André Malraux, etc. Des textes avec une sensibilité littéraire évidente, même si conçus pour être lus par le plus grand nombre : les deux ne sont donc pas exclusifs l’un de l’autre.
Mais pourquoi ne trouve-t-on plus cette sensibilité dans les articles des journaux à grands tirages aujourd’hui ? Savez vous qui a décidé à un moment donné de dire que l’exposé des faits devait être froid et désincarné ?
Oui, je le sais, c’est un certain André Luminot, qui, en 1953, a réuni tous les patrons de presse dans une cave voûtée, sous la gare Saint-Lazare et qui, tirant sur son havane d’un air pervers, leur a dit : « Les cocos, c’est fini l’âge d’or de la presse. Maintenant, on favorise le petit articulet médiocre. » Non, malheureusement il est très difficile de cerner ce qui s’est passé – je n’ai que quelques pistes à proposer (il y a peut-être des travaux universitaires sur la question, mais en cherchant rapidement je n’ai jamais trouvé les réponses que j’attendais ; j’ai à un moment pensé à écrire un livre qui raconterait cette histoire, mais je n’ai pas trouvé le temps de le faire). D’une part, si la première école de journalisme (l’ESJ) a été créée en 1899, ce n’est qu’après la Libération que la formation des journalistes devient un enjeu central en France. Et ce pour une raison simple : de nombreux journaux et journalistes ayant collaboré avec l’ennemi, il y avait l’idée que former les journalistes, notamment à la question de la rigueur journalistique, à l’éthique, ce serait une façon d’éviter que cela n’arrive à nouveau. Et il est vrai que les écrivains-reporters n’étaient pas forcément passionnés par la notion de vérité : ainsi peut-on prendre Cendrars en flagrant délit de bidonnage dans un « reportage » durant la drôle de guerre, dont on découvre (en annexe à l’édition 10/18 de Panorama de la pègre) qu’il l’a en réalité construit grâce à une lettre d’un ami, n’ayant jamais mis les pieds sur les lieux qu’il décrit pourtant en se mettant en scène.
Il faut aussi parler de l’importance du développement des newsmagazines à partir des années 1960 : en 1964, L’Express et Le Nouvel observateur décident d’imiter le modèle américain, type Time magazine. Ce qui veut dire : un ton froid, des reportages dits « objectifs », mais aussi une façon de coller à la « modernité », c’est-à-dire la société de consommation qui prend son essor. C’est donc à la fois l’arrivée des pages « conso » et la perte du « je » dans l’écriture journalistique. Mais ces hebdomadaires français auraient pu faire un autre choix en aller chercheur leur inspiration aux États-Unis, par exemple copier ce qui est pour moi le journal idéal, The New Yorker, qui existe depuis 1925 : un titre où la longueur des papiers et la qualité de l’écriture sont deux des variables principales. D’ailleurs aux États-Unis, le principal prix « littéraire » est le Pulitzer, qui récompense un journaliste ; en France, c’est le Goncourt, qui récompense un écrivain. Ce n’est pas complètement anodin : là-bas, l’idée d’une écriture journalistique est valorisée. Truman Capote a commencé De sang-froid dans le New Yorker ; Hunter Thompson, l’inventeur du « gonzo » publiait ses reportages dans Rolling Stones, etc. En France, on a eu Actuel, L’Autre journal qui ont suivi cette veine soit gonzo soit littéraire, mais à partir du milieu des années 1990, tout a disparu. En 2006, lorsqu’on a lancé Le Tigre, il n’existait plus de titre généraliste où ces questions étaient posées. Ce n’est qu’après nous que les « mooks », type XXI et consorts, se sont lancés sur ce créneau du reportage d’écrivain.
La question de la sensibilité appelle celle du narrateur et de sa subjectivité. Comme le disait déjà au 19e siècle l’historien allemand Johann Gustav Droysen : « c’est seulement en apparence que les ‘faits’ parlent d’eux-mêmes, par eux seuls, à l’exclusion de toute autre voix, ‘objectivement’. Ils seraient muets sans le narrateur qui les fait parler. » Les journalistes sont partiaux dans le traitement des sujets qu’ils abordent. Personne n’est dupe. Pourtant, la première chose qu’un apprenti journaliste apprend, c’est à ne pas dire « je », de disparaître derrière l’objet de son article. Cela nuit considérablement, il me semble, à l’image des journalistes. Si un journaliste dit « j’ai vu ça, on m’a dit ça, je pense que... », alors il est possible de critiquer sont point de vue personnel et sa méthode. En revanche, quand un journaliste dit : « il s’est passé ça et telle est la signification objective de cet événement », lorsque l’on n’est pas d’accord avec ce qui est dit, on ne peut s’en prendre qu’à l’ensemble de la profession et pas au type qui met son nom au bas de l’article. À ce sujet, vous défendiez lors de votre candidature à la direction du monde en janvier 2011, ce que vous appelez la « réfutabilité » de l’information. Qu’entendiez vous par là ?
Cela fait quelques temps que j’essaie de creuser cette piste autour de la réfutabilité, notion créée par Karl Popper pour déterminer ce qu’est une théorie scientifique. « Toutes les corneilles sont noires » est une théorie scientifique, car il est possible de le réfuter en présentant une corneille blanche. « Dieu existe » n’est pas réfutable, ce n’est donc pas une théorie scientifique. Appliquée au journalisme, cela revient à donner au lecteur les moyens de comprendre les conditions de fabrication d’un article, lui laisser la possibilité de le « réfuter », c’est-à-dire de contredire les données avancées, les relativiser, etc. Prenez l’affaire Tarnac : ce n’est pas évidement la même chose si vous lisez un article qui dit « L’ultra-gauche déraille » (célèbre une de Libération) ou qui dit « Selon les flics, l’ultra-gauche déraille ». Je prends l’exemple d’un article que je viens d’écrire pour Le Tigre (décembre 2012-janvier 2013) autour des archives du mathématicien Alexandre Grothendieck. Arrive un moment où j’interroge le responsable du patrimoine de l’université de Montpellier, qui possède ces archives alors que leur auteur souhaite qu’elles ne soient pas rendues publiques. Il me semble important d’indiquer que, sur certains points, je n’ai pas les moyens de mener une contre-enquête, et que du coup je ne peux que choisir de croire en ses propos : ce qui rappelle au lecteur qu’il n’y a, là, qu’une seule source. Dans n’importe quel article de journaliste, il y a des passages entre guillemets (le « verbatim »), puis d’autres intégrés au texte qui, pourtant, la plupart du temps, proviennent également des propos de la personne interrogée. Pour rendre un papier vivant, un journaliste a tendance à mêler deux niveaux d’écriture : l’oral, et les faits. Or, s’il n’y a qu’une source pour les deux, ce n’est évidemment pas la même chose que s’il y en a deux. De même, je n’avance jamais aucun fait, aucune citation, sans sourcer de façon plus ou moins précise (c’est-à-dire que je peux par exemple dire que je pioche dans diverses sources sans forcément préciser qui vient d’où) : le lecteur a la possibilité de refaire intégralement mon travail pour voir comment j’ai construit mon propos. La seule chose qui manque, pour le lecteur, c’est le verbatim intégral de l’interview – et d’ailleurs, j’imagine très bien qu’on pourrait le mettre à disposition (sur le site du Tigre, en complément de l’article) ; c’est par manque de temps que je ne le fais pas. On me dira que dans un quotidien il n’est pas possible de mettre toutes les sources, les dates et lieux de rencontre des personnes interrogées, etc. C’est vrai, mais on nous bassine tellement avec le plurimédia que je me demande pourquoi les versions « augmentées » numériques n’intègrent pas toutes les conditions de fabrication d’un article.
On est là à mi-chemin entre la question du style et celle de la rigueur : pour moi, l’un ne vas pas sans l’autre – j’ai parfois quelques soucis avec quelques très beaux papiers du Tigre où l’auteur se sent assez libre (au motif, justement, que nous pratiquons un journalisme différent) de ne pas trop sourcer ce qu’il avance. Je laisse passer, mais dans l’idéal, il me semble qu’un très beau papier, très bien écrit, devrait également être très rigoureux dans sa façon de présenter les faits aux lecteurs.
Comment peut-on espérer aujourd’hui créer de nouvelles formes de journalisme, plus subjectives, plus sensibles ? La presse papier est en crise. On nous le répète suffisamment. Baisse des recettes publicitaires, baisse des ventes, concurrence dite déloyale des moteurs de recherches sur Internet... Malgré tout ça, le Tigre (parmi d’autres) innove, que ce soit sur la méthode, l’expression ou le graphisme. Et vous proposez cette innovation pour un prix au numéro loin d’être exorbitant. Mais en contrepartie les contributeurs ne sont pas payés. Est-ce que le journaliste est voué à devenir un amateur qui gagne sa vie ailleurs et écrit par passion ? L’amateur est lui aussi pris dans son quotidien et son gagne-pain. Est-il plus disponible que les journalistes professionnels que vous décriviez au départ ?
Il était déjà difficile de répondre à ce genre de questions il y a une douzaine d’années (moment où, avec Lætitia Bianchi, nous avions fondé « l’ancêtre » du Tigre, la revue R de réel) – c’est encore plus délicat aujourd’hui, où la crise qui frappe la presse « traditionnelle » a un effet ricochet sur la presse « différente » (pour qualifier l’une et l’autre rapidement). Je ne suis pas persuadé que Le Tigre ait vocation, en soi, à être une entreprise si peu commerciale, ni à faire écrire non pas des amateurs (car le terme est ambivalent) mais des gens qui gagnent leur vie par ailleurs. C’est parce qui ni Lætitia ni moi n’avons jamais eu le moindre sens commercial, ni grande envie de rentrer dans le grand bain de l’entrepreneuriat que nous avons accepté (ou développé) cette façon particulière de travailler. Qui a, tout de même, un grand avantage : nous ne continuons Le Tigre que si nous en avons le désir (puisque, loin de nous faire gagner de l’argent, il nous en fait perdre dans la mesure où il réduit drastiquement notre temps disponible), et ceux qui y participent ne le font que par envie profonde – ce qui permet de s’assurer de la qualité finale du journal. Travailler par routine, écrire pour payer son loyer sont impossibles au Tigre, et c’est d’un grand bénéfice, en tout cas pour nos lecteurs... Lecteurs qu’il est du coup possible de solliciter lorsque nous avons des problèmes de finances : ils comprennent que notre démarche se situe dans un champ qui n’a pas grand-chose à voir avec le commerce traditionnel.
Je sais que ce n’est pas un modèle généralisable à l’ensemble de la presse, et nous profitons des métiers « normaux » qu’exercent nos contributeurs, mais jusqu’à présent, je n’ai pas trouvé d’autre façon de faire. Ce qui ne veut pas dire que je n’éprouve pas le désir, parfois, d’aller voir s’il serait possible de conserver un même degré d’exigence sur la forme, le fond, le choix des sujets, etc. dans une structure plus grosse, plus classique, avec plein de salariés. L’avantage que nous avons, avec notre économie « de guerre », c’est que nous restons globalement épargnés par la crise de la presse ; depuis quelques années, je sais que Le Tigre ne pourra plus mourir pour des raisons économiques : il tiendra tant que nous en aurons la volonté.