


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


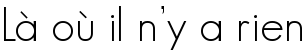
 |
|
|
Publié dans le
numéro 028 (avril 2013)
|
Nous sommes cinq à descendre du train. Il est 10h47. Le ciel est gris et le quai parfaitement rectiligne, la température extérieure avoisine les 2°C ; il ne pleut pas. Derrière moi PLAN 28, mon RER, sonne puis s’éloigne vers les dernières gares de la ligne : c’est ici, à Orsay-Ville dans l’Essonne, que commence mon voyage. À Orsay-Ville, François Maspero était presque au bout du sien. C’était il y a plus de vingt ans, en 1989. Lui était parti de Roissy-Charles-de-Gaulle, à l’autre bout de la ligne B du RER. Chaque jour il prend le train et avance d’une station. Puis il visite, regarde, décrit ce qu’il y a autour, et il lui faut trois semaines pour franchir la petite cinquantaine de kilomètres qui le sépare d’Orsay-Ville ; un voyage comme une croisière, autant de ports que de gares. Il en fait un livre, un très beau livre : Les Passagers du Roissy-Express. Un livre qui donne envie de voyager, de regarder et d’écrire ce qui est juste autour de soi, de Paris. Alors je ferai le tour de la Francilienne. La Francilienne, c’est une autoroute : A104, N104 ou N184 suivant ses tronçons. Autour de Paris, il y a d’abord le boulevard périphérique, puis l’A86 et, plus loin, la Francilienne, le troisième contournement de la capitale, long de 160 km. À l’origine, dans les années 70, elle était rocade interdépartementale des villes nouvelles. Le tour, je le ferai à vélo. Trois ou quatre jours de voyage, on verra bien, le long de l’autoroute, autour de cette boucle inachevée - il n’y a qu’un C à l’envers - dont le quart ouest, toujours en projet, manque encore. Qu’y a-t-il aux marges de la ville ? Et que voit-on en ralentissant ? Car là, si l’on y passe, c’est en voiture. Les trains mènent vers Paris, le long des rayons du cercle, et les voitures, les camions longent sa périphérie. Mais sur cette autoroute comme sur les autres, on ne pédale pas. Je la suivrai donc au plus près, la carte en main (IGN no 190, Paris - Chantilly - Fontainebleau, série Top 100 « Tourisme et Découverte », échelle 1/100 000).
Ce matin je suis allé prendre le RER à Gare du Nord, je voulais me transporter directement en un point de la boucle. J’avais choisi Orsay-Ville, au pied du C inversé, au sud-ouest de Paris, car, sans que je ne me l’explique, il y avait comme une évidence à pédaler dans le sens contraire des aiguilles d’une montre ; j’irai jusqu’à Cergy-Pontoise. Je suis parti tard même si je n’aime pas ça : en voyage on veut que la journée soit la plus longue possible alors on part de bonne heure, mais comment mettre un vélo dans un RER bondé. À 9h15, je suis sur le quai de la voie 42. Malgré l’heure tardive, il y a du monde, beaucoup de monde. L’écran indique que tous les trains sont retardés, le préposé aux annonces parle d’un « accident grave de voyageur en gare d’Aubervilliers » et d’une circulation interrompue dans les deux sens. Au bout du quai, sous les quatre écrans qui permettent au conducteur de voir la rame en son entier, les machinistes attendent les trains - l’interconnexion est suspendue. L’un remarque mon vélo, il est cycliste aussi. Le week-end prochain, il veut faire une sortie avec un collègue. Ils ne savent pas où aller, ils rigolent : pourquoi pas Néchin, en Belgique. Oui, ils iront à Néchin. À 9h54, je laisse passer le premier train pour Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Le suivant est annoncé à 10h12 : c’est PLAN 28. À 10h47, je sors du train à Orsay-Ville.
jour 1
La Francilienne est toute proche, à quelques kilomètres à peine, juste en haut, sur le plateau de Courtabœuf. Il faut monter, sortir de la vallée de l’Yvette et d’Orsay qui semble endormie ou abandonnée pour la journée, on ne sait trop et je ne m’y arrête pas, comme s’il me fallait rattraper le retard du RER. Et puis pédaler réchauffe. À peine rencontré mon premier panneau N104, ma route s’enfonce dans les bois. J’avais rêvé de ZI, de ZAC, de vapeurs de gasoil et je n’ai qu’odeurs d’humus, troncs centenaires et chants d’oiseaux.
La route est déserte, même la bruine a cessé. Les premiers villages, presque la France profonde. Succession d’images d’Épinal : une réclame pour les apéritifs Dubonnet sur les murs d’une vieille ferme puis un facteur, son Kangoo arrêté, porte ouverte, au milieu de la route. J’avale les kilomètres tout au plaisir de pédaler, les muscles se chauffent et s’assouplissent. Il n’y a pas de vent, l’air est immobile, c’est moi qui vais à travers lui. L’euphorie des départs et de l’effort. Je passe d’un côté à l’autre de la Francilienne : banlieues pavillonnaires, maraîchage, quelques caravanes. Marcoussis, Montlhéry (je monte jusqu’à la tour Saint-Merry), Linas, Longpont-sur-Orge (un petit chemin de terre au bord de la rivière), Brétigny-sur-Orge (des collégiens dans une cour de récréation), Le Plessis-Pâté (cet homme dans son garage, le premier à qui je m’adresse, de l’eau pour ma gourde), partout cette quiétude. Rien ne bouge. Je pédale jusqu’à ce moment, l’évidence même : je vais trop vite et je ne vois rien. La crainte, avec ces kilomètres déjà parcourus, d’avoir dilapidé trop vite un trésor. Ralentir, s’arrêter sans attendre.
Là, un café, poser le vélo contre la façade et y entrer. Je suis au hameau de Liers, commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, les serveurs sont chinois et les clients me tournent le dos, regards aimantés par le jeu et les bêtes : l’heure du tiercé approche, du trot attelé. Le café se remplit soudain, on se gare à la hâte dans la rue, tend son ticket pour faire valider son jeu, puis le silence des premiers hectomètres de course avant les encouragements et les bons mots. J’achète Le Parisien (on a volé un chasse-neige dans la commune voisine). À travers la vitre, je remarque, comment ne l’avais-je pas vu, un éléphant, sculpture immense, juste en face, sur le parking du café, entre deux mûriers platanes. Acheté par les anciens propriétaires dans les années 50, trop grand pour passer sous la porte cochère, il est resté là depuis. L’arrivée du tiercé est validée. On est bon perdant ici. Le PMU propose déjà la course suivante - mirage du gain -, on règle les cafés. Les uns repartent vers leur chantier, les autres restent face à l’écran. Je sors et je vais voir l’éléphant. Il est presque à l’échelle 1.
Au coin de la rue, quelques centaines de mètres plus loin, à nouveau l’étonnant : un long mur blanc et des inscriptions en cyrillique laissent deviner un cimetière russe. Un panneau fané par le soleil et les intempéries annonce : 6000 tombes, 18000 émigrés russes, Rudolf Noureev, Andreï Tarkovski... À l’intérieur, blancheur immaculée d’une église orthodoxe, croix en bois surmontées d’un bulbe bleu, allées plantées de bouleaux et d’épicéas, le cyrillique partout, des noms à particule, beaucoup de Russes blancs partis en 1917. Au fond du cimetière, un couple. Eux sont espagnols, fils et filles de républicains, des rouges assurément qui veulent bien convenir que le cimetière est beau mais quand même : ceux-là étaient les ennemis de la révolution. Leurs ancêtres à eux sont à la périphérie, aux côtés des Portugais, des Italiens, des Polonais, de ceux qui sont venus travailler.
Puis je rencontre deux femmes plutôt âgées, l’une d’elles est la fille d’un marbrier. Elle me montre son nom : Di Bernardo. La signature est partout sur la tranche des pierres tombales. Son père est venu d’Italie après la Première Guerre ; les pompes funèbres, il fallait bien gagner sa vie. Ses fils ont pris la suite. La troisième génération n’a pas repris, on a vendu. Toute la famille est là, à gauche c’est sa cousine, décédée l’an passé. Avec son amie, elles connaissent bien l’histoire du cimetière russe de Sainte-Geneviève, liée à celle de la Maison russe, là-bas derrière le stade ; elles peuvent m’y accompagner d’ailleurs, c’est leur route. À la fin des années 1920, une princesse russe se fait offrir un château, elle le transforme en un centre d’hébergement pour les Russes exilés en France après la révolution d’Octobre. Rapidement, ils sont plus d’une centaine à vivre et à vieillir là, aristocrates, généraux des armées blanches, puis exilés de toutes sortes. Ils sont enterrés au cimetière communal. Au fil du temps, le carré russe s’agrandit et attire les Russes de toute l’Europe : c’est là qu’on veut sa sépulture.
Le chemin qui mène au village passe derrière la Maison russe - « Tu te souviens, les pensionnaires cultivaient leurs légumes là » - et un peu plus loin, avant cette petite maison, sur ce bout de terre à l’abandon, pris dans les ronces et couvert de feuilles mortes, ils enterraient leurs chiens et leurs chats. Elle le sait : son père leur fabriquait de petites stèles.
À l’accueil de ce qui est toujours une maison de retraite, on ne sait trop que répondre à mes questions alors on me donne la brochure destinée aux nouveaux pensionnaires. Il est quinze heures trente.
Après Sainte-Geneviève-des-Bois, il y a Fleury-Mérogis. Le plus grand centre pénitentiaire d’Europe, plus de 3900 détenus. Face à une prison, il doit y avoir un hôtel et c’est ce que je cherche. Il y en a même deux, je prends le moins cher : l’hôtel Saxo, entre le Quick et Sushiland, dans la zone de la Greffière. Le bâtiment, modules préfabriqués, commence à dater. Le parking, truffé de nid de poules, semble avoir été bombardé. À l’intérieur, des convecteurs hors d’âge tentent d’assécher un air chargé d’humidité. Le téléviseur diffuse les informations en boucle : « Coup de tonnerre au Vatican » peut-on lire sur les bandeaux qui défilent au bas de l’écran. Oui il y a des chambres libres. Est-ce que je peux rentrer avec mon vélo ? Oui bien sûr, on le mettra dans une des chambres condamnées ou dans ma chambre, c’est comme je veux. Je ressors à pied.
Fleury, c’est deux avenues. Celle du Docteur Fichez, un kilomètre tout au plus entre l’A104 et Viry-Châtillon, des cités de chaque côté, plus la zone de la Greffière avec ses deux hôtels 24/24, son garage automobile, un magasin de meubles, un bazar, Tony Fruits, le Quick, le buffet asiatique « wok à volonté » et Sushiland. Et puis il y a la deuxième avenue : l’avenue des Peupliers, perpendiculaire à la première. Des peupliers, il n’y en a que sur les premiers mètres, au pied des tours qui hébergent surveillants de prison et gendarmes. Il y en a jusqu’à ce panneau : « Domaine privé. Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ». Après, il est interdit de rouler à plus de 30 kilomètres par heure, de prendre des photos et de filmer. L’avenue est longue, parkings immenses de part et d’autre, à droite le personnel, à gauche les visiteurs. Les bâtiments sont plus loin sur la droite. Dans l’ordre : le centre des jeunes détenus, la maison d’arrêt des hommes, puis tout au fond la maison d’arrêt des femmes. C’est l’heure de la relève. Le parking des surveillants se vide, on rentre chez soi le portable à la main, le volant dans l’autre. Certains marchent jusqu’à leur tour voisine.
À la maison d’arrêt des hommes, monstre de béton, c’est aussi l’heure de la fin des parloirs. Face à la sortie, ou à l’entrée si l’on veut, il y a le bâtiment d’accueil des familles, avec des vestiaires pour se changer et des casiers pour laisser ses affaires avant d’entrer dans la prison proprement dite, des bornes pour prendre rendez-vous pour le parloir suivant et des affiches qui expliquent les conditions de visite (trois visites de 30 minutes par semaine par détenu, trois personnes maximum plus un enfant de moins de 14 ans, justificatifs à fournir). Je prends un café à la machine. Un monde de femmes : on vient voir les copains, les maris, les pères... Quelques groupes de jeunes aussi qui rejoignent leur voiture, presque une ambiance de sortie des classes et, derrière, le béton, des tonnes de béton et des milliers d’hommes. Je reviens à pied, passe l’arrêt de bus où l’on attend le DM 05 avec le sac de linge sale. Les gendarmes font de la course à pied : allers-retours entre leur caserne et la maison d’arrêt des femmes. Face aux prisons, de l’autre côté de l’avenue, derrière les parkings, il y a des prés (« Réserve foncière. Ministère de la Justice ») et au fond un bois.
Plus tard, je remonte l’avenue du Docteur Fichez. Je marche sur le bas-côté avec un homme et une femme qui traînent de lourdes valises dans les ornières et la boue. Au bout, un rond-point où les frontières se rejoignent : à droite c’est Grigny, en face Viry-Châtillon, et à gauche Morsang-sur-Orge ; les communes sont imbriquées comme les pièces d’un puzzle. Mais ce qui délimite vraiment, ce sont les avenues : d’un côté les grands ensembles, de l’autre les pavillons, et là on ne se mélange pas. Le soleil se couche sur la zone de la Greffière. Je m’en retourne vers l’hôtel Saxo, goûtant cette lumière horizontale, ces derniers timides rayons de ce soleil d’hiver, qui s’en vont disparaître derrière l’hôtel Première classe, et je trouve ça beau. Le soir au Sushiland, il n’y avait pas de sushis mais un buffet asiatique.
jour 2
En fait, Fleury-Mérogis, ce n’est pas que deux avenues. Il y a aussi Fleury-Village que je n’avais pas vu hier. J’avais cru Fleury une ville nouvelle. L’église, la mairie, quelques maisons et une grosse ferme sont au sommet d’une butte. L’autoroute est là, juste derrière. Je m’arrête sur le pont. Le trafic est dense, surtout vers l’ouest. Il y a un peu de vent ce matin, une bruine imperceptible comme un embrun, presque un air marin. Le ciel est bas, uniformément gris, d’un gris presque laiteux. Le froid fige l’encre de mon stylo. J’en utilise deux en alternance, le second accroché à mon tee-shirt est mis à réchauffer contre ma peau.
De l’autre côté, c’est toujours Fleury. C’est le parc d’activités des Ciroliers. L’activité principale ici, c’est ce que l’on appelle la logistique. On décharge des camions dans des entrepôts pour ensuite recharger la marchandise dans d’autres camions. Alors autour, il y a des garages poids lourd, toutes les marques sont là, disséminées dans la zone : Volvo, Scania, Renault Trucks, Iveco, MAN, Mercedes et DAF. Le gel des derniers jours et le passage incessant des camions ont abîmé la chaussée. Au bout de la zone, juste avant cet entrepôt en construction - « ici bientôt, la révolution des courses : Chronodrive » - où pour le moment les engins de levage peinent dans la boue, il y a ces piles de palettes magnifiques. « Achat-Vente », est-il indiqué à l’entrée. Deux caravanes servent de bureaux. Gérard est cariste, les piles parfaites c’est lui. Les palettes bleues et les rouges sont consignées, on ne peut que les louer. Celles qui ne sont pas peintes sont à vendre. Elles sont triées selon leur état et le tarif n’est pas le même. Toutes sont des « Palettes Europe », reconnaissables aux logos EUR et EPAL marqués sur leur tranche comme le fer rouge sur la cuisse des vaches. Emmitouflé dans sa parka, Gérard regarde venir de loin un petit camion - « La palette, ça trafique » - et remonte sur son Fenwick.
Après, c’est Bondoufle. Les usines sont plus anciennes, certaines à l’abandon. Il y a des camions-snack avec leur groupe électrogène, des semi-remorques décrochées en attente d’un relais, des chauffeurs qui dorment dans leur cabine, rideaux tirés - ils ont fait la nuit -, et un camion-école qui tourne dans la zone. Plus loin, une petite forêt et le trio des bords d’autoroute - cimetière, station d’épuration, « aire d’accueil des gens du voyage » - séparent la ZI de la ville de Courcouronnes. Dans la forêt, un homme est seul dans sa voiture. Cités boisées puis village coquet, les rues sont calmes, parfaites pour le cyclisme. Au sud, la zone pavillonnaire est délimitée par l’aqueduc de la Vanne, comme protégée par un rempart : c’est l’approvisionnement en eau de Paris. Construit à la fin du xixe siècle, il court sur 173 km jusqu’au réservoir Montsouris dans le XIVe arrondissement.
À Évry, dans le quartier des Pyramides, j’ai cherché le foyer des jeunes travailleurs qui héberge les septuagénaires qui ont construit la ville il y a quarante ans. À Corbeil-Essonnes, j’ai longé la Seine qui n’était pas loin de déborder. À Saint-Germain-lès-Corbeil, je l’ai traversée. Au Carré-Sénart, on construit, et je ne voudrais pas y habiter. À Lieusaint, il a neigé. À Brie-Comte-Robert, je me suis demandé s’il fallait garder toutes les ruines de châteaux médiévaux. À Lésigny, j’ai pédalé à travers un golf détrempé. Et à Pontault-Combault, fatigué, j’ai cherché un hôtel autour de la gare, sauf qu’il n’y en avait pas. Alors, je suis allé un peu plus loin, à Lognes, à l’intersection des autoroutes A104 et A4.
Dans la zone industrielle Paris-Est, j’ai trouvé l’hôtel Europarc. Ici, le créneau c’est Disney. Le parc d’attraction est à 15 km et là-bas les hôtels sont hors de prix. Le vélo, pas de problème, ici aussi il y a des chambres condamnées. Autour de l’hôtel, quelques anciennes usines, dont une des surgelés Findus, reconverties en entrepôts, une agence Kiloutou, Fraikin (un autre loueur) et, au loin, Norbert Dentressangle et ses dizaines de camions rouges. Si pédaler réchauffe, on ne peut s’arrêter longtemps, mon visage est cuit par le froid, mes jambes sont courbatues, je ne sors pas de l’hôtel. Il y a à voir par la fenêtre. On roule au pas sur la Francilienne, long ruban coloré de semi-remorques, et au bas de l’hôtel, de l’autre côté de la haie qui délimite le parking, il y a l’herbe rase de l’aérodrome de Lognes-Émerainville et les hangars des différents aéroclubs dont les noms célèbrent les pionniers de l’aviation : Sadi-Lecointe, Guillaumet... Comme la journée se termine, les petits avions atterrissent un à un sur la piste. Aux beaux jours, on doit venir regarder ce ballet, là dans ce champ à droite qui est aujourd’hui gorgé d’eau et où sont installées douze tables de pique-nique. Il y a aussi ces deux silhouettes, là-haut dans la tour de contrôle. Impression d’ailleurs. La nuit tombe, je vois leur ombre, comme en apesanteur dans cette cage vitrée accrochée aux lumières rouges du sommet de la tour. D’où vient cet élan, cette sensation que nous sommes proches ?
jour 3
Je pars et j’oublie de mettre mes stylos contre ma peau, l’encre est à nouveau figée. Alors je pédale. À la sortie de la zone industrielle de Paris-Est, au bout des pistes de l’aérodrome, l’A104 rencontre l’A4, qu’elle emprunte sur quelques kilomètres, comme si elle cherchait à quitter Paris, pour ensuite reprendre sa rotation, son rayon agrandi, vers le Nord et Roissy-Charles-de-Gaulle. Moi, je suis à Torcy, de l’autre côté du pont, devant la gare RER, face au centre commercial Bay 1. Mes jambes sont encore dures ce matin, et Torcy est vallonnée. Ici s’arrêtent les rames de l’une des branches de la ligne A du RER, et on se presse, on se hâte, pour ne pas rater le prochain train. Après j’ai roulé, j’ai mangé, j’ai roulé, j’ai mangé, le deuxième des sept commandements du cyclotouriste en tête, ceux légués par Paul de Vivie dit Vélocio, l’un des inventeurs du dérailleur et le premier des voyageurs à vélo : mange avant d’avoir faim. Alors j’ai mangé encore et pédalé lentement jusqu’à ce que la forme vienne.
J’ai traversé le parc culturel de Rentilly, la Marne à Lagny puis j’ai fait un détour pour passer par Bordeaux (commune de Villevaudé). À Villeparisis, j’ai retrouvé ces enseignes que je vois depuis trois jours : la maison verte des Léon de Bruxelles, les néons rouges des Buffalo Grill, le Q blanc sur fond rouge des Quick, le M jaune des McDonald’s, les lettres jaunes sur fond bleu des Castorama, la feuille des Botanic... À Tremblay-en-France, j’ai mangé à nouveau puis je me suis perdu.
Le corps a son rythme dans l’effort : ses hauts, ses bas. Le haut, c’est très précisément deux heures après le départ, quand une sensation de bien-être vous envahit au détour d’une zone industrielle, malgré le froid ou la pluie, et que les phrases se bousculent en vous. Si l’effort est régulier, la sensation reste et les endomorphines aident à voir, comme si le relief apparaissait enfin et que la beauté des lieux ressortait d’où nos habitudes l’avaient cachée. Oui, elles étaient belles ces subtiles nuances de gris - hangars et routes sur fond de brouillard -, dans la ZA de Paris-Sud juste après la vieille nationale 6 ! Le bas se manifeste, lui, une heure environ après avoir mangé, en début d’après-midi. C’est ce moment où l’on manque de lucidité, où s’il ne faisait pas si froid on s’allongerait dans l’herbe le temps de digérer, le temps que le sommeil s’empare de vous et vous rende ensuite à la route. Hier, ce manque de lucidité, c’était dans la forêt de Notre-Dame, sur un chemin de terre boueux, un peu avant Pontault-Combault. Devant moi, la flaque tenait plus de la mare et je l’ai traversée en mouillant mes pieds à chaque tour de roue. Et aujourd’hui, à Tremblay-en-France, je me perds, tombant deux fois sur le même rond-point, jusqu’à trouver ce pont qui enjambe la Francilienne.
Ici l’autoroute est limite, frontière, rempart. Elle contient plus qu’elle ne protège de l’extérieur. La ville est comprimée, on se serre les uns contre les autres à l’intérieur de ces rocades. De l’autre côté, ce sont les champs, la terre nue, épuisée à force d’avoir été retournée, laissée libre de toute construction comme si une réminiscence de toutes ces guerres avait commandé que cette zone reste non aedificandi. Au bout de ce glacis et de la D88E, il y a Tremblay-Vieux-Pays. François Maspero y était venu, au deuxième jour de son voyage, il y a vingt ans : « Le Vieux-Pays c’est comme la fin des terres. Derrière, il y a la clôture, et derrière la clôture il y a les avions qui s’envolent vers d’autres terres. (...) La vie semble suspendue, précaire, comme un bivouac dans les ruines semées de papiers gras, au bord de l’abandon final. »
Tremblay-Vieux-Pays est toujours au bout des pistes, presque sous les avions. Mais aujourd’hui on construit, on rénove au Vieux-Pays. À l’entrée du village, il y a un IUT neuf et une résidence pour personnes âgées. À côté de l’église, il y a une maison des associations dans un ancien bâtiment de ferme et, juste derrière le clocher, la « Résidence du Vieux Pigeonnier » est en train de sortir de terre. Une superette et une salle des fêtes sont en projet. Des panneaux municipaux vantent les charmes de Tremblay-Vieux-Pays, « dernier bourg rural de la Seine-Saint-Denis », son « cadre préservé ». Les avions, on les entend, mais on n’en parle pas. Un peu plus loin dans le village, il y a le parc du Château-Bleu. On y promène les enfants. Pour la première fois depuis deux jours, le soleil a fait son apparition. Dans le château, un restaurant plutôt haut de gamme est installé. Sur le parking du centre équestre voisin, les mères déposent leurs filles, rutilantes dans leur tenue d’équitation achetée chez Décathlon.
Je reviens sur mes pas, traverse à nouveau le village, puis prends à droite direction Villepinte. Il reste un rayon de soleil et le vent est de dos. Il y a même quelques arbres sur le bas-côté. Un rond-point et c’est un choix : Villepinte ou Roissy-Charles-de-Gaulle. Sur la droite, je vois ces avions qui se déplacent sur le tarmac des pistes comme des fauves derrière les grilles d’un zoo, alors je prends à droite. Je n’irai pas à Villepinte que traverse la Francilienne en son milieu. Je ne visiterai pas le parc des Expositions. Voyager, c’est accepter de passer à côté, ne pas tout voir justement, une suite de deuils minuscules. En plus, à droite il y a une belle piste cyclable. On y a planté quelques arbres, essences variées. Il y a même des lampadaires tous les vingt mètres. Le revêtement est neuf et on a tracé quelques chicanes pour casser la monotonie de la plaine. Il n’y a personne et je ne peux m’empêcher de me dire que là, je fais l’objet d’un peu trop d’égards.
À mi-chemin de cette piste cyclable, il y a ce panneau - alors qu’autour ce ne sont que parcelles immenses, nulle haie pour interrompre la ligne d’horizon, et que la terre avale sans relâche les déchets jetés par les fenêtres des voitures : « Partez à la découverte des espaces verts de Seine-Saint-Denis à pied, à vélo, sur la route du Chemin des Parcs, en découvrant la richesse de la flore et de la faune de ces continuités écologiques. » Au bout, à gauche, quelques kilomètres plus loin, c’est la pointe nord du parc des Expositions et ses hectares de parkings bitumés et, à droite, la zone fret de l’aéroport fléchée « Cargo 1-2-3-4-5-6 ». Les routes sont larges, adaptées au trafic poids lourd, et les bâtiments partagés entre les bureaux des transitaires et les entrepôts. Quelques escaliers mobiles, de ceux que l’on amène au pied des avions, rouillent au bord d’un champ. Je passe l’« Aérogare des agents en douane » pédalant sans trop savoir où aller, la zone est immense et les distances le sont autant. Pas un piéton évidemment.
Le carrefour suivant propose : « Cargo 1-2. Maison de l’Environnement ». Je souris, écologie et vapeurs de kérosène ensemble : c’est là que j’irai. Je suis les panneaux et me retrouve sur ce qui a tout d’une autoroute. La largeur des voies, le danger peut-être, incitent à la vitesse. Je pédale comme en un contre-la-montre. Les semi-remorques me doublent et ajoutent au vent de face le vent latéral. Finalement elle est là, entre deux bretelles d’autoroute : un parking vide, un âne et trois moutons, un petit verger, quelques ruches et le bâtiment au fond.
« La Maison de l’Environnement et du Développement durable vous offre l’occasion unique d’emprunter cette allée qui reproduit fidèlement la configuration d’une piste de décollage et d’atterrissage habituellement réservée aux avions et aux personnels techniques. » Il y a tout en effet et en miniature : les panneaux rouges avec le numéro de piste, ici 33-15, le marquage au sol et le système lumineux d’aide à l’atterrissage. Cela tient de ces parcours d’initiation à la sécurité routière que les enfants empruntent à vélo. « Le numéro donné à une piste correspond à son orientation par rapport au Nord magnétique, le tout arrondi puis divisé par 10. Si nous prenons l’exemple de la piste d’envol, son orientation étant de 332° par rapport au nord magnétique, elle sera donc numérotée 33 face au nord et 15 face au sud. En effet l’écart entre les deux directions inverses étant de 180°, cela induit une différence de 18 entre les numérotations opposées d’une même piste. » On entend presque l’enseignant, au tableau noir, craie à la main, récitant son cours magistral. Seule entorse à la démonstration, les architectes ont dessiné une piste qui serpente jusqu’à l’entrée du bâtiment. Mon arrivée surprend. L’édifice est vide de visiteurs mais le personnel nombreux. On ne vient pas par hasard au fond de la zone Cargo, à vélo qui plus est. Façades vitrées, coursives, grands espaces, d’évidence on a voulu rappeler l’aérogare.
Au bas de quelques marches, il y a un homme, plus âgé que les autres. Patrick est un contrôleur aérien à la retraite. Il vient, deux demi-journées par semaine, tenir un stand de la Direction générale de l’Aviation civile. L’objectif, me dit-il, est d’informer les riverains des contraintes techniques expliquant le survol de leur habitation. Volontairement ou non, Patrick a l’honnêteté de dire que « les nuisances sonores gênent le développement des aéroports ». La Maison de l’Environnement est clairement à destination des habitants des communes voisines, son site Internet s’appelle « entre-voisins ». Affiches et brochures vantent ses actions, la Maison de l’Environnement de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle a de l’argent et en est généreuse : financement d’infrastructures routières, visites de l’aéroport, insonorisation des habitations, cours d’anglais, semaine du handicap, forum de l’emploi, récolte du miel, quizz aéronautique dans les écoles primaires avec baptême de l’air à la clé... Et partout on rappelle les retombées économiques de l’aéroport pour faire oublier ses nuisances.
Même si je ne suis pas riverain comme il le dit, Patrick peut me montrer son stand. Sur son ordinateur, il y a une vue satellite de la région parisienne avec les itinéraires de survol des avions. L’animation est un enregistrement de la journée du 22 juin 2012, ce jour-là est une configuration face à l’ouest, « les avions atterrissent toujours face au vent ». Les avions apparaissent un à un et laissent dans leur sillage un trait de couleur, rose s’ils atterrissent à Roissy, bleu s’ils en décollent, orange à destination et en provenance du Bourget, vert et mauve pour l’aéroport d’Orly. Peu à peu le ciel de la région parisienne se remplit de traits jusqu’à n’être qu’une abstraite planche de couleurs.
Patrick me parle de ses débuts, l’électronique embarquée n’avait pas encore fait son apparition. Il fallait atterrir à vue, et à Roissy on avait enterré des réacteurs au bord de la piste pour dissiper le brouillard. C’est la société Bertin qui avait fait cela, vous savez celle des aérotrains... Son enthousiasme est intact, je reste une heure et demie à la Maison de l’Environnement. Personne d’autre n’est venu, il se fait tard.
J’avais prévu de m’éloigner de la zone aéroportuaire et des tarifs hôteliers prohibitifs. Le trafic sur les quatre-voies est chargé, je traverse l’A1. De l’autre côté c’est Roissy-en-France, le village d’origine. Il y a 2657 habitants à Roissy et de l’argent - toutes ces entreprises de l’autre côté de l’autoroute -, alors on a créé de grands espaces verts, on a construit un office du tourisme un peu surdimensionné, un théâtre, une piscine, une salle des fêtes, on a mis de jolis pavés dans la rue principale et des panneaux sur les façades des maisons du village : de grandes photos d’époque - celle qui n’est plus - avec ce slogan : « Roissy étonnant destin ». Quelques images qui pourraient avoir été prises dans n’importe quel village de France, toutes si typiques, une ville chargée d’histoire et de patrimoine, est-il écrit. Une charrette devant un café, des paysans qui mènent des bœufs au marché, l’église il y a cent ans... Mais si l’on s’est battu pour garder ses terres quand est arrivé l’aéroport, comme aujourd’hui on le fait ailleurs, on ne le saura pas : ce n’était pas le destin de Roissy, et le patrimoine se doit d’être inoffensif.
À Roissy, peut-être que la vie est dans les hôtels, dans cette longue rue du Verger, sans arbres bien sûr, mais où les hôtels immenses - on pourrait être autour de n’importe quel aéroport international dans le monde - sont alignés de chaque côté du trottoir. Les navettes vont et viennent depuis les aérogares, et le parc des Expositions n’est pas loin. Il y a 5000 chambres à Roissy et 8000 sont prévues en 2015. Qui dort là ? Qui travaille là ? Les coulisses de la rue du Verger. Oui, ce sont les coulisses de la rue du Verger qu’il faudrait aller voir. Qui construit ces hôtels ? Comment vient-on y travailler ? Qui vient y dormir ? Qui laisse des pourboires et qui n’en laisse pas ? Combien de nuit y reste-t-on ? D’où vient-on travailler là et dans lequel de tous ces établissements vaut-il mieux être employé ?
jour 4
Je commence par chuter, pas tout de suite, mais juste après Goussainville. En haut de Goussainville, c’est le quartier des Buttes-Chaumont. Après, la ville s’arrête et la route descend dans la vallée. Petite route, ligne blanche et derrière moi une voiture auto-école. Leçon du jour : apprentissage de la patience, les voitures poussent et s’entassent derrière le jeune conducteur. L’A104 est à une centaine de mètres et, sur le pont qui permet de la franchir, il y a un trottoir, séparé de la chaussée par une bordure en béton. Un vague souvenir d’auto-école à Grabels dans l’Hérault, alors je m’écarte et monte sur le trottoir. L’auto-école hésite quelques instants puis commence à me doubler. Soudain sous moi comme un vide et ces quelques secondes qu’il faut pour comprendre ce qu’il se passe : le trottoir n’est qu’une immense plaque de glace, le vélo part. Je m’accroche à la rambarde du pont, tombe. Le vélo, les sacoches, glissent jusqu’au bout du trottoir et terminent leur course dans le fossé. La file de voiture me dépasse lentement. Je me relève ; dessous, le trafic sur la Francilienne est fluide. Ma poignée est tordue.
Je m’arrête prendre un café au village suivant, Fontenay-en-Parisis. Des rues vides comme toujours - mais où y avait-il du monde si ce n’est dans les hôtels de Roissy-en-France ? Dans le bar, Le Coucou de la Vallée, deux hommes, de ceux qui passent leur journée là, et deux serveurs, tous en survêtement. Les sucrettes de ceux qui sont passés prendre le café plus tôt jonchent le sol. La télé - ce n’est pas encore l’heure des courses - est branchée sur France 5. Personne ne la regarde. Un reportage commence, son titre : Un Viking en Afrique du Sud. Helge est un aventurier, il remonte le fleuve Orange. Le serveur coupe le son. Plus le temps passe plus Helge est écarlate et exténué. Sa peau est brûlée par les coups de soleil, je crois qu’il voudrait s’allonger et dormir, sans avoir à s’inquiéter pour sa caméra qui attire, suscite les convoitises, le gêne plus que tout.
Dehors, il pleut d’une pluie fine, de celles qui ne dérangent pas le cycliste. Jusqu’à Cergy-Pontoise, plus de centres commerciaux, plus de zones industrielles mais la plaine de France et ses immenses parcelles céréalières. Peut-être parce que le brouillard réduit l’espace, peut-être parce que je porte des lunettes et que j’ai chaud sous mes nombreuses couches de vêtements, peut-être parce que ce verger infini, nu de toute feuille, est beau, et qu’il y a cette odeur de cheminée dans ce village, peut-être parce je suis en selle depuis deux heures - je me sens dehors et à l’abri à la fois.
Après Montsoult, c’est la forêt. Je passe par celle de l’Isle-Adam, kilomètres rectilignes et verticalité des grands arbres, la route pour moi. J’en sors au bord de l’Oise, la crue n’est pas loin ici aussi. Le chemin de halage sur lequel je pédale est presque sous les eaux, la terre est grasse, les flaques profondes et nombreuses, les flots lourds et menaçants. Leçon des derniers jours, je m’écarte et emmène mes roues de l’autre côté des pavillons anciens qui bordent la rivière.
Dans cette rue, il y a du monde. On se salue, on discute. La rue est bordée sur sa gauche par des villas, cachées par de hautes haies, et sur sa droite par un stade de football le long duquel un homme est à l’abri sous une guérite, de celle que l’on voit devant les ministères. Est-ce que je cherche quelque chose, une adresse peut-être ? Son ton est doux. Non, je ne cherche rien. Mais lui, que surveille-t-il dans cette rue ? Il est là parce que ces villas sont le siège du Conseil national de la résistance d’Iran et des Moudjahiddines du peuple. Ses dirigeants, qui se sont battus hier contre le Shah et aujourd’hui contre les Guides de la révolution islamique, sont en exil en France, à Auvers-sur-Oise, depuis 1981. Cet homme qui garde, presque avec tendresse, ces pavillons est iranien aussi. « Salam » - quelqu’un d’autre passe dans la rue. On prépare un thé. Lui, cela fait vingt ans qu’il est parti, vingt ans d’exil en Allemagne puis en France. Il s’excuse de son français qui est presque parfait. Le thé est bon. Il est parti parce qu’on a tué sa femme, alors maintenant il veut aider. Nous discutons un moment. Je repars avec de la documentation et lui retourne à sa guérite solitaire. Petite rue d’Auvers-sur-Oise, est-ce qu’il pleut en Iran aujourd’hui ?
Après j’ai roulé, vite, un peu comme quand un sommet est en vue, Cergy est juste là. Les yeux rivés sur la cime, indifférent à la pluie, parce qu’on veut vaincre la montagne, si petite soit-elle : Cergy-Pontoise, mon Himalaya. J’y suis arrivé tôt et un peu mouillé, vers quatorze heures. Je suis allé voir où la Francilienne se terminait, et c’était assez confus, peut-être au centre commercial Art de Vivre, à côté d’une « aire d’accueil des gens du voyage » et d’un crématorium.
Puis j’ai cherché une fin car il me manquait une fin. J’ai tourné, suis allé voir les écluses au bord de l’Oise, ai visité une conserverie, vu le quartier des Chennevières à Saint-Ouen-l’Aumône. Il y aurait tant à dire, à décrire, des portes à pousser et des bancs où s’asseoir, mais il faut bien rentrer chez soi, mettre un point au bout de ce voyage alors j’ai pris le train en gare de Saint-Ouen-l’Aumône-Quartier de l’église. Une petite gare où, pour passer d’un quai à l’autre, on traverse les voies, en faisant le tour de la petite maison du garde-barrière.
Le train ne tarde pas, Cyril l’attrape de justesse, son skate sous le bras. Il regarde mes sacoches, me sourit puis me demande si je suis en voyage. Alors je parle, je décris cette euphorie du déplacement, les yeux qui voient, les mots qui viennent. Son regard est dubitatif, qu’est-ce que j’ai vu autour de Paris, dans l’immobilité de l’hiver, le long de cette autoroute, précisément là où il n’y a rien et où personne ne va ? Tant de choses, la vie peut-être, celle d’aujourd’hui et les traces de celle d’hier, celle qui travaille et celle qui hiberne aux franges de la ville, et si l’on faisait le trajet en sens inverse - l’idée m’effleure un instant -, on en verrait d’autres encore. Et quand il me demande, comme pour se rassurer, si j’ai vu Van Gogh, au moins, en traversant Auvers-sur-Oise, il me faut un moment, un long moment, pour savoir de quoi il parle. Mais il est vrai que je reviens d’un long voyage.