


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


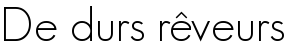
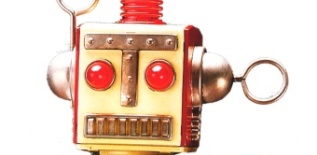 |
|
|
Publié dans le
numéro 29 (jan.-fév. 2009)
|
Lire aussi :- Rire de tout (et avec n’importe qui si possible)
- Tentative de réorganisation chronologique de l’affaire dite « de Tarnac »
- Rapport de police concernant le nommé Souchon Alain
1997. Julien Coupat est en DEA à l’EHESS. Il travaille sur le thème : « Perspective et critique de la pensée situationniste ». Petit rappel : l’Internationale Situationniste est une avant-garde artistique révolutionnaire, née en 1957, et dont le but était de dépasser la vanité des contestations avant-gardistes antérieures, en ouvrant à la création le champ du comportement et des situations de la vie quotidienne. Le premier octobre 1998, se tient à Nanterre le colloque Marx international II. Parmi les ateliers, l’un s’intitule : « Oser chercher critique. Rendez-vous des jeunes chercheurs ». Parmi les intervenants : Julien Coupat, présenté comme « doctorant EHESS, métaphysicien critique, co-animateur de la revue Tiqqun », et dont le sujet de thèse est « Capitalisme, avant-garde et critique révolutionnaire ». Les interventions doivent porter sur « la précarité des situations, de l’identité même de “jeune chercheur” ». Jusque-là, rien que de très classique. Si ce n’est que dans Tiqqun, on peut lire un compte rendu moins conventionnel de ce colloque :
« Un des métaphysiciens-critiques se trouva invité, par une méprise à peu près complète, à intervenir au congrès Marx International II sur le thème bien impertinent d’“oser chercher critique”. Il n’aurait évidemment jamais consenti à si grotesque compromission — on sait la part que prend le Parti communiste dans ce genre de bouffonneries —, si les autres guignols invités à pontifier là en sa compagnie n’avaient été deux rédacteurs du « Décembre » des intellectuels français, publié dans la collection Liber-Raisons d’agir, sous l’œil protubérant du vénéré Bourdieu. [...] Son tour venant, il [ndlr. Julien Coupat] livra, après tant de consternantes platitudes, sa contribution au débat : “Tout bien pesé, le dépérissement de l’Université et la disparition du sujet étudiant ne sont que d’infimes détails au sein d’un processus autrement titanesque : je veux parler de la décomposition de la société marchande. [...] Pour l’heure, la critique n’a que faire des docteurs en sociologie [car] c’est de poètes et de théologiens qu’elle a désormais besoin et non de fonctionnaires consciencieux de l’intelligence sociale. [...] Tous ceux qui ne peuvent se résoudre à quitter le navire quand il sombre déjà si visiblement au motif qu’ils estiment plus les carrières dans l’engloutissement que la liberté périlleuse du partisan, lient leur destin à un monde qui s’en va.” » [1]
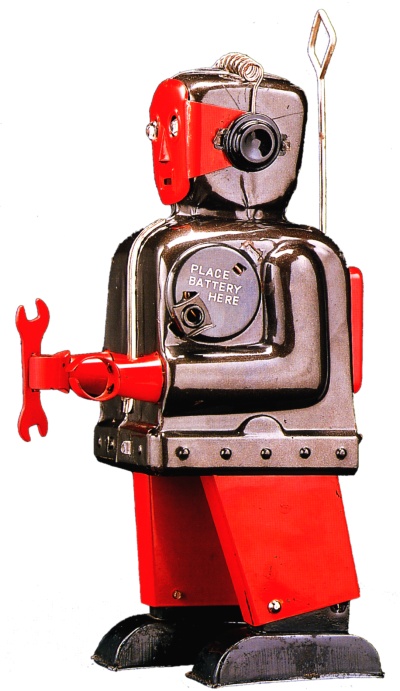
Printemps 2004. L’Appel, un petit livre sans mention d’auteur [2] ni d’adresse, paraît. « Ceci est un appel. C’est-à-dire qu’il s’adresse à ceux qui l’entendent. Nous ne prendrons pas la peine de démontrer, d’argumenter, de convaincre. Nous irons à l’évidence. » [3] Assurément, L’Appel est un texte politique. Les mouvements politiques des dernières années sont analysés, et les luttes militantes décriées :
« Seattle, Prague, Gênes, la lutte contre les OGM ou le mouvement des chômeurs, nous avons pris notre part, nous avons pris notre parti dans les luttes des dernières années ; et certes pas du côté d’Attac ou des Tute Bianche [ndlr : pacifistes italiens]. Le folklore protestataire a cessé de nous distraire. [...] De Davos à Porto Alegre, du Medef à la CNT, le capitalisme et l’anti-capitalisme décrivent le même horizon absent. La même perspective tronquée de gérer le désastre. »
En guise d’exemple, un extrait d’un texte [4] écrit par des manifestants anti-G8 qui contient la phrase suivante : « En ce qui concerne les envies individuelles, il pourrait être égalitaire que chacun consomme à mesure des efforts qu’il est prêt à fournir. » Conclusion de L’Appel : « Le libéralisme existentiel a si bien su propager son désert que c’est désormais dans ses termes mêmes que les gauchistes les plus sincères énoncent leurs utopies. » Et de refuser également la posture des signataires du manifeste « Nous sommes la gauche », « signé [en 1997] par tout ce que la France compte de collectifs citoyens et de “mouvements sociaux” », car il « énonce assez la logique qui, depuis trente ans, anime la politique extra-parlementaire : nous ne voulons pas prendre le pouvoir, renverser l’État, etc. ; donc, nous voulons être reconnus par lui comme interlocuteurs. »
Les auteurs de L’Appel se définissent a contrario. Non pas comme un groupe (« ce n’est pas le nous d’un groupe »), encore moins donc comme un groupe politique, mais comme une « position » — une posture dans l’époque actuelle, à mille lieux de la « pensée Max Havelaar laissant peu d’espace pour parler d’éthique autrement que sur l’étiquette » :
« Le chèque à Amnesty, le paquet de café équitable, la manif contre la dernière guerre, boire Daniel Mermet sont autant de non-actes déguisés en gestes qui sauvent. [...] Cette position s’affirme dans l’époque comme une double sécession : sécession avec le processus de valorisation capitaliste d’une part, sécession, ensuite, avec tout ce qu’une simple opposition à l’empire, fût-elle extra-parlementaire, impose de stérilité ; sécession, donc, avec la gauche. »
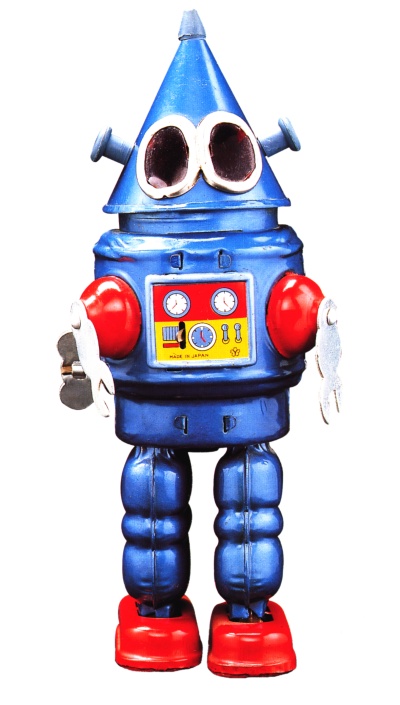
Mais faire quoi, alors ? Entre autres, ce que font les Black blocs [5] : s’affronter aux forces de l’ordre. Le texte fait référence aux manifestations de Gênes lors du G8 de 2001, lorsque des militants de la LCR « brandissent leurs drapeaux rouges labellisés “100 % à gauche” » :
« Ils sont immobiles, intemporels. Ils vocifèrent leurs slogans calibrés, entourés d’un service d’ordre. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, certains d’entre nous affrontent les lignes de carabiniers, renvoyant les lacrymos, défonçant le dallage des trottoirs pour en faire des projectiles, préparant des cocktails Molotov [...] À ce propos, les militants parlent d’aventurisme, d’inconscience. Ils prétextent que les conditions ne sont pas réunies. Nous disons que rien ne manquait, que tout était là, sauf eux. »
Le texte évoque donc la « tentation de l’activisme », puis la lutte armée :
« Payer chaque campagne au prix fort. La laisser consommer toute l’énergie dont nous disposons. Puis aborder la suivante, chaque fois plus essoufflés, plus épuisés, plus désolés. » « Il paraîtra judicieux, par ailleurs, au vu de la friabilité des subjectivités contemporaines, même de nos dirigeants, mais au vu aussi du pathos larmoyant dont on a réussi à entourer la mort du moindre citoyen, de s’attaquer plutôt aux dispositifs matériels qu’aux hommes qui leur donnent un visage. Cela par souci stratégique. Aussi bien, c’est vers les formes d’opération propres à toutes les guérillas qu’il nous faut nous tourner : sabotages anonymes, actions non revendiquées, recours à des techniques aisément appropriables. »
Reste une dernière question : « Mais qu’est-ce que vous voulez au juste. Qu’est-ce que vous proposez. » Réponse : « 1. Empêcher par tous les moyens la recomposition de la gauche. 2. Faire progresser, de “catastrophe naturelle” en “mouvement social”, le processus de communisation, la construction du Parti. 3. Porter la sécession jusque dans les secteurs vitaux de la machine impériale. »
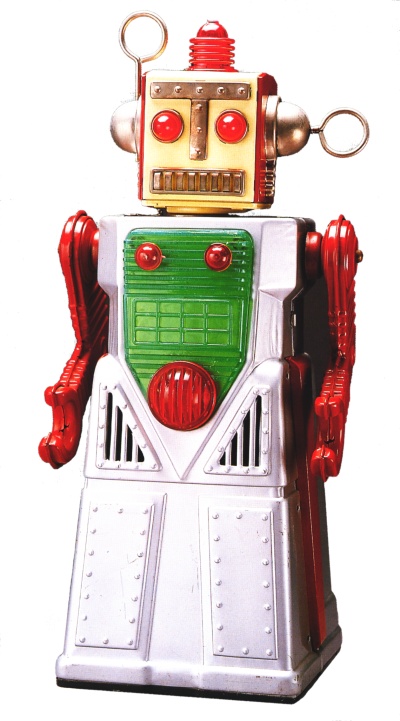
En 2007 sort aux éditions La Fabrique un petit livre intitulé L’Insurrection qui vient, signé par le « Comité invisible ». Les deux textes sont extrêmement proches dans le ton [6], mais ne se répètent pas. Entre 2003 et 2007 il y a en effet eu les événements de 2005 en banlieue, qui servent de fil conducteur au livre : « L’incendie de novembre 2005 n’en finit plus de projeter son ombre sur toutes les consciences. Ces premiers feux de joie sont le baptême d’une décennie pleine de promesses. » Le ton est encore plus incantatoire et mélancolique que L’Appel — la dépression étant analysée comme un geste de refus : « Nous ne sommes pas déprimés, nous sommes en grève. Pour qui refuse de se gérer, la “dépression” n’est pas un état, mais un passage, un au revoir, un pas de côté vers une désaffiliation politique. » Parce que L’insurrection qui vient s’adresse à des lecteurs traditionnels, le livre prend le temps de démonter pièce par pièce l’intégralité du monde actuel, « un monde dont nul ne peut plus nier qu’il s’écroule, un monde où “devenir autonome” est un euphémisme pour “avoir trouvé un patron”. » Situation qui est considérée comme une chance : « La décomposition de toutes les formes sociales est une aubaine. C’est pour nous la condition idéale d’une expérimentation de masse, sauvage, de nouveaux agencements, de nouvelles fidélités. » Comme dans L’Appel, les réponses politiques ou militantes traditionnelles sont jugées inutiles — jusqu’à ces phrases qui constituent le point de départ de l’affaire :
« Retenons du sabotage le principe suivant : un minimum de risque dans l’action, un minimum de temps, un maximum de dommages. [...] Saboter avec quelque conséquence la machine sociale implique aujourd’hui de reconquérir et réinventer les moyens d’interrompre ses réseaux. Comment rendre inutilisable une ligne de TGV, un réseau électrique ? Comment trouver les points faibles des réseaux informatiques, comment brouiller des ondes radios et rendre à la neige le petit écran ? [...] Anéantir ce néant n’a rien d’une triste besogne. L’agir y retrouve une nouvelle jeunesse. »
Les questions de L’Insurrection qui vient pourraient paraître... presque banales (« Comment arrêter les centrales nucléaires ? Comment vivre ensemble sans s’écraser mutuellement ? Comment accueillir la mort d’un camarade ? »), si ne venait la question finale : « Comment ruiner l’empire ? » Question qui peut sembler politique, mais aussi, comment dire ? « romantique », a dit le père de Julien Coupat. Dans une posture littéraire. Ruiner l’empire, donc. Le maire sortant, Jean Plazanet, évoque ainsi l’arrivée des « jeunes gens » à Tarnac : « J’ai vu de suite que j’avais affaire à des gens intelligents et très prévenants. Ils cherchaient une vieille ferme, ils en avaient marre de la vie parisienne. Tous les jours, ils venaient chez moi, emprunter des outils pour le jardin, les filles venaient avec ma femme pour la cuisine et pour tricoter. » Cuisine pour les filles et bricolage pour les garçons... On perçoit un peu mieux l’écart entre la radicalité et le caractère incantatoire du discours théorique et la vie réelle des présumés saboteurs. « Ruiner l’empire » en tenant une épicerie, en tricotant, en distribuant des tracts, en écrivant des livres et en s’opposant aux forces de l’ordre dans quelques manifestations altermondialistes... L’Insurrection qui vient se termine sur ces lignes, qui admettent la différence entre l’exhortation et la vie réelle :
« [On nous dira :] soit vous parvenez à constituer une menace pour l’empire, et dans ce cas, vous serez rapidement éliminés ; soit vous ne parviendrez pas à constituer une telle menace, vous vous serez vous-mêmes détruits, une fois de plus. Reste à faire le pari qu’il existe un autre terme, une mince ligne de crête suffisante pour que nous puissions y marcher, suffisante pour que tous ceux qui entendent puissent y marcher et y vivre. »
La « mince crête » où vivre, c’était donc Tarnac. En présentant comme des « terrorristes » Julien Coupat et ses proches, l’État français vient sans doute de leur offrir un grand cadeau : une stature à la mesure de leurs rêves de grandeur [7]. Les « événements » que l’auteur de L’Appel appelait de ses vœux, les voici. Car il faut être deux pour jouer au jeu du terrorisme [8]. En déclarant la « guerre à l’empire » tout en tenant l’épicerie d’un village, voire en osant écrire qu’il serait bon que des trains soient sabotés, voire éventuellement en participant au sabotage d’une ligne de train, Julien Coupat et son entourage étaient tout juste bons à être considérés comme des émules (certes entêtés) de Guy Debord et comme des activistes capables de retarder un train pendant un quart d’heure. Coup de chance inespéré ! L’État vient de montrer sa faiblesse : il a eu vraiment peur d’eux. Julien Coupat, qui écrivait : « Nous connaissons notre faiblesse : nous sommes nés et nous avons grandi dans des sociétés pacifiées, comme dissoutes. Nous n’avons pas eu l’occasion d’acquérir cette consistance que donnent les moments d’intense confrontation collective. Ni les savoirs qui leur sont liés », disposera à présent d’une certitude : avoir vécu un moment de confrontation directe avec le pouvoir. Julien Coupat écrivait que le monde avait besoin « de poètes et de théologiens ». Poète et théologien, il l’était assurément un peu. Le style de Julien Coupat est d’un lyrisme digne de Cassandre, annonciateur du chaos, et le lyrisme est performatif : il vise à produire devant les yeux du lecteur ce qu’il désigne par son énonciation ellemême. Les Renseignements Généraux sont tombés à pieds joints dans la force de la littérature : le voici à présent redoutable opposant politique. À brandir le spectre du terrorisme, on crée de toutes pièces l’état de guerre, celui qu’à Venise, en janvier 1999, les Tiqqun décrivaient :
« Un jour, une société a tenté, par des moyens innombrables et sans cesse répétés, d’anéantir les plus vivants d’entre ses enfants. Ces enfants ont survécu. Ils veulent la mort de cette société. Ils sont sans haine. C’est une guerre qui n’est précédée d’aucune déclaration. Au reste, nous ne la déclarons pas, nous la révélons seulement. Deux camps. Leur différend porte sur la nature de la guerre. Le parti de la confusion voudrait qu’il n’y ait qu’un camp. Il mène une paix militaire. Le Parti Imaginaire sait que le conflit est père de toutes choses. Il vit dispersé et en exil. Hors de la guerre, il n’est rien. »
[1] http://netx.u-paris10.fr/ actuelmarx/livret.htm. Cette action est l’un des « coups d’éclat du Parti Imaginaire », quelque part entre un sermon place de la Sorbonne et un tract sur Houellebecq (Le Monde, 8 nov. 1998).
[2] Julien Coupat est-il l’auteur de L’Appel et de L’Insurrection qui vient ? Pour des raisons judiciaires, son éditeur et ses soutiens souhaitent le nier. La proximité stylistique est en tout cas évidente, et deux de ses proches l’ont confirmé. Dans la version papier de cet article, par manque de place, il manquait ces précisions : À la sortie du livre en 2007, le Nouvel Observateur (26 avril 2007), manifestement renseigné par l’éditeur, écrivait déjà : « Tout ce qu’on sait de ces anonymes qui tiennent à le rester, c’est qu’ils se retrouvent dans des ruines retapées du centre de la France, où ils cultivent fruits, légumes, idées. Ils sont cinq, ont entre 24 et 35 ans. Certains ont fait des études, d’autres pas. » Après le 11 novembre, deux proches de Coupat confirmeront qu’il fait bien partie des auteurs. D’abord Olivier Pascault : « Il a de même été l'une des plumes principales du Comité Invisible popularisant L'insurrection qui vient. » (http://www.le-terrier.net/polis/tarnac/pascault.htm). Et d’autre part son père, lors de l’émission « C à dire » sur France 5, qui répond au journaliste l’interrogeant sur le fait que son fils a écrit, avec L’insurrection, un livre qui « prône la violence » : « Sûrement, mais il a écrit sur d’autres choses, vous savez, il a écrit sur la commercialisation du corps de la femme. C’est remarquable. » (18 novembre 2008) Il est tout à fait logique que Julien Coupat dise qu'il n'est pas l'auteur de L'insurrection, puisqu'il n'en est manifestement que le co-auteur.
[3] Texte tronqué sur www.cmaq.net/fr
[4] « Quand on aura aboli le capitalisme et le salariat », par « les organisateurs du Village alternatif, anticapitaliste et antiguerre contre le G8 d’Evian ». Disponible sur : www.bibliolibertaire.org
[5] Les Black blocs (« blocs noirs ») sont des groupes de manifestants violents notamment issus du Mouvement autonome allemand.
[6] « Dans les milieux autorisés », le livre était surnommé « L’Appel pour les nuls ».
[7] Offrant une promotion nationale à des textes jusque-là confidentiels...
[8] On n’adhère donc pas ici (naïveté ?) à la thèse d’Éric Hazan, l’éditeur du livre, qui considère cette affaire comme un préambule parmi d’autres à l’État policier qui se mettrait en place. Thèse critiquée par Fabien Jobard www.mediapart.fr comme étant « une inversion mimétique » conduisant à « grandir ce que l’on se fait fort de conjurer, la peur » au lieu de privilégier des analyses (et donc des résistances) plus rationnelles. L’affaire des présumés sabotages de la SNCF pose néanmoins de graves questions sur les motifs de l’inculpation. Éric Hazan pose la question avec justesse : « En réalité, pour nous tous cette affaire est un test. Jusqu’à quel point allons-nous accepter que l’antiterrorisme permette n’importe quand d’inculper n’importe qui ? » Cf. sa pétition sur www.lafabrique.fr