


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


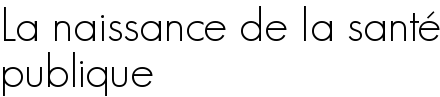
 |
|
|
Publié dans le
numéro VIII (mars-avril 2008)
|
Lire aussi :
![]() G.R.O.S et gras
G.R.O.S et gras
![]() Fumer ne tue pas
Fumer ne tue pas
![]() Cinq = dix. L’exemple des fruits et légumes
Cinq = dix. L’exemple des fruits et légumes
L’État moderne considère que la santé du corps social est sa préoccupation légitime. Il existerait un contrat social implicite par lequel la population investirait l’État d’une responsabilité de prévention. Quels sont les principes d’une juste intervention, qui ne soumette pas les citoyens aux excès d’une bienfaisance paternaliste ?
La politique de santé publique privilégie le bien-être de la population dans son ensemble à celui des individus. La distinction entre santé individuelle et santé collective date des premiers efforts des États pour tenir des relevés de population et des registres des événements vitaux (naissance, mariage, mort) afin de se donner les moyens d’évaluer la santé des populations. L’idée que les chefs d’État ont le devoir de promouvoir la santé de leur peuple est ancienne : une population en bonne santé se reproduit bien, fournit des soldats robustes, des bons travailleurs et des femmes fécondes. Si la question de l’hygiène de la population est un souci ancien, la naissance de la santé publique marque un décrochement historique. On doit à Michel Foucault [1] d’avoir théorisé ce basculement, en forgeant un terme resté célèbre : la biopolitique, action concertée du pouvoir en place sur la vie de la population — action allant de pair avec la surveillance de l’individu et l’émergence du pouvoir disciplinaire. Foucault prend l’exemple du dispositif de la quarantaine mis en place lors des épidémies de lèpre et de peste, au XVIIe siècle, pour théoriser la genèse de la biopolitique.
Figure centrale de cette évolution, la discipline scientifique nommée l’épidémiologie étudie la fréquence et la répartition dans l’espace des problèmes de santé dans les populations humaines, ainsi que le rôle des facteurs qui les déterminent. On distingue l’épidémiologie descriptive (qui établit les taux de natalité, mortalité, etc.) de l’épidémiologie explicative (qui cherche les causes des pathologies), et de l’épidémiologie évaluative (qui apprécie les résultats des actions politiques dans un souci d’efficacité). L’apparition de la santé publique est ainsi allée de pair avec une mathématisation du réel [2]. Tout est désormais quantifié : « Le discours de santé publique qui se déploie dans les pays industrialisés impressionne par la fréquence des recours à des arguments chiffrés, au point parfois d’en être littéralement saturé. Tel facteur de risque peut se voir imputer la responsabilité de x décès par an. Articles, médias, interventions gouvernementales ou débats parlementaires : le citoyen se trouve confronté à une profusion de statistiques dont la compréhension s’avère problématique », note ainsi Luc Berlivet [3], qui ajoute que même lorsqu’il y a des débats au sein de la communauté scientifique, les pouvoirs publics « n’en sont pas moins pressés d’avancer des éléments chiffrés, ne seraitce qu’à titre provisoire » (3), le recours à des arguments dits scientifiques étant devenu, de manière tacite, une habitude rhétorique.
La transformation de notre représentation de la santé suscitée par l’essor de l’épidémiologie moderne est conséquente : « En focalisant l’attention sur les “individus à risque”, êtres statistiques dont la probabilité de développer une ou plusieurs pathologies s’avère significativement plus élevée, les épidémiologistes ont amené la distinction du sain et du malsain en créant un état intermédiaire. L’individu à risque n’est pas encore malade, mais sa probabilité plus élevée de développer la maladie semble déjà interdire qu’on puisse le dire en bonne santé » (3). Ainsi, nous sommes tous devenus des malades en puissance. Poussant cette logique à l’extrême, des firmes pharmaceutiques peu scrupuleuses s’ingénient à rendre malades les derniers bien-portants, dans un but mercantile [4].

Les critiques contre le caractère liberticide des politiques de santé publique ont eu lieu dès les années 1970 aux États-Unis. De nombreux travaux sociologiques ont été menés sur le « contrôle social » [5] découlant du domaine de la prévention des maladies. Ivan Illich s’est insurgé contre le « caractère impérialiste et autoritaire » [6] de la médicalisation de la société. L’individu subirait une pression à la conformité résultant en une « micro-éthique de la honte » [7], variante intériorisée de la « macroéthique de la peur » à laquelle recourent les dictatures. Pour tous ces auteurs, la santé publique apparaît bien comme une nouvelle moralité séculière dont les commandements sont « perdez du poids, arrêtez de fumer, évitez le cholestérol », etc. Le risque d’un eugénisme « discret, apaisé, redessiné aux contours du rêve de santé parfaite » [8] serait bien réel. À l’inverse, certains sociologues minimisent la portée des politiques de santé publique. Leur argument est simple : en dépit des théories foucaldiennes, le succès de l’État, lorsqu’il tend à s’imiscer dans la vie des gens, est faible. Didier Fassin [9] affirme ainsi : « Pour vérifier l’efficacité de ce biopouvoir proclamé ou dénoncé, encore faut-il se demander ce qu’il est réellement [...] or il y a loin de la coupe aux lèvres ».
Reste la question : quelles sont les limites acceptables de l’entreprise étatique visant à convaincre le citoyen d’adopter les comportements préventifs ? Pour les partisans de l’individualisme radical, l’État a outrepassé ses fonctions. Le libéralisme théorisé par John Stuart Mill n’affirme-t-il pas que le gouvernement n’a le droit d’intervenir qu’au moment où les actions de l’individu risquent de nuire à autrui ? La santé publique succomberait ainsi à un paternalisme excessif dans les cas où elle interdit des comportement adoptés par des individus éclairés ne pouvant nuire qu’à eux seuls : cas du port de la ceinture de sécurité, du casque à moto, de la cigarette, de l’alimentation « trop » grasse, etc. On reprendra quant à nous la formulation suivante : « la politique s’épuise à se déplacer hors de son champ lorsqu’elle veut résoudre les problèmes en lieu et place des citoyens »8 ; le dirigeant doit être « celui qui crée les conditions de possibilité qui permettent aux sujets humains de déployer leur vie et non pas celui qui donne des règles de bien-vivre » (8).

Autres ouvrages
Émile Malet, Santé publique et libertés individuelles, Passages, 1993.
Alain Leplège & Philippe Blanc, “Ethique et santé publique”, in Cités no3, 2000. Danielle Charest, Haro sur les fumeurs !, Ramsay, 2007.
Georges Canguilhem, Le Normal et le Pathologique, 1943.
Robert Crawford, « You are dangerous to your health : the ideology of victim-blaming », International Journal of Health Services, 1977.
Raymond Massé, Éthique et santé publique, Presses de l’Université de Laval, 2003.
[1] Michel Foucault, « Les mailles du pouvoir », in Dits et écrits ; Histoire de la sexualité, Gallimard, 1976-1984
[2] Giorgio Israël, La mathématisation du réel, Seuil, 1996
[3] Patrice Bourdelais (dir.), Les Hygiénistes, Belin, 2001
[4] Alan Cassels & Ray Moynihan, Monde diplomatique, mai 2006
[5] Peter Conrad & Joseph Schneider, Deviance and Medicalization, From Badness to Sickness, Mosby, 1980
[6] Ivan Illich, Némésis médicale, Seuil, 1975
[7] Alan Petersen & Deborah Lupton, The New Public Health, Sage Publications Ltd, 1996. Jacob Sullum, For Your Own Good : The Anti-Smoking Crusade and the Tyranny of Public Health, Free Press, 1998
[8] Philippe Lecorps & Jean-Baptiste Paturet, Santé publique, du biopouvoir à la démocratie, ENSP, 1999
[9] Didier Fassin, Faire de la santé publique, ENSP, 2005 ; Jean-Pierre Dozon & Didier Fassin (dir.), Critique de la santé publique. Balland, 2001