


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


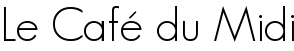
 |
|
|
Publié dans le
numéro 023 (Novembre 2012)
|
Deuxième épisode d’une série sur les bars, qui emmènera l’auteur sur les routes de France : le récit, qui s’appuie sur une journée complète passé sur place, obéit à dix contraintes cachées, répétées d’épisode en épisode, et qui seront dévoilées à la fin.
Episode 2.
Le Café du Midi. 6-8 place Reggio, Bar-le-Duc, Meuse
La lune me montrait le chemin de Bar-le-Duc. Elle s’était levée quand j’étais parti, grosse, énorme, une énorme lune d’automne qu’on voyait déjà dans le ciel encore clair au-dessus de l’autoroute de l’Est, grosse au-dessus du flux des voitures qui quittaient la Grande Ville pour aller, je ne sais pas, mais moi, j’allais là où était la lune. Elle était pleine et ronde et bien blanche, c’était la pleine lune du 29 septembre. Je pensais un peu aux explorateurs des nouveaux mondes d’il y a quatre cents ans qui traversaient les océans et qui regardaient la lune en se disant qu’elle tournait autour d’eux comme le soleil tournait autour de la Terre. Je me rappelais la fin de Fondation, d’Isaac Asimov, qui se passe non dans le passé mais dans quelque chose comme vingt mille ans, quand les héros du livre cherchent à retrouver les origines de l’humanité et trouvent absurde l’idée d’un astre originel unique accompagné d’un satellite gros comme une petite planète ; et pourtant, ce gros satellite était là devant mes yeux, je le voyais briller au-dessus des tours de la cathédrale de Reims. En quittant l’autoroute après Châlons-en-Champagne, la lune était toujours là-haut, plein est : elle donnait aux paysages de Lorraine — qui ne sont pas plats mais légèrement penchés, comme si l’on remontait le rebord d’une assiette avant de retomber sur une autre, et parsemés de petites forêts — une allure fantomatique. Je vis le TGV dont je longeais la ligne sans le savoir me dépasser comme un rayon doré : il était éclairé de l’intérieur mais je ne pouvais pas distinguer les passagers, comme s’il était vide, comme si j’étais tout seul sur cette route de Marne et de Meuse, avec les biches et mon autoradio. La lumière blême me faisait songer à d’autres fantômes : à ce moment je n’aurais pas été étonné de me voir barrer la route par un régiment maudit de soldats en capotes bleu ciel, ou plutôt en Feldgrau de l’armée du Kronprinz, gazés ou brûlés au lance-flamme, en 1915 ou 1917, des âmes sans repos échappées d’un cimetière militaire perdu dans les bosquets. Ils m’auraient arrêté dans un virage, une vieille mitrailleuse Maxim au pied d’un arbre, le visage mangé, squelettique comme celui du Transi de Ligier Richier qu’on voit à l’église Saint-Étienne, en haut de Bar-le-Duc. Ils m’auraient demandé, dans leur allemand d’il y a cent ans : « Was machst du hier ? Was willst du ? » et je leur aurais répondu que je ne voulais pas les déranger dans leur damnation éternelle, que je voulais aller à Bar-le-Duc pour passer la journée dans un bar. Les crânes sous leur casque d’acier rouillé se seraient tournés vers le visage décharné de leur officier, et ils m’auraient laissé passer. C’est d’ailleurs ce qu’ils firent, parce que le lendemain, après une courte nuit dans l’Etap Hôtel transformé en Ibis Budget, je me réveillai ; il y avait du brouillard à la fenêtre, mais j’étais bien à Bar-le-Duc.
La petite préfecture n’offrait pas, ce dimanche, beaucoup de choix à celui qui ne veut pas regarder couler l’Ornain ou se hisser à la ville haute — d’où l’on voit les deux ravins, celui de la rivière et celui, de l’autre côté, qui sépare le petit éperon des collines du sud — mais qui veut simplement passer la journée au café. Il y avait comme partout ailleurs Le Comptoir de Maître Kanter ; il y avait un café, Le Parisien, où j’aurais pu comme la fois précédente parier sur les courses et au Rapido. Je craignais d’être parti à la va-vite et de ne rien trouver qui convienne ; et puis finalement, place Reggio, je découvris le café du Midi. Il y avait une terrasse, du soleil, un beau lettrage doré formant le nom du lieu ; une sorte de prototype de café français qu’on aurait pu mettre sur carte postale et regarder en se disant : « Ah, oui, on dirait la France » et nul autre pays ; et même cette chose étrange que d’avoir le nom de Reggio de Calabre pour une place d’une ville de Lorraine se justifiait : comme la moitié des places, des monuments et des rues de ce pays, elle tenait son nom d’un maréchal d’Empire, Oudinot celui-ci, Nicolas Charles, né à Bar-le-Duc en 1767, deux ans avant l’Empereur, et qui fut le « Bayard de l’Empire », suivant les mots de l’Empereur lui-même, qui fit de lui le premier et dernier « duc de Reggio et de l’Empire » en 1810 ; le duc de Reggio fut même de ceux qui passèrent la Bérézina, deux ans plus tard. Il a sa statue à l’extrémité sud-est de la place qui porte son nom. C’était donc bien la France, ce fragment de Lorraine, et j’y commandai mon premier café de la journée à Isa, la patronne, vers dix heures du matin.
De la terrasse du café, je voyais beaucoup de choses et rien à la fois. Le dimanche à Bar-le-Duc, c’est comme le dimanche partout, c’est un peu morne le matin, mais agréable, et c’est triste à partir de quatorze ou quinze heures. Je voyais la préfecture à droite, bâtie du temps où c’était ici la frontière, en 1908. À gauche, l’agence Manpower, et puis un kebab et une supérette. En face, une boulangerie. Le tout était en pierre blonde, pas plus de deux étages, sauf du côté du café où les immeubles étaient plus hauts. La terrasse était plein sud (c’était même écrit, comme un argument commercial, sur les tickets de caisse du café du Midi). Juste en face, une vieille enseigne peinte, semblant dater de la même époque que la préfecture, proclamait en blanc délavé : « Bières de la Comète ». Au-dessus des deux étages on apercevait la ville haute. Il faisait vraiment très beau, et certains clients avaient même leurs lunettes de soleil, en quasi-Calabrais. La première cliente que je vis, et auprès de laquelle je m’assis, ressemblait étrangement à Laurence Parisot. Mêmes cheveux courts, mêmes petits yeux bleus, même petit nez retroussé. Elle portait un manteau de cuir noir, fumait. Elle partit très vite, sans doute vexée que je l’aie démasquée.
Du café comme poste d’observation de la société, en France, en 2012 : le café du Midi, à Bar-le-Duc, était un point de ralliement d’une sorte de petite bourgeoisie attachée à son mode de vie urbain, et d’autant plus intéressée à le manifester que la ville était petite et le département un peu oublié, avec ses même pas deux cent mille habitants. Le café du Midi faisait partie de la classe des « grands cafés de province », comme dans la chanson de Charles Trenet, avec les plantes vertes mais sans les joueurs de manille, qui avaient disparu depuis longtemps. Une institution de sociabilité promue par sa localisation avantageuse, sa terrasse, et par le poids de l’habitude.
Mes voisins de terrasse — dont la tablée s’augmentait de nouvelles têtes au fur et à mesure de la matinée, jusqu’à atteindre un régime de stabilité d’une huitaine de personnes qui dura environ une heure, de onze heures à midi — parlaient de leurs vacances au Club Med et un peu de politique. L’un d’eux faisait figure de Sage, celui auquel on lançait quelques provocations banales, quelques idées dans l’air du temps, et dont on attendait la réaction pour savoir que penser :
— [Le Sage] Oh, son père ! Son père, tu pouvais pas parler avec lui si tu voulais pas passer au minimum un quart d’heure... Toujours à te tenir la jambe ! Et puis alors toujours les mêmes trucs : les Roms, les Arabes, etc., et les impôts ! Bah tout le monde en paye, des impôts...
— D’ailleurs, ils ont commencé à annoncer la couleur, là... Ho ho ho !
— [Le Sage] Ouais... Mais au train où ça va maintenant, ils vont disparaître, ceux qui les paient, les impôts... La machine, elle va se casser... Et on n’aura personne pour les payer, les impôts. Comme quoi l’austérité, ça ne peut pas marcher.
— Ouais. Enfin ce qui va se passer c’est comme d’habitude, c’est que c’est les mêmes qui supportent tout l’effort : les petites entreprises...
— Tu vois ce que je crois, moi, c’est que le Parti socialiste — pas tous hein, mais certains barons — ils sont encore sous influence trotskyste-maoïste, enfin... marxiste : ils veulent détruire le capitalisme...
— [Le Sage] Je pense pas que Mitterrand ait détruit le capitalisme français, hein... Il l’a plutôt renforcé !
— Oui enfin je te parle pas de Mitterrand justement...
— [Le Sage] Non, mais enfin il arrive un moment où dans tout secteur, de toute façon, n’importe quelle entreprise ou organisation qui est seule sur son marché finit par se casser la gueule, publique ou privée... Regarde les grandes banques en Angleterre, complètement libres, ils ont fini par les nationaliser ! Quand tu penses à ce qu’avait fait Thatcher... Et si tu réfléchis, le communisme s’est cassé la gueule pour exactement les mêmes raisons, sauf qu’il y avait personne pour le nationaliser...
— Ouais... Le problème il vient aussi de ceux qui en veulent toujours plus... Plus ils en ont, plus ils en veulent... Des rapiats !...
— [Le Sage] Arrête, arrête. C’est la nature humaine, ça. Et puis regarde, je sais pas si tu as vu ça, sur Internet il circule en ce moment la photocopie d’une note de restaurant payée par trois types à Saint-Tropez. Soixante-dix mille euros. Soixante-dix mille ! Avec le champagne à cinq mille, caviar, langouste et compagnie... Mais ces gens-là, ils vivent tout simplement dans un autre rapport à l’argent. C’est tout. Ils en gagnent trois cent mille par mois...
— Donc leurs soixante-dix mille, c’est comme si toi tu dépensais trois cents pour un repas, avec tes deux mille euros par mois...
— [Le Sage] Voilà... Et encore... Mais c’est vrai qu’on vit une époque de libéralisme absolu, sans plus aucun règlement... Moi je viens d’une époque... Tu vois, je suis fils de paysans. Je me souviens, à l’époque quand on sortait avec un tracteur et deux remorques attelées et qu’il y avait un clignotant qui marchait pas, tu pouvais être sûr que trois kilomètres plus loin, tu te faisais aligner ! Pan !... Et tu pouvais leur expliquer que tu bossais, que le matériel agricole bah ça se casse, ça se déchire : rien à faire. Et c’était comme ça, réglementé. Aujourd’hui je vois les mecs passer avec leur tracteur sur des ponts où ils ne passent pas en largeur, ça frotte des deux côtés...
— Et tout le monde s’en fout.
Le Sage aurait dû m’inspirer de la sympathie, et sur le moment il m’en inspirait un peu, je dois dire, mais quelque chose dans toute sa science m’indisposait. C’était sa supériorité, je crois, la manière dont son évidente aisance intellectuelle asseyait son rôle parmi ses amis — il était un peu plus vieux d’ailleurs, et je crois que c’était plutôt les amis de sa femme. À un moment il se mit à chercher du soutien de mon côté, celui de l’étranger neutre et impartial. C’était à propos des pourboires : il n’en voulait point laisser, me dit-il, car « c’est compris dans le prix ». Alors qu’aux États-Unis, vous comprenez, c’est normal, puisque « c’est pas compris dans le prix ». Je ne l’approuvai pas. C’était donc son secret : il n’était pas généreux, et même mesquin. Il faisait le malin, avec ses théories sur la chute du communisme, et ses copains du Club Med au Sénégal. Deux tables plus loin, une dame d’une cinquantaine d’années racontait comment sa fille se faisait trimbaler de stages en entretiens, sans trouver de travail pour autant ; elle était même allée à Nancy pour s’entendre dire que désolé mademoiselle, mais l’entretien a été annulé, il n’y a plus de poste, au revoir. « On fait rien pour les motiver, les jeunes. » Deux d’entre eux, des mecs de vingt ans, évoquaient l’Espagne à côté de moi : « L’Espagne comment ça se casse la gueule ce pays. C’est ouf. — Ouais, c’est pour ça, tu vois, faut se casser. Moi je me vois bien tu vois, dans les îles, à faire du jet-ski, loin d’ici ; ici c’est mort. » La crise occupait les esprits, et le Sage me dégoûtait un peu maintenant, avec sa supériorité facile. Vers midi et demi, tout ce monde se leva, se dispersant pour le repas dominical. Il ne restait que quelques Arabes et des types que je pris pour des Turcs et que nul rosbif n’attendait à la maison.
Par la suite, je m’interrogeai sur ces Turcs. Ils avaient des têtes de Turcs, certes, mais ils avaient tout aussi bien des têtes de Roumains, d’Albanais, ou même de certains Vendéens à la peau très mate ; leur langue, que je ne comprenais pas, était pleine de roulements et de sons mouillés, comme le peu que je savais du turc. Plus tard, en remontant les rues barisiennes vers la ville haute pour aller voir le fameux Transi, je remarquai plusieurs voitures et camionnettes immatriculées en Bulgarie, et je fis le rapprochement, et je m’imaginai alors que ces Turcs étaient en réalité des Bulgares, débarqués ici en pleine crise pour travailler, pour refaire dans la Meuse des toitures et des salles de bain chez des gens comme le Sage qui ne devait pas leur donner de pourboire, à eux non plus ; des Bulgares à mille neuf cent quatre-vingt-neuf kilomètres de chez eux, enfin de Sofia, selon Google Maps — à supposer qu’ils vinssent de Sofia et pas de Dobrich ou de Vargas. Je les imaginais passer le dimanche au café du Midi, comme les honnêtes hommes qu’ils étaient, s’achetant, eux les sous-Européens qu’on n’autorisait officiellement pas à venir travailler chez nous, une dignité barisienne au prix d’un café-crème ; mais peut-être qu’ils s’en foutaient totalement, et peut-être qu’ils n’étaient même pas bulgares.
Comme ils étaient partis, le Sage et ses copains, je pouvais faire un peu attention à Isa, la « patronne », qui était là pour tout le dimanche, Isa, dite Zaza pour les copines et Isabelle pour les enfants. Elle était assez belle, en fait, grande, avec de larges épaules, des yeux bleu clair et des cheveux teints. Elle avait l’accent traînant de l’Est, un peu dur, un peu doux, mais chez elle, c’était plutôt doux, parce qu’elle mettait de la gentillesse dans les mots et dans ses gestes, l’air de rien, laissait traîner un peu les cafés consommés sur les tables inoccupées ; elle avait l’air de comprendre, les femmes, les hommes ; elle avait des mots gentils : « Votre collègue a déjà commandé, tellement qu’il est parfait, c’t’homme-là. » La décoration de son café ne ressemblait plus à grand-chose ; à l’intérieur, il y avait des petits canapés en cuir fauve et brun un peu partout, des poufs, des petites tables rondes accolées, beaucoup trop nombreuses pour un dimanche ensoleillé : la terrasse était pleine, mais la salle était vide, et je restai quelque temps tout seul ; j’écoutais la radio, c’était NRJ. J’entendis cinq ou six fois la promotion de la prochaine tournée européenne de Lana del Rey et celle du nouvel album des BB Brunes. J’entendais là, au café du Midi, les mêmes morceaux que dans d’autres cafés, sur d’autres continents, et je bénissais NRJ pour sa programmation mondialisée quand le programmateur choisit de diffuser Empire State of Mind. Je communiai alors avec l’Univers, j’étais à Bogotá buvant de l’aguardiente, j’étais dans le Queens buvant une Indian Pale Ale, j’étais à Bar-le-Duc mangeant un panini bien cuit. Une petite mouche vint se poser sur mon bras, longtemps, sans même le goûter.
Dans L’Est républicain, je lus un petit article rédigé dans un français glacé. J’y appris que la veille de mon arrivée, le TER circulant entre Châlons et Verdun avait heurté une bête égarée aux alentours de Baleycourt et du hameau de Regret ; que le choc, « violent comme peut l’être celui d’une collision avec un animal de cette taille », avait sérieusement endommagé la locomotive ; mais qu’aucun des neuf passagers n’avait été blessé dans l’accident. La vache, elle, les passagers entendirent « ses os se briser ». Je me demandai ce que ça devait faire, d’entendre les os d’une vache se briser ; pendant ce temps-là, Isa m’avait replacé sur la terrasse. J’avais remarqué que la Kronenbourg locale n’avait pas le même goût : c’était la « Fleuron d’Alsace », dépourvue de l’insipidité légendaire de la Kro de chez moi. J’en commandai une autre, en constatant que la terrasse s’était entre temps peuplée d’un autre genre de clientèle. Ce n’étaient plus les familles mais les jeunes, les presque-trentenaires qui venaient en bande et parlaient bien fort de la soirée de la veille ; ou deux filles qui s’entretenaient de la vie, de l’amour, et d’autres choses encore.
Au grand café, on peut rester indéfiniment tant que l’on commande et boit ; personne ne vous posera de questions ni ne vous regardera de travers, pour la bonne raison que personne, si vous restez la journée, ne reste autant que vous : ils croient que vous venez d’arriver ou que vous allez bientôt partir. Seule Isa savait, forcément, mais elle respectait le contrat de l’anonymat garanti pour le prix de trois bières et de deux cafés. Je partis quelque temps après, vers dix-sept heures, en laissant, moi, un pourboire, et je pris la direction de Verdun par la Voie Sacrée. Je repensai alors à la vache de L’Est républicain : Baleycourt et le hameau de Regret, lieux de l’accident du TER, étaient là, sur le chemin, dernières bornes de la Voie Sacrée avant d’arriver à Verdun. Je me dis qu’il était bon que la vache fût morte près d’une Voie Sacrée, imaginant son fantôme accompagnant ceux des soldats maudits du Kronprinz.