


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


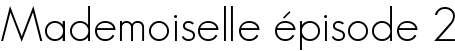
 |
|
|
Publié dans le
numéro 002 (Février 2011)
|
2010, dernier lundi de l’année, 2°C à l’enseigne de la pharmacie rue de la Chaussée d’Antin, angle de la rue de Provence. Au premier étage des Galeries Lafayette, des silhouettes engoncées dans des épaisseurs de laine, duvet, peaux de bête, déambulent d’un pas un peu raide dans les allées surchauffées. Sur le stand, je déballe des t-shirts en lin couleurs cerise et abricot, des blouses en voile de coton rouge coquelicot, des robes de dentelle blanches comme des lys - la primeur du printemps-été : quelques pièces de la nouvelle collection.
Des « pièces ». Au luxe, c’est ainsi qu’on appelle les vêtements, comme les œuvres dans les galeries d’art. Tout au bout de l’allée, après le bar à champagne et les étals colorés de macarons Pierre Hermé, on entre dans le fief des grandes maisons de couture. Dans la pénombre feutrée, des projecteurs font vibrer le métal des arceaux suspendus comme des cages dorées au-dessus des stands - ici, des « corners ». Les boutiques plus vastes occupent un pan de mur avec leurs divans profonds, épaisses moquettes, faux tableaux de maîtres. Dans une alcôve, une robe nacrée de sequins et de perles tourne sur elle-même comme une danseuse étoile, étourdie par son propre prix - 100 000 euros. Là, les cabines d’essayage sont des « salons », et on dit « je suis en clientèle » pour signifier qu’on est occupé à une vente. Vêtus d’uniformes sombres aux insignes de leur marque, hiératiques comme leurs mannequins, les vendeurs sont postés sur les perrons, sempiternellement debout dans le même clair-obscur, à attendre que vienne une cliente. « Réveillée par l’arrivée inopinée d’un visiteur aussi tardif, la meute éparse, magnifique et désœuvrée des grands valets de pied, soulevant leurs nobles profils aigus de lévriers, se dressèrent et, rassemblés, formèrent le cercle autour de lui » (Du côté de chez Swann). Parfois je pense aussi aux domestiques des grands aristocrates du 18ème siècle, qui portaient les couleurs de leurs maîtres et s’affrontaient à l’aube, entre maisons rivales, pour défendre leur honneur à la cane car ils n’étaient pas jugés dignes de porter l’épée. Au deuxième étage du Printemps, j’avais rencontré Baptiste, dandy freluquet à l’humour cinglant, fier comme un paon de travailler pour un couturier prestigieux chez qui tout est blanc, fournitures, portants, fauteuils, jusqu’à la caisse que l’équipe devait régulièrement repeindre. Comme les meubles, les vendeurs étaient vêtus de blanc, et dans leurs longues blouses de coton, affront ! On les prenait souvent pour les serveurs de la sandwicherie du troisième. Baptiste arrivait tôt le matin, quittait tard le soir, servait ses clientes avec un tel dévouement qu’il pouvait débarquer à tout moment, jour de repos ou pas, pour faire faire un ourlet. Mais qu’on s’avise de bousculer un sac à main et de l’abandonner là, gisant sur le tapis blanc, et Baptiste pouvait dégainer, offensé comme si on avait insulté ses morts. Pourtant il ne gagnait pas beaucoup plus d’argent que s’il avait vendu des jeans. Quant aux grands valets de pied des Galeries Lafayette, ils mangent à la cantine, à côté des vendeuses de la lingerie. Mais quand par hasard je les croise aux toilettes du personnel, au coude à coude avec des ouvriers gris de poussière, je suis toujours étonnée de les surprendre dans ce décor miteux, en train de se brosser les dents après leur pause déjeuner.
Plus on monte aux étages, plus les prix baissent. Alors, dans le brouhaha et la lumière crue des néons, jupes, pulls, pantalons redeviennent ce qu’ils sont, « des articles », « de la marchandise », et même : « de la came ». Ce matin, j’ai donc reçu de la came. Tout un chargement échoué à l’entrée des réserves, sur le pallier, face aux monte-charges. Cindy est en vacances, Lucile de repos pour la journée. Je vais et je viens de « l’avant » vers « l’arrière », poussant des portants à roulettes, tirant des portants sans roulettes, traînant des caisses de vêtements, charriant des sacs d’antivols et de câbles, déplaçant à coups de pied des cartons de cintres en plastique et d’autres de cintres en bois. Et comme toujours quand les vêtements s’amoncellent sur la caisse au milieu des emballages éventrés, des mains frénétiques surgissent pour tâter, fouiller, déployer, examiner sous toutes les coutures dans l’ivresse d’arracher une bonne affaire, donnant des allures de marché à mon échoppe où la moindre robe coûte un tiers de smic.
Une Polynésienne achète une veste en lin bleu ciel. Avec un sourire radieux, elle me dit en tapant son code de carte bancaire : « Thank you, I’m so glad. It makes my day ! ». Je pars en réserve pour remplacer la veste. Dans l’allée, installés sur les grands fauteuils en osier, une famille de Chinois pique-niquent de cuisses de poulet rôti, œufs durs, laitue.
Une Australienne achète une robe en soie blanche à petites fleurs parce qu’en Australie, c’est l’été. Sur le chemin de la réserve, je trouve la famille de Chinois allongés sur les fauteuils, sans chaussures, en train de faire la sieste.
Deux copines achètent la même robe en soie noire à petites fleurs, dans la même taille. « Moi je m’en fiche qu’on ait la même robe », dit l’une. « Moi aussi », dit l’autre. Dans l’allée, les fauteuils sont vides. Autour, quelques lambeaux de peau de poulet sur le marbre clair.
« Ça va la belle ? » s’écrit Aurelia Monteanu en surgissant au pas de charge sur le stand, ses deux téléphones aux poings. Je lui dis qu’elle a l’air en forme. Elle me répond en faisant la grimace : « Da, comme-ci comme-ça. Lavoro, lavoro, lavoro » puis, sur un ton mélodramatique, « pas manucure, pas coiffeur... ». Je connais Aurelia depuis qu’elle s’est installée à Paris, où elle gagne plus ou moins sa vie comme « personal shopper » : elle choisit des vêtements qu’elle revend avec un bénéfice à de riches clientes roumaines, qui la plupart du temps n’en veulent pas et les lui renvoient. Aurélia achète et rend beaucoup, avec la même angoisse. Comme toujours elle est pressée, et me demande d’une voix torturée : « Qu’est-ce qui est joli ? ». Je passe en revue la nouvelle collection. Elle hésite sur les tailles, les couleurs, me prie d’essayer une veste pour se faire un avis, passe plusieurs coups de fil en italien et en roumain, finit par se décider pour la veste, deux robes, des t-shirts en lin, un short en jean. Sur le pallier, je retrouve la came telle que je l’ai laissée. Je déchire le cellophane du portant pour attraper les robes et la veste sur cintres, je perquisitionne les unes après les autres les caisses pleines à craquer de vêtement pliés, ça y est je tiens aussi les t-shirts, et le short... plouf, le short vient de chuter dans une bassine d’eau croupie. Je le repêche tant bien que mal au moment où quelqu’un me tape sur l’épaule. « Ca va belle gosse ? Bien ? T’as passé un bon Noël ? Tranquille ? Tu finis à quelle heure ? Moi à 22. Tu m’attends ? ». C’est Félicien, manutentionnaire, colosse réunionnais d’une vingtaine d’années qui me guette souvent à la sortie des réserves. J’esquive sa bise, « oui, super, non, j’peux pas » et repars à toute allure, bras chargés, short au bout des doigts, trainant dans mon sillage une forte odeur d’égout.
« Ca va Miss ? T’as passé un bon Noël ? ». Vincent, jeune pompier volontaire aux Galeries, se décide enfin à entrer après avoir rodé un bon moment autour du stand. Il démarre ses vingt-quatre heures de service, dont quatre de sommeil, « dont deux bénévoles ». Il me dit qu’il va commencer par aller faire des courses : dans la caserne, il est le préposé à la cuisine. « De la viande, de la purée... Faut la nourrir, la bête ! » s’esclaffe-t-il en parlant du capitaine, une armoire à glace moustachue. « De toute façon, aujourd’hui, c’est calme... », et avec un air de regret : « A part une dame qui s’est sectionné le pouce en claquant la portière de sa voiture, j’ai eu seulement quelques évanouissements ». Je lui demande ce qu’ils ont fait pour le pouce. « Ben on a appelé les pompiers ».
J’emmène Elena, la chef de rayon russe, consciencieuse, austère, ancienne responsable dans la joaillerie de luxe, renifler la bassine d’eau croupie. Solennelle, elle déclare qu’il doit s’agir des glaçons du pot de Noël du personnel. Elle ajoute en brillantant ses prunelles : « Je me charge de son évacuation ».
« Alors Emilie, ça va ? Ça vend ? » rugit Gérard, autoproclamé « roi du pinard », la cinquantaine ogresque. La première fois qu’il m’a rendu visite sur le stand, à ma question « Et toi, qu’est-ce que tu fais ici ? », il a roulé de gros yeux sous ses triples foyers : « Pas grand chose ». Je sais seulement qu’il est entré dans le magasin en 1994 et, d’après mes observations, c’est un pilier de l’entrée du personnel. Alléchée par son ancienneté, émoustillée par sa position stratégique, convaincue d’agir dans l’intérêt du Tigre, j’ai pressée Gérard de questions. J’ai ouvert des yeux fascinés par les chiffres (« On est 4000 employés aux Galeries »), partagé ses coups de gueule (« La sale de pause, elle est pas nette »), tressailli à ses scoops (« Y’a que la pizza qui vaut le coup à la cantine »). Depuis, enhardi, il me alpague à l’entrée, à la sortie, et ne rate pas une occasion de venir me saluer d’une bise sonore accompagnée d’une main amicale, un jour sur mon épaule, le lendemain dans mon dos, aujourd’hui contre ma hanche... Halte-là, Gérard !
Autour des fauteuils en osier, un homme en djellaba claire, pakistanais ou bangladeshi, et quatre femmes vêtues de longs voiles vert pomme, fushia, violet, orange. Soudain l’homme sort de son sac une nappe en toile cirée blanche à motifs de fraises, il l’étale sur le sol, bien en biais à l’entrée de la réserve, enlève ses chaussures, s’agenouille et se met à prier.
Dans le recoin de pause, des hommes de « la Spéciale », l’équipe de vigiles interne au magasin, discutent en sirotant leurs cafés. L’un d’eux raconte une altercation qu’il vient d’avoir avec une cliente : « Ecoutez madame, je fais mon métier. C’est pas le métier le plus intéressant du monde mais c’est avec ça que je gagne ma vie ».
Dans l’allée, la nappe repliée dans son sac à dos, un trench beige sur sa djellaba, l’homme et les femmes aux couleurs vives s’éloignent vers les ascenseurs en discutant.
« Hé Emilie, salut... ». C’est Soizic, qui pendant deux ans tenait un stand voisin du mien quand je travaillais au Printemps. Je suis toute contente de la voir, et lui demande ce qu’elle fait là. Elle m’explique qu’Isaac, le responsable de la marque qui l’emploie, lui a annoncé trois jours plus tôt qu’à partir de maintenant, elle serait aux Galeries. Pourtant le stand faisait des chiffres d’affaires mirobolants, Soizic s’y sentait bien et était très amie avec sa coéquipière, Laura. Quand elle lui a demandé pourquoi il avait décidé de la muter, Isaac, avec son cheveu sur la langue, lui a seulement répondu : « Pour rafraîsssir ». « Il a pris Nathalie qui bossait ici, moi là-bas et hop, il nous a échangées... Il veut juste me casser, que je reste toute la journée dans mon coin sans parler à personne. Mais qu’est-ce qu’il croit ? Je suis pas une sauvage ! ». Elle me dit qu’elle a pris rendez-vous avec les syndicats du Printemps - « Il veut la guerre, il l’aura ».
D’en face, Nisrine me fait signe de la rejoindre. Je la trouve bouleversée. Elle me raconte qu’Alice, une jeune femme brune, souriante et discrète, vendeuse d’un stand voisin, vient de se faire licencier. Après un encaissement, elle a passé sa carte Monoprix pour récupérer les points de fidélité de la vente. Le vendeur d’à côté l’a vue et immédiatement dénoncée à la chef de rayon du secteur, Dominique Jacot, qui l’a renvoyée pour faute, sans indemnités de départ. Nisrine me dit que les vigiles l’ont cuisinée un moment dans leur bureau : « «On sait qu’y a un trafic de Smiles au deuxième étage. Si tu nous dit qui c’est, on sera plus gentils avec toi». Mais Alice, c’est pas une balance. Son mec la battait, elle s’est enfuie, maintenant elle élève seule sa fille. Elle le sait, tout ça, Dominique. Et elle la vire comme ça ! » J’apprends qu’aux Galeries, quand un chef de rayon dénonce un employé pour fraude, il a une prime de cinquante euros. « Dominique, qu’elle s’avise pas de rentrer sur mon stand. Je lui dirais : «Je suis obligée de te parler ? Non. Alors dégage» ».