


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


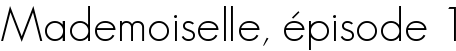
 |
|
|
Publié dans le
numéro 001 (janvier 2011)
|
« Mademoiseeêlle ! » Une robe de soie noire vient de s’élever au-dessus de la barre de vêtements et reste suspendue là-haut, comme un suaire ondoyant dans l’air climatisé. « S’il vous plaît... » insiste la voix avec impatience. À contrecœur, je contourne la structure arrondie du stand qui, avec ses armatures de fer et son socle en bois, a la forme d’un manège. « Dites-moi... C’est quoi comme couleur, ça, pour vous ? » demande la cliente en me mettant la robe sous le nez. Du visage anxieux, tenaillé par le doute, mon regard se porte sur le tissu, noir, incontestablement. C’est parfois une jupe ou un sac à main que je surprends à léviter, brandis par des corps invisibles derrière les rangs serrés des vêtements sur cintre. Et parmi les questions qui bondissent elles aussi par-dessus les portants, « Qu’est-ce que c’est ? » est la plus lancinante. Alors, incrédule comme Salomé, la sage-femme biblique ordonnant à la Vierge : « Marie, dispose-toi, car ce n’est pas un mince débat qui s’ouvre à ton sujet » et lui mettant derechef un doigt dans sa nature, je me transporte sur les lieux du mystère. Un nouveau tour de ronde pour découvrir qu’en fait d’objet occulte, il s’agit d’un manteau présentant toutes les propriétés caractéristiques d’un manteau.
Trois jours par semaine, je vends les vêtements pour femme d’une créatrice de mode parisienne très cotée. J’ai travaillé au Printemps pendant deux ans, et depuis mai dernier, je suis un peu plus bas sur le boulevard Haussmann : aux Galeries Lafayette. La semaine dernière, comme je venais d’extraire avec peine une plantureuse sexagénaire d’un chemisier trop petit, la vendeuse du stand d’en face m’a lancé en riant : « Mais tes clientes, c’est des folles ! » Je ne travaille qu’à mi-temps, j’ai gardé pas mal de la patience qui me vaut dans le secteur le surnom un brin narquois d’« assistante sociale ». C’est vrai, il m’arrive d’être intriguée par ces femmes, comme elles j’aimerais croire qu’à tous les coins de rue me guettent tant de mirages et de métamorphoses. Et j’imagine ces folles penchées à leur fenêtre, se demandant si, en bas, il y a des gens sous les chapeaux. Si certaines doutent, d’autres sont excessivement bien renseignées. « Sophie Mimoun, elle est passée hier, pas vrai ? Elle a pris quoi ? » Quelques secondes pour vérifier que non, je ne suis pas tenue au secret professionnel, et je désigne les dernières acquisitions de Mme Mimoun. « Tu me mets tout comme elle. Pareil, en taille zéro », et devant ma mine réprobatrice : « Je fais un régime, je vais perdre. » La dernière fois, c’est une digne quinquagénaire rousse à lunettes, petite et sèche comme une sauterelle, qui enfile un manteau en renard, puis un autre en lapin, un troisième en mouton. Elle est d’humeur bavarde : des fourrures, elle en a eu il y a trente ans, elle s’en est séparée, ça prenait trop de place. Arrive une jeune femme brune venue essayer une redingote grise en chevron, de coupe masculine. Elles partagent le même grand miroir face aux cabines d’essayage. Je m’éloigne une seconde et j’entends dans mon dos la rousse dire à la brune : « Alors vraiment, il faut que je vous dise : ça ne vous va pas-du-tout ! On dirait même que vous êtes bossue. » L’autre achète quand même et repart furieuse.
Rue de Provence, hiver 2010. Devant l’entrée du personnel, des employés en uniforme fument des cigarettes en frissonnant. Certains sont assis au coude à coude sur les deux petits bancs sales plantés face à face, devant les escaliers d’évacuation ; la plupart debout claudiquent d’un pied sur l’autre en attendant qu’une place se libère. Une fois n’est pas coutume, aujourd’hui je suis à l’heure et me prête de meilleure volonté au rituel du pointage. Je m’arrête à la première borne pour faire glisser ma carte, l’écran affiche 12h01 et les sept chiffres de mon numéro de badge. Traversée du hall, d’un côté la consigne du personnel, de l’autre le guichet où comme chaque jour les nouveaux font la queue pour s’enregistrer. Salut au vigile, deux portes battantes et vlan ! lumière synthétique, il fait une chaleur de serre là-dedans, le « Bambino » de Dalida se perd dans le bourdonnement qui monte des rayons de la parfumerie. Je fends le courant contraire d’un groupe de touristes chinois, juste avant les marches sur ma droite il y a trois Saoudiennes, peut-être Qataries ou Émiraties, elles rient d’une petite troupe de bonzes un peu à l’écart, ils sont tournés vers un autre, radieux dans sa robe orange, chaussettes et sandales en plastique, qui pose pour la photo devant la vitrine Louis Vuitton. Slalom entre deux flâneurs à sac à dos, piétinement, accélération avant l’embouteillage de poussettes devant l’ascenseur, virage à droite pour m’engouffrer dans l’escalier dépeuplé mais sonore du brouhaha d’en bas, montée quatre à quatre des marches au parquet ciré malgré le souvenir du vol plané d’une cliente dont on avait retrouvé le talon deux mètres plus haut, planté dans une rainure du bois.
Au premier tout est calme encore, quelques touristes se contorsionnent pour prendre en contreplongée le sapin de Noël bleu et rose poussé en une nuit au centre du rez-de-chaussée, et dont le sommet touche presque la coupole. À cette heure-ci, les gens se pressent au deuxième et au troisième où les vêtements sont moins chers. Sur les coups de 17 heures ils commenceront à refluer vers l’étage qu’ils traverseront d’un pas de promeneurs fatigués, s’arrêtant pour caresser les fourrures, se moquer des robes importables, éventuellement se faire tirer le portrait en laissant dépasser leur tête du col comme avec les trompe-l’œil de mariées ou de Monsieur Muscle, et s’asseoir sur tout ce qui peut ressembler à un siège pour donner à goûter aux enfants, attendre l’ascenseur ou simplement se reposer avant de se remettre en marche.
« Ça va ma chérie ? » me demande Cindy, liane brune, trente-cinq ans, mère divorcée de deux grands enfants, parfois dite « la Gitane » parce que son mari était un gitan de Montfermeil où elle a grandi. Je réponds invariablement « Oui et toi ? » en claquant la bise à Lucile, la responsable du stand, trente-trois ans, Antillaise aux dreadlocks blondes, maquillage égyptien et décolletés vertigineux, ex-danseuse hip-hop. « Ça va à part qu’ils sont relous aujourd’hui ! Ils touchent tout, ils achètent rien. - Ben on est samedi, qu’est-ce t’as ? riposte Lucile. Là ils viennent voir les vitrines. Jusqu’à Noël y’aura que ça, des badauds. »
Décembre est un mois creux, le tunnel de l’ennui avant la frénésie des soldes. Mais le samedi l’équipe est réunie, les « drôles de dames » au complet comme nous appelle Coco, « vendeuse Galeries » d’un stand voisin - « conseillère de vente » d’après son badge, tandis que nous, embauchées par la marque, arborons un « démonstratrice » plein de promesses. Comme d’habitude, je laisse quelques objets de première nécessité dans le tiroir de la caisse et, comme d’habitude, branle-bas, frayeur, tremblements, on cherche partout les clés de la réserve pour que j’aille y déposer le reste de mes affaires. Je les découvre dans une poche de la veste de Lucile. Pour se venger de mes ricanements sataniques, elle me crie avec un accent de mama antillaise : « Oh ça va espèce de crapule ! Chat noir ! Typhus ! » Je lui raconte que la semaine dernière, une cliente revêche coiffée d’une toque en léopard rouge a voulu acheter un haut de la collection. Ne le voyant pas sur les cintres et après une tentative de description (« Il a un col rond - Mais encore ? »), elle s’exclame : « Elle le porte, votre collègue ! Vous savez la blonde... » Intérieurement, je passe les deux autres en revue. « Vous voulez dire la Noire ? » Elle panique : « Enfin Noire je ne sais pas... De couleur, oui. »
Tandis que toi homme blanc :
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,
Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris...
Et après cela, c’est moi que tu oses appeler « Homme de couleur » !
déclame Lucile d’une seule traite.
Du stand à ma réserve il y a soixante-quatorze pas si l’on sort par la gauche, tourne à droite au niveau d’une vitrine d’accessoires Martin Margiela éclairés comme la Joconde, remonte l’allée de marbre clair jalonnée de spacieux fauteuils en rotin et, juste avant les paravents qui calfeutrent le « Salon Cofinoga », on prend encore à droite. Au trente-sixième pas, enjambée fatidique, on se retrouve « à l’arrière » : sur le palier, dalles de béton brut, bennes dégueulant d’ordures, cartons éventrés devant les monte-charges, fils électriques à nu sur le crépi gris. Tout au fond « la salle de pause », un recoin à la jointure de deux couloirs où trônent une machine à café, trois chaises miteuses, un tabouret. Quant aux réserves proprement dites, imaginez une enfilade de cages de deux mètres de large sur quatre de haut, éclairées au néon et séparées les unes des autres par des grillages en fer.
Mardi dernier, une Ukrainienne à bouche et seins siliconés est arrivée juste avant la fermeture. En dix minutes elle a dépensé 835 euros, soit le prix d’une ceinture en agneau, un pull en mohair et une robe moulante à rayures lurex, « bleu Klein » selon la référence, mais semblant tout droit sortie du vestiaire de Michou. Rien d’exceptionnel. Cet été, en un claquement de doigts, des femmes en tailleur-pantalon et micro-oreillette s’étaient déployées aux quatre coins du stand, et la plus jeune princesse de la famille royale du Qatar m’avait acheté pour 4000 euros de vêtements. « Là c’est rien, elle se promène », m’avait glissé son chauffeur pendant que j’emballais ses achats. Bien sûr, j’ai aussi des clientes qui passent et repassent plusieurs jours d’affilée, essaient, reposent, se torturent pour une bague fantaisie à 30 euros. Le grand écart des prix est tel que, sur les ving-trois mètres carrés du stand, les pleines aux as cohabitent avec des fauchées prêtes à se saigner pour un petit fétiche à la mode. Alors rien d’exceptionnel, si ce n’est que la pulpeuse Ukrainienne, elle, a oublié deux paquets qu’elle n’est jamais revenue chercher. Mon butin, qui a dormi quatre nuits en réserve : trois paires de chaussettes en fil d’Écosse et plusieurs boîtes de confiserie de luxe. À peine mes affaires posées, je me réjouis d’y goûter. Mais... Mais ! Dans le grand sac en carton les ballotins ont été mis en miettes, les rubans déchiquetés, les souris ont dévoré les caramels de la rue Saint-Honoré !
À l’avant, je trouve Nadia et sa mère Cathy, deux « bonnes clientes » comme on dit, devenues des amies de Lucile. « Il fait une chaleur dans cette porriture de magasin ! » peste Cathy avec son accent juif tunisien, « c’est la shrana dans mon manteau. » Lucile leur raconte sa dispute avec Sylvianne Cohen, venue se faire rembourser une robe en lamé or que de toute évidence elle n’avait pas achetée ici. « Mouret avait pénétré plus avant dans le cœur de la femme, il venait d’imaginer «les rendus», un chef-d’œuvre de séduction jésuitique. «Prenez toujours, madame : vous nous rendrez l’article s’il cesse de vous plaire.» » (Zola, Au bonheur des dames). Cent vingt-sept ans plus tard le mot suscite encore le désespoir et la rage des vendeurs (« L’autre c... de Mme Untel, elle m’a encore fait un rendu ce matin »), m’évoquant toujours l’image d’une flaque de vomi. « Bonjour, je viens pour un rendu », a donc annoncé Mme Cohen à Lucile, qui lui a répondu : « Ah non, madame ! Sans ticket de caisse c’est impossible », à quoi Mme Cohen a rétorqué que « vraiment, ce serait péché de pas me la reprendre ». Après trois quarts d’heure de pourparlers et pour éviter le scandale, la cliente a finalement obtenu gain de cause de la part d’Elena, la « chef de rayon » du secteur, autre terme suranné du Bonheur des dames tout récemment remplacé par « manageur de vente ». « Ah si j’avais été là... Mauvaise Juive, va ! » conclut Nadia.
Lucile est partie déjeuner. Cindy me raconte sa semaine, l’amour surtout, récit interrompu par une succession de personnes cherchant les toilettes. Un homme nous accoste : « Excusez-moi mesdemoiselles, où se trouve le Pont de Cristal ? - Le quoi ? Ah la passerelle... Tout droit à droite », l’expédie Cindy.
Une fille de vingt-cinq ou trente ans, brune, l’air un peu triste, cherche une robe. « C’est pour son mariage civil », précise sa mère d’un air entendu. Je lui propose une robe en soie à motifs bleu et blanc qui rappelle celles de Maggie Cheung dans In the Mood for Love. Le père débarque. Il porte moustache et appareil photo en bandoulière. « À ma fille tout lui va, mais rien ne lui plaît », déplore-t-il. Je lui dis : « C’est mieux que l’inverse. » La fille sort de la cabine. Elle est très jolie dans la robe, mais devant le miroir elle s’inspecte d’un air critique. « Ma chérie, tu peux porter ça parce que toi, tu as des fesses », déclare la mère. La fille est catastrophée, elle est persuadée d’être callipyge. Le père s’en mêle : « Vaut mieux avoir des fesses que pas de fesses ! Pas de fesses, c’est moche ! » La pression monte, je sens qu’on attend que je prenne position dans le débat. Le téléphone sonne, je m’éclipse.
Une petite femme blonde déboule sur le stand. Je lui lance un bonjour sonore et souriant. Elle s’approche de moi comme si elle allait me sauter à la gorge, et articule en martelant chaque syllabe : « Vous pourriez porter votre badge ? » Je la regarde avec tout le mépris dont je suis capable : « Mais oui. » Je lui tourne le dos. Furieuse, je pars en réserve tout raconter à Nisrine, la vendeuse de chez Vivienne Westwood. « Émilie, c’est pas bon. C’est Véronique Sauvet, la grande, grande patronne des Galeries. » Cindy est dépitée : « Oh non... Ils vont encore envoyer un mail à la boîte. » Comme la fois où l’acheteur des Galeries Lafayette l’avait surprise cachée derrière la caisse... en train de boire une gorgée d’eau.