


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


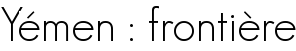
 |
|
|
Publié dans le
numéro 001 (janvier 2011)
|
Harradh, frontière saoudienne
La première feuille est toujours la plus difficile. L’amertume saisit la bouche, un rictus de dégoût monte au visage, mais il faut le retenir, passer l’épreuve en pensant à la promesse du réconfort qui suivra. Monzher, assis en tailleur à côté de moi, détache méthodiquement d’un nouveau rameau les pédoncules tendres et les jeunes pousses qui viendront s’empiler contre la paroi de ma joue, se gonfler de salive et distiller, aux quatre coins de mon corps, le jus psychotrope qui leur racontera combien la vie peut être simple. Je saisis les morceaux de qat d’une main désinvolte, prêt pour le voyage, écoutant en bruit de fond des blagues salaces de mon collègue palestinien. Il en rit tellement qu’il s’étoufferait presque. Les autres rigolent de façon plus mesurée ; apparemment les Yéménites sont plus réservés sur ces choses-là. L’un d’eux, jeune docteur à la barbe de bon croyant, visage émacié et lunettes de premier de la classe, se lève soudainement, le visage crispé, et décide qu’il est l’heure pour lui d’aller prier. En fait, je soupçonne qu’il veuille s’échapper avant que les choses ne deviennent vraiment trop scabreuses. Il va retrouver le monde divin, droit et sans épanchement...

Je continue à saisir les feuilles une par une, puis deux par deux, le geste est maintenant mécanique, le temps commence à s’étirer. C’est tout ce que j’attendais. L’amertume de la première bouchée n’est plus qu’un lointain souvenir. Je me couche sur le côté, affalé sur un coussin, replie ma fouta (pagne local) entre mes jambes et laisse la drogue faire son effet. Je rirais presque des blagues de G., moi aussi, quand j’arrive à comprendre la finesse de son argot. C’est curieux, après dix-huit ans à parler cette langue, j’en ignore encore pratiquement toutes les vulgarités. Il faut dire qu’elles varient tellement d’un pays à l’autre, comme les accents, la grammaire, le vocabulaire, la syntaxe, les détours et les finesses, les inspirations et les insinuations. Ce n’est plus une langue, mais tout un chapelet de dialectes que je continue à dévider, toujours aussi surpris du plaisir procuré par chacun de ses grains au passage entre mes doigts. Dans les méandres que mon esprit commence à suivre, poussé par les amphétamines, je revoie le jour 0, dans la brume au bord du Nil froid d’un mois de novembre 1992... Et je mâche, je mâche, car en mâchant, les pensées passent et repassent sans laisser aucune trace. Tout est ce qu’il devait être. Le sens des choses n’importe plus vraiment, et pourtant tout semble couler de source. Comme être là, ce soir-là, habillé à la yéménite, affalé sur un coussin, à rire sans trop savoir pourquoi à des blagues mal comprises, dans un hôtel un peu véreux d’une ville-frontière lugubre, remplie de Saoudiens pas trop réglos venus mâcher le qat interdit chez eux, et de pauvres hères éthiopiens, somaliens ou soudanais, tentant leur chance pour passer clandestinement dans le Royaume et y grappiller des pétrodollars. Le temps a fini de s’étirer car il ne compte plus vraiment. Je saisis maintenant des branches entières et croque directement feuilles et tiges, tel un panda à son bambou, ou plutôt, vu le lieu, tel un dromadaire à son épineux chétif. Je me réincarne herbivore et j’aime ça. Je suis pourtant censé être ici pour recueillir des informations inédites sur un des conflits les plus ignorés de la planète. Une douce effluve d’interdit emplit mes pensées. Je pourrais être un espion, en fait, j’en ai peut-être l’âme - mais certainement pas le courage. Et pourtant, aujourd’hui, j’ai bien failli prendre la tangente...
Onze heures du matin, camp no 1, plaine de Mazraqi. Oublions que nous sommes mi-octobre, il fait aussi chaud qu’aux portes de l’enfer. Des volutes de poussière rendent l’horizon bien improbable. Des rangées de tentes, fatiguées, pour ne pas dire misérables, s’alignent à perte de vue. Papiers perdus et sacs plastiques s’échappent avec le vent, les rares arbustes, qui ont totalement perdu l’espoir d’égayer l’endroit, se plient en deux pour ne pas rompre. Je range mon cahier dans ma sacoche, une nouvelle cargaison d’informations couchée fébrilement sur les pages blanches et sors du container climatisé pour retrouver, avec un certain soulagement, la fournaise et les tumultes atmosphériques. J’allume une cigarette, pour passer le temps, car mes collègues n’ont pas fini de leur côté. Je vois passer devant moi des personnes marchant d’un pas lent, l’air hagard. Des vieux surtout, la barbe pointue et blanche, mais désordonnée, le turban un peu de travers, la fouta mal fagotée. Quelques silhouettes, noires et opaques, de femmes. Pour une fois, j’envierais presque leur niqab, pour pouvoir me protéger les yeux de la poussière endiablée. Personne n’a l’air d’avoir vraiment une destination précise. Ils marchent pour passer le temps, j’imagine. Que faire d’autre quand on croupit depuis trois ans dans un camp de déplacés fuyant le conflit qui ravage le nord du Yémen, un de ces camps dont on n’a jamais parlé aux news car, ma foi, on a bien assez de l’Irak, de l’Afghanistan et d’Haïti en ce moment. Les damnés de cette planète ne s’imaginent probablement pas qu’il y toujours plus damnés qu’eux... Un groupe d’enfants passe en tapant sur des petits bidons de plastique et en chantant à la suite d’un des animateurs du Secours Islamique, ONG responsable du camp, qui essaient, tant bien que mal, de préserver l’humanité du lieu. Les vieux, eux, continuent à errer d’un bout à l’autre de l’allée centrale. Leurs femmes triment autant ici qu’au village, il faut bien continuer à nourrir la famille, mais pour eux, sans champs à cultiver, sans troupeaux à rassembler, l’ennui devient la seule occupation.

J’entends mes collègues, allés prendre le café sous une grande tente de bédouins, s’esclaffer à côté d’un homme âgé à fière allure, une jambiya (poignard yéménite) bien calée sur l’estomac. Ils me font signe d’approcher et me présentent à ce personnage haut en couleurs. J’ai oublié son nom mais n’oublierai pas le nombre de ses enfants : cinquante-cinq. Enfin, à quelques unités près. De quatorze femmes. Et déjà quatre-vingt-quinze petits-enfants (je me demande qui tient le registre pour lui). Il n’a pas du en allaiter beaucoup, ni leur faire souvent à manger, encore moins les changer, quand on voit comme il a encore l’air fringant. Un coureur de jupons, mais selon les rites locaux. On n’a que des enfants légitimes et on n’a jamais que quatre femmes à la fois. Il suffit de se divorcer d’une des quatre à chaque nouvelle rencontre. Chose assez simple, faut-il dire, sous ces latitudes : « Enti taleq, enti taleq, enti taleq », deux témoins et le tour est joué. Soit trois fois : « Je te répudie », lancé par le maître tout-puissant. Le sheikh procréateur rit de toutes ses dents verdies par une vie à mâcher du qat. Au même moment, je vois passer une petite fille, à peine sept ans j’imagine, déjà voilée de pied en cap, un bidon d’eau sur la tête, qui semble peser aussi lourd qu’elle. Vu les coutumes locales, elle sera bientôt en âge de se marier. Elle fera une ribambelle d’enfants à un homme de quelques décennies plus vieux qu’elle et acceptera l’épouse suivante avec soulagement, sachant que cela signifie pour elle la fin des enfantements dans la douleur. Allez, un grand sourire à notre sheikh, Mabrouk (« Félicitations ! ») pour avoir fait preuve d’une telle virilité, une bouffée de poussière, et on repend la route. Destination camp no 3.
La Jeep traverse des terrains vagues peuplés de chiens malingres pour déboucher sur un nouvel alignement de tentes misérables. L’intérieur des tentes, lieu des femmes, est invisible. Des enfants à moitié nus jouent sans trop y croire à l’entrée de leur demeure de fortune. Les hommes, déjà pris dans les vapeurs du qat alors que midi n’a pas sonné, sont allongés sous l’auvent de leur tente. L’endroit exhale un doux désespoir. Nous recherchons un chef de village qui doit nous raconter comment tout cela s’est passé, le conflit, l’exil et les espoirs de retour. Ça y est, sa tente est repérée. Il est lui aussi allongé, un enfant assis contre lui. La scène est douce, on aurait presque envie de repartir sans le déranger. Ou plutôt de le rejoindre sur son tapis poussiéreux pour l’écouter dévider son histoire, de s’allonger, de mâcher et de boire du café, de respirer difficilement à cause de la chaleur, de sentir un filet de sueur couler entre les omoplates et de frémir en sentant la fraîcheur infime quand la brise le fait s’évaporer... Au lieu de cela, mon collègue lui dit de monter dans la voiture pour aller se mettre dans un endroit plus confortable. L’envie me passe par la tête de le contredire et de sauter hors de la voiture pour aller me coucher d’office sous l’auvent. Mais je n’en fais rien. Je me dis, un peu condescendent, que le chef sera peut-être content de passer quelque temps dans l’atmosphère réfrigérée d’un des bureaux de l’administration du camp. L’homme vient donc s’asseoir à nos côtés et nous voilà repartis. J’aurais à peine eu le temps d’ouvrir la fenêtre pour sentir l’air brûlant se jeter à mon visage. Que ce soit ici ou en Haïti, et encore plus à Bagdad, je serai toujours le blanc dans la voiture blanche marquée des deux lettres noires.
Les mots se courent les uns après les autres sur les pages de mon cahier. Mon stylo s’épuise. Cet homme est une vraie mine d’informations. Nous remontons à ses côtés la triste histoire du conflit de Sa’ada, mêlant pauvreté, illumination religieuse, histoire millénaire (impliquant, comme toujours dans cette région du monde, des descendants directs du Prophète) et magouilles de trafiquants d’armes. Sans compter les massacres et les morts d’innocents. Les bombardements par l’armée saoudienne - qui feraient passer l’armée israélienne pour des enfants de chœur, car tout y est passé, hôpitaux, écoles, maisons, marchés - succèdent aux dérives d’une secte d’illuminés, les Houthis, sorte de talibans locaux, qui ont réussi en quelques années à défaire l’armée yéménite (ce qui n’est pas forcément un grand fait militaire vu son piteux état) et à imposer leur loi de fer sur ces marges déshéritées de l’Arabie Heureuse. Les Houthis ont aussi la bonne idée d’appartenir à une secte chiite (les Zayidites) - enfin certains diront qu’ils sont moins chiites que certaines sectes sunnites, mais allez donc y comprendre quelque chose à ces ramifications sans fin de la foi musulmane -, ce qui, à deux encâblures du fief wahabite qu’est l’Arabie Saoudite, n’est de pas très bon goût. Les Zayidites ont régné sur le Yémen pendant mille ans, avant d’être détrônés par la république en 1962. Ils ne l’ont jamais avalé et un jour, à l’occasion d’une énième vexation de la part d’un gouvernement arrogant et corrompu, ils ont pris les armes. Petit à petit, le conflit est passé de local à national puis régional, bientôt international puisque les rumeurs vont bon train sur une assistance de l’Iran et du Hezbollah à ces fantassins d’un ordre sévère. Les complexités du conflit nécessiteraient des semaines de recherche, un travail de fourmi. Nous n’avons que quelques heures. Ces paroles recueillies à la va-vite vont servir à bâtir des hypothèses, qui seront à la base de programmes d’aides divers et variés qui eux-mêmes attireront des financements de bailleurs de fonds tout ça pour... eh bien soi-disant pour aider à rétablir la paix et permettre à ce pauvre chef de village et aux siens en exil depuis trois longues années, de rentrer chez eux, de réintégrer leurs maisons de pisé aux contours de fenêtres décorés de chaux, de refertiliser leur terre, de cueillir à nouveau les grenades poussant dans leurs jardins luxuriants et de relancer leurs troupeaux de chèvres à l’assaut du mont Razzeh, 3 650 mètres d’altitude - pas si loin d’ici, et pourtant si loin de nous, car au sein du territoire fièrement défendu par ces satanés Houthis... Si je n’y prenais garde, je croirais soudain que ma frénésie d’écriture sur la table bancale de ce bureau dénudé puisse déclencher une série d’effets menant à la résolution d’un conflit millénaire. Je relève la tête de mon cahier, rencontre le regard bienveillant mais un peu circonspect du chef de village et comprends que rien ne changera probablement dans les jours ou les mois qui viennent - et allez savoir si les années ne s’en mêleront pas aussi...

Je finis par me dégager du siphon du questionnement sans fin, de la recherche de la vérité vraie, de cette volonté d’aller jusqu’au cœur de l’atome de ce conflit d’un autre âge, engoncé dans les territoires impénétrables du nord du Yémen, dans ces wadis profonds et fertiles dominés par des escarpements sévères auxquels s’accrochent des villages de pierre et de pisé sortis des Mille et Une Nuits. Comme dans tout conflit, la vérité n’existe pas. Il s’agit juste de la confrontation de deux visions du monde et des événements qui l’émaillent. Chacun tient sa vérité comme dernier rempart contre la défaite et l’annihilation. Comme il est trop dangereux, paraît-il, d’aller bavarder avec ces farouches Houthis, je n’aurais accès qu’à un seul côté de la médaille. À moi de romancer ce que l’autre côté pourrait être, et j’aurai là mon rapport, le fruit de mon labeur, la contrepartie de mon salaire. Car je suis ici avant tout pour gagner ma vie, à défaut de pouvoir changer celle des autres. Les choses sont claires, de plus en plus claires, et donc plus vivables, pour tout le monde. Je sens une forte empathie pour ce pauvre chef de village, pour sa dignité qui perce sous sa mine un peu négligée, pour son découragement qui semble chercher dans mes questions une nouvelle raison d’espérer que les choses vont peut être changer.
J’aimerais pouvoir le prendre dans ma voiture et le ramener chez lui, parler avec ces Houthis, mâcher le qat en leur compagnie et les ramener à la raison. Pourquoi vous entretuer ? Pourquoi empêcher les femmes d’exposer ne serait-ce que le bout de leur nez au message bienfaiteur du soleil ? Pourquoi donner une carabine à vos adolescents plutôt que la promesse de flirts enivrants au bord des wadis remplis de lauriers roses ? Pourquoi faire remonter à la surface de ce XXIe siècle des schismes et des vexations suintant de la nuit des temps ? La terre du Yémen est généreuse, son ciel encore plus, ne perdez pas de temps à essayer de rendre les gens parfaits, les humains sont faits pour pécher... Oui, de l’empathie, et une forte envie d’aller me perdre dans ces montagnes qui nous barrent l’horizon, d’aller me coucher sur l’encolure de cette frontière inconnue pour continuer à croire que la sagesse est à portée de main des hommes...
Le qat s’est éteint. Les sacs sont vides. Les paroles se sont tues. Chacun vaque à ses chimères, la lucidité l’emporte. Le monde est lisse, nos vies aussi. Pour quelques heures encore, les conflits s’effacent devant la simplicité de l’existence. Nous sommes ici pour vivre, n’est-ce pas ? Harradh devient une étape lumineuse dans ma progression vers je ne sais quelle sagesse dont la promesse n’a jamais été aussi prégnante. Peu importe la détresse qui nous assaille dès la sortie de l’hôtel, les mendiants accrochés aux fenêtres, les déplacés qui croupissent sous leurs tentes, la vie continue, satisfaite d’attraper, par inadvertance, des moments solaires, des sourires d’enfants, au détour d’un camp de déplacés ou d’une ruelle de bidonvilles, ou sur les plages de mon enfance.