


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


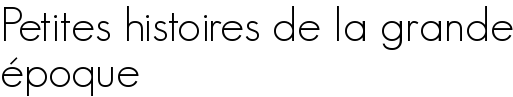
Un entretien avec Walter Lewino réalisé rue Greneta (Paris) le dimanche 18 avril 2010 par Raphaël Meltz.
Vous avez travaillé dans une dizaine de journaux différents, à de nombreux postes. Comment qualifieriezvous votre parcours ?
J’ai une formule, qui vaut ce que les formules valent. Je dis toujours : je suis trop mégalo pour être arriviste. C’est pour ça que je me suis bien débrouillé dans la presse. Dès le départ, il était évident que je ne cherchais pas le pouvoir. Ou alors je cherchais mon petit pouvoir : dans tous les journaux où j’ai travaillé, j’ai formé mon petit groupe, où personne n’est venu m’embêter. J’avais mon coin, avec les gens qui travaillaient pour moi. Je faisais ce que je voulais. Et personne ne m’embêtait, parce que je ne cherchais pas à avoir une autre place. À un moment, au Nouvel Obs, Jean Daniel m’avait dit : « Lewino, il faudrait que vous preniez la partie littéraire. » J’ai répondu : « Non, ça ne m’intéresse pas. »
Dans les années 1950, vous avez été correcteur à Combat, à Arts, à L’Équipe. Comment, techniquement, cela fonctionnait-il ?
Le journaliste amenait son papier à une dactylo, qui le tapait. Il y avait très peu de journalistes qui savaient se servir d’une machine à écrire. Souvent même le manuscrit allait directement à l’imprimerie. C’était le typo qui relisait et qui composait l’article. Sur une machine linotypiste. Le clavier n’était pas du tout comme celui d’une machine à écrire. On tapait les mots d’un seul geste : par exemple, -ent, c’est un geste. C’était une espèce de danse. Mais il y avait pas mal d’erreurs, c’est pour ça qu’il fallait beaucoup de correcteurs. Dans la lino, il y avait des petites matrices en cuivre, lettre par lettre, dans la partie haute de la machine, et quand un gars tapait sur le « l », il y avait une espèce de code comme une serrure, la lettre « l » tombait et venait se mettre contre le creuset de plomb. Le typo tapait toute la ligne, les lettres se mettaient côte à côte, une espèce de pince les attrapait, et les plaçait contre le creuset de plomb. Aussitôt que les lignes de plomb étaient sorties de la linotypie, elles étaient rassemblées par un gars ; un coup de rouleau d’encre, du papier mouillé, et on tapait dessus avec une brosse. On tapait souvent deux épreuves, une pour la rédaction, une pour les correcteurs. Les correcteurs recevaient ça, en même temps que l’original, et on comparait. Parfois, on changeait, quand c’était mal écrit. Ça dépendait, bien sûr : si on avait affaire à une signature, on ne s’amusait pas à changer le style. Mais on pouvait arranger. Ça dépendait
des correcteurs. Moi, à Arts, à la fin, je réécrivais les papiers.
On dit qu’historiquement, les ouvriers du livre étaient l’aristocratie de la classe ouvrière.
Oui, c’était des intellectuels. De mon temps, c’était déjà un peu fini. Les anciens typos ou correcteurs s’habillaient autrement que les ouvriers ; ils mettaient un chapeau plutôt qu’une casquette. Mais les correcteurs ont toujours été des rigolos. Je me rappelle du grand surréaliste Benjamin Péret, qui gagnait très bien sa vie comme correcteur. Lui, tout ce qui était sport, il signait sans lire. Il disait : « C’est des conneries, ça on s’en fout. Les sportifs, ils savent pas lire ! » Pour devenir correcteur, il fallait avoir un copain. Le syndicat du Livre était le seul à fonctionner avec une convention totalement illégale : ne pouvaient travailler dans les imprimeries que les gens syndiqués au Livre. C’était le contrôle de l’embauche. Ça arrangeait les patrons, parce qu’ils pouvaient changer au dernier moment le nombre de pages du journal. Un gars qui avait déjà fait un service quelque part venait faire un deuxième service : le syndicat le faisait venir. À L’Équipe, j’arrivais à 21 heures ; ça s’arrêtait à 23 heures, la première édition était bouclée. On allait au bistrot ; puis je revenais pendant une heure jusqu’à une heure du matin, au cas où des résultats sportifs tombaient. J’ai travaillé aussi au Journal officiel, c’était plus sérieux. C’était quai Voltaire. Il y avait un gars qui habitait dans l’île Saint-Louis, et il venait travailler en barque — les gens avaient des barques ! Pour venir, ça allait, mais pour repartir, quand il avait des courants... Il travaillait de nuit. Et il y avait deux ou trois bistrots qui étaient ouverts sur sa route, alors il s’arrêtait. Il finissait beurré, paraît-il. Correcteur, c’était une bonne combine, le métier n’était pas trop dur, quatre heures, quatre heures et demie de travail tous les soirs. Quand j’ai commencé, la retraite n’existait pas. On employait toujours quelques vieux typos, qui continuaient à travailler, mais qui faisaient d’autres boulots. Il y en avait un dont le seul boulot était d’aller au PMU jouer les paris des autres. Il faisait partie de l’équipe. Le patron disait : « Je préfère que ce soit toi qui fasses ça, plutôt que les autres descendent tout le temps pour aller faire leurs jeux. » Il y en avait un autre qui passait les rouleaux, parce qu’il était trop vieux pour la lino. J’étais à Combat quand la retraite est arrivée. Les gars de plus de soixante-cinq ans ont dû s’arrêter de travailler du jour au lendemain. Le chef correcteur, il n’a pas voulu partir. Il est revenu le lendemain. Il est revenu pendant huit jours. Il ne voulait pas partir ; il a fallu lui supprimer sa chaise. Il disait : « Mais je suis parfaitement capable de travailler ! »
Vous avez aussi travaillé à Arts.
Oui, le journal avait de l’importance intellectuellement. Il a été dirigé assez longtemps par Pauwels, puis par Jacques Laurent. Là j’ai fréquenté Nimier, Nourissier, Bernard Frank, tous les hussards antiSartre. Truffaut était chroniqueur de cinéma. J’ai le souvenir que Jacques Laurent en voulait aux Goncourt, et il avait demandé à Georges Arnaud, le gars du Salaire de la Peur, dont ce n’est pas le vrai nom du reste, de faire un papier contre le jury du Goncourt, en les démolissant. Mais il y avait à ce moment-là Giono au jury et Jacques Laurent, pour une raison quelconque, ne voulait pas qu’on dise du mal de Giono. Il avait donc rectifié la prose de Georges Arnaud. Et Georges Arnaud, à qui on avait amené les épreuves, je le vois débarquer, cette espèce de grand fou, avec ses moustaches rouquines, cherchant partout Jacques Laurent pour lui casser la gueule. Jacques Laurent s’était vraiment mis à quatre pattes sous une chaise. « Je vais lui faire voir, Giono c’est un con comme les autres ! », criait Georges Arnaud. C’est toujours un peu nostalgique, les souvenirs, c’était un peu ça, la presse de l’époque, il y avait une sorte de liberté, d’engueulade. C’était un journal où il y avait des polémiques à n’en plus finir...
Pourquoi vous n’avez pas continué comme correcteur ?
Parce que j’ai été attiré par des copains, qui considéraient que... Correcteur, c’est considéré comme... Beaucoup de correcteurs sont des journalistes refoulés. Il faut les entendre critiquer les journalistes : « Oh ! Il ne sait pas comment s’écrit tel mot ! Quel con ce mec », en parlant de quelqu’un qui a une plume formidable. Pas tous, bien sûr. Il y a les rigolos, dont je faisais partie, qui ont un peu la tête ailleurs, et il y a les mecs qui s’enferment dans une espèce de déprime. On ne voit que les conneries qu’ils laissent, jamais ce qu’ils rattrapent. Alors souvent il y a une sorte d’indifférence qui se crée dans ce milieulà. Beaucoup ont un autre métier à côté. Maintenant, je ne sais plus comment c’est... Donc j’étais copain avec le directeur artistique de Arts, Anesse, qui m’a traîné dans un autre petit journal. Je n’y suis pas resté, je suis entré à France Observateur. C’était pendant la guerre d’Algérie. Il y avait des gens comme Suffert, Nourissier, Revel, Bernard Frank, qui ont tourné différemment ensuite... J’étais très ami avec Hector de Galard, qui était une sorte de marquis rouge, une des plus vieilles familles de France, il m’appréciait beaucoup, c’est comme ça que j’ai pu revenir au Nouvel Observateur des années après.
Que faisiez-vous à France Observateur ?
J’étais une sorte de secrétaire général de la rédaction. Il y avait Claude Bourdet, qui était un fou, un fou talentueux. Il n’a jamais voulu admettre que de Gaulle avait fait la paix en Algérie, il continuait à penser que c’était faux. Pour lui, ce n’était pas possible. Du coup, toute la rédaction était en conflit avec Bourdet, parce qu’on avait bien été obligés de reconnaître que de Gaulle n’était pas l’épouvantable fasciste qui avait été décrit au départ, et que finalement il avait fait la paix en Algérie. Bourdet était absolument contre, il nous sortait des documents comme quoi on avait rien compris, comme quoi l’OAS et lui étaient de mèche. Il venait, dictait à une secrétaire son papier, qui était publié comme une sorte de tribune libre alors qu’il était le directeur... Un jour, en 1962, coup de téléphone de Bourdet, qui nous dit : « Est-ce que ça tire, aussi, chez vous ? » Il nous décrit les bruits de mitrailleuses qu’il entend de chez lui : « J’ai reconnu tel modèle de mitrailleuse israélienne. » Et donc il triomphait, sur le mode « On s’est disputés mais vous voyez que j’ai raison, ça y est l’OAS débarque, l’armée débarque ». Ça avait été un très grand résistant, et pour lui la résistance recommençait. « Ça tire chez vous ? » On ouvre la fenêtre : « Pas du tout. — Attention, ils vont venir ! Je reste au poste, ma femme est partie aux nouvelles. » Plus tard, des gars nous rejoignent au bureau, on leur demande, un type nous dit : « Oui oui, à la Tour Eiffel, ils tirent un feu d’artifice pour le lancement du film Le Jour le plus long. »
Vous êtes partis au moment du rachat du
journal par Claude Perdriel et de l’arrivée de Jean Daniel.
À la fin, France Obs’ se vendait très mal : la guerre d’Algérie, qui était sa raison d’être, était terminée ; Bourdet n’y était plus, ça devenait une feuille de chou. Et les gars qui avaient une signature, ou qui étaient bons, ne voulaient plus travailler là-dedans. Il n’y avait plus personne, j’étais quasiment le seul, il n’y avait plus que des pigistes ! Martinet, qui était le patron du journal, était en pleine discussion pour se vendre à Perdriel, qui a fait venir Jean Daniel. Moi j’allais démissionner, Daniel était embêté, parce que j’avais une réputation... que je mesurais mal : j’étais un héros de la guerre. Je ne comprenais pas beaucoup pourquoi, juste après la guerre, des gens comme Georges Braque m’invitaient à bouffer, me parlaient, alors que j’avais repris mes études pour passer mon bac... Il y avait un côté que je comprenais mal... C’est comme mon cancer maintenant, j’en suis à mon deuxième cancer, bon, c’est un cancer. Je vois les mecs, aussitôt qu’ils ont un cancer, ils en font trois cents pages... peut-être intéressantes, du reste. Je ne me vois pas écrivant là-dessus. Qu’est-ce que je pourrais dire, j’en ai rien à foutre, de ce cancer... Ces connards, avec leur chimiothérapie, ils ont transformé mes cheveux en une espèce de duvet, comme un poussin... Mais je m’en fous !
En 1967, vous avez publié chez Albin Michel L’Éclat et la Blancheur, un roman entièrement composé de textes détournés.
Un énorme succès d’estime, mais les ventes ont été modestes, cinq ou six mille. C’était un livre de collages, qui raconte la vie d’un Français moyen, avec des fragments de publicité. Ça commence par une petite annonce. Je récupérais des textes, et je transformais « faites ceci, faites cela » en « il fait ceci, il fait cela ». Il n’y a pas que de la publicité, il y a tout dedans, des phrases de magazine, des livres pratiques. Guy Debord m’avait dit : « Pour votre bouquin, il faudrait trouver un titre de slogan. » J’avais voulu l’appeler La Lumineuse fraîcheur du teint scandinave, qui était le slogan d’une crème pour bonnes femmes très renommée à l’époque. Mais j’avais demandé à la marque, et ils avaient refusé. Alors j’ai inventé un slogan, « L’éclat et la blancheur ».
Avec le photographe Jo Schnapp, vous avez publié l’un
des premiers livres de photos des graffitis de mai 68 : L’Imagination au
pouvoir.
J’ai donné la moitié des droits d’auteur au groupe de
l’Internationale situationniste, puisqu’ils étaient les auteurs ou les
inspirateurs de la plupart des slogans. J’ai reçu une lettre signée par
tout le groupe : « Camarade Lewino, Merci pour la phynance. Sans temps
mort, sans entraves. » Ça ne leur a pas fait énormément de fric, mais
j’ai partagé. Mai 68, pour moi, c’est simple : j’avais quarantequatre
ans, à l’époque. J’habitais dans le Ve arrondissement. Un jour, je
revenais à vélo, je descendais la rue Saint-Jacques. Cohn-Bendit et les
autres « enragés de Nanterre » étaient convoqués à la Sorbonne pour le
conseil de discipline. Et là qu’est-ce que je vois ? Une troupe de flics,
ou de CRS, devant le musée de Cluny, et une bande de jeunes gars,
garçons et filles mélangés, un peu en blue-jeans, qui s’approchent avec
des cailloux, qui leur lancent, et hop, qui partent comme des moineaux.
Je me dis : « Tiens : qu’est-ce qui se passe ? » J’ai su qu’il y avait une
manifestation le lundi suivant, j’y suis allé ; et là j’ai vu qu’il y
avait un gars avec une bombe de peinture qui était camouflé pour ne pas
se faire repérer — il avait un mouchoir sur le visage. Avec sa bombe, il
écrivait des slogans. Le premier que j’ai repéré, c’était « Jouir sans
entraves », qui vient de la brochure de Khayati, je crois, De la misère
en milieu étudiant. Partout le gars, avec sa bombe, il mettait des
slogans. Là je me suis dit : « Mais c’est formidable, il faut les
photographier aussitôt. »
Et c’était qui, ce type ?
C’était Christian Sebastiani, un sympathisant, fanatique, de l’IS. Rien ne l’arrêtait ! Plus tard il m’a expliqué l’origine des slogans. Alors par exemple « Baisse-toi et broute », qui était sur les escaliers de la Sorbonne, et qui a tellement marqué, il m’a dit : « C’était un gars qui était à une réunion, il avait dit ça, on ne sait pas pourquoi, et ça m’était resté dans la tête. » Je lui avais demandé : « Tu les trouvais où les bombes ? » Il m’a répondu : « Je vais tout t’avouer. À l’origine, je ne voulais pas écrire des trucs. Un con m’avait dit : “Tu prends les bombes, tu les secoues, tu les jettes sur les flics, ça explose.” Alors j’en ai piqué chez un marchand, je les ai ramassées en lui disant : “Nous fais pas chier”, j’en avais un plein sac, et puis quand j’en ai eu lancé deux ou trois, je me suis aperçu que ça explosait pas du tout. Et comme il ne se passait pas grand-chose, j’ai vu que c’était marrant d’écrire, j’en ai profité pour écrire ce que j’avais dans la tête. » Ensuite j’ai revu Debord, après la sortie du livre, pour qu’il m’explique l’origine des slogans. J’en ai fait un papier dans Combat. Par exemple, à propos du fameux « Ça saigne », Sebastiani m’avait dit : « Celui-là ce n’est pas moi qui l’ait fait, c’était là bien avant mai 68, c’était lors d’une première manif, et c’était resté là, ç’avait pas été effacé. »
Vous gardez quel souvenir de Debord ?
Debord, je n’étais pas intime avec lui. J’étais surtout très lié à sa femme, Michèle Bernstein. On habitait juste à côté. Des fois, elle faisait du borchtch à la russe, que je ramenais à la maison. Elle avait publié Tous les chevaux du roi. Pfff... C’est pas exceptionnel... C’était une sorte de parodie des bouquins à la Sagan. Après, elle a sorti un deuxième bouquin sur le même thème, chiant comme tout, qui s’appelait La Nuit. Une parodie de Sagan, c’était amusant, mais une parodie du nouveau roman... Le nouveau roman, déjà c’est chiant, mais alors la parodie du nouveau roman ! Debord, je l’ai vu souvent, mais on était un petit peu sur la réserve. On se vouvoyait. À l’époque, je ne buvais pas... Or pour être copain avec Debord, il fallait un peu se saouler la gueule ; il buvait plus ou moins le Ricard pur... Ce que je savais de Debord, c’était par Bernstein, qui me racontait beaucoup de choses. Elle a toujours eu beaucoup d’influence sur lui. Même quand elle ne faisait plus partie des situs, parce qu’il l’avait virée, quand il s’est mis à virer tout le monde, elle était toujours dans le coup, ils rigolaient tous les deux : « Allez, on va virer Vaneigem. Allez, vas-y. » Bernstein, rien ne l’arrêtait, c’était une rigolote, assez cynique, très cultivée... Elle était surtout dans l’humour, dans la plaisanterie. Et Debord, au départ, c’était un peu ça, le mouvement situationniste travaillait énormément dans l’humour et l’esthétisme. Puis, peu à peu, c’est devenu une arme de guerre pseudo-révolutionnaire. Debord s’est pris de plus en plus au sérieux... Je ne dis pas qu’il avait tort.
Vous avez aussi travaillé pour la presse hippique.
Je n’étais pas bien payé à France Observateur, alors je travaillais à Week-end pour me refaire du fric. Je faisais l’Almanach du tiercé, qui sortait une fois par an. C’est là que j’ai rencontré Bernstein, qui était secrétaire. Sur une de ses idées, j’ai inventé une méthode, « l’autopsie du tiercé », qui doit toujours exister. C’est un classement au mérite des chevaux. Je ne suis quasiment jamais allé sur un champ de courses... Le milieu est horrible. Il y a messieurs les entraîneurs, messieurs les propriétaires... Je faisais mes statistiques avec des archives. J’étais le mathématicien du tiercé. En comparant systématiquement les courses précédentes, les distances, les terrains, les poids, sans réfléchir, avec des règles mécaniques, j’étais arrivé à un classement souvent assez conforme aux pronostics généraux. Des mecs qu’on appelait les « méthodistes », qui parient avec des méthodes, se servaient de ça. J’avais établi que si on joue systématiquement certains trucs, il n’y avait que deux cas où on n’était pas toujours perdant. Si on jouait systématiquement les trois ans qui viennent de gagner par plus de trois longueurs, sur dix ans ça s’équilibrait... L’autre truc, c’était du temps où le grand jockey s’appelait Saint-Martin : il fallait jouer Saint-Martin s’il montait un cheval pour la première fois. Ce qui était logique, parce que quand un entraîneur avait la monte de Saint-Martin, c’était pas pour lui donner un tocard. Quand j’ai été viré de Week-end après mai 68, il y a eu des centaines de lettres de protestation. Parce que tous les méthodistes, ça coupait leur système ! Et puis, j’ai eu envie de replonger dans la presse normale, j’en avais marre d’être un faux journaliste hippique. Je suis devenu rédacteur en chef technique à L’Express, puis je suis allé au Point. Je me suis occupé du « Guide du Point ». C’était les huit premières pages, un peu comme le « Rendez-vous du Nouvel Observateur », une partie consommation, et une partie culturelle.
On dit toujours que le succès
des news magazines, Le Nouvel Obs, L’Express, Le Point, dans ces
années-là, les années 1970, cela correspond au triomphe de la société de
consommation. Est-ce que vous vous retrouviez là-dedans ?
Moi, non, mais il est évident que... Par exemple, les jeux du Point ont contribué à sauver le journal. J’avais reçu un livre d’un psychologue anglais avec des tests de QI, qui n’avait eu aucun succès. J’ai retrouvé le livre, et proposé à l’éditeur de publier les premiers QI dans la presse. Ce qui a en effet particulièrement convenu aux jeunes cadres dynamiques. Il paraît qu’ils se rencontraient en se disant : « Comment ça va, 132 ? », « Comment ça va, 148 ? »... Après j’ai continué à faire des QI, je les faisais faire par un centralien complètement fou, qui faisait ça admirablement. Et pour les étalonner, je les testais sur une vingtaine de personnes dans le journal. Pour voir la difficulté. Ce n’était pas du vrai QI, il y avait un peu de connaissance, alors que le vrai QI c’est de la pure logique. Ça établissait la hiérarchie du Point : Imbert, le rédacteur en chef, avait une très bonne note. Suffert au contraire avait moins de 100 ; ça ne m’étonnait pas, parce que Suffert était un fou, un imaginatif, mais il n’avait aucune logique. Le Point était soutenu par Hachette pour concurrencer L’Express. Au bout de quelques mois, au printemps 1974, ça allait très mal, le journal ne marchait pas. Hachette leur a dit : « On en discute à la rentrée, on verra si on met la clé sous la porte ou pas. » Alors ils se sont réunis entre eux, les chefs, pour trouver quelqu’un, une idée. Ils se sont dit : « On va demander à Lewino, l’imaginatif du coin, voir s’il n’a pas une idée. » J’ai dit que je voulais bien faire des jeux, en exigeant que ce soit au milieu du journal, sur huit pages, un cahier détachable, d’une autre couleur, pour qu’ils se voient bien. Ce qui m’a sauvé, c’est que Imbert, le rédacteur en chef, était absolument contre : « On va être complètement ridicules, les gens de L’Express vont rigoler, on va être comme les journaux populaires, comme les féminins. En tout cas, je ne m’en occupe pas, je ne veux pas être responsable de ces conneries. » Et plus personne n’a contrôlé ce que je faisais. Ils ont embauché des jeunes qui allaient faire de la publicité sur les plages, en donnant des T-shirts avec les jeux du Point, le truc de promotion habituel. Quand ils ont vu les gens de Hachette en septembre, ils ont montré les chiffres de juillet, d’août : c’était reparti. Mais ils se sont bien gardés de dire que c’était les jeux !
Vous vous êtes ensuite spécialisé dans les jeux d’été ?
Quand je suis retourné au Nouvel Obs en 1978, j’ai fait un truc qui a eu beaucoup de succès. C’était un concours de devoirs de vacances. Par exemple : « Marcel Proust et Poulidor sont dans un wagon de chemin de fer. Imaginez leur conversation. » Ou : « Connaissez-vous un imbécile ? Décrivez-le. » Ou encore : « Un soir, on frappe à votre porte, c’est Mesrine. Que faites-vous, que se passe-t-il ? » Ou : « Discours de Jean-Jacques Rousseau protestant pour qu’on ne mette pas ses cendres au musée Pompidou. » Il y avait une journaliste politique qui, quand elle avait vu le test, avait dit : « On ne peut pas laisser la question sur Poulidor et Marcel Proust. Tout le monde va rigoler : Poulidor la pédale, et Marcel Proust l’homosexuel. » Le complexe de gauche... Alors Galard, qui était très chrétien de gauche, vient me voir : « Ça m’embête, elle dit que tout le monde va rigoler. » Alors j’ai enlevé Poulidor... Et j’ai mis Sheila, la chanteuse, à la place. Qui passait pour être un mec, du reste ! Les gens devaient faire le devoir, en trois pages, et le renvoyer au journal. On a reçu 2500 réponses. Une femme avait eu un prix sur l’imbécile, elle avait décrit son mari : c’était à la fois critique et plein de tendresse. Comme on publiait les six meilleurs, on le passe dans le journal. Et là, drame : elle m’appelle. « Vous avez mis mon nom ! — Oui, comme vous avez eu un prix, on devait publier votre nom. » La belle-famille ! Ça avait fait un scandale...
C’est la période où vous avez créé vos tests les plus célèbres.
Au Point, un directeur m’avait dit : « Lewino, on a commandé un sondage sur des hommes politiques en portrait chinois, on a demandé aux gens d’associer Marchais, Mitterand, Giscard, Servan-Schreiber, etc., à des animaux. On a le résultat, mais on ne sait pas quoi en faire... Est-ce que tu ne peux pas le récupérer pour faire un jeu, ou un test ? » J’ai dit : « Pourquoi pas. » J’ai reçu le résultat détaillé. Et j’ai fait un test, « Êtes-vous de gauche ou de droite », mais c’était difficile, j’avais du mal à trouver des bonnes questions, ça ne marchait pas très bien. Mais j’avais toujours l’idée qu’on pouvait faire un bon test sur ce thème. L’été 1980, j’ai proposé ça au Nouvel Obs. Hector de Galard, toujours inquiet, m’a fait signer un papier comme quoi j’en prenais la responsabilité. On en parle à Jean Daniel, qui part en vacances en disant d’accord. Hector me dit : « On va l’appeler “Test mystère” — Oui, mais le résultat, ça sera “Êtes-vous de droite ou de gauche”. » Lui : « D’accord, mais pas sur la première page. » Alors ça s’est appelé « Test mystère », on ne sait pas pourquoi, et dans les résultats on comprenait que c’était « Êtes-vous de droite ou de gauche ». Jean Daniel le reçoit en vacances, et il explose : « C’est quand même pas Lewino qui va décider si je suis de droite ou de gauche ! » Sa fille Sara, qui avait dix-huit ans, lui a fait faire. Et il se retrouve dans la gauche, mouvance Michel Rocard, le difficile mélange entre l’efficacité et le réalisme, quelque chose comme ça. C’était tout à fait ça ! Du coup, il a été ravi.
Vous vous y étiez pris comment ?
J’écrivais mes trente questions, dont aucune n’était directement politique. Je partais du principe que tout est politique. Je proposais six réponses d’égale intensité, pas comme les tests qu’on fait pour se marrer, où les réponses sont rigolotes, mais dont aucune ne convient vraiment. Moi, c’était : « Vous offrez un costume à Michel Rocard. Cowboy ? Scout ? Curé ? etc. » La dernière question, c’était : « Quel fromage préférez-vous ? » J’avais pris des fromages importants, camembert, roquefort, fromage de chèvre, etc, sans savoir ce que ça allait révéler. J’ai fait passer le questionnaire à soixante personnes dont on savait qu’elles étaient de sensibilité de gauche — parmi des personnes du type des lecteurs de l’Obs, parce que dans les campagnes, il n’y aurait pas eu les mêmes résultats. Pareil pour soixante personnalités de droite, et j’en ai gardé soixante au centre, pour le contrôle. Puis j’ai mis en fiches, et voilà. Par exemple : les gens de droite ont préféré statistiquement le camembert. Après, bien sûr, il y a de la magouille journalistique pour les mouvances... C’est comme ça qu’on établit les tests psychologiques, c’est purement statistique. Le Rorschach a été fait sur 100 000 personnes plus ou moins névrosées, et on a déterminé des constantes. Même le test « Êtes-vous une salope ? », que j’ai fait pour Elle, à leur demande, je l’ai fait comme ça. Il y avait une petite salope, une grosse salope, une pas salope du tout, « salope » étant pris dans le sens sexualisé. Ça a eu un succès fou, mais il y a eu des lettres de protestation, des désabonnements. Là encore, les questions, quand je les ai faites au départ, je n’avais pas d’a priori. Par exemple : « Vous surprenez votre mari en train de s’exhiber sur le balcon, qu’est-ce que vous faites ? Vous rigolez ? Vous l’engueulez ? Vous faites de même ? Vous menacez d’appeler les flics ? Vous lui lancez un seau d’eau ? » On peut penser que si « vous faites de même », c’est que vous êtes une salope, mais ce n’est pas sûr. Après je faisais passer les questions à des filles, je leur demandais... Le problème, c’est qu’à la fin, je n’avais plus personne à tester. Parce que quand j’établissais mes statistiques, les gens qui faisaient le test n’avaient pas le résultat. Ils me demandaient : « Qu’est-ce que je suis ? » Je leur disais un truc bidon, pour les soulager, pour qu’ils recommencent après, mais au bout d’un moment...
C’était théorisé, cette façon de faire ?
Non, c’est sorti de ma tête. Je n’ai pas pris de livres, je n’ai pas regardé. Je m’en fous, tout sort de ma tête. Du reste, je crois de moins en moins à la connaissance et à la formation, et de plus en plus à l’imaginaire. Je crois qu’on crève de la connaissance. Je pense qu’il faut arrêter les crédits à la recherche. Tous ces spécialistes qui se bousculent au portillon ! Mais ce n’est rien : il n’y a pas d’imaginaire. J’ai une formule : « Un philosophe qui n’a pas d’idées, on fait un livre. Un philosophe qui a une idée, on fait une école. »
Vous avez écrit un roman, Fucking Fernand, qui a été adapté au cinéma.
Il est cité comme exemple comme le film qui n’a eu aucun succès en salle, et qui a pas mal marché à la télévision. Ils sont en effet partis de mon bouquin... C’est mon seul rapport avec le cinéma. Ah la vache ! Moi je trouvais ça con de faire un film avec ça. J’avais d’autres idées, meilleures, pour des films. Ils ont payé Jean Aurenche, très cher, pour faire le scénario. Ensuite ils ont retravaillé dessus. La productrice trouve Paul Vecchiali comme metteur en scène. On mange ensemble... J’ai vu ce que c’était le cinoche. On discute de savoir qui va jouer dans le film. Vecchiali dit : « Je crois que je peux avoir un contact avec Paul Newman. Et si Newman est d’accord, je suis sûr que Brando acceptera de faire l’autre. » À la fin du repas, mon film était fait par Newman et Brando ! J’avais du mal à y croire. Je me suis dit : « T’es peut-être un con, Lewino, tu ne connais pas le monde du cinéma, pourquoi pas ? » Finalement ça été Jean Yanne, et Thierry Lhermitte ! Et c’est pas Vecchiali qui l’a tourné... Ils ont repris des situations, mais ce n’est plus la même histoire. Le film, je ne suis même pas allé à la première, je l’ai vu à la télé.
Vous êtes à la retraite depuis un long moment, et vous n’avez jamais arrêté de travailler...
J’écris des trucs, je les envoie aux éditeurs, ils ne me répondent pas, mais je m’en occupe à peine, parce que j’ai tellement l’angoisse du temps qui passe, tellement peu d’années encore à vivre, et tellement d’idées qui se trimballent encore dans ma tête, que je préfère faire des choses que de me préoccuper de ce qui est terminé.