


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


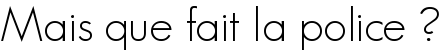
 |
|
|
Publié dans le
numéro 30 (mars-avril 2009)
|
— Les malfaisants, les pünks, si vous êtes là, du calme, parce que nous sommes des vigiles !
(ouaf, ouaf !)
— du calme, Schopenhauer ! [...] Car n’est pas vigile qui veut, monsieur !
(Sketch des Inconnus)
[Lire également : Cap 250.000 vigiles.]
Il était une fois une époque où la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, l’Estonie, la Lituanie montraient la voie. « La France en retard sur ses voisins européens », titrait Le Figaro (13 décembre 2008). Quoi ? Le post-communisme serait-il à la mode au sein de la rédaction dudit journal ? Il faut le croire : puisque ce « retard », c’est le fait que nous n’ayions pas, comme en Hongrie ou en Pologne, des agents de sécurité (ou « APS », entendez : les vigiles) qui soient plus de deux fois plus nombreux que la force publique (entendez : les policiers et gendarmes). Voici comment on en est arrivés là. Et voici pourquoi il est temps de faire marche arrière. Car oui, pour votre sécurité (intellectuelle), c’est encore possible.
Plutôt qu’une simple diatribe somme toute assez attendue contre l’État sécuritaire, où les vigiles seraient d’emblée vilipendés en tant qu’élément apparu de concert avec les tests ADN, Edvige, etc. [1], nous avons choisi de privilégier une approche historique et sociologique, moins manichéenne de prime abord — pour mieux critiquer l’évolution en cours depuis les trente dernières années. On ne peut en effet comprendre la privatisation de la sécurité sans se pencher sur l’histoire de la police. Un vigile, pourquoi ? Pour surveiller. Oui mais pourquoi un vigile, hein ? Que fait la police ?
***
La sécurité privée recouvre un large panel d’activités : la surveillance des biens, le transport de fonds, la protection des personnes, le contrôle d’accès ou la conception, l’installation et la gestion des centrales d’alarme. C’est la surveillance humaine qui représente actuellement l’activité la plus importante de la branche. Les agents de sécurité privée peuvent être recrutés soit par une personne privée (par exemple une grande surface commerciale ou une résidence...), soit par l’État. C’est bien sûr ce dernier point qui est crucial : la commande publique, en hausse, représente actuellement 23% du marché de la sécurité privée en France. Ce qui revient à sous-traiter la sécurité du pays à des acteurs privés. Cette question se double d’un point particulier, Vigipirate [2] : la présence de vigiles aux entrées des bâtiments publics (bibliothèques, ministères, musées, etc.) en découle, et accroît le sentiment d’empiètement du discours sécuritaire sur les libertés publiques. Mais ces vigileslà ne représentent qu’un aspect particulier dans la problématique de la hausse de la part de la sécurité privée en France. Étant donné l’étendue de la question, et notamment la base réglementaire de telles mesures, Vigipirate fera l’objet d’un dossier à part entière du Tigre — et il n’en sera qu’à peine question ici.
En filigrane de la question des vigiles, et avant même la question de la fracture entre sécurité publique et sécurité privée, il y a un débat historique : est-ce le maire ou l’État qui doit protéger les citoyens ? La police est nationalisée depuis la Seconde Guerre mondiale. [cf. encadré « Les maires contre l’État »] Mais cet état de fait a été constesté, et cette évolution est intrinsèquement liée à la mise en avant de la notion d’« insécurité » dans le débat politique à partir de la fin des années 1970 [cf. encadré « La naissance d’un discours »]. Ce changement de paradigme va faire un effet boule de neige — sans que l’on puisse savoir qui est l’œuf et qui est la poule, du discours sécuritaire et du sentiment d’insécurité.
Des affrontements politiques droite-gauche qui se tassent, une société de consommation qui se replie sur la peur... Dans l’accentuation de cette peur sociale, qui constitue un tournant historique, la gauche a une responsabilité immense. L’inflexion majeure se fait dans les années 1980, sous Mitterrand : les élections municipales de 1983, marquées par la percée du Front national, consacrent l’insécurité comme l’un des enjeux politiques prioritaires. Dans ce nouveau contexte, les maires des grandes et moyennes villes, de droite comme de gauche, réclament de plus larges responsabilités pour s’imposer comme des acteurs-clés de la sécurité dans leur ville. Or, et c’est là toute la nouveauté des politiques municipales de lutte contre l’insécurité, ces mesures se couplent avec des solutions comme la vidéosurveillance ou l’emploi de vigiles, relevant du modèle anglo-saxon de la « prévention situationnelle » [cf. encadré]. La rhétorique du « pour votre sécurité » se met en place [3].
En l’espace d’une vingtaine d’années (puisqu’on n’a pas fait marche arrière depuis), l’insécurité s’est donc imposée comme l’une des principales préoccupations des maires. Des observatoires locaux de la délinquance et des incivilités, des sondages récurrents (sur le mode : « N’est-ce pas que vous avez peur, hein ? — Ben oui »), des experts en sécurité [cf. encadré « Les experts »] qui, en un cercle vicieux très prévisible, demandent... un renforcement de la sécurité, après facturation de leurs bons conseils. Comment en irait-il autrement ? Puisqu’il s’agit d’un marché, qui ne connaît pas la crise. Quitte à déformer un peu la réalité pour vendre leurs bons services, on a ainsi vu fleurir les « amalgames entretenus par certains entrepreneurs de morale... et de solutions sécuritaires. » [4] Le genre d’amalgames visant à faire croire aux citoyens que la lutte antiterroriste et la surveillance d’un supermarché, c’est la même chose. La récurrence du dialogue « Pourquoi ? — À cause de Vigipirate »[c] en témoigne.
![[Cindy Cookie] [Cindy Cookie]](/IMG/jpg/imgvigiles06.jpg)
Un lobby a un but : vous convaincre que vous avez besoin de ce qu’il propose, en vertu d’un mouvement historique inéluctable. Le bon vieux principe du marketing, quoi. Sauf que le marketing appliqué au domaine de l’action publique requiert précisément la vigilance de tous. Le Livre blanc [5] intitulé La participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe est à ce titre édifiant. « La présidence française de l’Union européenne en soutenant notre initiative a pris date pour l’avenir et a indiqué clairement que la sécurité des Européens ne se construira pas sans une harmonie dans la coproduction [6] de sécurité », peut-on y lire — et de fait, le Livre blanc est préfacé par Nicolas Sarkozy.
Au terme d’une étude concernant l’ensemble de l’Union européenne, on apprend donc que la sécurité privée, « de “particularité” que les acteurs publics ont longtemps toisée, s’est muée au fil des années en spécificité que ces mêmes acteurs publics viennent solliciter pour des missions précises. Les vigiles, autrefois suspects de fouler au pied les valeurs démocratiques, sont devenus des agents chargés de la sécurité d’autrui et reconnus pour leur professionnalisme ». Voilà pour le discours de façade sur « cette “renaissance” (sic) », hélas « freinée dans quelques pays ».
Le Livre blanc affirme que les raisons de la progression de la sécurité privée en Europe sont « transculturelles », et les regroupe en trois catégories : l’apparition de nouvelles formes de propriété et de consommation, les « propriétés privées de masse » (espaces privés qui, tels les centres commerciaux, les parcs de loisirs ou les enceintes sportives, sont ouverts à un large public), « la logique assurantielle qui a amené de plus en plus de particuliers à investir dans le domaine de la sécurité pour protéger leurs domiciles ainsi que ces nouveaux biens de consommation de masse qui, comme les automobiles, puis les deux-roues, ont progressivement colonisé la voie publique » (phrase poétique pour parler des surveillants de parking), l’engorgement des services de la police publique, et (à croire que les auteurs ont eu la bonne idée d’y aller crescendo, comme dans toute bonne dissertation) « ce qu’il est convenu d’appeler la crise fiscale des États qui oblige les autorités publiques à revoir le périmètre de leurs investissements ». Oh la belle périphrase ! Les caisses sont vides, messieurs dames. Alors, « certains pays cherchent à limiter voire à diminuer le nombre de leurs fonctionnaires » — et si la France en faisait partie ? Les périphrases poétiques continuent : « la plupart envisagent le problème sous l’angle d’un recentrage de leurs activités sur un “cœur de métier” policier ». Et le cœur de métier, c’est le judiciaire. Les policiers la loupe à la main ; les vigiles pour le reste et notamment les basses tâches que sont les « gardes statiques ».
Une partie des fonctions traditionnelles de service public ont d’ores et déjà été déléguées à des acteurs privés [7]. La délimitation entre public et privé est brouillée : « Il n’est plus du tout pertinent de postuler que la sécurité des lieux publics soit de la compétence exclusive des autorités publiques, tandis que les systèmes de sécurité privée sont limités à la protection de la propriété privée. »[d] Ce sont les agents de sécurité privée qui se chargent, exclusivement, de contrôler les accès et de patrouiller dans les couloirs du métro. En Autriche, ce sont des agents privés qui contrôlent les vignettes justifiant le paiement des autoroutes. En Italie, la « vidéoprotection » urbaine (eh oui, c’est le mot nouveau pour dire « vidéosurveillance » !) est confiée à des entreprises privées, y compris pour ce qui relève de la voie publique. En Hongrie, les entreprises privées surveillent certains tribunaux et ministères. L’Allemagne et l’Espagne confient les installations militaires au secteur privé. En Roumanie, des « interventions conjointes » de la police et des agents privés sont à l’étude afin de « maintenir l’ordre public et lutter contre les comportements anti-sociaux ». Ainsi, un policier et un agent privé peuvent patrouiller dans le même véhicule — « toutefois ces équipages hétéroclites ne produisent pas toujours les résultats attendus, les occupants ne s’entendant pas automatiquement sur leurs objectifs respectifs ». Au Royaume-Uni, pays qui est allé le plus loin dans la délégation de son service public, outre le stationnement et les contraventions, ce sont l’escorte et le transfert des détenus qui sont une activité prise en charge par le secteur privé depuis 1992. Onze des 130 prisons du Royaume-Uni sont privées : la sécurité des détenus et leur « santé physique et mentale » y sont délégués à des entreprises de sécurité privées « disposant de la possibilité légale d’user de la force quand son recours est justifié ». Le personnel en charge de tels centres, précise le Livre blanc, doit être « formé et agréé » (ça alors !). Toujours au Royaume-Uni, la détention administrative, en aéroport ou dans les centres de rétention, est déléguée au secteur privé, de même que les reconduites à la frontière. Les mauvais esprits diront : mais quelle différence, qu’un clandestin croupisse dans un centre de rétention et soit malmené par un vigile, ou par un policier ? La différence, fondamentale, se trouve du côté de la société civile, et des comptes qu’elle peut demander à l’État.
La part de la commande publique dans le recours à la sécurité privée est croissante. « Dans tous les pays étudiés, la plupart de nos interlocuteurs estiment comme inéluctable, dans les années à venir, cette tendance à la coopération, notamment [...] parce qu’après avoir cédé le terrain au secteur privé, les pouvoirs publics semblent incapables, souvent pour des raisons pécuniaires, de revenir à la situation antérieure. » La commande publique représente actuellement, on l’a dit, 23% du marché en France — contre 30% en Espagne, 50% en Hongrie. L’opportunité est double : réduire les dépenses de l’État en diminuant le nombre de fonctionnaires de police, et parallèlement créer de nouveaux emplois.
« C’est l’État qui fixe les contours du marché de la sécurité privée en se retirant peu à peu de ses missions traditionnelles (renseignement commercial, renseignement familial, transports de fonds, contrôle des passagers et des bagages dans les ports et les aéroports, protection des grandes manifestations culturelles et sportives, protection rapprochée des personnes, assistance aux expatriés, études de sécurité publique, intelligence économique, analyse des phénomènes criminels, recherche d’ADN...) et en les concédant, sans toujours le dire ou l’assumer, au secteur privé », poursuit le Livre blanc. De fait, en décembre 2008, le secrétaire d’État à l’Emploi, Laurent Wauquiez, a signé avec l’Union des entreprises de sécurité privée une convention visant à favoriser la création de 100.000 nouveaux emplois dans le secteur d’ici 2015 [cf. reportage : Cap 250.000 vigiles.]
Mais là où le bât blesse, c’est sur la qualité des agents employés indirectement... par l’État. L’explosion du secteur a provoqué la multiplication d’entreprises de taille moyenne dont certaines « ont fréquemment recours à des pratiques jugées déloyales » : le dumping en Hongrie, le travail dissimulé en Roumanie (des salariés non déclarés, parfois parce qu’ils possèdent un casier judiciaire éloquent), le recours aux « faux indépendants » en Belgique (des employés déclarés travailleurs indépendants, échappant ainsi aux conventions collectives imposant un salaire minimum), les enchères inversées en France (l’attribution d’un marché au prestataire le moins cher), etc.
« Soucieux d’économiser les deniers publics, d’autant qu’ils se raréfient, le premier critère de choix dans l’attribution du marché reste le plus souvent le tarif de la prestation. Dans son rôle de client public, le discours de l’État est donc ambigu. D’un côté, il cherche à moraliser la profession en écartant les entreprises peu scrupuleuses sur la qualité des prestations et les salaires versés aux employés, et de l’autre il conforte indirectement ces mêmes entreprises indélicates en tirant les prix du marché vers le bas. »[f] Et d’en ajouter une couche : « Les entrepreneurs ne comprennent pas que les autorités puissent déléguer des tâches aussi délicates, telle la protection de sites sensibles, et attendent un service de qualité en le rétribuant aussi mal. » Avec, en note, cette belle formule : « Aux dires de nos interlocuteurs, le marché du Bundestag aurait été attribué, pour des raisons budgétaires, à ce genre d’entreprise. »[f] Ce sont donc les entrepreneurs qui font la morale à l’État. Manière pour eux de relégitimer leur profession, en s’attaquant aux moutons noirs... pour mieux valoriser leur travail et ainsi mieux vendre leurs services.
« Rien ne sera possible si nous ne savons pas organiser et développer un dialogue social qui favorise l’épanouissement des femmes et des hommes qui font ce métier avec fierté et dont les compétences permettront de faire de notre industrie un secteur attractif, moderne et performant »[f] affirme ainsi Claude Tarlet,vice-président de la CoESS [8] assez enclin au lyrisme, qui n’hésite pas à citer en exergue de son texte du... Gœthe : « Quoi que tu rêves / d’entreprendre, commence-le / L’audace a du génie, / du pouvoir, de la magie ».
Ce qui est agréable dans un document officiel, outre ces irruptions poétiques intempestives, c’est ce qui s’y dit en creux. Le discours officieux du document officiel, en quelque sorte. Le discours de Claude Tarlet se traduit ainsi aisément par : actuellement, le secteur n’est ni attractif, ni performant. Ce que confirme le Livre blanc quelques pages plus loin : « Des milices privées, prêtes à tous les débordements, accueillant au mieux des “incapables”, au pire “des brutes alcooliques”. L’image d’Épinal (post crise industrielle) est sérieusement ancrée. »[f] Plus loin, il est question d’« image déplorable ». On est bien loin de la vision idyllique donnée par la page d’accueil du site d’une entreprise de services en sécurité privée : « Diplomate, psychologue, observateur, attentif, avec une très grande résistance nerveuse, et beaucoup de sang-froid lors de situations critiques. »
De fait, la vie des vigiles n’est pas vraiment enviable. Les agents effectuent une tâche routinière, « généralement dénuée d’intérêt ». Ils sont souvent isolés sur le lieu de leur travail. « À ce stress, s’ajoute la pression de la hiérarchie afin de conserver des marchés volatiles. Les agents exercent la nuit ou le week-end, perturbant ainsi leur vie familiale. Dans les centres commerciaux, les agents sont peu respectés voire méprisés par les clients. Enfin, l’absence de perspectives de carrière rend l’attractivité du secteur faible. Mais, avant tout, c’est la médiocrité des salaires qui plombe l’appétence pour cette profession » [9].
Cet état de fait rend le turn-over très important dans la plupart des pays européens. Ainsi, le taux de rotation moyen du personnel s’élève à 35% au Royaume-Uni, 65% en Pologne, 66% en France ! Une rotation des effectifs qui est un mode de management bien commode permettant aux entreprises d’ajuster leurs effectifs en fonction des commandes, à coup d’embauches et de licenciements. Si l’on ajoute à cela une sous-traitance en cascade « particulièrement courante dans la profession », on en arrive à un état des lieux peu reluisant. Mais poursuivons. La sécurité privée est « un secteur marchand particulier. Il en résulte, au niveau européen, que sa place [...] doit être différente de l’ensemble des autres secteurs marchands »[f] :une grande phrase pour dire que les questions de déontologie, de formation professionnelle, de certification, sont à ériger en objectifs prioritaires.
Où en est-on ? Tous les États européens, « à la notable exception de l’Irlande » (tiens ! et si c’était pour cela qu’aux côtés de la Pologne et de la Hongrie, l’Irlande avait le plus fort taux de sécurité privée en Europe ?), imposent la possession d’une autorisation pour pouvoir exercer dans le secteur de la sécurité privée. Les candidats à un emploi d’agent de sécurité « doivent tous répondre à deux conditions essentielles » : l’âge (être au moins âgé de 18 ans) et la moralité (un casier judiciaire vierge). C’est sûr que la présence, « pour votre sécurité », d’un délinquant de quinze ans, ça ferait tache. D’autres critères s’ajoutent ou non selon les pays : la nationalité (condition que n’exige pas la France), la bonne condition physique, la langue, les obligations militaires, le non-cumul des fonctions avec la vente d’armes ou la justice... Donc, et les auteurs du Livre blanc s’en félicitent : pas de petit gros baragouinant l’italien, ancien braqueur surendetté, vendeur d’armes à ses heures... La bonne humeur se poursuit avec le paragraphe intitulé « La délicate gestion de l’armement ». Où l’on apprend que « pour des raisons culturelles, l’utilisation d’armes à feu constitue une épineuse question pour nombre d’États [...] Lorsqu’elle est autorisée [10], l’utilisation des armes est rendue complexe dans nombre de pays » (regrets). Il faut « pouvoir justifier des connaissances théoriques et pratiques requises pour son utilisation » — on s’en étonnerait presque. La durée de la formation des vigiles est quant à elle disparate : un simple entretien en Allemagne (« qui, bien qu’il soit facile d’accès, est mieux apprécié des entrepreneurs que la formation facultative de 40 heures »). Dans les pays de l’Est, les anciens policiers sont dispensés d’examen préalable, facilité d’accès qui a permis en Roumanie et Slovaquie, « aux dires des représentants de la profession, à maints anciens policiers ou gardiens de prison de préempter la plupart des postes de dirigeants de société privée. Le secteur serait ainsi “noyauté” par d’anciens agents de l’État. Dans ces pays ayant fraîchement accédé à la démocratie, cette collusion entre les anciens policiers devenus agents privés et les jeunes policiers restés dans le domaine public sème parfois le trouble dans les esprits et nuit à la réputation de la profession. »[f] Hmm...
En France, la loi relative à la prévention de la délinquance votée en 2007 établit le principe d’une formation minimale obligatoire de 70 heures à échéance de 2009 — « Cependant son application suppose des moyens considérables. [...] Les entreprises déplorent que les délais d’instruction des dossiers puissent parfois durer jusqu’à six mois, alors qu’elles doivent adapter en permanence leurs effectifs aux besoins d’un marché de plus en plus concurrentiel. De fait, nombre d’agents sont employés avant le feu vert étatique, rendant ainsi le contrôle d’accès à la profession plus théorique... »[f]
Et le Livre blanc de se faire lui-même accablant... pour ce qu’il appelle de ses vœux, en rappelant que « la menace d’une privatisation » de la police amène à une « suspicion mutuelle, voire de la franche hostilité » entre les deux secteurs, et une « concurrence qui pourrait déboucher sur des conflits, voire sur des cas de corruption ».
La France compte 65 millions d’habitants ; la Pologne 38,5 millions ; or la Pologne non seulement a plus de policiers, mais deux fois plus de forces de sécurité privées que publiques. Bravo ! Mais on est méchants : c’est sans doute le Royaume-Uni, notre voisin à imiter, qui pour 60 millions d’habitants — donc une population comparable à la France — compte des effectifs d’agents privés faisant presque jeu égal avec les forces publiques. Alors qu’en France (et à peu de choses près en Allemagne et en Espagne), les forces privées représentent seulement [NDLR : ceci est de l’ironie] la moitié des forces publiques. L’Italie (mais que fait Berlusconi ?) présente quant à elle la particularité de connaître à la fois la police publique la plus importante d’Europe et des forces privées très marginalisées. Et lorsqu’on additionne forces publiques et forces privées de sécurité, « la répartition des pays européens fait apparaître une fracture importante entre quelques pays européens très policés, parmi lesquels on retrouve tous les pays accédants de 2004 [i.e. les pays de l’ancien bloc soviétique, ainsi la Hongrie qui compte 1083 professionnels de la sécurité pour 100 000 habitants, soit 1% de sa population] et d’autres pays peu policés, au premier rang desquels les pays scandinaves »[f]. Alors soyons gaiement de mauvaise foi... puisque les politiciens le sont, qui créent à grands renforts de sondages les orientations politiques désastreuses. Au lieu du traditionnel sondage « Voulez-vous plus de sécurité ? », proposons le sondage stupide « Préférez-vous la Suède ou la Pologne ? » Ah ! que ne faut-il pas faire pour défendre la démocratie... Peut-être rappeler de bonnes vieilles évidences ? En cas de troubles politiques, quid de ces forces d’appoints où la responsabilité se dilue, par le jeu de la sous-traitance ?
***
Il y a ainsi deux questions qui se recoupent, mais pas toujours : celle du désengagement de l’État, et celle de la présence visible, pour le citoyen, des forces de sécurité privées. Lorsque le transports de fonds, ou la garde d’un site militaire, est confié à une société de sécurité privée, le citoyen n’en a que peu conscience — même si la problématique sous-jacente est importante. Lorsqu’un vigile lui demande d’ouvrir son sac au supermaché, la problématique est celle de l’urbanité. Qu’est-ce qu’une ville ? Comment souhaite-t-on vivre dans une ville ? En étant fouillé à l’entrée d’une bibliothèque, d’un magasin, d’un bureau ?
Il y a un point fondamental : la plupart des vigiles « visibles » au quotidien agissent pour le compte d’un lieu privé, et donc œuvrent non pas « pour votre sécurité » comme cela est écrit à tort, mais bien plus prosaïquement afin d’éviter le vol, par leur seule présence censément dissuasive. [cf. encadré « Juridiquement »] Or, par leur apparence et par le fait qu’ils outrepassent parfois leurs droits réels, ils acquièrent une portée symbolique qui dépasse leur prérogatives : la « sécurisation » de l’espace public, au même titre que la police. « Du fait même de cette imposture, la présence redoublée de vigiles dans l’ensemble du champ social produit des effets invisibles sur le public. »[e] Le vigile donne l’impression d’être du côté des forces de l’ordre. Or « et il faudrait s’étonner de ce que jamais les médias ne relaient une information aussi cruciale, les APS [agents privés de sécurité] sont des citoyens comme les autres. Ils n’ont pas plus de pouvoir qu’un citoyen ordinaire, pas plus de privilèges ou d’autorité. Les professionnels de la sécurité sont des “professionnels” au même titre que ceux de l’horlogerie ou de la restauration. Ils jouent donc la plupart du temps un rôle qui n’est pas le leur. Car non seulement le vigile n’est pas plus près de la loi ou de la justice qu’un citoyen lambda, mais il y est soumis au même titre. »[e]
La police, on l’a vu, est accusée de s’être coupée du terrain, et d’avoir fait le lit du sentiment d’insécurité. Or, coupé du terrain, le vigile l’est bien plus. Balloté d’un endroit à l’autre (« La semaine dernière, nous étions à Disneyland. Aujourd’hui ils nous envoient ici, c’est tout. »[c]), au gré de leurs conditions de travail précaires, agissant aux marges de la légalité, les vigiles ne sont que des épouvantails. Des épouvantails bien pratiques pour le pouvoir lorsqu’il s’agit de se délester de ses responsabilités. Ainsi Martin Mongin cite-t-il le cas où, alors même que le droit de grève est... un droit, la présence de vigiles (à l’entrée des universités, par exemple) se substitue à celle de la force publique. En évitant la confrontation directe de la police le vigile agit comme un « masque »e, un échelon intermédiaire à franchir avant la confrontation au pouvoir. Exemples de réponses de vigiles lors des contrôles systématiques — à la question : pourquoi fouiller mon sac ? « Parce que j’ai envie », parce que « Vigipirate est en vigueur », « c’est pour vérifier que vous n’ayez pas des choses qui n’ont rien à faire dans l’université : banderoles, armes », et « en raison des événements » — Mais quels « événements » ? « Ben vous savez : Vigipirate, tout ça, le terrorisme... les grèves. »[c] Alors pour finir, laissons parler Figaro — le vrai Figaro, le seul qui vaille :
« Moi, j’entre ici, où, par la force de mon art, je vais, d’un seul coup de baguette, endormir la vigilance, éveiller l’amour, égarer la jalousie, fourvoyer l’intrigue, et renverser tous les obstacles. »
Beaumarchais, Le Barbier de Séville, I.6, 1775.
Bibliographie générale
a. Tanguy Le Goff, « L’insécurité “saisie” par les maires, un enjeu de politiques municipales », in Revue française de sciences politiques, no 55, 2005.
b. Laurent Mucchielli & Philippe Robert (dir.), Crime et sécurité, l’état des savoirs, La Découverte, 2002.
c. Institut de démobilisation (cf. http://i2d.blog-libre.net/), ensemble de documents sur les vigiles, 2006.
d. Thierry Delpeuch, « Les nouvelles politiques de sécurité en trompe-l’œil ? », in Droit & Société, no 61, 2005.
e. Martin Mongin, « Alarmante banalisation des vigiles », in Le Monde diplomatique, janvier 2008.
f. Livre blanc, 2008 (cf. ci-dessous).
g. Thierry Oblet, Défendre la ville, P.u.f., 2008.
• Sebastian Roché, Le sentiment d’insécurité, P.u.f., 1993, et Police de proximité, Seuil, 2005.
• Sebastian Roché (dir.), Réformer la police et la sécurité. Les nouvelles tendances en Europe et aux États-Unis, Odile Jacob, 2004.
• Laurent Mucchielli, Violences et insécurité. Fantasmes et réalités dans le débat français, La Découverte, 2002.
• Robert Sablayrolles, Les cohortes de vigiles, École française de Rome, 2001. [sur les Vigiles Urbani dans l’Antiquité].
Bibliographie & liens sur les instances sécuritaires
• Livre blanc « La participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe », coédition du CoESS et de l’Inhes, consultable sur : http://www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/INHES_LivreBlanc_15122008.pdf
• Inhes (Institut des hautes études de la sécurité intérieure), www.inhes.interieur.gouv.fr. Organisme éditant la revue Les cahiers de la sécurité.
• CoESS(Confédération européenne des services de sécurité), www.coess.eu. Regroupement de fédérations nationales d’entreprises de sécurité privée. Son rôle consiste à veiller à l’amélioration du processus d’harmonisation des législations nationales en matière de sécurité privée. Parmi les membres de la CoESS, les grandes multinationales du secteur (Group 4 Securicor, Securitas, Prosegur, Brink’s).
• Snes (Syndicat national des entreprises de sécurité) www.e-snes.org
• Fesu (Forum européen pour la sécurité urbaine) http://www.fesu.org
• Blog securite-privee-france.over-blog.com : si vous voulez tout savoir du dernier vigile ayant tabassé un client et de la malice des rottweilers, c’est là.
[ ENCADRÉS ]
Les maires contre l’État
Pendant la IIIe République, ce sont les maires qui assurent « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique » de leur commune, en vertu de la loi du 5 avril 1884. « Bien souvent occulté dans le débat public, cet arrièreplan historique est pourtant déterminant »[a] pour comprendre la volonté actuelle des maires de récupérer le pouvoir qui était le leur, en partie via l’offre de sécurité privée. Or, sous le régime de Vichy, la loi Darlan du 23 avril 1941 stipule l’étatisation de l’ensemble des polices urbaines. Fait historique paradoxal à première vue, la Libération entérine le travail du régime de Vichy : à la Libération, « l’État est apparu comme un gage de modernité et de rationalisation de l’action publique face à un “local” tenu pour espace archaïque et clientéliste »[a]. La nationalisation de la police a constitué un profond tournant : « l’étatisation des polices municipales a distendu progressivement le lien entre policiers et populations locales, faisant de la surveillance du territoire une mission accessoire et dévalorisée face au prestige des “belles” enquêtes judiciaires. »[4] Centralement administrée par le ministère de l’Intérieur depuis son étatisation en 1941, la police urbaine n’a en effet plus de comptes à rendre à la population ni à son représentant, le maire. À l’agent d’antan, ce familier du terrain, connu de tous, se substitue un policier de passage. Dans le détail, la rupture des liens qui réunissaient les forces de l’ordre et les citadins s’explique par trois faits. Le recrutement des policiers, de local, devient national. Les agents de police se trouvent donc affectés, pour des temps plus ou moins longs, dans des villes qu’ils ne connaissent pas, et où bien souvent ils ne résident pas. En outre, la figure du policier a été profondément modifiée par les progrès techniques. Le policier marchait dans la rue ; le voilà qui se retrouve dans une voiture, où ses interventions et déplacements lui sont dictés par radio en fonction des appels reçus, ce qui tend à le mettre beaucoup plus à la disposition du central que de la population locale. « La police urbaine, plus mobile parce que motorisée, réalise des opérations au coup par coup, mais dessaisie de son territoire »[a], ce qui favorise les bavures policières. Enfin, les polices n’ayant plus de comptes à rendre localement au maire, leurs priorités sont devenues celles de leurs chefs hiérarchiques — priorités qui sont celles de l’État : l’ordre public, non pas au sens de « tranquillité », mais bien de sécurité nationale. Le contexte politique de l’après-guerre a bien sûr beaucoup joué dans cet état de fait. La priorité gouvernementale, dans l’immédiat après-guerre et au cours des années 1960 et 1970, est le maintien de l’ordre face aux mouvements sociaux et politiques : décolonisation, agitation étudiante, grandes grèves, occupations d’usines... L’insécurité (le terme n’est alors pas encore à la mode), ou du moins la sécurité, renvoient à cela : la violence politique. « L’obsession du ministère de l’Intérieur à l’égard des risques de subversion gauchiste conduit à un renforcement de la police des foules (police d’interposition entre l’État et le peuple) dans le but de contenir les violences politiques, au détriment de la police urbaine, police du quotidien. »[a] Avec le recul, certains sociologues perçoivent cette prééminence de la lutte politique comme un « abandon » des questions quotidiennes : « Les années Marcellin [ministre de l’Intérieur de 1968 à 1974] achèvent de préparer la montée en puissance de l’insécurité, même si celle-ci n’émergera dans le débat public qu’à la faveur d’une recomposition radicale du contexte économique et social. »[b] Attention : cette approche ne doit pas faire croire qu’il s’agit de retrouver un âge d’or de la police...
La naissance d’un discours
C’est au milieu des années 1970 que les élites politiques s’emparent du thème de l’insécurité. En 1977, le rapport Peyrefitte, intitulé Réponses à la violence, fait date en imposant le sentiment d’insécurité « comme une préoccupation des pouvoirs publics (qui ne se démentira plus jusqu’à nos jours), et comme un objet d’action publique en soi »[a]. Sous Giscard, la loi Peyrefitte du 5 janvier 1981 sur la sécurité et les libertés s’étend de la grande délinquance aux menus méfaits et légalise les contrôles d’identité « à titre préventif ». Représentations dramaturgiques de l’insécurité, instrumentalisation des chiffres de la délinquance... la préoccupation sécuritaire est lancée, poursuivie par la gauche lorsqu’elle arrive au pouvoir. C’est ainsi Gilbert Bonnemaison, élu en 1967 maire (PS) d’une ville à forte composante populaire (Épinay-sur-Seine), puis député en 1981, qui est l’inspirateur sur la scène politique nationale de la politique dite « de prévention sociale de la délinquance ». C’est lui qui, durant les années 19801990, a œuvré à renforcer le rôle des maires en matière de sécurité. Il a ainsi créé, en 1987, deux structures visant à échanger les expériences des villes en matière de sécurité : le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (Fesu) et le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC). Le tournant symbolique du discours du parti socialiste sur la sécurité s’opère quant à lui en 1997, lors du colloque de Villepinte intitulé « Des villes sûres pour des citoyens libres », organisé à l’initiative du ministre de l’Intérieur Jean-Pierre Chevènement.
Les experts
La hausse de la thématique sécuritaire fait naître de nouveaux emplois. Peu nombreux avant 1997, des techniciens de la sécurité ont essaimé au niveau local à la faveur de la mise en place des Contrats locaux de sécurité par le gouvernement Jospin. Ces coordonnateurs de la sécurité redéfinissent les politiques menées par les collectivités locales sur le terrain de la sécurité quotidienne... et, étonnamment, se font les promoteurs des innovations municipales en matière de sécurité. Innovations ? « Le développement de mesures visant à dissuader par une présence humaine ou des dispositifs techniques (la vidéosurveillance) les troubles à l’ordre public, aux dépens des mesures sociales. »[a] Cette politique procédurale s’est accompagnée de la création, à l’échelon national, de diplômes et de formations : ainsi les diplômes proposés depuis 1998 par l’université Paris V (diplôme universitaire « Politiques et dispositifs de sécurité urbaine », DESS « Ingénierie des risques »), etc… sans compter les nombreuses formations assurées par des structures spécialisées, comme le Forum français sur la sécurité urbaine (FFSU), la direction interministérielle à la Ville ou le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Cette logique de professionnalisation du secteur de l’ingénierie en sécurité s’est traduite, au sein des municipalités, par l’apparition de « nouveaux “bataillons” de professionnels aux profils universitaires variés (juristes, économistes, psychologues, sociologues, ingénieurs...), dotés d’une formation spécialisée dans “l’ingénierie en sécurité”. Ainsi, ce qui n’était qu’une fonction assurée par des agents sociaux autodidactes, principalement issus de la sphère du travail social, reconvertis sur la thématique “sécurité-tranquillité publique”, tend à devenir une profession possédant ses outils, ses techniques, son lexique, ses propres formations et ses diplômes validants. »[a]
La « prévention situationnelle »
Franck Furstenberg a théorisé dès 1971 la notion d’insécurité. Dans Public Reaction to Crime in the Streets, il distingue la peur personnelle du crime (« crime risk ») et la préoccupation morale et politique pour le crime (« crime concern »). La peur personnelle est liée à des éléments objectifs : faits délictuels dont un individu a été victime ou dont il a eu un écho par un proche. La préoccupation sociale pour le crime dépend quant à elle du « monde qui est celui des valeurs morales et politiques (ce à quoi l’on croit) et des normes (ce qu’il faut pour la société) ». On peut être préoccupé par l’ordre sans avoir été victime et, inversement, on peut avoir été victime d’un fait délictueux sans éprouver une préoccupation sociale pour le crime. Cette dissociation entre le sentiment d’insécurité et la violence réelle s’est longtemps traduite par une mise à l’écart de la question de l’insécurité. Puis la doctrine dominante est devenue celle des Américains James Wilson et Georges Kelling, promoteurs dès les années 1980 de la « tolérance zéro », au nom de la théorie dite de la « vitre brisée » en vertu de laquelle la lutte contre les petits désordres quotidiens (les « incivilités ») ferait reculer les plus gros délits. La « new penology » consistant à durcir les peines dans le but essentiellement de rassurer les « honnêtes citoyens » a ainsi transformé la prévention en « prévention situationnelle » : une expression traduisant le fait de rendre les espaces publics et privés moins « criminogènes », et de bannir de l’espace public ses usages jugés « déviants ». Ce qui se traduit, dans les faits, par de multiples modifications dans l’environnement urbain : élimination de lieux pouvant servir de cachettes, mise en place d’interphones et de grilles, recours à la surveillance privée, conception de bancs visant à rendre impossible la position couchée, donc les clochards et autres « indésirables », conceptions architecturales ne permettant pas les « rassemblements hostiles »...
Juridiquement
Les vigiles sont des citoyens comme les autres, pas une force de police. Sur la voie publique, les vigiles n’ont aucun pouvoir. Leur présence est uniquement dissuasive.
L’encadrement législatif des vigiles s’appuie sur plusieurs textes : la loi du 12 juillet 1983 sur les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes. Sur la voie publique, les agents de sécurité ne possèdent pas plus de pouvoirs que le citoyen lambda : comme chacun d’entre nous (en vertu de l’article 73 du Code de Procédure Pénale), en cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni par une peine d’emprisonnement, ils peuvent en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police le plus proche. Ils ne peuvent interpeller les contrevenants, mais juste les retenir en attendant l’arrivée de la police. « Ils peuvent demander à un clochard de se déplacer de quelques mètres et éviter d’entraver l’accès à un commerce, mais seule la police possède le droit de le faire partir. »[f] Dans des cas particuliers, les agents peuvent effectuer une fouille sous la responsabilité de la police. En cas de difficulté, cette dernière prend le relais. La loi de 1983 stipule qu’un agent de prévention et de sécurité doit être perçu comme une personne de droit privé afin « d’éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police ». Les vigiles « peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ». Il est interdit aux APS « de s’immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d’un conflit du travail ou d’événements s’y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes ».
En bon français : sans votre consentement, un vigile ne peut vous fouiller. On ajoutera qu’un blouson n’est pas un bagage à main. Un portique qui sonne à l’entrée d’un magasin est-il un cas de « flagrant délit » ? D’un point de vue strictement juridique, non — ces portiques pouvant être déclenchés par une autre personne, et, mieux encore, à distance — pratique pour le moins douteuse, rusée en diable, qui serait employée dans certaines surfaces de vente pour donner aux vigiles un motif de contrôle valable du bagage à main de la personne franchissant la ligne de caisse, sans pouvoir être accusés de délit de faciès. D’un point de vue strictement pratique, la personne qui n’a effectivement rien volé a tout intérêt à coopérer, comme on dit — et donc à montrer son sac. D’un point de vue philosophique, si ladite personne est encline à remettre en question les fondements de la politique sécuritaire (auquel cas son opposition au vigile est une opposition à la politique de l’État, ce qui, on ne le rappellera jamais assez, est un élément constitutif et salutaire de la démocratie), une contestation est légale. Se poser la question de savoir si quelqu’un agit de droit est essentiel. Ne pas le faire, c’est apprendre à obéir à un ordre quel que soit sa provenance — et c’est comme ça qu’une population en vient à accepter que « pour sa tranquillité et sa sécurité », un État totalitaire s’installe.
[1] Le Tigre reviendra, dans des dossiers à venir, sur ces autres points, et notamment sur la vidéosurveillance.
[2] Mobilisant police et gendarmerie, le plan Vigipirate a été lancé dès 1978 pour lutter contre toute menace de déstabilisation intérieure venue d’une puissance étrangère. Jamais abrogé, réactualisé après les attentats du 11 septembre, il est devenu « Vigipirate renforcé ».
[3] Ceci ne signifiant pas que toutes les mesures « sociales » aient disparu de l’arsenal des réponses des municipalités — Thierry Oblet[g] critique ainsi la thèse (défendue notamment par Loïc Wacquant) de la substitution actuelle de l’État pénal à l’État social.
[4] Igor Martinache, www.liens-socio.org
[5] Un Livre blanc est un document officiel publié par un gouvernement ou une organisation internationale afin de faire des propositions de long terme.
[6] Avec la loi Pasqua du 21 janvier 1995 (loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité) émerge la notion de « coproduction de sécurité ». Les professionnels de la sécurité privée réussissent à faire inscrire dans le droit l’idée selon laquelle ils sont des partenaires naturels de la police, et donc un secteur auxiliaire plutôt que concurrent.
[7] Cf. « Les effets pervers du partage de la sécurité. Polices publiques et privées dans une gare et un centre commercial », in Sociologie du travail, octobre 2008.
[8] CoESS : Conférédation européenne des services de sécurité.
[9] À l’exception notable de la Suède, où les salaires sont confortables (2200 euros mensuels pour un garde statique, contre 1200 euros en France).
[10] L’usage des armes par les agents de sécurité privée est totalement interdit dans quatre pays : le Danemark, l’Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. En France, il n’est autorisé que pour le transport de fonds. Si certains États autorisent donc le port d’armes pour le transfert de fonds, la surveillance des banques, le gardiennage de sites sensibles ou la protection rapprochée, ils l’interdisent tous pour la gestion de centraux d’alarme, la surveillance des immeubles et le contrôle d’accès aux lieux publics ou privés.