


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


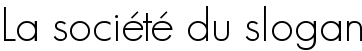
 |
|
|
|
Publié dans le
numéro 31 (mai-juin 2009)
|
[L’intégralité du dossier, images comprises, peut être téléchargé au format PDF en suivant ce lien.]
Lowe France, c’est : une organisation totalement intégrée, au service du développement, du management et de la production de la « High Value Idea ». Human Connection, c’est notre manière de travailler. Tout simplement parce que nous avons la certitude que c’est le meilleur moyen de créer des idées justes, neuves et uniques. Human Connection, c’est aussi l’ambition que doit porter chacun de nos projets, chacune de nos idées quels que soient les supports, quels que soient les moyens. Pour développer des idées à même de créer une relation forte entre les consommateurs et les marques, il faut avant tout réussir à définir ce qui est réellement l’essentiel. C’est ce que l’on appelle le « Problem biased thinking ». Avec la diffusion massive des nouvelles technologies, l’individu, tour à tour citoyen, consommateur, salarié, actionnaire, créateur... peut tout voir, tout savoir. Nous sommes à l’heure de l’individu 360° et voici venu le temps des marques conversations. Communiquer ne signifie plus créer un message unique, partout répété. Il s’agit de créer un système de communication cohérent, permettant une conversation entre l’annonceur et ses publics. Un système né d’un mix totalement libre dans la manière d’aborder les sujets et les problématiques. Pôles spécialisés Édition | design graphique, [une citation s’affiche en grand, aux côtés de la photo de la responsable du pôle communication écrite] : « Il ne faut jamais céder sur les mots (Freud) »[www.lowestrateus.com]
Il
ne faut jamais céder sur les mots, a dit Freud. Et c’est pourquoi
Lowe Strateus, grande agence de communication parmi d’autres, ne
cède pas sur les mots. Ce qui tombe bien, étant donné que cette
agence de com’ est responsable de campagnes de communication
publique. La Sécurité routière, par exemple, c’est eux. C’est
eux qui ont trouvé, en 2008 : « T’assures dans la vie, alors
assure sur la route », à l’attention des conducteurs de 50
cm3. Un slogan, comment dire ? dans l’air du temps. Un slogan qu’on
pourrait ne même plus remarquer, tellement il est banal. « Ce que
l’on qualifiera de “communication gouvernementale
institutionnelle” représente une réalité tangible
et massive : [...] tout un chacun est amené sinon à en
éprouver les conseils et les injonctions, du moins à en percevoir
les messages et les slogans parfois mémorables. »[a]
Mémorables de nullité — et (bien plus grave) de fausseté,
ajoutera-t-on. La décision d’écrire ce dossier est sans doute
venue un jour où l’on en avait croisé un... de trop. Le mot qui a
fait déborder le vase. Où, après un trajet en bus, dans le bus
je valibus, on s’asseyait, souriez vous êtes filmés,
on descendait, on n’est pas là pour se faire écraser,
quelques pas plus loin, pas d’inquiétude ! c’est un cancer,
on grignote un truc qui nous dit, pour votre santé, pratiquez une
activité physique régulière, on rentre en métro, préparer
ma sortie facilite ma descente. Le point commun de tous ces
messages est le suivant : il ne s’agit pas de publicités. Si
c’était pour nous vendre un shampooing ou de la lessive, ce serait
un tout autre débat : que les vendeurs de lessive soient des
bonimenteurs, on le sait — ou à peu près. Mais là, la différence
est de taille : il s’agit des messages censément « d’intérêt
général », oeuvrant pour le bien commun. Des messages émanant du
gouvernement, d’associations d’utilité publique, d’ONG, voire
d’organismes privés « faisant comme si » ils s’inséraient dans
un discours public [cf. encadré : qui parle ?]. Alors Le
Tigre a eu envie de savoir d’où venait cette profusion de
messages, de comprendre ce qui était censé en justifier certains et
pas d’autres, enfin interroger l’utilité desdits messages. Afin
de mettre ceux qui cèdent sur les mots face à leurs
responsabilités. Et de poser une pierre dans un débat qui concerne
l’ensemble des citoyens : est-il légitime que les citoyens aient
l’impression de crouler sous le poids des slogans ? Vite, un
sondage, un post-test !
Jacques
Bille, chef du SID (Service d’information et de diffusion, cf.
ci-dessous) de 1978 à 1981 (entretien, 1997, [a])
— Parlant de la
communication gouvernementale, vous dites que l’on est passé
d’interventions ponctuelles à un processus plus générique,
d’intérêt public. Comment justifiez-vous cette évolution ?
— C’est
intéressant car c’est un vrai grand problème. C’est une
évolution dans l’action politique.
— Vous la datez de cette
période ?
— Oui. Alain Peyrefitte, sur ce plan, est le dernier des
Mohicans... On voit un clivage entre les périodes de Gaulle et post
de Gaulle. On passe d’une fonction régalienne et tribunicienne à
une période différente largement incarnée par Giscard. [...] Tout
cela paraît banal à dire aujourd’hui mais je pense qu’il y a eu
un vrai changement.
C’est donc à la fin des années 1970 qu’un mouvement historique, dont nous ne sommes (hélas ?) pas sortis, s’amorce : la com’ devient un élément central de la politique. « Avec Giscard puis avec Mitterrand, la communication envahit la sphère politique. Elle s’y incrustera au point de la dévorer. Dès lors, du président de la République jusqu’au plus obscur secrétaire d’État, en passant par certains grands élus, chacun se dotera de conseillers en communication. À droite comme à gauche. »[a] Mais, dira-t-on, quel rapport entre la communication pour les « grandes causes nationales » (Sécurité routière, santé, sida...) et la communication politique au service d’un homme ou d’un gouvernement ? C’est bien là un des enjeux, et non des moindres, posés par la profusion de ce type de slogans : la communication gouvernementale et la communication d’intérêt général tendent à se confondre, au nom du syllogisme : un gouvernement ayant pour idéal l’intérêt général, toute communication gouvernementale est idéale, puisque d’intérêt général. Et ainsi, la confusion entre « action juste » et « action gouvernementale » s’instaure.
Jean-Claude
Colliard, ancien directeur de cabinet de Mitterrand (entretien, 1997,
[a])
— On a tendance à dater le développement de la communication
gouvernementale de la deuxième moitié des années 1970...
— Oui
[...] Cela va s’accélérer parce que c’est finalement un moyen
commode, presque légitime, volontiers présenté comme légitime, de
s’adresser à l’opinion. On ne parle pas de politique, on parle
de l’intérêt général.
— Qu’est-ce qui, selon vous,
différencie ce type de communication de ce qu’on appelait
autrefois la « propagande » ?
— La convenance de vocabulaire, car
c’est de la propagande. Mais « propagande » est un mot connoté
négativement, après notamment son utilisation par l’Allemagne
nazie. « Propagande », c’est la version noire de la communication.
Je ne crois pas qu’il y ait de différences de fond ; seulement le
terme est négatif, connoté et vieilli.
« L’invention » des campagnes d’information d’intérêt général a lieu dans la décennie 1970. La Sécurité routière[c] est la première en date. À l’origine, une réalité : l’essor de l’automobile après-guerre. La Prévention routière est créée en 1949, à l’initiative des sociétés d’assurances. Les premières campagnes publicitaires, privées, voient le jour, avec pour but « la préparation psychologique, par l’utilisation de tous les moyens modernes de propagande et le contrôle étroit de la circulation par des effectifs renforcés de police et de gendarmerie... »[a] Au fil des ans, les pouvoirs publics deviennent les maîtres d’oeuvre de la Sécurité routière, érigée en cause d’intérêt national : une délégation à la Sécurité routière est créée en 1972. Parallèlement, Simone Veil découvre les vertus de la communication : « Favorablement impressionnée par la campagne sur la Sécurité routière, Simone Veil met les mêmes outils médiatiques au service de la santé. »[a] C’est ainsi qu’est organisée, en 1976, via le Comité Français d’Éducation pour la Santé (CFES), la première campagne française de prévention contre le tabac recourant aux médias audiovisuels, suite à des rapports alarmistes de la Commission du cancer. Il faut recontextualiser la chose : soudain, des hommes politiques découvrent avec un ravissement certes assez compréhensible, qu’ils tiennent, avec la télévision et plus largement avec les méthodes importées de la publicité, une manière spectaculaire de s’adresser massivement aux citoyens... donc à l’électorat.
Jacques
Bille, chef du SID de 1978 à mai 1981 (entretien, 1997, [a])
— Un
axe qui est apparu quand j’y étais, c’est l’axe « comment
parler au grand public ». Plus aux journalistes, plus aux élus
locaux, mais au grand public, parce qu’il est apparu nécessaire de
parler. Dans notre arsenal, il y avait quelque chose qui s’appelait
« la communication du gouvernement », l’article 16 du cahier
des charges de la télévision. Cela donnait la possibilité au
gouvernement d’intervenir à tout moment sur les ondes publiques.
Il y avait des panneaux au début et à la fin de cette séquence qui
disaient : « Ceci est une communication du gouvernement. »
Alors apparaissait M. Peyrefitte (ou un autre !), derrière une table,
pour dire tout le bien qu’il pensait de telle ou telle mesure.
[...] Les premières actions de la Sécurité routière sont passées
au titre de la communication gouvernementale. C’est vrai qu’il y
avait une impasse : on ne pouvait pas utiliser massivement une
procédure qui devait rester exceptionnelle. On est donc passé à un
système de communication publicitaire.
Les équipes mises en place à la tête du Comité Français d’Éducation pour la Santé (l’actuel INPES), dirigé par Michel Le Net, qui lance les premières politiques de communication de très grande ampleur dans la seconde moitié des années 1970, tiennent à se démarquer des schèmes paternalistes et moralisateurs véhiculés par ce qu’on appelait jusqu’alors « l’éducation sanitaire ». En 1972, il est possible de découvrir, au détour de textes, des références explicites à Alexis Carrel, « de cela il n’est plus question par la suite : les délégués généraux à l’éducation n’ont plus rien à voir avec les professeurs d’hygiène. »[a] Les médecins se font moins nombreux, au profit d’une nouvelle catégorie : les spécialistes de sciences sociales (sociologues, psychosociologues, démographes, etc.). « Va émerger une doctrine de l’éducation pour la santé qui se stabilise dans les années 1980. Il s’agit de présenter les pratiques de prévention de manière “positive” et “libératrice” »[a], dont un exemple est la campagne de 1976 : « Sans tabac, prenons la vie à plein poumon ! » Tout le problème est là : c’est de la propagande, mais cela ne veut plus en avoir l’air. C’est de la com’. On ne fait plus la morale au citoyen, on lui fait croire qu’il est libre de tout. D’où l’utilisation de procédés rhétoriques pour le moins contestables — nous allons le voir —, et ce d’autant plus que ce n’est plus une ligue hygiéniste qui parle (rappelons que les initiatives privées de lutte contre le tabagisme sont anciennes, et étaient virulentes dès la fin du XIXe), ni un rassemblement de dames patronnesses, mais bien... l’État.
Jean-François
Kahn (table ronde, 1990[b])
— Ne nous masquons pas la réalité. La
communication en matière humanitaire, civique et sociale, c’est de
la propagande. Il faut le savoir et le dire. Or la propagande est un
art, avec ses règles qui doivent être respectées même s’il
s’agit de « bonne » propagande pour l’université, la santé, la
vie... Parmi ces grandes règles figurent le recours à l’émotion,
l’éveil de l’intérêt par la distraction, la provocation. La
seule différence avec la propagande tient à la finalité des actes.
Bien sûr, il y a la question : où doit-on tracer la limite entre le privé et le public ? Jusqu’où l’État est-il légitime ? Un point est assez intéressant, et assez peu évoqué : celui du mélange de bonne foi et d’aveuglement des responsables de cette évolution. L’ouvrage Bleu blanc pub, trente ans de communication gouvernementale en France[c], où s’expriment les hauts fonctionnaires, publicitaires des agences de com’ ayant mis en oeuvre ces campagnes, est à cet égard passionnant. On y découvre bien sûr une phraséologie à la gloire de la communication — on ne peut s’empêcher de citer cette phrase du politologue Stéphane Rozès : « Depuis la nuit des temps, celui qui communique éprouve le souci de s’assurer d’être bien entendu. Le Christ lui-même, rapportent les Évangiles, aurait demandé à ses disciples ce que l’on disait de lui autour d’eux. »[c] Mais ce livre est édifiant car il donne la parole « de l’intérieur » aux bâtisseurs de la communication politique. On découvre ainsi, face à l’essor du pouvoir des mass-médias dans les années 1970 puis 1980, la façon dont les hommes politiques ont participé à cette évolution globale de la façon de gouverner. Certains un peu naïvement, d’autres un peu à contre-coeur, beaucoup « pour la bonne cause », se posent tous plus ou moins la même question : comment parler à ce crétin de public ? Un exemple mémorable, oublié de tous : la baleine de la Sécurité sociale, qui donne lieu à ce dialogue, d’une franchise assez louable :
Adrien
Zeller, secrétaire d’État chargé à la Sécurité sociale en
1987, initiateur de la campagne sur les états généraux de la
Sécurité sociale. (entretien, 2009[c])
— Pourquoi avoir choisi
l’image de la baleine ?
— Il fallait capter l’attention alors
que, à l’époque, le sujet à la mode, c’était le sida. La
Sécurité sociale passait régulièrement à la trappe, sauf en cas
de polémique. La baleine était une bonne image. C’était un
animal gros, bienveillant, sympathique. Le but étant aussi
d’apaiser, cet animal, attachant, menacé, jouissait d’une très
bonne attractivité dans l’opinion. C’était marquant, sans
provoquer la panique.
— Quels sont les éléments déterminants
pour communiquer sur un « déficit » et la nécessité de faire des
efforts pour le résorber ?
— Je pense que les deux facteurs
déterminants sont le degré de maturité d’un peuple et celui de
ses médias. Aujourd’hui, il a un peu augmenté sur un sujet comme
la Sécurité sociale [...], mais malgré tout, on continue à
creuser le déficit alors que c’est profondément injuste.
Honnêtement, je pense qu’aujourd’hui je serais plus courageux.
Il faut arrêter la fuite en avant. [...] Il y a un vrai problème
avec la vérité. Il faudrait plus de débats de fond, avec des
experts.
La Sécurité sociale, le tri sélectif, le gaspillage de l’eau, les dépenses énergétiques, la nutrition... Autant de sujets où, plutôt que le courage et la législation, l’État semble faire une campagne de pub pour mieux occulter les débats de fond. Des campagnes qui disparaissent et réapparaissent au petit bonheur la chance. Ainsi les économies d’énergie, via un « Faisons vite, ça chauffe ! » (2008), les transports, « Le tram-ouais ! » (2003), la défense de l’environnement, « Ne prenons plus l’air à la légère ! » (1997), etc. Autant de jeux de mots stupides dont on se demande quel comportement ils ont bien pu modifier... La Sécurité sociale fut aussi grande pourvoyeuse de slogans [cf. encadré]. Tout est mis sur le dos du pauvre consommateur, obligé de se sauver et de sauver le monde grâce à sa poubelle jaune, sa poubelle bleue, ses médicaments génériques et ses cinq fruits et légumes. Du côté des médias, c’est le même leitmotiv : le public étant sot, comment parler au public ?
Jean-Michel
Gaillard, directeur général d’Antenne 2 de 1989 à 1991 (table
ronde, 1990[b])
— Peut-on espérer une meilleure place, dans les
médias, pour la communication d’intérêt général, et plus
particulièrement pour l’éducation civique ?
— La contrainte de
diffusion de l’expression directe des partis politiques et des
organisations syndicales, avant le journal de 13 heures, est une
catastrophe. Personne ne regarde l’émission. [...] Tout ce qui est
imposé, obligatoire et habillé comme tel, même avec une motivation
sociale, ne passe pas. Pour « passer » à la télévision, promouvoir
une cause et atteindre sa cible, il faut « faire de la télévision ».
Il n’y a que deux formules : soit choisir la forme de l’immédiateté,
concentré publicitaire, de l’ordre du clip, de l’impact pub,
fait par des publicitaires, travaillé dans cet esprit-là pour
toucher, sensibiliser et marquer, ou bien réaliser une émission qui
jouera sur la sensibilité du public et amènera, par le biais des
animateurs, des artistes, à prendre conscience d’une cause, [par
exemple le Téléthon]. Quant à l’idée du « publi-reportage » ou
du « rédactionnel », il faut s’en méfier. Le public accepte des
émissions sponsorisées par Procter&Gamble, le café Grand-mère
ou une lessive, sans aucun soupçon (et on peut considérer que c’est
un problème), mais lui parler du fonctionnement du Sénat dans une
émission sponsorisée par le président Poher, ou de la santé à
travers une émission du CFES, le fera fuir.
Ah ! si le peuple était moins bête... On notera la mauvaise foi de l’opposition entre « la pub » et « Alain Poher »... comme si le vaste entre-deux était voué à rester vacant. De la pub, de l’émotion, ou rien. Le débat public ? Impossible. C’est bien là un des problèmes graves soulevés : « Le refus d’accorder une place essentielle au pouvoir et aux relations conflictuelles entre les groupes sociaux. »[a] La communication institutionnelle est fondée « sur l’idée d’une « administration scientifique et non partisane de la vie politique »[a]. Avec le principe de l’intérêt général, les idéologies sont médiatisées de telle sorte qu’elles ne peuvent pas être considérées comme le résultat de préférences arbitraires... ou, précisément, comme la mise en œuvre d’idéologies. En clair : sous couvert d’intérêt général, du « cela va de soi », du « c’est le public qui veut ça », les évolutions sociales édictées par des idéologies politiques sont mises au rang d’évidences, et donc non contestables par la société civile. Exemples : « L’euro fait la force » (1997), « L’euro, c’est plus facile ensemble » (2001), mais aussi les affichettes à l’intérieur des bus disant « Souriez, vous êtes filmés », qui sous-entendent que le débat sur la vidéosurveillance a déjà eu lieu, et qu’il faut donc faire bonne figure.
Avant ou après l’action
On
a parlé, un peu, d’hommes politiques pétris de bonnes intentions
faisant appel à des communicants au nom du bien-être de leurs
administrés. Mais il faut aussi parler des cas où la communication
se substitue à la politique, ou la précède... Nicolas Sarkozy,
alors ministre de l’Intérieur, interviewé dans L’Express (17
novembre 2005), a eu ces mots : « La communication est à l’action
ce qu’est l’aviation à l’infanterie ; l’aviation doit passer
pour que l’infanterie puisse sortir ; c’est lorsqu’on a gagné
la bataille de la communication qu’on peut commencer à agir. »
Bernard Candiard, ancien chef du SIG [cf. encadré], ne disait pas
autre chose : « De la lutte antitabac à la Sécurité routière,
la communication d’avant l’action se voit dévolu le rôle
d’assurer une meilleure tolérance de la population aux mesures
coercitives. »[c]
Jean-Claude
Colliard (entretien, 1997[a])
— Le droit du public à l’information
sur les activités du gouvernement vous paraît-il également être
entré en compte ?
— C’est un habillage convenable. Le droit du
public, c’est la meilleure et la pire des choses. [...] Quand le
gouvernement fait une campagne de communication, ce n’est pas avec
la préoccupation essentielle du droit de savoir du public. Sa
préoccupation essentielle, c’est : « Est-ce que je peux montrer
que j’agis dans le bon sens pour faire remonter ma cote dans les
sondages ? » Il y a ensuite un discours de légitimation de la
pratique politique. On ne va pas dire : « Je mets dix millions
d’argent public pour faire monter ma cote de trois points dans les
sondages » ; on va dire : « Je mets dix millions parce que le
public a le droit de savoir ce que nous faisons et que cette
politique, qui est bonne pour l’intérêt national, ne peut réussir
que s’il y est associé. »
On rejoint là la question de la propagande : lorsque la communication dite d’intérêt général n’en a plus que les atours, via des procédés rhétoriques similaires — et notamment l’usage du « je » et du « nous ».
Jacques
Bille (entretien, 1997[a])
— Estimez-vous qu’il faut faire des
campagnes sur des mesures et pas sur des images ?
— J’ai
toujours été radicalement hostile à toutes les politiques
d’image. Je trouve qu’on ne peut pas utiliser l’argent public
à valoriser l’image. [...] Il est difficile de concevoir un chef
du SID qui ne soit pas en phase avec la politique menée. J’ai
longtemps rêvé d’un SID au-dessus des partis. Car si le chef du
SID fait de la politique, on est foutus. [...] Mais je reconnais que
c’est dur. Pour Mati- gnon, le SID, c’est une machine à
photocopier et à imprimer de grosse envergure, c’est une machine
à faire des argumentaires et à payer des sondages. Si vous
demandez à un préfet ou au directeur de cabinet de Matignon, le
SID, c’est cela. Il faut que le responsable du SID soit quand même
proche du Premier ministre, afin que, s’il se bagarre avec un
ministre, il ait un soutien. Mais cette proximité, il ne doit pas
l’utiliser dans l’autre sens, c’est-à-dire pour véhiculer un
message partisan, « propagandesque » et finalement sans intérêt.
Là où se sont un peu perdus quelques-uns de mes successeurs.
L’une des campagnes visées par les propos de Jacques Bille est sans doute « Pour nous, la France avance », destinée à valoriser l’action du gouvernement Fabius en 1985, et dont l’instigateur Joseph Daniel, chef du SID de l’époque, s’explique ainsi avec le recul :
Joseph
Daniel (entretien, 2007[c])
— La loi du 15 janvier 1990 ne permet
plus qu’un gouvernement réalise une campagne bilan en période
préélectorale, à l’image de « La France avance » en
1985, ou de « La France se redresse » menée par le
gouvernement Chirac en 1987. Êtes- vous favorable à cette
législation ?
— Dans le contexte politique et psychologique
actuel, avec des niveaux extrêmes de défiance des citoyens envers
les élus, et après les affaires de corruption qui ont marqué la
vie publique, je peux comprendre que l’on interdise aux pouvoirs
publics d’utiliser les moyens de communication publicitaires,
financés par les contribuables, pour valoriser leur action. Mais je
rappelle que « Pour nous, la France avance » s’est arrêtée
trois mois avant les élections. Je me refuse à regarder la
communication de 1986 avec les yeux de 2007. Le post-test de l’IFOP
indiquait d’ailleurs à l’époque que, si 37% des spectateurs de
la campagne pensaient que « faire ce genre de campagne, c’est
gaspiller l’argent de l’État », 50 % étaient de l’avis
inverse.
On notera que l’actuel directeur du Service d’Information du Gouvernement est Thierry Saussez, conseiller en communication chargé de la campagne Balladur en 1995, et de celle de Sarkozy en 2007... Comme neutralité, on aura vu mieux : il n’est pas anodin de placer à la tête du SIG un spécialiste de campagnes électorales, habitué à vendre des promesses.
La mesure de l’efficacité
L’histoire de la communication gouvernementale en faveur de la santé publique est émaillée de cette opposition entre le désir de maîtrise du vivant, gagé sur la science et les sondages, et l’étonnement face aux choix individuels. La campagne « Sans tabac, prenons la vie à plein poumon ! » voit le jour en 1976 ; c’est un échec : « Sans doute Michel Le Net et ses collaborateurs pensaient-ils que tout un chacun était aussi enclin qu’eux-mêmes à placer sa confiance dans les chiffres... L’expérience leur enseigna que les motivations humaines ne se laissent pas facilement saisir dans des dispositifs, aussi rationnels soient-ils, suscitant une perplexité croissante quant à une hypothétique mesure de l’efficacité des campagnes. »[a] Dans la volonté de manipuler les foules par la propagande, on voit ce qu’il y a en sous-main : un profond mépris. L’idée que si l’on fait varier les indicateurs qui conviennent, on fait faire ce qu’on veut au bon peuple. Voter, arrêter de fumer, etc. S’il est indéniable que le nombre de morts sur les routes a diminué, le doit-on vraiment aux campagnes d’information ? Il est permis d’en douter, le renforcement de la législation (port de la ceinture, limitation de la vitesse, radars) et les progrès techniques (voitures plus sûres, routes de meilleure qualité) jouant en ce domaine un rôle prépondérant. Lorsque Balladur avait pris le métro en 1995, il avait eu cette phrase mémorable : « Il fait chaud. » Si nos dirigeants devaient se contenter d’un verre, ça va, et prenaient un peu plus souvent les transports en commun parisiens plutôt que leur berline, nul doute qu’ils constateraient la maigre utilité des bulles multicolores ânonnant « Préparer ma sortie facilite ma descente »...
Jacques
Bille (entretien, 1997[a])
— Ressentiez-vous la nécessité
d’évaluer les effets de toutes ces opérations ?
— Oui, dès le
premier jour. J’étais assez obsédé par l’idée de pouvoir
rendre des comptes à tout moment, du fait que c’était de
l’argent public. [...] Cela explique la recherche assidue de
post-tests pour connaître les résultats. Je me souviens d’une
réunion sur les post-tests à propos d’une campagne d’handicapés,
sur le thème « Apprenons à vivre ensemble ». Que
voulez-vous évaluer sinon des scores sympathiques d’agrément ?
« Le problème vient de ce que, jusqu’à présent, personne n’a trouvé le moyen de mesurer précisément l’effet de la communication sur les risques de santé. »[a] Souvent, revient le leitmotiv « le problème, c’est qu’on sait pas mesurer... ». Alors même que l’on devrait se réjouir de ne pas pouvoir établir de telles mesures de... la liberté.
Jean-Michel
Gaillard (table ronde, 1990[b])
— Je suis toujours un peu inquiet
quand j’entends parler de maux sociaux et de la nécessité d’une
hygiène sociale. Cela me paraît conduire assez largement à une
logique de propagande et de contrôle social, ce qui m’effraie
toujours un peu. Cela s’est beaucoup fait au XIXe siècle, on n’a
pas pour autant résolu tous les problèmes.
Là où le processus est pernicieux, c’est lorsque l’usage mobilisateur du sondage crée l’illusion de l’adhésion : « La plus grossière des erreurs commises lors de l’évaluation d’une campagne de sécurité routière consiste sans doute à prendre pour efficacité réelle l’intérêt qu’elle a pu susciter dans la population et les milieux officiels. Il n’est pas possible d’évaluer le succès d’une campagne de sécurité d’après le nombre ou l’importance d’articles de presse, de lettres adressées aux journaux, de commentaires au Parlement ou de conversations entre amis et voisins ou autres manifestations d’intérêt à la suite des efforts déployés au cours de la campagne, pas plus qu’il n’est possible d’en juger d’après les compliments flatteurs adressés aux organisateurs. »[a]
Or, ce procédé est évidemment très largement utilisé par les agences de communication, qui justifient, ce faisant, de vendre leurs services soi-disant indispensables. Dans le registre inutile, on a ainsi quelques exhortations au civisme qui se suivent et se ressemblent : « Voter, c’est participer » (1983), « Voter, c’est exister » (1999), « Ne laissez personne décider pour vous. Votez », ou encore « Je pense, donc je vote » (1999) :
B.
Peltier, directeur du service de communication du Bureau Français
du Parlement européen [témoignage client]
« Préparer les
élections européennes de juin 1999 fut une entreprise exaltante.
Elle relevait a priori du mythe de Sisyphe tant le désamour
caractérise les relations entre les citoyens français et les
institutions européennes. Au regard d’un budget qui était de
surcroît faiblement doté (près de 450 000 euros), nous avons opté
pour un travail tout à la fois précis, ciblé et inventif. Des
champs qui n’avaient jamais été explorés jusqu’alors ont été
investis avec humilité mais conviction : le métro parisien, les
culs- de-bus strasbourgeois ou marseillais, les quais de gare en
province, les salles obscures de l’Hexagone, les péages
autoroutiers, certains groupes d’influence ont été des supports
efficaces de la campagne. » [www.precision.fr]
Voilà donc un exemple flagrant de com’ ayant débouché sur cette splendeur : une paraphrase misérable de Descartes facturée 450.000 euros, placardée sur les culs-de-bus strasbourgeois et marseillais... Nul doute que le taux de participation a dû s’en trouver profondément modifié... Dans d’autres cas, l’appel au vote n’est pas dénué d’arrières-pensées : ainsi le « geste de fraternité » appelant au vote lors du référendum sur la Nouvelle-Calédonie (1988) — où l’abstention (qui est traditionnellement forte lors des référendums) aurait marqué un fort désaveu de la politique menée par Michel Rocard.
La fin justifie-t-elle les moyens ?
Philippe
Breton [Le Monde diplomatique, mars 1997]
« Le domaine
politique n’échappe pas à cette contradiction qui fait que la
démagogie serait légitime si le programme politique est bon. [...]
Comment lutter contre la propagande de l’extrême droite quand on
ne condamne pas son emploi dans le camp démocratique ? Toute parole,
quelle qu’elle soit, se corrompt d’être diffusée à l’aide
de procédés manipulatoires qui ne respectent ni celui qui l’émet
ni celui qui la reçoit. Les normes qui permettraient d’opérer
une partition entre ce qui relève du respect et ce qui émarge à
la violence manipulatoire existent. Déjà la culture grecque de
l’argumentation, à peine inventée, les discutait. Depuis cette
époque, tout homme politique qui franchit par exemple la ligne
rouge de la démagogie sait qu’il le fait. »
La différence, c’est celle entre la législation, la règlementation, la persuasion, et la manipulation. La formule classique est la suivante : « Nul n’est censé ignorer la loi. » Or, progressivement, via la pensée du marketing où il s’agit de valoriser le « client », une nouveauté est apparue : il n’y a plus la loi, simple, claire, ni le règlement, mais bien une sorte de rhétorique floue, tour à tour culpabilisante, puis sympa, puis faussement menaçante. La loi, la simple loi, est censée être vieux jeu. Placarder un règlement (dans les transports en commun par exemple) ne suffit plus. La sobriété n’est plus de mise. Ce n’est plus « la validation du coupon est obligatoire », c’est « dans le bus je valibus ». La rhétorique du faux parler djeuns, où la collectivité parle... sans aucun respect à des jeunes dont elle se plaint bien souvent du manque de respect. Idem pour le « T’assures dans la vie, assure sur la route ! » On croirait voir un président « câblé » taper de façon condescendante sur l’épaule d’un jeune à capuche. Même son de cloche à propos de la nouvelle campagne de la RATP dans le métro parisien :
Matthieu
Jung, écrivain [Libération, 12 mars 2009]
« Les
communicants ont choisi le thème de la retombée générale en
enfance [...]. Nous avons subséquemment découvert, collés sur les
fenêtres des voitures, imprimés sur des bulles de bande dessinée
aux couleurs de l’arc-enciel, à destination des débiles légers
que nous sommes tous devenus, pourvus de cerveaux immatures habitant
des corps d’adultes, nous avons découvert des slogans tels que :
« Au signal sonore, je m’éloigne des portes. » Nous saisit
alors la nostalgie [...] des strictes, sobres et concises « règles
de sécurité et d’usage » pas pédagogiques et pas sympas,
[dont] le ton pas cool laisse planer des sous-entendus carrément
comminatoires. « La fermeture des portes est annoncée par un
signal sonore : ne plus descendre dès qu’il fonctionne ; ne pas
gêner la fermeture des portes. » Et voilà, c’était tout. »
Bref, les autorités ne parlent plus français. Un État paternaliste insupportable, qui fait copain-copain avec les citoyens, grâce à une poignée de « communicants ». Lesquels communicants, eux, pensent que « faut le faire parce que ça marche », tout simplement. Voyez plutôt : « En France, la politique, c’est sérieux. Pourtant, c’est le ton humoristique qu’a choisi volontiers le politique pour parler aux citoyens des sujets les plus difficiles. L’humour est aussi le ton privilégié quand l’État veut s’adresser aux jeunes. Dans la mesure où l’objectif de ces communications est ultimement de modifier les comportements, s’inspirer de la formule prêtée à Molière au sujet de la comédie, Castigat rigendo mores (« elle corrige les moeurs en riant »), peut en effet sembler judicieux. Au vu du succès remporté par l’humour bravache “En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées”, par l’humour potache de “Un verre ça va, trois verres, bonjour les dégâts” ou par l’humour grinçant de “Tu t’es vu quand t’as bu ?”, l’État semble avoir trouvé là un registre de communication efficace. »[c] L’efficacité : telle est la ligne de défense. C’est oublier un peu vite que la surprise générale créée par le ton de la campagne « Un verre ça va... », dans les années 1980, est passée. Et que cela ne fait rire plus personne, les slogans qui riment. Certains procédés confinent quant à eux à l’inutilité totale. Ainsi l’emploi du « nous », qui prend l’interlocuteur par la main, qui est bienveillant et évite la stigmatisation de telle ou telle personne. La Sécurité routière a ainsi trouvé : « Faisons la route ensemble » (1990), « Ensemble on est sur la bonne route » (1991), « Vous tenez le volant, vous tenez la solution » (1996). Jean-Claude Colliard (entretien, 1997[a]) — Considérez-vous que des « besoins de communication » s’imposent à un gouvernement ? — Les moyens matériels sont réputés être de l’intérêt général, puisque c’est de l’argent public. En réalité, il s’agit de mettre sous forme d’intérêt général une communication dont le but est finalement politique. Le gouvernement décide tout seul, dans un système où le débat parlementaire est quand même très diminué et n’a plus la même résonance qu’autrefois. Lorsqu’il y avait un débat parlementaire important, il y a vingt ou trente ans, il y avait trois pages du Monde ; aujourd’hui c’est traité en un quart de page. Donc il n’y a pas la même résonance.
D’autres structures langagières créent, en tant que telles, l’adhésion : c’est la base même de la propagande, de la manipulation psychologique des foules, que de savoir les manier. Les annonceurs sont des sophistes : des manipulateurs du langage. Beauté de la grammaire ! L’emploi du « je », par exemple, est un vieux classique, qui force l’interlocuteur à se sentir concerné, donc à accréditer n’importe quel message émis par le gouvernement. Tous les pays du monde ont eu recours au beau jeune homme plein d’entrain s’écriant peu ou prou « je m’engage ! », en temps de guerre. De même, l’exhortation sur un registre familier crée la familiarité, donc met en confiance le récepteur. Des affiches d’un parti extrémiste qui diraient : « L’étranger ? Il vole ton pain, te laisse pas faire ! » seraient convaincantes, au sens premier du terme : puisque l’énonciateur se permettant de parler au citoyen « sur ce ton » semble se soucier du bien commun. Évidemment, cela ferait scandale. Et pourtant... on n’en est pas si loin. Alors, que font les mouvements anti-pub ? Que fait la société civile ? Que font les parlementaires ? Mais c’est la force du peuple : il n’est pas aussi con que l’espèrent secrètement les publicitaires. Les citoyens, entourés de tels messages, ne les lisent même plus. Ne se révoltent plus. Finiront peut-être par, à force. En vertu du slogan : « Trop, c’est trop ! »
Bibliographie
a.
Quaderni no33, automne 1997, et notamment les articles de
Caroline Ollivier-Yaniv, Luc Berlivet et Séverine Decreton. Les
entretiens cités ont été réalisés par Caroline Ollivier-Yaniv.
b. Table ronde organisée à l’Assemblée nationale le 7 décembre
1990 par l’association Communication publique, sous la présidence
de Marceau Long, publié in : Revue française d’administration
publique no58, avril 1991.
c. Jean-Marc Benoît, Jessica Scale,
Bleu blanc pub. Trente ans de communication gouvernementale en
France, Le Cherche midi, 2009.
— Philippe
Breton, Serge Proulx, L’Explosion de la communication, La
Découverte, 2006.
— Caroline Ollivier-Yaniv, L’État
communicant, P.u.f., 2000.
— Michel Le Net, L’État
annonceur. Techniques, doctrines et morale de la communication
sociale, Les éditions d’organisation, 1981.
Qui parle ?
Aujourd’hui encore, les statuts des annonceurs de messages à vocation civique sont très divers. L’État et les collectivités locales, bien sûr. Mais aussi la RATP, l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, et l’INPES (ayant succédé au Comité français d’éducation pour la santé), établissement public placé sous tutelle du ministère de la Santé. L’Institut national du cancer est un groupement d’intérêt public, la Ligue contre le cancer est une fondation privée reconnue d’utilité publique. À différencier de l’ARC, une association. À cette surabondance des messages émanant du secteur non-marchand, il faut ajouter les entreprises se réappropriant les poncifs des messages d’intérêt général : ainsi les fabricants de voiture ayant « le réflexe citoyen », favorisant le « développement durable », etc. On ajoutera le cas, plus flou encore : JCDecaux, la société d’affichage publicitaire, a créé en son sein, en 1996, un « département des arts graphiques » ayant par exemple conçu la campagne ridicule « On est pas là pour se faire écraser », qui n’émane donc pas des pouvoirs publics. Pourquoi ? apparemment pour remplir les espaces d’affichage Decaux restés vacants... Conséquence : « Dans ses messages, la communication privée devient concurrente directe de la communication d’État. Un Français sur deux seulement parvient à identifier les vrais émetteurs des campagnes publiques auxquelles ils sont exposés. »[c]
La morale, l’argent et la presse
Sur le lien entre publicité et morale, qui mériterait un dossier à part entière, on citera la position de Jean-François Kahn : « On nous demande de passer des pages de pub pour les grandes causes, cancer, sida... Comme si cela ne coûtait rien au média... Sans comprendre qu’une pub gratuite équivaut pour le journal à un don. L’ignorance des interlocuteurs-annonceurs sur l’effort consenti par le média amène à exercer des pressions d’ordre moral qui peuvent aboutir à un effet secondaire à celui recherché. »[b] Autre problématique, le cas des campagnes gouvernementales qui, outre une autoglorification, seraient une aide déguisée à la presse. Claude Soula http://claudesoula.blogs.nouvelobs.com, billet du 22 mars 2009 affirme ainsi à propos des pubs clamant « Des mesures immédiates. Des mesures justes » : « Cette pub est autant une subvention publique pour les journaux, qu’une campagne de propagande. C’est une des conséquences des états généraux de la presse : le gouvernement, dans un grand élan de générosité (absolument pas désintéressé), a annoncé qu’il doublera le montant de ses investissements publicitaires dans les journaux, qui passeront ainsi à 40 millions d’euros par an. Cela va nous faire plein de campagnes progouvernementales à avaler ! Ce week-end, tous les quotidiens affichent donc cette propagande, juste après la grande manif anti-Sarko, pour faire un contrepoint. [...] Aucun patron de journal ne s’est demandé s’il était justifié oupas pour un État de subventionner la presse privée en faisant ingurgiter à ses lecteurs des campagnes aussi « orientées ». Ils n’ont plus les moyens de se poser ces questions d’éthique. Si on est optimiste, on se dira que ces « informations » ne servent pas à grand-chose, que c’est de l’argent foutu en l’air, que la campagne n’est pas assez originale ou bien conçue pour faire changer les opinions, surtout dans Libération. Si on est pessimiste, on se demandera si ce deal entre le gouvernement et la presse d’opinion negagnerait pas à être plus clair : si l’Élysée estime que la presse joue un grand rôle dans le débat démocratique, et qu’il faut donc sauver les quotidiens, n’existe-t-il pas des mesures d’aides plus directes que ces campagnes d’opinion ? Faut-il faire payer ainsi à la presse d’opposition et à ses lecteurs les subsides qu’on lui verse ? »
Le Service d’Information du Gouvernement ou SIG (anciennement SID)
Le SID (Service d’information et de diffusion) a été créé par décret en 1976 ; il a été renommé SIG (Service d’Information du Gouvernement) en 1996, sans que ses attributions officielles ne soient modifiées. Le SIG encadre la réalisation de campagnes de communication sur de multiples thèmes : France Télécom, la sécurité routière, le passage à l’euro, le traité de Maastricht, les plans de relance des gouvernements successifs... Grâce au label du SIG, les campagnes publiques bénéficient d’un abattement dans tous les médias sur l’achat d’espace.