


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


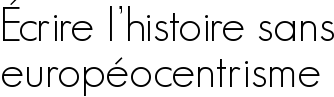
Entretien avec Romain Bertrand, historien spécialiste de l’Indonésie, auteur de L’Histoire à parts égales (Seuil, 2011).
Que sait-on de Java lorsqu’on n’en sait pas grand-chose ? Que c’était une colonie hollandaise. Fort de ce maigre savoir, qu’imagine-t-on de Java juste avant l’arrivée des Hollandais, en 1596, au terme de ce que l’on appelle la « Première Navigation » et dont le but était de s’assurer un accès direct au commerce des épices ? À peu près rien.
Rien, puis des Hollandais triomphants. «Cet oubli sélectif n’a rien d’une innocente inculture : il est la condition même de ce que nous avons appris à considérer, implicitement, comme la supériorité, innée ou acquise, de l’Europe sur le reste du monde. Bien sûr, l’européocentrisme [...] a muté : ce n’est plus de mépris, mais d’oubli de l’Autre dont il est question. Nous professons doctement l’égale dignité des civilisations, mais ne célébrons qu’un seul Panthéon de la pensée.» Puisqu’Untel a gagné, c’est qu’il devait gagner — qu’il ne pouvait en être autrement : c’est ce qu’on appelle être victime d’une lecture téléologique de l’histoire — déduire l’avant de l’après.
Le principe de l’écriture de L’Histoire à parts égales est on ne peut plus simple : ne pas se contenter de lire le récit qu’ont donné les Hollandais de leur périple à Java, mais lire aussi, voire au préalable, les écrits javanais et malais de la même époque. Ceci afin de redonner vie au contexte économique et politique de l’Insulinde à l’orée du XVIIe siècle et de percevoir comment, dans ce contexte, a été perçue l’arrivée des Hollandais. Et là, stupeur ! — ou évidence : « Dans les textes malais et javanais évoquant les Européens, l’indifférence le disputa longtemps à la moquerie. Le registre le plus souvent utilisé pour décrire le comportement des nouveaux venus fut celui de l’impair, du manquement protocolaire. » D’autant plus que la haute aristocratie javanaise, au nom de l’idéal de vie ascétique dont elle se réclame pour asseoir son statut social, a une piètre idée des commerçants arrogants (qu’ils soient hollandais ou non), dont elle se moque à longueur de textes.
Car ce n’est pas la grande « Hollande » qui a rencontré « Java ». C’est « une poignée de marins et de marchands sans manières » de la Compagnie unie des Indes néerlandaises orientales qui s’est installée aux portes du sultanat de Banten pour s’assurer le contrôle des épices. Au fil des textes où les marchands deviennent les personnages secondaires d’une histoire proprement javanaise, et où l’on voit s’effilocher la grandeur présupposée du colonisateur européen, c’est toute la complexité d’une société en proie à bien d’autres questionnements qui apparaît : « Qui oserait encore, au vu de tout cela, faire de Java un isolat lointain dont le destin aurait tout entier dépendu du rapport aux Hollandais ? » Le livre entre dans le détail des incompréhensions réciproques, des problèmes de traduction et de mesure, dans les cadeaux pingres des Hollandais et leur refus impoli des deux buffles offerts par leurs hôtes... On constate qu’en matière d’artillerie lourde, les Javanais n’avaient rien à envier aux armées européennes de leur temps. On suit le périple d’un traducteur qui fit un aller-retour jusqu’en Hollande et s’en revint à Java pour décrire les canaux gelés, la neige et les chevaux « bien joliment ornés de cloches et de cymbales ». On découvre les ruses des uns et des autres (comment obtenir un territoire immense alors qu’on a monnayé « un terrain d’une étendue égale à celle d’une peau de bœuf » ?).
La prétendue incapacité malaise ou javanaise à l’exactitude chronologique, la prétendue imperméabilité de la littérature insulindienne à la véracité des faits : Romain Bertrand balaie ces présupposés par le biais desquels tant d’historiens se sont dédouanés de donner le point de vue de la partie adverse. Les scribes de la cour de Mataram savaient bien mesurer le temps avec exactitude... mais ils n’avaient pas trouvé les Hollandais dignes de faire partie de leurs chroniques. « La rencontre impériale n’est pas une pièce de Racine : le principe de l’unité de temps et d’action, propre au théâtre classique, ne s’y applique d’aucune manière. L’idée même d’une rencontre comme duo ou duel, comme entente ou querelle “à deux”, relève d’un parti pris analytique qui se situe dans le droit fil des historiographies européocentristes. La réduction du monde de la rencontre à une confrontation binaire s’est opérée au moyen d’un patient travail de mise en forme. » La métaphore du plan large, utilisée en conclusion par Romain Bertrand, est d’une pertinence qui rend évidente, a posteriori, le biais qui est le nôtre à chaque fois que l’on lit l’histoire d’un point de vue unique : « Tout ici, bien sûr, est affaire de cadrage. Si la caméra filme en gros plan le face-à-face, le temps d’une audience, entre Houtman et le régent de Banten, voilà l’histoire javanaise confinée dans le réduit du rapport à l’Europe. Mais si le réalisateur opte pour un plan panoramique, et que surgissent en arrière-plan de la scène un marchand chinois venu du Fujian, un maître du port gujérati, un ouléma persanophone et un émissaire de Sukadana, alors cette histoire échappe déjà aux fictions européocentristes. Ce qui fait pencher pour le plan large, ce sont bien sûr les documentations elles-mêmes (malaises et javanaises aussi bien qu’hollandaises, portugaises ou britanniques), qui fourmillent de destinées mêlées, d’identités fluides et d’objets chamarrés. Vouloir faire rentrer à tout prix ces cohortes d’actants dans le cadre étroit d’une interaction en huis clos reviendrait à rien moins qu’à essayer de donner le bal du manoir dans un cabanon de plage. » Un cabanon de plage !
L.B.
Un entretien avec Romain Bertrand réalisé par Lætitia Bianchi le 07. X.2011
Je vous cite : « On n’en finit pas de s’étonner de lire, sous la plume d’un Fernand Braudel d’évidence victime de ses sources, que la Première Navigation fut “un périple triomphal” et se solda par l’occupation de Java en 1597 ! Tel fut probablement le discours prétentieux et revanchard tenu à l’époque par la Hollande auprès de Madrid et Venise, les concurrentes de toujours. » Vous montrez, à l’inverse, des Hollandais complètement en déroute...
Oui, c’est une épopée croquignolesque et tragique... En fin de compte, tout ça est assez minable ! Et on en a fait le premier épisode d’une histoire triomphale...
Vous étudiez donc la rencontre entre l’Europe et l’Insulinde du point de vue des sources européennes, mais aussi malaises et javanaises. Cette façon de décentrer le point de vue pour raconter l’histoire doit-elle être rattachée au courant historiographique qu’on appelle actuellement la « global history » ou la « world history » ?
Il y a des tas d’étiquettes — « histoire transnationale », « histoire connectée »... Mais les batailles d’étiquettes ne sont pas mon problème. D’autant plus que la « global history », ce n’est pas une chapelle... c’est plutôt une galaxie avec des milliers d’historiens aux méthodes très très différentes ! On peut ânonner « histoire globale », en appeler de manière incantatoire à « l’histoire connectée », et ne rien changer dans la façon d’écrire l’histoire... L’histoire globale ne cesse de nous dire qu’elle va nous décentrer, mais le fait est qu’elle ne va souvent guère plus loin que le bout de l’archive européenne. Je suis un spécialiste de l’Insulinde pour qui la venue des Européens en Insulinde s’appréhende à l’aune des sources insulindiennes, c’est cela qui change la manière d’écrire l’histoire.
C’est une démarche récente ?
Il faut se méfier des effets de mode éditoriaux. Les grands éditeurs se prennent d’engouement pour un type d’historiographie et le promeuvent en le présentant comme neuf... alors que ça a existé pendant des décennies dans une relative indifférence. On pourrait croire que l’histoire globale est une mode récente et anglo-saxonne, mais le fait est qu’elle est assez ancienne — et française — dans sa forme la plus exigeante, dont on parle ici — le fait de ne pas s’en tenir aux sources européennes. Les recherches ayant donné certains travaux remarquables remontent aux années 1970 : je pense à Denys Lombard, à Jean Aubin, ou plus récemment à Sanjay Subrahmanyam...
Et Kenneth Pomeranz ?
On présente à raison le travail de Kenneth Pomeranz comme une grande révolution historiographique. En France, on en a fait beaucoup usage, moi le premier. Tout le monde a entendu parler de Pomeranz...
Entendu parler, peut-être... Quant à le lire...
Ah oui, il y a des passages très arides, on n’est pas lancés sur les chevaux dans la steppe ! Pomeranz est historien économiste au départ. Alors oui, les annexes sur la distribution des mines de charbon... Mais sa thèse est très puissante. Contre la pensée européocentriste pour qui la modernité s’invente en Europe et en Europe seulement, Kenneth Pomeranz montre que jusqu’aux années 1750, pour peu qu’on s’entende sur l’échelle de la comparaison, l’Europe et la Chine ont un niveau de développement comparable.
Rappelant que « plus personne ne croit à la comptine lénifiante de Grandes Découvertes menées sans concours asiatiques ou amérindiens par des visionnaires solitaires », vous saluez d’autres ouvrages, dont Le Monde au XVe siècle de Patrick Boucheron...
C’est un miracle, ce livre... très cher, sur un sujet assez ardu, mais qui a eu du succès ! Ce qui montre qu’on peut faire des livres remarquables qui marchent, contre le discours du déclin inexorable, du public moins érudit... Je ne pense pas que le public français d’aujourd’hui soit plus bête que celui d’il y a trente ans... Simplement, il n’y a plus d’offre éditoriale pour lui.
Il y a de grands livres qui n’ont pas trouvé d’éditeurs ?
Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. C’est ça qui me désole : quand on parle de la crise des sciences sociales, c’est une crise de l’édition en sciences sociales. Il y a d’excellentes thèses qui pourraient donner de très beaux voire de grands livres. Mais les frilosités sont terribles. Le pessimisme est contagieux, et créateur d’effet de réalité. À force de dire qu’il n’y a plus de lecteurs, on finit par moins tirer, donc par ne plus publier... On tire à 2000 exemplaires aujourd’hui des ouvrages qui dans les années 1970 auraient été tirés à 15000 en première édition. Heureusement qu’il y a Le Monde au XVe siècle de Patrick Boucheron, ou encore Les Quatre parties du monde de Serge Gruzinski...
Revenons à vous : comment en êtes-vous venu à faire de l’histoire « à parts égales » ?
Je suis un spécialiste de l’Asie du Sud-Est. J’ai commencé par apprendre l’indonésien et par aller voir les sources malaises et indonésiennes. Et finalement, je suis allé voir les sources européennes après. On a dit que dans mon livre, la charge de l’exotisme basculait du côté européen. Or ça a été pour moi une expérience concrète : les mondes malais et javanais m’étaient beaucoup plus familiers que le monde des sources portugaises et hollandaises ! Lorsque j’ai commencé à collecter la documentation pour écrire ce livre, l’étrangeté pour moi était du côté européen.
C’est courant, l’apprentissage des langues pour l’accès aux sources ?
En histoire coloniale (ce sur quoi je travaillais), non. Parce qu’il y a une histoire de l’Indonésie, et il y a une histoire de la colonisation hollandaise de l’Indonésie... Et ces deux histoires dialoguent malheureusement très peu.
À ce propos, j’ai relevé une petite pique dans votre introduction : « Il fut un temps où l’histoire française, forte des acquis de son compagnonnage avec les spécialistes d’aires culturelles lointaines, avait ouvert ses fenêtres aux “vents du large”. Au vu de la diminution drastique de la part des études africaines ou asiatiques dans l’offre universitaire de recherche et d’enseignement, cet héritage semble, hélas, avoir été largement dilapidé. » Il y a un paradoxe : les spécialistes du reste du monde, depuis la décolonisation, où sont-ils ?
Vous avez raison... Jusque dans les années 1970, la pratique coloniale ordinaire (le fait pour un officier colonial d’administrer un district en Haute-Volta ou en Indochine) impliquait une compréhension minimale des sociétés locales et de leurs langues. L’orientalisme est né pour les besoins de la colonisation. Aux Pays-Bas, le premier titulaire de la chaire des langues malaise et javanaise, Snouck Hurgronje, est quelqu’un qui a formé les officiers coloniaux qui partaient en poste en Indonésie néerlandaise.
Pourquoi la France a-t-elle été si longtemps championne des études sur l’Indochine ?
Parce que ces compétences-là avaient un sens. Mais attention : les savants n’ont pas été les pourvoyeurs d’alibis faciles de la colonisation ; ils ont parfois été défenseurs acharnés contre les conquêtes militaires. Et puis jusque dans les années 1970-1980, il y a une histoire française qui est la grande École des Annales. Et l’EHESS, où sont tous les gens qui travaillent sur l’Afrique, l’Asie, l’Amérique latine, a été créée in fine dans le sillage du projet d’un Fernand Braudel, qui commence par écrire l’histoire de la Méditerranée... Ça c’est une histoire ouverte aux vents du large ! — dont l’acteur n’est plus un roi ni un peuple, mais un lieu. Et c’est une histoire qui embraye sur des histoires longtemps considérées comme périphériques, et pourtant centrales : l’histoire de l’Empire ottoman, de la régence d’Alger... Donc c’est vrai, il y a eu un moment où les aires culturelles étaient très intégrées à l’histoire française, puis un déclin, qui se voit concrètement sur le nombre de postes, de cours...
Alors même que l’on parle beaucoup de « mondialisation »...
C’est l’immense paradoxe d’une France saturée de discours politiques des uns et des autres nous disant que nous sommes confrontés au monde, que le monde est complexe, que la globalisation est ceci et cela, et qui en même temps affaiblit les ressources institutionnelles pour la comprendre. C’est-à-dire la formation aux langues rares et l’enseignement des cultures extra-européennes. Quant aux livres de philosophie... que des auteurs européens ! Alors non, parfois c’est risible, on y met un petit peu de Confucius et de Lao-Tseu. C’est un peu comme si on écrivait une histoire asiatique de la philosophie et que pour dire « n’oublions pas l’Europe ! », on y mettait côte à côte Platon et Hegel.
Bref, c’est un manque de curiosité ?
Oui. Ce qui m’irrite un peu, c’est quand j’entends dire que les chercheurs indonésiens sont assez peu au fait de la recherche européenne, française... On se demande pourquoi ils le seraient, ils enseignent à Surabaya et pas à Paris ! On a envie de dire : et vous ? Vous avez déjà lu un collègue indonésien ? Qu’est-ce qui vous permet de dire ça, et puis pourquoi serait-il forcément au courant de ce que vous faites ? Les systèmes académiques sont en effet assez cloisonnés. Mais ils le sont finalement partout. Nous, chercheurs européens, on a cette illusion que l’internationalisation, c’est, en gros, le rapport des autres aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, et à l’Europe continentale... comme si nous étions le cœur académique du monde. Et après il y aurait, comme ça, des surgeons : les Indiens, parce qu’ils sont passés par Cambridge... Mais quand on regarde la carte académique réelle aujourd’hui, deux des puissances académiques émergentes, en termes de production — mais pas qu’en termes quantitatifs...
...pas parce qu’ils sont plus nombreux !
...oui, pas parce qu’ils sont plus nombreux, mais en termes de renouvellement des questionnements, deux des grandes puissances académiques, donc, sont le Mexique et le Brésil — deux États qui ont énormément investi dans la recherche. Sur un campus de Mexico, il y a 200 000 étudiants, et ils ont le Colegio de Mexico, qui vaut le Collège de France. Aujourd’hui, le marché des publications de sciences sociales en langue espagnole est colossal. Idem pour le Brésil. Pendant très longtemps, le Portugal a fait l’histoire de ses anciennes colonies ou de ses anciens comptoirs... Aujourd’hui, le Brésil fait l’histoire du Portugal : des ouvrages sur le Portugal manuélin sont écrits par des auteurs de Sao Paulo ou de Rio. C’est une réalité que les gens en France ont du mal à percevoir. Donc la question n’est pas celle de nos remords... La réalité est que si l’on prend la Chine, l’Inde, le Mexique ou le Brésil, on a en termes d’effectifs d’étudiants, de chercheurs et de publications le vrai centre de gravité du monde académique. Alors évidemment, Oxford et Cambridge sont toujours considérés, même en Asie, comme valant mieux que l’université publique de Jakarta ! Mais il n’empêche qu’il ne faut pas se laisser prendre à l’illusion que nous sommes toujours le centre du monde. Je suis souvent frappé par le nombrilisme d’un certain nombre de collègues, qui ont de la peine à imaginer qu’en Afrique subsaharienne aussi il y a de grandes universités. À Dakar, il y a une grande université, avec une excellente recherche. En Afrique du Sud de même. Voilà... Je pense que le diagnostic sur l’état du monde académique, au sens du monde académique global, doit être révisé. Parfois, des collègues me disent : « hhhmm... (d’un air compatissant) tu vas à un colloque à Singapour ? à Dakar ? »..., comme si je partais aux confins du monde !
Petite pique encore, dans votre introduction, sur les programmes scolaires...
Rappelez-vous, à la fin de l’année dernière, cette immense controverse, tout à fait terrifiante... Une proposition avait été faite par les auteurs d’un manuel scolaire d’offrir le choix de travailler soit sur un sujet classique, soit sur l’histoire d’un empire africain médiéval : l’Éthiopie, le Songhaï, le Monomotapa... Et ce n’était pas spécialement mis en avant, c’était juste dire : pourquoi pas, sur tel tronçon du programme, parler de ça. Eh bien ça a provoqué une levée de boucliers incroyable ! Il y a eu des articles, en particulier dans Le Figaro, de professeurs d’histoire ou d’essayistes disant, mais c’est monstrueux, on ne va plus apprendre l’histoire napoléonienne, Clovis, tout ça ! Vous voyez qu’on part de très très loin — parce que ça aurait donné lieu, en termes concrets, à deux cours sur toute une année ! Or cela a suffi à faire un scandale et à geler la réflexion là-dessus. Et pourtant je pense qu’il y a une urgence pédagogique à ça. Parce que les enfants à qui on enseigne aujourd’hui sont des gens qui pour une part peuvent tracer l’histoire de leur famille en des lieux qui se situent en dehors de l’Europe. Est-ce que c’est légitime de ne leur parler que de l’histoire de l’Europe ? J’ai une grand-mère qui était d’origine kabyle. J’ai toujours appris dans ma famille que l’histoire de la Kabylie ne commençait certes pas avec l’arrivée des Français ! La Kabylie a été une grande province romaine dans l’Antiquité, a joué un rôle tout au long de l’époque moderne, a été sous domination ottomane, et l’Empire ottoman était autre chose que nos malheureuses petites cours provinciales... Alors quand on dit, il faut parler aux élèves de l’histoire de la France... coloniale, bon, d’accord, il vaut mieux en parler que de ne pas en parler. Mais en même temps, l’histoire de la Sénégambie ne commence pas avec l’arrivée des colonnes françaises. Et c’est important. Moi aussi je suis inculte en histoire africaine... et je suis rétrospectivement atterré par l’enseignement de l’histoire qu’on a eu à subir !
À l’inverse du discours catastrophiste sur l’école, on peut imaginer que les générations à venir vont voir apparaître des chercheurs dont les travaux seront enrichis par une double ou triple culture...
Probablement oui, tout à fait. Mais encore faut-il que l’université, et l’académie en général, les laisse formuler leur savoir dans des catégories qu’elle juge légitime. L’université, c’est aussi une formidable machine à formater... Un sujet de thèse : vous arrivez, très fier, c’est original, c’est flamboyant ! Puis vous rencontrez votre directeur de thèse, et une heure après vous sortez, votre sujet a été retaillé, coupé aux entournures, rogné... Vous pouvez arriver avec un magnifique sujet sur la Sénégambie et repartir avec un sujet de thèse d’histoire coloniale franco-française ! Mais bon, on a encore en France de grands spécialistes de l’Afrique, de l’Empire ottoman...
Et l’histoire produit des livres très novateurs en ce moment.
Oui, on a cité Sanjay Subrahmanyam, Denys Lombard... Il y a aussi Timothy Brook que j’adore, qui a écrit Le chapeau de Vermeer, ou encore Jonathan Spence, formidable historien littéraire. Son livre sur la rencontre de Matteo Ricci avec les mandarins chinois, Le Palais de mémoire de Matteo Ricci, est une expérience de lecture totale et déstabilisante. Spence a inventé, pour aller vite, le roman historique vrai, sans notes : tous les dialogues sont tirés de sources, mais données en fin d’ouvrage — le texte lui-même est écrit comme un roman. Ce qu’on ne sait pas faire en France. Mais bon... Si on a cité tous ces noms-là, c’est bien parce que quelque chose est en train de se constituer depuis le début des années 1990. Donc il y a un renouveau, c’est clair.
Je reviens à votre livre, qui s’attarde longuement sur un pan oublié de la pensée européenne. Je cite : « Le problème n’est pas que le Taj us-Salatin nous déconcerte ou que le Serat Cabolek nous laisse perplexe, mais plutôt que le Bruno de L’Expulsion de la Bête triomphante ou le Bodin de la Démonomanie nous étonnent. Car il n’est pas de hasard quand il s’agit d’oubli. [...] Si l’on trouve une même apologie de la prophétie et de l’astrologie comme arts de gouvernements dans les serat des poètes de cour de Kerta et dans la Cité du Soleil de Campanella, c’est que le lieu de l’exotisme n’est pas le monde malais ou javanais, mais ce moment si particulier que fut, d’un bout à l’autre de l’Eurasie, la fin du XVIe siècle. »
Oui : en gros, on a gardé Descartes... en oubliant qu’à la même époque, il y a tout un ensemble de pensées très différentes. Ouvrez le Banquet des cendres de Giordano Bruno ! C’est une vraie expérience. La mort de Bruno, c’est 1600 : la date fétiche du début de la révolution scientifique, de la modernité rationaliste — même si c’est évidemment un peu faux chronologiquement, c’est à un demi-siècle que ça se joue. Mais en tout cas, tel est le grand récit : le Siècle d’or. Ce qui a été effacé et mis à distance aux XVIIe et XVIIIe siècles, c’est un rapport particulier du savoir au corps. L’idée que le savoir peut s’acquérir en s’éprouvant, par l’épreuve physique. C’est ça, l’expérience mystique. Ce que décrit Michel de Certeau, quand il parle du « lieu de la parole mystique », quand il dit que le XVIIe va cantonner dans un tout petit lieu étroit (le livre) quelque chose qui auparavant était une dimension permanente. À un moment donné, on a cessé d’admettre que le corps puisse être le lieu du savoir. Or chez Giordano Bruno, il y a des appels à la connaissance qui font du corps le lieu du savoir, et c’est la même chose dans le monde javanais de l’époque. Dans les orthodoxies, la médiation est le lieu du savoir, qu’elle soit textuelle ou cléricale. Dans l’expérience mystique, c’est le corps. Et donc le savoir est douloureux — faites une semaine de jeûne, vous verrez que c’est douloureux... mais vous verrez aussi que vous apprenez ! Toute une tradition, qui a été celle des savoirs monastiques, s’est perdue. On l’a disqualifiée — et c’est parce qu’elle a été disqualifiée qu’elle nous paraît aujourd’hui si étrange. Alors dans les manuels de philosophie, j’aimerais bien qu’on nous mette des extraits de la Démonomanie des sorciers de Bodin et pas seulement ses écrits sur la constitution mixte... Même des grands noms, on les a retaillés aux entournures. On lit les Empires du soleil et de la lune de Cyrano de Bergerac comme un texte fantaisiste, onirique... alors qu’il a été montré qu’il parlait de l’état de la science de son époque.
Pour finir, j’en viens à quelques mots de votre introduction, qui m’ont étonnée : « Comme celles des salons feutrés d’Ancien Régime, les portes s’entrouvrent lorsqu’il est question d’art et de saveurs, car il est toujours de bon ton de s’émouvoir des arabesques des enluminures indo-persanes ou de s’étonner des trajectoires sinueuses du café, du cacao et du tabac. Mais elles se referment à double tour dès qu’il est question de choses sérieuses, c’est-à-dire de politique, de science et de philosophie. » L’art n’est-il pas le biais le plus direct pour en finir avec l’ethnocentrisme ? Par exemple, Serge Gruzinski a été commissaire de l’exposition « Planète métisse » au quai Branly...
Ce n’est pas contradictoire... Les enluminures indo-persanes... Bon, j’adore ça. Mais ce que je reproche à la plupart des expositions « orientalistes », c’est de mettre en avant la fascination esthétique. Et il y a des questions de mise en scène. Je rêve d’une muséographie qui renverserait les choses — où il y aurait le nom et les dates biographiques des sculpteurs africains, sur chaque pièce d’art dit « premier » (sic !) et à côté, un magnifique tableau de Giotto légendé : « civilisation italienne, XIII-XVIIè siècle »... Ces effets d’assignation assymétriques me gênent. Parce que la fascination esthétique, c’est du remords à bon compte. C’est très bien, l’émotion esthétique, mais ça ne nous dit rien... Faire au pas de course une exposition où on a vu de très belles enluminures, et se dire qu’on a vécu un voyage en étrangeté, je crois que c’est sous-estimer grandement l’épaisseur de l’étrangeté.
BIBLIOGRAPHIE
Denys Lombard, Le carrefour javanais. Essai d’histoire globale, EHESS, 1990.
Jean Aubin, Le latin et l’astrolabe, 3 vol., Fondation Calouste Gulbenkian, 2000-2006.
Kenneth Pomeranz, Une grande divergence, 1990, trad. Albin Michel, 2000.
[Pomeranz affirme que les « régions-centre » de l’Europe (l’Angleterre) et de la Chine (le
delta du Yangzi) sont des mondes « aux ressemblances surprenantes » : même densité,
même espérance de vie, institutions politiques favorisant le commerce et le développement
d’une proto-industrie, etc. Pomeranz explique le fait que la révolution industrielle ait eu lieu en Grande-Bretagne plutôt qu’en Chine par un hasard écologique et conjoncturel : la disponibilité des ressources en charbon dans le sous-sol anglais, et l’exploitation
du Nouveau Monde.]
Patrick Boucheron (dir.), Le Monde au XVe siècle, Fayard, 2010.
Serge Gruzinski, Les Quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, La Martinière, 2004.
Jack Goody, Le vol de l’Histoire, 2006, trad. Gallimard, 2010.
Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Armand Colin, 1949, rééd. « Livre de Poche », 3 tomes.
Sanjay Subrahmanyam, The Career and legend of Vasco da Gama, Cambridge, Cambridge
University Press, 1998.
Timothy Brook, Le chapeau de Vermeer. Le XVIIe siècle à l’aube de la mondialisation, 2008, Payot, 2010.
Jonathan Spence, Le Palais de mémoire de Matteo Ricci, 1984, Payot, 1986.
Serge Gruzinski (dir.), Catalogue de l’exposition « Planète métisse », musée du quai Branly | Actes Sud, 2008. Cf., sur le rôle des images, l’entretien de Serge Gruzinski, dans la revue Tracés, n°12, 2007.