


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


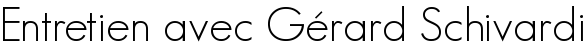
Gérard Schivardi, on vous a découvert en 2007. Maire de Mailhac, un village de 400 habitants dans l’Aude, artisan maçon, candidat aux élections présidentielles... Comment en êtes-vous arrivé là ?
Mon parcours politique, il a commencé à l’âge de huit ans. Mon grand-père était un immigré italien, qui avait été très mal reçu par la France. À l’époque, on se faisait traiter de macaronis, il y avait beaucoup de mépris. À huit ans, je lui avais dit : « Écoute Papy, un jour je serai maire de Mailhac pour montrer qu’un petit-enfant est capable, au moins, d’arriver à être maire dans ce pays. » En 1989, le maire est venu me proposer d’être sur sa liste. J’ai fait six ans comme conseiller municipal, six ans comme second adjoint, et en 2001, on m’a demandé d’être candidat en tête de liste. J’ai été élu maire en 2001 ; il y avait une liste concurrente. En 2008, j’ai été réélu, et là il n’y avait plus qu’une seule liste : il faut dire qu’en 2001, il y avait une équipe formidable, et l’équipe actuelle est une super-équipe aussi. On a tellement bouleversé le village, on l’a tellement transformé, que les gens n’ont pas voulu se présenter contre nous. J’ai aussi été élu au conseil général en 2003.
En 2002, j’avais créé un comité de sauvegarde des communes et des services publics, qui regroupe un peu plus de 4000 conseillers municipaux dans le pays. Au mois d’octobre 2006, on fait une manifestation à Paris contre les lois d’intercommunalité forcée, pour la défense des communes. J’avais réuni une quarantaine de copains maires. À la fin de la manifestation, on s’est réunis, et on a discuté un petit peu de ce qu’on savait des programmes des candidats présumés sur ces questions. Et rien ne correspondait à ce qu’on attendait. Là, des copains maires me disent : « Tu t’es occupé de ce comité de sauvegarde, présente-toi aux élections présidentielles. » Je suis resté très... très surpris, hein. Bon. J’ai dit : « Laissez-moi un temps de réflexion. » J’ai eu la chance que ma femme soit là : je les ai laissé discuter entre eux, on est partis dehors tous les deux. Je lui ai demandé : « Qu’est-ce que tu en penses ? - Tu te rends compte, quand même ? - Écoute, on verra bien. » Je suis retourné à la réunion, et je leur ai donné mon accord.
Vous êtes alors partis à la recherche des 500 parrainages pour être candidat ?
C’était déjà tard, on était en novembre, mais ça s’est fait très rapidement. Dans le groupe des maires, il y en avait une dizaine qui étaient au Parti des travailleurs, dirigé par Daniel Gluckstein, qui s’était présenté en 2002. Le parti a proposé de me donner un coup de main en mobilisant son réseau de militants. Ils ont contacté les maires de ma part, avec un courrier que j’avais fait. En trois semaines, on était à 570 : on avait une marge de 70 au cas où...
Mon seul regret, c’est que j’aurais dû attendre le dernier jour pour les déposer. Parce que dès que j’ai fait l’annonce officielle, là-haut ils se sont dit : « Qu’est-ce que c’est que ce type-là ? » Et vite vite ils se sont mis à distribuer des parrainages de manière à ce qu’il y ait plusieurs candidats non issus des grands partis. Vous aviez Le Pen, Chasse, pêche, nature et tradition, Besancenot, et Bové qui étaient en difficulté. Si j’avais attendu, ces quatre candidats n’y étaient pas. D’un autre côté, vis-à-vis de ma population, je ne pouvais pas attendre le dernier moment. Ils ont été tellement heureux, les gens du village, d’avoir un candidat à la présidentielle...
Est-ce que vous étiez prêt à être exposé médiatiquement ?
On en a parlé avec ma femme. Je lui ai dit : « Je vais en prendre plein la figure, est-ce que tu te sens capable de supporter ce qui va se dire ? Et qu’est-ce que tu penses pour nos deux fils ? » Elle m’a répondu : « Si ça te fait plaisir, vas-y. Les enfants, je vais m’en occuper. » La seule chose qu’elle m’a demandée, et que j’avais prévue, c’est qu’une fois par semaine, quoi qu’il arrive, je sois à Mailhac. J’arrivais le soir, le lendemain matin je passais à la mairie. La secrétaire me mettait tout ce qu’il y avait d’important, mes adjoints se sont mis à disposition, ce problème je l’avais réglé. Mais elle tenait à ce que je fasse deux repas par semaine à la maison, ce qui était tout à fait normal. Au début, le plus jeune de mes fils avait dix-sept ans. Pour discuter avec lui, le préparer, par rapport à ses camarades, tout ce qu’on pourrait dire comme conneries.
Entre ce que vous aviez imaginé et ce qui s’est passé, il n’y a pas eu de différences ?
Non. La seule mauvaise surprise que j’ai dû avaler comme un con, c’est le mensonge de Claire Chazal - et je lui ai dit en face. Elle avait dit au 20-Heures : « L’extrême-gauche présente un candidat. » Ce n’est pas vrai, je suis un républicain. J’ai passé ma vie au parti socialiste. En 2003 je l’ai quitté parce que je me suis présenté aux cantonales contre un candidat socialiste. Je suis pour la propriété privée... Il y a énormément de choses pour lesquelles je ne suis pas d’extrême-gauche. En toute honnêteté, je commence à peine à savoir qui était Trotsky.
Si vous vous étiez présenté tout seul, sans le soutien du Parti des travailleurs, on ne vous aurait pas collé cette étiquette-là.
On ne peut pas, en France. À cause des signatures. Ou alors il faudrait commencer deux ans avant la campagne, aller faire du porte à porte dans toutes les mairies. Ce n’est pas possible. Si vous n’avez pas une structure qui vous accompagne, dans notre pays vous ne pouvez pas vous présenter. Maintenant, s’il y a une nouvelle candidature, elle sera soutenue par le Parti ouvrier indépendant. Un nouveau mouvement que nous avons créé, avec Daniel Gluckstein et d’autres personnes de la société civile. Un vrai parti républicain, qui n’est pas du tout le Parti des travailleurs... Et qui est contre l’Union européenne, alors que tous les partis sont pour l’Union européenne. Je suis pour l’Europe des peuples libres, fédérés entre eux. C’est tout à fait autre chose. D’ailleurs, une des grandes surprises de la campagne, c’est quand j’ai déclaré : « Je rejoins de Gaulle, qui au début prêchait pour Europe des nations libres, pas une Union européenne. » De Gaulle se réveillerait aujourd’hui, il serait fou.
Alors que vous étiez un inconnu auparavant, on s’est brutalement mis à entendre parler de vous quand il s’est avéré que vous aviez les 500 signatures.
Ça a été l’affolement. Le jour où Debré a annoncé à la télévision les candidats officiels, en moins de vingt-quatre heures il y a eu cent appels téléphoniques de médias à la mairie. Radios, télés, journaux, autant de France que de l’étranger, à se battre... La secrétaire de mairie, elle craquait. Devant la mairie, vous aviez toutes les télévisions qui se battaient pour essayer de m’interviewer. C’était fou. Or le corps du programme, ils le connaissaient : du moment où on a lancé la candidature jusqu’au moment de l’annonce officielle des candidats, je ne me suis pas caché !
Et comment avez-vous géré ce changement de rythme ?
Je vous le dis en face : j’ai pris des vacances. C’était cent fois moins stressant et fatigant que mon métier. Les autres candidats, ils étaient fatigués, ils n’en pouvaient plus, ils se shootaient, moi je ne me suis jamais shooté. J’ai passé ça comme des vacances, studieuses parce que je n’étais pas formé à ça. Mais j’ai un principe dans la vie : on est tous égaux. Alors rien ne m’effraie, rien ne me dérange. Moi je m’en fous de la politique, en tant que rapport personnel. Je me bats surtout parce que j’ai deux fils et que je veux que le pays s’en sorte, c’est tout. Après, je ne ferai pas carrière ou quoi que ce soit. Si, par hasard, je repars en 2012, ça sera la dernière fois.
Vous parlez de vacances, mais il faut bien que la campagne soit un peu organisée. Comment est-ce que ça se passe, techniquement ?
J’ai un ami qui est au Conseil d’État, qui s’est occupé de tout ce qui est juridique, qui me donnait les renseignements là-dessus. Un autre ami s’est occupé des déplacements. On avait fait le planning des réunions, des meetings. Il a contacté une agence de voyages, qui s’est occupée de tout ce qui est transport, logement...
Ensuite, il y avait deux membres du Parti des travailleurs. Un qui s’occupait des médias, et puis un autre, un ancien chauffeur de taxi parisien, qui connaissait Paris par cœur et s’est mis à ma disposition pour me conduire en voiture de studio en studio. Et voilà, c’est tout, un chauffeur, et un ancien journaliste qui connaissait très bien les médias, qui réceptionnait toutes les demandes, et qui me disait : « Gérard, il faut aller à TF1, à France 2, à Canal +, est-ce que tu acceptes ou pas », parce que parfois je n’acceptais pas. Il y avait des émissions que je trouvais tellement ridicules que je ne voulais pas y aller. Je considère que la candidature à la présidence, ce n’est pas de la rigolade. Par exemple, comment il s’appelle, Ruquier, je considère que, avec la situation du pays, ce n’est pas possible. On m’a dit : « Il faut y aller », mais j’ai refusé.

Dans un reportage que j’ai vu, on vous voit accompagné, certainement par ces deux personnes, et l’un dit : « Il dort chez l’habitant. » C’était vrai, ça ?
Oui. Là aussi, j’ai un principe : ne pas dépenser l’impôt. Dès que j’ai eu les parrainages, j’ai demandé officiellement qu’on me dise le montant total de remboursement auquel avait droit un candidat. On m’a dit : « Le maximum, c’est 700000. » À partir de là, j’ai fait en sorte de ne pas arriver à 700000. Et j’ai fait 696000. Partout où j’allais, pour un meeting, je téléphonais, je demandais à des citoyens lambda s’ils pouvaient m’accueillir. Dès fois, c’était dans ma famille, d’autres fois, chez des amis, des amis d’amis. J’ai dormi une seule fois à l’hôtel, à Paris. Je finissais très tard, et je devais repartir de bonne heure. C’est l’hôtel qui touche la gare de Lyon, le Mercure, je crois. Je suis arrivé à deux heures du matin, le concierge était tellement heureux de me voir qu’on a discuté jusqu’à quatre heures, et je devais repartir à six heures ; j’ai pris une douche, et je suis parti, voilà ma nuit à l’hôtel à Paris. C’est ce je raconte souvent : j’ai travaillé au forfait quand j’étais jeune, je suis capable de m’endormir en trois minutes, pour me reposer. Donc, dans le train, je me reposais. C’est l’habitude de la vie de travail.
Les comptes officiels de campagne montrent en effet que vous êtes celui qui a le moins dépensé. Mais, sur les 696000, vous avez 233000 de déplacements, hôtellerie, restauration. Ce qui vous fait 33% du montant total. Évidemment c’est parce que le total n’est pas élevé, mais en moyenne pour tous les candidats, ce poste ne compte que pour 3% des dépenses [1]
Parce que j’étais en bas [dans le Sud]. Eux, ils sont en haut, ils habitent Paris. TGV, avion, je ne vous dis pas combien de fois. Je me rappelle avoir fait un meeting à Marseille, de Marseille prendre un avion pour aller à Nantes, de Nantes prendre un avion pour aller à Lyon. Pff... les déplacements !
En plus, dans ce que vous dites, il y a la recherche des parrainages, parce que j’ai remboursé tous les gars qui ont pris la bagnole, qui ont fait cent bornes pour aller voir des maires. J’ai tout remboursé. Je ne voulais que des gens y soient de leur poche. Alors qu’il y en a qui ont dépassé largement, qui auraient même dû être invalidés. Le président de la République, logiquement, il ne devrait pas être président de la République. [2]
Il faudrait fixer un plafond d’un million d’euros pour tout le monde. Et quiconque le dépasse est foutu dehors. Ils ont fait plus de vingt millions d’euros, attendez, combien de gens on peut nourrir avec ça ? Combien de logements on peut faire pour les mal-logés ? Hé oui.
Vous avez senti, pendant la campagne, que les gens commençaient à vous connaître ?
Ah oui, oui. Et ça continue de plus en plus. Le nombre de personnes qui m’écrivent... J’avais demandé à Daniel Gluckstein, qui s’était présenté pour le Parti des travailleurs en 2002, comment ça s’était passé, les élections. Il m’avait dit : « Six mois après, c’est fini, rideau, tranquille et tout. » Moi, trois ans après, ça continue.
Alors ça, avec ma femme, on en parle encore. Parce que je ne peux aller nulle part. Au bout d’un moment, il y a toujours quelqu’un qui vient. Les gens sont très gentils, je le dis honnêtement. Je n’ai jamais eu quelqu’un qui m’attaque, les gens sont très gentils, très cool avec moi, très polis, mais je ne peux plus aller nulle part en étant tranquille, au sens propre du terme. Mais c’est bien, parce que ça permet de discuter avec des gens. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c’est des centaines de personnes, je ne parle pas de dizaines, partout, qui m’arrêtent. Bon, alors, on s’y fait. Je n’ai rien à cacher.
Les gens, je suis comme eux. Je vis comme eux, je travaille, les fins de mois parfois me font me dresser les cheveux sur la tête. Et puis peut-être mon physique est passe-partout plus facilement, je ne sais pas. Je le vois bien, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et les jeunes ! Beaucoup, les jeunes !
Ça fait plaisir, honnêtement. Je serais menteur si je disais le contraire. Ça fait plaisir. Ça veut dire aussi que ça a marqué. Quel que soit le résultat de l’élection. Ça a marqué. Les gens s’aperçoivent que... Et puis, bon, il faut parler de Canteloup, aussi. Canteloup accentue ce côté convivial.
Oui, depuis la présidentielle Nicolas Canteloup vous imite régulièrement, sur Europe 1 et dans son spectacle. Mais c’est une imitation un peu caricaturale, non ? Vous êtes présenté comme un chasseur, un ivrogne.
Au début on m’avait dit : « Il y a un imitateur qui te fait passer pour un ivrogne », j’ai appelé mon épouse, j’ai dit, il faut que tu regardes dimanche l’émission de Drucker. Elle m’a appelé, elle m’a dit : « C’est une catastrophe. » Mes enfants et elle l’ont très mal pris.
Mais, après, je l’ai rencontré. Chez Drucker, une émission spéciale Canteloup, Drucker m’avait téléphoné en me disant : « Je souhaiterais que vous soyiez là », bon, avec son baratin. Je suis monté. Je peux vous garantir que Canteloup est quelqu’un de très réservé, très timide, et quand je suis arrivé au théâtre où ils enregistrent, dès qu’il m’a vu, la peur de sa vie. Mais alors, la peur ! Quelqu’un m’avait dit : « Monsieur Schivardi, la personne qui écrit tous les textes de Canteloup, il est de l’Aude. Caverivière, il s’appelle. » Donc je me le suis mis derrière la tête, ça. Et, au moment où je suis passé à l’émission, j’ai adressé mes remerciements à Caverivière, parce que Canteloup n’est que l’interprète de ses textes. Et Drucker a essayé, parce qu’il est coquin, plus encore que Canteloup, il a essayé de m’embarquer sur le fait que dans Caverivière il y avait « cave ». Et j’ai répondu : « Mais monsieur Drucker, il y a rivière, rivière c’est de l’eau, vous tombez mal avec moi, je ne bois pas l’apéritif. »
Mais cette façon d’être caricaturé masque totalement le fond de votre discours ?
Je pense que les gens font la part des choses. Parce que dans cette émission de Drucker, j’ai remis les choses en place. Sur le ton de la plaisanterie, bien sûr, mais j’ai quand même dit que je ne buvais pas, que je ne chassais pas.
Et puis ça me permet de maintenir le nom. Hé oui... Je pense que Canteloup a bien compris. Je l’ai eu au téléphone il y a quelques jours. La première question qu’il m’a posée, c’est : « Est-ce que tu seras candidat ? » Ce n’est pas dénué d’arrières-pensées. Il se dit : « Si je peux l’aider, si je peux faire disparaître Chasse, Nature et tradition, ou les faire passer pour... Et lui permettre à lui continuer à avancer tranquillement... »
Comment avez-vous vécu les nombreuses interviews que vous avez donné pendant la campagne ?
Il y un article sur internet : « Schivardi, la terreur des plateaux ». J’étais trop à l’aise, les journalistes n’arrivaient pas à comprendre. Ils ne savaient plus quoi me poser comme questions, ils avaient peur des réponses. Voilà, j’étais à l’aise.
J’ai trouvé ça extraordinaire. J’ai vécu des moments que tout Français ou Française mériterait de vivre. Par exemple, quand vous ne connaissez pas les plateaux de télévision, que vous passez trois, quatre, cinq fois par jour sur un plateau... Quand vous recevez les grands noms du journalisme, avec qui vous avez des discussions pendant des heures, et que vous vous apercevez que quand vous leur expliquez le pourquoi du comment de la chose, tout à coup ils réalisent que depuis des années ils disaient des conneries. Ce qui n’empêche pas qu’ils continuent à dire des conneries quand même, il faut être clair... Mais j’ai eu des rapports avec certains qui me disaient : « C’est vrai, vous avez raison, on n’avait pas pensé que... »
Mais vous donniez l’impression de ne pas forcément bien maîtriser le rapport au temps dans les émissions. De ne pas vraiment aborder le fond des choses.
Ça, ça ne se reproduira pas la prochaine fois si je suis candidat. J’ai appris... Et maintenant, je suis entouré de gens plus près de ces problèmes-là... Et puis en fonction de ce que j’ai ressenti... Ça ne va pas se passer comme ça. C’est pour ça que j’ai dit qu’il manquait un mois ou deux. Parce que, au fur et à mesure où ça avançait, des gens sont arrivés vers moi, pas du Parti des travailleurs, et ils m’ont fait toucher du doigt : « Regarde ça, fais attention à ça »... C’est un apprentissage comme un autre.
Par exemple, la première question qu’ils me posaient, c’est : « Vous êtes trotskyste ? ». Ils ne la poseront plus, parce que je ne répondrai pas, j’attaquerai directement sur le programme. Or je répondais là-dessus. Les deux minutes où je répondais manquaient après. Ça, je l’ai emmagasiné.
Qu’avez-vous pu changer en cours de campagne ?
Je me rappelle d’Elkabbach... Il m’appelle un matin à huit heures pour un direct dans le journal... J’étais rentré à vingt-trois heures la veille, je préparais le budget de la commune. J’ai répondu, mais je m’en foutais... Honnêtement. Et lui en a profité. Et j’ai des amis dans l’audiovisuel qui m’ont dit : « Quand tu montes à Paris, accorde-nous une après-midi. » Ils avaient tout enregistré, et ils m’ont expliqué vers quoi, avec ses questions, il voulait m’emmener. Ensuite, il m’a interviewé à Europe 1. Bon, je suis arrivé une heure avant, on est reçu dans son grand bureau... aussi grand que la mairie, il est là, franchement imbu de sa personne, sa secrétaire, un petit café, bonjour-bonjour, et puis moi, pas un mot. Il ne savait pas comment faire... « Alors, monsieur Schivardi, tout va bien ? - Oui. » Et quand on s’est levés pour aller faire l’interview, au milieu de la rédaction, je voulais que les journalistes entendent, je me suis tourné vers lui, et je lui ai dit : « Maintenant monsieur Elkabbach, ça ne va pas se passer comme l’autre fois à la radio, hein. - Comment ? - Non, ce coup-ci, je vous ai en face. » Parce que c’est des vicelards... Il avait amené au feu deux jeunes journalistes qui devaient me poser des questions, et une journaliste qui était à Bruxelles. Cette émission, elle vaut de l’or : à mes yeux, ça a été la meilleure, à ce niveau-là. En plus j’ai pu mettre un contrôleur à la voix, derrière, pour interdire qu’ils modifient ma voix. Parce qu’il y avait eu des manipulations de son, partout. Et Elkabbach, il n’arrivait pas à me poser des questions. C’était rigolo, parce que la fille, depuis Bruxelles, me posait des questions sur l’Europe. J’étais tellement tranchant qu’il a commencé à prendre peur, il faisait des grands signes, je pensais qu’il avait un problème d’écouteurs, en réalité il voulait qu’on me coupe, et ils n’ont pas pu couper, parce qu’il y avait le gars qui les surveillait. Ce qui fait que la fille, je l’ai complètement enterrée sur l’Europe.
Votre voix était remixée ? Pourquoi ?
Pour qu’elle soit incompréhensible. Un jour, un copain m’appelle de Lille, me dit : « Gérard, j’ai rien compris de ce que tu as dit à la radio. » Et j’avais un meeting à Lille. Salle comble. Une fois que j’ai eu fini, j’ai posé la question à la salle : « Est-ce que vous m’avez compris ? » Tout le monde m’avait compris. Or, quarante-huit heures avant, ils n’avaient pas compris. C’est pour ça que j’ai eu un doute, j’ai appelé un copain, et je lui ai demandé de me filer un coup de main jusqu’à la fin de la campagne. À partir de cette émission-là, il m’accompagnait, un ingénieur du son, de très bon niveau : il rentrait dans le studio et vérifiait qu’on ne manipulait pas le son. Et tout a été modifié, croyez-moi.
Est-ce que vous ne manquiez pas de moyens, de militants ? Je pense à vos spots de campagne, qui étaient quand même du bricolage absolu. Vous êtes sur la place de la République, on ne vous entend pas...
[gros soupir] Je n’avais pas envie de le faire... Ça, il faudra le modifier, parce que j’ai tiré des conséquences de tout ça. Ce que j’aime, c’est le débat, pas tout le cinéma médiatique qu’il y a autour de l’élection. Moi, je préfère un studio, les candidats sont là, et on y va.
La campagne officielle, c’est tout un cirque qui se met en place pour favoriser les grands partis qui ont les moyens financiers de faire.
Vous auriez pu le faire en studio, il y a bien les moyens de France 3 qui sont mis à disposition, non ?
C’est compliqué... Et puis, ce n’est pas ça qui m’intéresse... Ce qui m’intéresse, c’est le débat, c’est ce qu’on fait là. Et avec des gens, et avec les candidats. Par contre, si on y retourne, à partir de 2011, vous n’aurez pas fini de me voir.
Ce qui vous gêne, avec la com’, c’est de devoir simplifier le message ?
De ne pas dire la vérité.
Mais on peut la dire vite.
Ce n’est pas ça, la vérité. La vérité, c’est de discuter. Il y a des solutions...
Lorsque vous avez déclaré, avant le premier tour : « Si on avait eu un mois de plus, on aurait pu créer la surprise », ce n’était pas exagéré ?
Quand je parlais de surprise, ce n’était pas pour l’élection présidentielle. Parce que le système électoral français est fait pour que... Mais on aurait eu un mois de plus, je vous garantis qu’on aurait fait mal. Parce que, plus ça avançait, plus il y avait du monde. Et du monde qui comprenait. D’ailleurs, ça continue. C’est pour ça que je vous dis : « Attention. » Dans vingt, vingt-cinq ans, le Parti ouvrier indépendant deviendra le parti phare de notre pays. Ils pourront faire ce qu’ils veulent : ils peuvent boycotter, ils peuvent interdire, massacrer, chercher des histoires de midi à quatorze heures... Les gens commencent à comprendre. Un pays qui n’a plus d’agriculture est un pays qui meurt. Il faut mettre en premier le ministère de l’Éducation nationale, en deuxième la Recherche, en troisième le ministère de la Culture. Et l’identité nationale : ils sont menteurs, tous. Ils savent très bien que la politique de l’Union européenne, c’est les régions, les régions extra-frontalières. Le jour où le Languedoc-Roussillon sera associé à la Catalogne, il n’y aura plus d’identité nationale, il y aura une identité régionale. Je suis contre : c’est clair, net et précis. Qui en parle ? Personne n’en parle. Parce que là vous touchez à l’Union européenne.
Ce qui me frappe, c’est la différence entre un discours politiquement assez radical, et puis une forme de légèreté chez vous, de bonhomie, de bonne humeur, le côté « c’était des vacances ».
Il faut être philosophe. Pourquoi je le prends de bonne humeur ? Parce que... la politique il faut être sérieux, tout en étant... Écoutez, après moi il y en aura d’autres, l’essentiel de la vie, c’est pas ça. L’essentiel de la vie, c’est de réussir sa vie personnelle, de finir ses jours le mieux possible, voilà, ce n’est pas une élection présidentielle... Autant je suis catégorique parce que je pense qu’on peut encore sauver la France et l’Europe, donc il faut appliquer des mesures, autant il faut le prendre avec... attendez, la chose la plus grave sur la terre, c’est la mort... ce n’est pas une élection. Quand je les vois, les costumes-cravates, j’ai envie de rigoler... Les hommes politiques se prennent pour des Dieux. Quel que soit le niveau de l’élection.
Vous-même vous ne l’avez pas vécu, ça ? Quand vous vous retrouvez au Palais des sports et qu’il y a plusieurs milliers de personnes, il ne se passe pas quelque chose de particulier pour vous ? Ça flatte l’orgueil, non ?
Un plaisir. C’est prenant... Ça fait quelque chose, honnêtement...Vous vous dites : « Merde alors... Ça alors... Tu as rempli le Palais des sports, tu as refusé du monde... » Mais bon... Moi le plaisir que j’ai eu dans ces moments-là, c’était de dire : tu n’es pas le seul à penser ça. Un grand plaisir. Mais de l’orgueil, non. Quand je suis sorti de ce meeting-là, vous seriez venu me voir à ce moment-là... Il y avait des journalistes de TF1 qui me suivaient partout. Je leur ai dit : « Je viens de vivre un grand moment de ma vie. » Parce que je me suis retrouvé en face de gens qui comprenaient ce que je leur disais - même si sur certains points il y en avait qui n’étaient pas d’accord - et ça c’est une forme de fierté personnelle.
Au final, vous avez obtenu le score le plus faible (123000 voix, soit 0,32% des suffrages exprimés).
Ah, le score... C’est le score que je m’étais fixé. Je m’étais dit dans les 300000. J’étais heureux. On a semé une graine, cette graine deviendra un arbre. C’est ma position. Il y aurait eu vingt voix, il y aurait eu vingt voix. Ce n’était pas quelque chose qui me... Je suis content d’avoir fait plus de 2,5% dans le département de l’Aude, je trouve que c’est une marque de reconnaissance.
Est-ce qu’après le premier tour, il y a un effet brutal de redescente, humainement ?
Je ne l’ai pas senti. Non, non. On me l’avait dit : « Tu risques de déprimer. » Moi, non : j’ai l’entreprise, la mairie. Le lundi matin, je suis allé travailler avec les ouvriers, il fallait placer un égout qui était assez compliqué, j’ai posé l’égout avec eux.
Disons qu’on retrouve un peu la tranquillité, son rythme normal... Ce putain d’appareil [son téléphone portable] arrête de sonner tout le temps. Mais, non. On m’a dit que Nihous avait fait une dépression, moi, non. Honnêtement.
La seule chose qui a changé dans ma vie, c’est que je suis sorti du cadre politique local, et que le fait que je sente qu’on va à la catastrophe m’oblige à lire encore plus, et à m’imprégner de la misère du monde, et ça c’est dur à supporter. C’est-à-dire qu’avant je n’avais qu’un bout de mon cerveau qui s’occupait du mondial, et là, bon, tous les jours, à un moment donné, avec mon épouse, ou mes enfants, on parle de quelque chose politique. Ça n’existait pas avant la campagne.
Le soir du second tour, j’ai allumé à vingt heures, j’ai regardé le résultat, j’ai éteint, j’ai continué mes occupations du dimanche soir, qui sont la préparation des chantiers du lundi. Ça ne m’a pas... Et pourtant, beaucoup de gens avaient peur que je retombe. Mais non, au contraire. J’ai appris tellement de choses, ça m’a beaucoup aidé dans la vie de la commune, au conseil général, ça m’a énormément aidé à préparer les élections cantonales de 2008, où je suis parti tout seul.
Mais le soir du premier tour, vous avez quand même fait une fête ?
Ah oui, ça a été une fête fabuleuse. Il y avait des journalistes de TF1 qui me suivaient pendant toute la campagne. L’un m’a dit : « Monsieur Schivardi, recommencez ! » Il avait vu quelque chose qu’il n’avait jamais vu. Une grillade d’enfer ! C’était une vraie fête. Jusqu’à quatre heures du matin. Je me levais à six heures trente pour aller au chantier.
Alors pourquoi tomber ? Je ne pouvais pas tomber. J’ai une conception de la politique qui est la mienne, elle ne plaît pas à tout le monde. D’abord, on n’est que de passage. Ensuite, on n’a pas à s’enorgueillir à être élu. On fait tout pour être élu, on est heureux si on est élu, mais c’est tout. Pour moi, le plus beau moment de ma vie, c’est le vendredi, en 2001, quand le conseil municipal de Mailhac m’a élu maire. Parce que j’ai fait un discours sur mon grand-père... Là, oui, c’est la vraie vie... Le reste, après...
Mais, tout de même, quand vous avez voté au premier tour, avec un bulletin à votre nom ?
Ça me faisait drôle... Quand je suis arrivé à Mailhac, le samedi à midi, parce que le vendredi soir j’étais encore en meeting, de voir les gens dans la rue, tout le monde venir me voir, ils sont venus voter, tout le monde, Schivardi, Schivardi, ça fait quelque chose... Je suis même émotionné, là. Ça fait quelque chose... Il ne faut pas dire le contraire. Mais, après, il faut relativiser. La vie continue...
[1] Par exemple, Nicolas Sarkozy ne dépense pour ce poste que 211000 euros, soit 1% des dépenses totales - 21 millions - ; à l'inverse, le poste « site internet » correspond à 675000 euros, contre 664 euros pour G.Schivardi.
[2] Rapport de la Commission nationale des comptes de campagne : « En revanche, la commission a utilisé son pouvoir de modulation du montant du remboursement de M. SARKOZY. En effet, il est apparu lors de l'instruction du compte de campagne que trois dons de personnes physiques dépassaient le plafond légal. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la commission a jugé que cette irrégularité n'était pas d'une gravité suffisante pour entraîner le rejet du compte mais a diminué le montant du remboursement forfaitaire de 13800 euros correspondant à l'excédent global par rapport au plafond fixé par la loi. »