


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


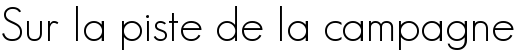
 |
|
|
|
Publié dans le
numéro 017 (Mai 2012)
|
[N.B. Cet article est paru en mai 2012, donc plusieurs mois avant la parution effective de Rien ne se déroule comme prévu, le livre de Laurent Binet.]
« Je me suis dit : putain, ces salauds ne se sentent plus pisser. On est à une semaine du jour J, et la salle de presse de François Hollande ressemble à une rencontre d’anciens combattants. J’ai jeté un coup d’œil aux gens autour de la table, et je me suis rendu compte qu’aucun d’entre eux n’était là lors des primaires. [...] Durant les primaires, Hollande s’est trouvé confronté pour la première fois à la politique du coup du lapin et du pied dans les couilles, et dans les deux cas il s’est montré très vulnérable à ce genre de gâteries. Le vice en politique, ça le troublait. Il n’était pas préparé à ça. [...]
C’est un des plus vieux trucs en politique, et des plus efficaces. Tous les vieux chevaux de retour s’en sont servis aux moments difficiles, et ça a été porté au niveau de la mythologie politique lors de la campagne de François Mitterrand en 1980, contre Michel Rocard. La course était serrée, et Mitterrand commençait à se faire du souci. Alors il a demandé à son stratège de lancer une campagne massive de rumeurs affirmant que son adversaire avait depuis toujours l’habitude de se livrer aux délices de la chair avec les truies d’une ferme voisine de sa maison de campagne.
- Mais bon Dieu, on ne va jamais s’en sortir en le traitant de baiseur de porcs, protesta le conseiller. Personne ne va croire un truc pareil.
- Je sais, répondit Mitterrand. Mais obligeons ce salaud à démentir.
Hollande n’a pas encore appris à faire face à cette tactique. »
Alors à votre avis, comment on a fait, pour avoir des extraits inédits du livre que l’écrivain Laurent Binet prépare sur la campagne de Hollande ? Laurent Binet, l’auteur de HHhH (Grasset, 2010), mis en contact par Valérie Trierweiler avec François Hollande pour rééditer l’opération menée par Yasmina Reza en 2007 avec Nicolas Sarkozy : un livre sur les coulisses de l’élection. Alors qu’au début des années 2000, on ne jurait que par le film sur les coulisses de l’élection (Paris à tout prix, municipales parisiennes, 2001 ; Comme un coup de tonnerre, campagne de Jospin, 2002), dix ans plus tard, à cause de la surabondance de l’offre télévisuelle, pour proposer quelque chose de véritablement inédit, on est obligé de solliciter les écrivains.
« Les camés ne rient pas tellement ; leur truc est trop sérieux. Et sur ce point le camé de politique ressemble fortement au camé qui se shoote.
La défonce est très forte dans ces deux mondes, pour ceux qui sont vraiment dedans - et tous ceux qui ont déjà vécu avec un camé vous diront que la seule façon de l’atteindre c’est de prendre une seringue et de se shooter.
La politique, c’est la même chose. Il y a un incroyable flash d’adrénaline qui arrive quand on s’engage à fond dans une campagne active - a fortiori quand vous étiez l’outsider et que vous commencez à sentir que vous pouvez gagner. [...]
De la même façon que ceux qui n’ont jamais été aux prises avec une seringue ne peuvent pas comprendre combien les drogués sont à mille lieux de tout, il est impossible même au meilleur et au plus talentueux des journalistes de comprendre ce qu’il se passe dans une campagne s’il ne la suit pas.
Il y a par exemple très peu de journalistes chargés de couvrir la campagne de Hollande qui comprennent autre chose que la surface de ce qui est en train de se passer dans le vortex ; ou alors, s’ils le comprennent, ils ne le publient pas ou ne le racontent pas à l’antenne. Et après avoir passé la moitié d’un an à suivre ce putain de zoo tout au long du pays et regarder la machinerie en œuvre, je suis prêt à prendre le pari que même les plus privilégiés des journalistes, au cœur de la campagne, en disent nettement moins qu’ils n’en savent. »
Revenons en arrière. Dans un restaurant du fin fond de la Corrèze. Au tout début de la campagne des primaires. L’auteur n’est alors accompagné que de cinq journalistes. Il est à table ; il n’a pas de de sel ni de poivre.
« Je suis donc allé en chercher au buffet et au passage je me suis cogné contre un type en gabardine marron qui remplissait tranquillement son assiette de carottes et de salami.
- Pardon, ai-je dit.
- Non, excusez-moi, a-t-il répondu.
J’ai haussé les épaules, et je suis retourné à ma table avec mon sel et mon poivre. On n’entendait du bruit simplement à la table du Monde. Les autres étaient soit en train de manger, soit en train de lire, soit les deux à la fois. La seule personne de la salle à ne pas être assise était ce type en veste marron au buffet. Il était encore en train de remplir maladroitement son assiette, dos à nous.
Ce type me disait quelque chose. Rien de particulier - mais suffisamment pour me faire lever les yeux de mon journal ; une espèce de flash subliminal de déjà-vu. À moins que ce ne soit la curiosité typique du journaliste qui s’ennuie, curiosité qui devient vite une habitude quand vous êtes perdu dans le brouillard intense d’un reportage sans queue ni tête. J’étais venu en Corrèze pour écrire un long truc sur la campagne de Hollande, et après douze heures passées à Tulle je n’étais même pas sûr qu’elle avait vraiment commencé, et je me demandais quel genre de conneries j’allais bien pouvoir écrire. [...]
Mon Dieu ! ai-je pensé. Le candidat ! Cette silhouette penchée, là-bas, au buffet, c’est François Hollande !
Mais où était son entourage ? Et pourquoi est-ce que personne ne l’avait remarqué ? Il n’était quand même pas tout seul ?
Non, impossible. Je n’avais jamais vu de candidat aux présidentielles évoluer en public sans être entouré par au moins dix «assistants» survoltés. Alors j’ai continuer à regarder, pour voir le moment où ses assistants allaient le rejoindre en nombre... mais j’ai fini par admettre que Le Candidat était seul : pas d’assistants, pas d’entourage, et personne ne l’avait remarqué dans la salle.
Ça m’a crispé. Manifestement Hollande attendait que quelqu’un vienne le saluer. Mais, dos à la salle, sans voir ce qu’il s’y passait, il ne s’était pas rendu compte que personne ne savait qu’il était là.
Alors je me suis levé et je suis allé jusqu’au buffet, regardant Hollande du coin de l’œil en me servant d’olives, en prenant une bière... Et je me suis décidé à lui faire une tape sur l’épaule, pour me présenter.
- Bonjour, monsieur. On s’est rencontrés il y a quelques semaines à un dîner chez Manuel Carcassone.
Il a souri et tendu la main pour me saluer.
- Bien sûr, bien sûr... Qu’est-ce que vous faites là ?
- Pour le moment, rien de particulier, ai-je répondu. On vous attendait.
Il a hoché la tête, tout en continuant à inspecter les crudités. J’étais extrêmement mal à l’aise. Notre précédente rencontre avait été plutôt agitée. Il revenait d’un déplacement en province, complètement épuisé et déprimé, et quand il est arrivé chez Manuel Carcassone, on avait fini de dîner, et je picolais sec. Le souvenir que j’en garde est assez flou, mais même dans ce flou je me souviens avoir déblatéré pendant à peu près deux heures sur le fait qu’il faisait tout n’importe comment. »
Bon, j’arrête le canular. Ce n’est même pas un poisson d’avril, tout juste un poisson de mai : ce n’est pas Laurent Binet qui écrit (son livre est prévu pour septembre), mais Hunter S. Thompson. J’ai juste changé les noms propres et fait quelques modifications mineures pour que l’adaptation fonctionne. Il s’agit d’une série d’articles repris dans Dernier Tango à Las Vegas [1]. Hunter Thompson, l’inventeur du « journalisme gonzo », a suivi le candidat George McGovern lors des primaires du parti démocrate, en prélude à l’élection présidentielle américaine de 1972. Contre toute attente, McGovern, qui est le plus à gauche des candidats (il est en faveur de l’avortement, opposant à la guerre du Vietnam, et laisse entendre qu’il n’est contre la marijuana, ce qui ne peut que plaire à Thompson), remporte la primaire démocrate. La suite sera moins glorieuse puisque Nixon l’écrasera lors de l’élection, avec le deuxième plus fort score de l’histoire américaine (68%). Pas grand-chose à voir avec François Hollande, donc, hormis le fait que, au début, ce candidat est un outsider.
L’intérêt de cette petite manœuvre réside dans la réflexion qu’elle permet sur le récit politique. Comment, quarante ans après Thompson, un écrivain peut-il se frotter à la matière politique ? Et pourquoi ? Laurent Binet, dans un entretien au Monde [2], cite ces textes de Thompson comme source d’inspiration, aux côtés de la série « À la maison blanche » (« West Wing » en VO, série qui narre les aventures d’un président déjà en place) : « Au départ, il suit tous les candidats, puis il se prend d’affection pour Thomas (sic) McGovern... C’est le meilleur schéma narratif possible : un « petit » candidat double tout le monde jusqu’à remporter les primaires. Ensuite, il perd contre Richard Nixon. On assiste donc à son ascension et à sa chute. »
Le meilleur schéma narratif possible : tout se passe comme si la notion de « storytelling politique », dont plus personne n’ignore l’existence dans les campagnes électorales [3], devait lui-même contaminer les récits - censément littéraires - desdites campagnes.
Mais ce qui fait l’intérêt du travail de Hunter Thompson, au-delà de sa valeur littéraire (représentative de l’Amérique des années 1970, ce que la traduction française peine à rendre), c’est plutôt ce qu’il raconte du journalisme politique. Thompson a écrit sa série de reportages sur la campagne dans le magazine Rolling Stones, un des rares quinzomadaires de l’histoire de la presse. Il écrivait donc tous les quinze jours sur l’actualité politique, des longs papiers, qui tranchaient évidemment avec le ton habituel des reportages politiques. Mais ce n’est pas simplement la question de l’écriture qui était en jeu ; mais également celles des sources. Voici ce qu’il écrit en introduction de la reprise en volume de ses reportages :
« Il y a des scènes dans ce bouquin que seuls pourront comprendre les gens qui y ont participé. La politique a son langage propre, souvent si complexe qu’il en devient un code, et tout le truc dans le journalisme politique est de savoir le traduire. [...] Vous trouvez des amis inattendus des deux côtés de la barrière, et pour les protéger - et les conserver comme sources d’informations - vous finissez par connaître toutes sortes d’histoires que vous ne pouvez pas publier ou auxquelles vous pouvez seulement faire allusion sans préciser d’où vous les tenez.
C’était une des barrières traditionnelles que j’ai essayé d’ignorer quand je me suis installé à Washington pour commencer à couvrir la campagne présidentielle de 1972. Pour moi, les informations «entre nous», ça n’existait pas. L’échec le plus durable et, à long terme, le plus grave du journalisme politique en Amérique naît des relations personnelles mi-club mi-cocktail qui s’instaurent inévitablement entre hommes politiques et journalistes - à Washington ou ailleurs - quand ils se rencontrent tous les jours. [...] Quand je suis parti pour Washington, j’étais décidé à éviter ce genre de piège. Au contraire de la plupart des correspondants, je pouvais me permettre de brûler tous les ponts derrière moi - parce que je n’y étais que pour un an, et que je me foutais éperdument de nouer des relations durables au Parlement. J’y venais pour deux raisons : 1) en apprendre le plus possible sur les mécanismes et les réalités d’une campagne présidentielle, et 2) raconter ça de la même manière que n’importe quoi d’autre - en grattant l’os aussi près que possible, et merde pour les conséquences. »
Dans un extrait coupé de l’entretien avec David Dufresne le mois précédent, nous abordions la question des sources, le fait qu’un journaliste se doit de les protéger pour ne pas tarir les informations qu’il pourrait être amené à révéler. C’était à propos d’une note de son ouvrage concernant Luc Bronner, journaliste au Monde spécialisé dans les questions de la banlieue (devenu depuis rédacteur en chef du quotidien), et auteur de nombreux articles sur l’affaire de Villiers-le-Bel. Lors d’un débat organisé en 2010, Luc Bronner est pris à partie par des militants, proches du groupe de Tarnac. Il s’en explique dans un mail à David Dufresne : « Sur le fond, je suis ressorti ulcéré de cette «rencontre». D’abord parce que, si les proches de Tarnac enlèvent leurs œillères, ils verront que, dans mon livre La Loi du ghetto [Calmann-Lévy], je décris les méthodes exceptionnelles mises en place par la justice et la police pour contenir les quartiers [...] Le deuxième point paradoxal, c’est qu’en travaillant sur Villiers, je me suis coupé avec la plupart de mes sources policières. [...] Je pense que ça ferait éclater de rire les hauts responsables du ministère de l’intérieur en particulier le Directeur général de la police nationale de me voir présenté comme leur «valet». » Sans revenir sur le fond de l’affaire, je m’interrogeais sur cette question du rapport entre le journaliste et ses sources : est-ce que le rôle d’un journaliste n’est pas, justement, d’aller, dès qu’il le faut, contre ses sources, y compris si cela signifie qu’il ne pourra plus les utiliser ? Est-ce que la « rente de situation » qui est celle du journaliste inséré dans un champ, avec les contacts qu’il faut, ne conduit pas à un profond appauvrissement du reportage et de l’enquête ? Est-ce que s’inquiéter de se « couper » de ses sources n’est pas, en soi, contradictoire avec le métier de journaliste ? Est-ce le propre d’un journal, qui peut se permettre de faire tourner les membres de sa rédaction de poste en poste, ce n’est pas d’aller contre ses sources ?
Ces questions, Thompson, si l’on sait dépasser ce qu’il peut y avoir de folklorique dans sa démarche (le détail du nombre de bières ingérées et le mal du crâne du matin sont des passages obligés, et un peu agaçants, de son récit), y répond de la meilleure manière qui soit : contrairement à ce qu’on veut faire croire, le gonzo est moins une mise en scène du côté « freak » de l’auteur qu’une remise en question profonde des codes fossilisants du journalisme traditionnel. Et c’est sans doute pour cette raison que les journalistes traditionnels ont tendance à systématiquement le juger amusant, extrémiste, déraisonnable, alors qu’il ne fait que redonner quelque noblesse à leur métier.
[1] Je me suis également, pour l'extrait sur la drogue et sur le candidat solitaire, éloigné de la traduction française, qui date de 1981 et qui est assez décevante, même si l'éditeur annonce qu'ella a été « revue et corrigée » pour cette nouvelle édition, chez Tristram, en 2010.
[2] Le 23 février 2012.
[3] Il s'agit de « raconter » une histoire, d'avoir un « narrateur » aux côtés d'un candidat - c'est ainsi par exemple que le New York Times qualifiait le rôle de David Axelrod pour Barack Obama (cf. Christian Salmon dans Le Monde, 12 janvier 2008) : autant de mots empruntés à l'univers de la fiction.