


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


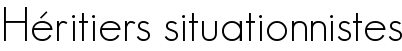
 |
|
|
Publié dans le
numéro 30 (mars-avril 2009)
|
Lors de l’arrestation de Julien Coupat et des personnes accusées d’avoir saboté les lignes de la SNCF à l’automne 2008, parmi tous les noms plus ou moins fantaisistes utilisés par la ministre de l’Intérieur et les services de police pour décrire la nébuleuse politico-idéologique auquel les « terroristes » appartenaient, il en est un, un seul, qui avait une certaine légitimité : celui d’ultra-gauche. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce terme n’a pas été forgé pour l’occasion, comme celui, plutôt comique, d’« anarcho-autonome ». Et même si son usage a parfois été contesté par ceux qu’il était censé désigner, il possède indubitablement une valeur descriptive. En effet, bien qu’ils soient restés attachés au projet communiste, les mouvements qu’on regroupe sous le nom d’« ultra-gauche » se sont toujours démarqués de l’extrême gauche par leur opposition à Lénine, à Trotski et à leurs héritiers. Ce qui particularise également l’ultra-gauche, c’est la critique, voire le rejet pur et simple, des modes d’action propres à l’extrême gauche - qu’il s’agisse de l’organisation en partis ou en syndicats, du parlementarisme ou du soutien aux luttes antifascistes ou de libération nationale. L’ultra-gauche a toujours privilégié des formes d’organisation anti-hiérarchiques basées sur la démocratie directe, et la concentration de toutes ses forces en direction d’un seul but : la révolution [1]. En effet, vouant aux gémonies les formations d’extrême gauche traditionnelles, la mouvance impliquée dans Tiqqun et ses avatars successifs ne se reconnaissait que dans un Parti « imaginaire » : le parti de ceux « qui choisissent de vivre dans les interstices du monde marchand et refusent de participer à quoi que ce soit qui ait rapport avec lui » [2]. Ce qui ne l’empêchait pas de reprendre la question du communisme à nouveaux frais, non pas comme système politique ou économique - « Le communisme se passe très bien de Marx. Le communisme se fout de l’URSS » - mais comme instauration d’une forme de communauté authentique : « Une chose m’est propre dans la mesure où elle rentre dans le domaine de mes usages, et non en vertu de quelque titre juridique. La propriété légale n’a d’autre réalité, en fin de compte, que les forces qui la protègent. La question du communisme est donc d’un côté de supprimer la police, et de l’autre d’élaborer entre ceux qui vivent ensemble des modes de partage, des usages. » (L’Appel)
Plus exactement - et les services de police l’ont reconnu eux-mêmes [3] – Tiqqun, Coupat et alii s’inscrivaient dans la filiation de l’Internationale situationniste (I.S.), un mouvement singulier à tous points de vue : Guy Debord, qui en fut l’un des principaux meneurs, le définissait en 1963 « à la fois comme une avant-garde artistique, une recherche expérimentale sur la voie d’une construction libre de la vie quotidienne, enfin une contribution à l’édification théorique et pratique d’une nouvelle contestation révolutionnaire » [4]. Né dans les années 1950 de la rencontre entre plusieurs artistes issus du surréalisme et du lettrisme, ce groupe en était venu progressivement à adopter les positions politiques de l’ultra-gauche de son temps ; une trajectoire singulière qui s’explique tout autant par sa rencontre avec certains intellectuels marxistes « hérétiques » (Henri Lefebvre, Cornelius Castoriadis, etc.), que par son ardente recherche des moyens susceptibles de rendre la vie intégralement poétique, par-delà les limites que lui impose un certain ordre du monde social.
Lorsque sont parus les deux premiers numéros de Tiqqun, il y a près de dix ans, la revue a instantanément été identifiée par tous les amateurs comme une nouvelle composante de ce petit milieu qui maintient vivant, aujourd’hui encore, l’esprit de l’I.S. Ils avaient notamment pu reconnaître dans l’ours de la revue les noms de Joël Gayraud, un habitué des cercles post-situationnistes [5], ou de Coupat lui-même, auteur peu de temps auparavant d’un travail universitaire sur l’I.S., et remercié par le sociologue Luc Boltanski, qui en avait utilisé les conclusions dans un ouvrage écrit au même moment [6]. Mais plus encore que ces noms, c’était la facture de la revue qui signait son appartenance aux mouvements post-situationnistes : un style brûlant, mais « qui brûle à la manière de la glace », selon le mot de Baudelaire ; l’usage récurrent du concept de spectacle, tel qu’il avait été élaboré par Guy Debord ; une présentation belle et sobre enfin, qui tranchait avec la radicalité du propos. Il n’y manquait même pas quelques petites polémiques internes au milieu, contre telle ou telle de ses figures marquantes, Jean-Pierre Voyer ou Jaime Semprun par exemple, en parfaite conformité avec « la vieille tradition gauchiste qui consiste à taper le plus fort possible sur les courants dont on se sent le plus proche et dont on veut à tout prix se distinguer » [7]. Tiqqun ressemblait ainsi à toutes ces publications sauvages dont les exemplaires se distribuaient alors à quelques centaines dans les librairies classiques du milieu post-situationniste à Paris, telles que Actualités rue Dauphine (aujourd’hui fermée), Un regard moderne rue Gît-le-Coeur, ou le sous-sol de la librairie Compagnie.
« Théorie du Bloom », « Théorie de la Jeune-Fille », « Thèses sur la communauté terrible »... Qui feuillette les pages de Tiqqun aujourd’hui pensera avoir affaire à des théoristes plutôt qu’à des terroristes. Dans les pages de la revue, c’était en effet une pensée fortement nourrie de philosophie qui se développait, inspirée par une lecture à la fois exigeante et inventive des œuvres de Hegel, Heidegger ou Carl Schmitt, mais aussi de Gilles Deleuze, Michel Foucault, Giorgio Agamben, et bien d’autres encore. Agamben justement, qui était devenu un ami de Guy Debord au début des années 1990, et qui tenait le travail de la revue en grande estime [8], avait fini par nouer des liens assez étroits avec plusieurs de ses rédacteurs : Julien Coupat, bien sûr, dont il a publiquement pris la défense ; Joël Gayraud, devenu son traducteur en France ; ou encore Fulvia Carnevale, avec laquelle il eut l’occasion de tenir séminaire commun à Venise [9]. Hommage discret en retour et gage de fidélité, L’Insurrection qui vient, le dernier traité publié dans la lignée de Tiqqun [10], et que la police a considéré comme un manuel de terrorisme, faisait allusion par son titre à La Communauté qui vient, livre énigmatique et séminal publié par Agamben en 1990.
La passion pour la théorie a toujours été constitutive du mouvement situationniste, qui, pour faire porter son accusation sur l’ensemble de la vie sociale, s’était fortement inspiré de ces maîtres du soupçon qu’étaient Marx, Nietzsche et Freud. A tel point que cette passion philosophique a parfois tourné à l’ivresse chez certains de ses continuateurs. Le lecteur curieux pourra s’en convaincre en consultant par exemple les volumes rédigés dans un style néo-hégélien entrecoupé de fulgurances colériques, publiés depuis près de vingt ans par l’équipe réunie au sein de la Bibliothèque des Emeutes puis de l’Observatoire de Téléologie [11] – un petit groupe dont la doctrine n’est d’ailleurs pas sans analogie avec celle de Tiqqun, dans sa fascination pour les diverses figures du lumpenprolétariat contemporain (gangs, jeunes de banlieue, marginaux et autres déclassés) [12]. D’une façon générale, la théorie des situationnistes et de leurs épigones est toujours parvenue à se maintenir à un niveau suffisamment estimable pour retenir l’attention de bon nombre d’intellectuels : l’influence des situationnistes a ainsi été déterminante pour des penseurs tels que Jean Baudrillard, Philippe Lacoue-Labarthe ou Paul Virilio ; et encore aujourd’hui, les publications de l’Encyclopédie des Nuisances, par exemple, sont lues avec intérêt dans les cercles gauchistes de l’intelligentsia universitaire [13].
Il ne faudrait pas croire pour autant que les mouvements situationniste et post-situationniste sont restés dans la théorie pure. Ce qui a fait leur réputation, c’était aussi leur capacité à donner à cette théorie une force de frappe, de l’engager dans la pratique, de faire en sorte que les armes de la critique se muent en une critique des armes, pour reprendre une expression de Marx qu’affectionnait particulièrement l’I.S. A l’encontre d’une certaine vulgate qui veut que les situationnistes aient été surtout une bande de potaches, la version arty du grand monôme étudiant de 68, il faut rappeler qu’ils s’y sont surtout illustrés en mettant le feu aux poudres à la Faculté de Nanterre, en se battant sur les barricades du Quartier latin, avant de faire partie du premier comité d’occupation de la Sorbonne et d’organiser le ravitaillement matériel des usines en grève [14]. Les autorités ne se trompèrent d’ailleurs pas sur le caractère subversif de l’I.S., dans la mesure où ses publications furent plusieurs fois saisies, ses membres poursuivis en justice, surveillés par la police, parfois mis en prison ou physiquement menacés.
Le souci de mettre en accord les idées et les actes a poussé de nombreux mouvements issus de la nébuleuse situationniste à continuer cette tradition, que ce soit en s’impliquant directement dans les conflits sociaux ou en intervenant ponctuellement de façon plus isolée. Citons par exemple quelques coups d’éclat tels que la divulgation publique en 1990, par les « Cangaceiros », des plans secrets de plusieurs prisons françaises en vue d’entraver leur construction ; ou encore les deux campagnes de sabotages qui révélèrent au grand public la nocivité des O.G.M. - la première, commencée en janvier 1998 à l’initiative de René Riesel, ex-situationniste rallié à l’Encyclopédie des Nuisances, et la seconde lancée à l’été 1999 par une multitude de petits groupes dont les tracts montraient clairement l’inspiration situationniste. C’est sans doute cette tradition de sabotage et de participation offensive aux mouvements de contestation, pour tout dire : cette capacité de perturbation, qui a attiré l’attention des services de police sur Coupat et ses compagnons. Les déclarations d’intention de Tiqqun en faveur des stratégies illégalistes et d’une généralisation du chaos social s’assortissaient sans doute d’un humour typique des milieux situationnistes : on se souviendra de la très docte Société pour l’Avancement de la Science Criminelle fondée par Tiqqun dans les pages de son numéro 2, et qui proposait des fiches-recettes permettant de réaliser tout aussi bien un emploi fictif qu’un cocktail molotov. Mais l’humour ne constitue-t-il pas une circonstance aggravante, lorsqu’il passe ainsi du noir au rouge, menaçant de faire éclater toutes les contradictions sociales ?
Au milieu de beaucoup d’idées perspicaces et de vues très justes sur notre époque, c’est peut-être l’insurrectionnalisme de Tiqqun qui pose le plus problème. Dans leur quête éperdue d’une intensité des paroles et des actes, Coupat et les siens ont systématisé et porté à son comble un certain discours de la lutte qui est propre aux mouvements radicaux. Ils ont ainsi forgé une véritable idéologie, qui veut que l’exercice de la domination soit compris comme une guerre permanente, et qu’une attitude révolutionnaire consiste à prendre acte de cette situation, à assumer jusqu’au bout le conflit qui est en elle. « Nous ne contestons rien, nous ne revendiquons rien. Nous nous constituons en force, en force matérielle, en force matérielle autonome au sein de la guerre civile mondiale », énonçait l’Appel. Et de rêver que cette force émerge à la manière d’une guérilla qui aurait « ses fermes, ses écoles, ses armes, ses médecines, ses maisons collectives, ses tables de montage, ses imprimeries, ses camions bâchés et ses têtes de pont dans les métropoles ». Et qu’un beau jour une série d’actes subversifs convergent vers un basculement général... Dans quoi ? C’est bien la question. Simone Weil, qui avait vécu de l’intérieur cette Guerre d’Espagne que les Tiqqun ont mise en avant comme modèle, avait pourtant prévenu : dans un soulèvement armé, « les nécessités, l’atmosphère de la guerre civile l’emportent sur les aspirations que l’on cherche à défendre au moyen de la guerre civile » [15]. Ce qu’elle avait déjà formulé quelques années auparavant de la manière suivante : « Il semble qu’une révolution engagée dans une guerre n’ait le choix qu’entre succomber sous les coups meurtriers de la contre-révolution, ou se transformer elle-même en contre-révolution par le mécanisme même de la lutte militaire. » [16]
[1] Il n'existe en France qu'un seul ouvrage synthétique sur l'ultra-gauche, celui de Christophe Bourseiller, malheureusement entaché d'un certain nombre d'erreurs et de mésinterprétations : Histoire générale de l'ultra-gauche, Denoël, 2003.]. C'est pourquoi il peut être dit sans exagérer, et peut-être même avec éloge, que Julien Coupat faisait partie de l'ultra-gauche, lui et ceux qui écrivaient dans la revue Tiqqun, ou dans les opuscules auxquels son nom est resté associé[[La revue Tiqqun a connu deux numéros (février 1999, octobre 2001) ; plusieurs textes en ont été extraits et repris à part chez divers éditeurs. Un Appel a ensuite été diffusé anonymement en 2004, L'Insurrection qui vient étant publié en 2007 aux éditions La Fabrique sous la signature du « Comité invisible ». A signaler aussi : une préface à un recueil d'écrits de Blanqui paru également à La Fabrique en 2006 (signée « Quelques agents du Parti imaginaire »), et tout dernièrement un tract assez long du Comité invisible, intitulé Mise au point et diffusé depuis la fin janvier 2009.Tous ces documents sont consultables sur http://bloom0101.org .
[2] Pour reprendre quelques unes des formules des « Thèses sur le Parti Imaginaire » dans le n°1 de Tiqqun.
[3] La sous-direction antiterroriste de la police judiciaire, dans son rapport au procureur de Paris, écrit que la pensée de Julien Coupat s'est formée « à l'école du situationnisme, mouvement anarchiste international prônant la lutte contre les structures actuelles de la société » (rapport consultable sur www.mediapart.fr/files/PV-TGV.pdf).
[4] Guy Debord, Les Situationnistes et les nouvelles formes d'action dans la politique ou l'art, texte repris dans ses Œuvres, Quarto Gallimard, 2006, p. 647.
[5] Joël Gayraud est aussi connu pour avoir attaché son nom à la traduction en français des écrits de la section italienne de l'I.S. (parue aux éditions Contre-Moule en 1988) ainsi qu'à celle, plus classique, des œuvres de Giacomo Leopardi. Il est par ailleurs membre du Groupe surréaliste de Paris. A noter que La peau de l'ombre, l'essai poético-politique qu'il a fait paraître aux éditions José Corti en 2004, relève également d'un certain esprit « tiqqunien ».
[6] Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le Nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999. Le travail de Julien Coupat s'intitulait pour sa part Perspective et critique de la pensée situationniste (mémoire de D.E.A. « Histoire et civilisations », sous la direction de Nicolas Tertulian, EHESS, Paris, 1996-1997).
[7] Matthieu Amiech et Julien Mattern, Le Cauchemar de Don Quichotte. Sur l'impuissance de la jeunesse d'aujourd'hui, Climats, 2004.
[8] Cf. entre autres « Une biopolitique mineure », entretien avec Giorgio Agamben réalisé par Stany Grelet et Mathieu Potte-Bonneville pour la revue Vacarme (n°10, hiver 2000).
[9] Séminaire tenu du 11 au 15 octobre 2005 auprès de l'Institut Universitaire d'Architecture de Venise. Avec l'artiste James Thornhill, Fulvia Carnevale a fondé en 2004 le collectif Claire Fontaine, qui reprend assez largement les thèses de Tiqqun sur un plan artistique tout en utilisant de manière ironique les
codes de l'art conceptuel : cf. www.clairefontaine.ws.
[10] Au-delà de l'identité de style et de pensée entre Tiqqun et L'Insurrection qui vient, le nom du « Comité invisible » apparaissait déjà dans le numéro 2 de Tiqqun, page 84 très exactement, à la fin d'un petit récit qui apparaît d'ailleurs comme une esquisse de celui qui vient clore L'Insurrection qui vient, et qui décrit les prodromes de la révolution annoncée par les auteurs.
[11] Les éditions Belles Emotions ayant été le trait d'union entre les deux (aujourd'hui, les membres de ces trois regroupements poursuivent leurs activités sous le nom « Téléologie ouverte », cf. http://www.teleologie.org).
[12] On notera d'ailleurs que l'écrivain et philosophe Medhi Belhaj Kacem, qui a participé quelque temps à l'aventure Tiqqun, avait fait ses premières armes au sein de la Bibliothèque des Emeutes (cf. EvidenZ / Medhi Belhaj Kacem, Théorie du trickster, Paris, Sens&Tonka, 2002, et Medhi Belhaj Kacem, Pop philosophie, entretiens avec P. Nassif, Paris, Denoël, 2005).
[13] Avant de devenir une maison d'édition en 1993, l'Encyclopédie des nuisances a d'abord été une revue de critique sociale d'orientation post-situationniste et anti-industrielle, fondée en 1984 et animée notamment par Jaime Semprun et Christian Sébastiani (ancien membre de l'I.S.) ; Guy Debord y a brièvement participé en 1985-1986.
[14] Et déjà quelques années auparavant, en mars 1965, l'I.S. avait été à l'origine de manifestations contre les manœuvres des troupes de l'OTAN au Danemark, manifestations qui avaient tourné à l'émeute et marqué durablement les esprits.
[15] Simone Weil, « Réflexions pour déplaire » (1936), repris dans ses Œuvres, Gallimard, 1999, p. 401.
[16] Simone Weil, « Réflexions sur la guerre » (1933), ibidem, p. 459.