


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


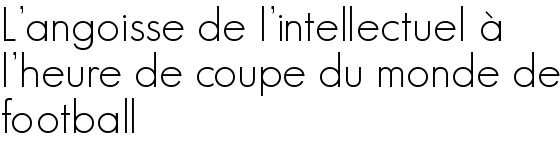
 |
|
|
Publié dans le
numéro 10 (19 juin-2 juillet 2010)
|
Tous les quatre ans, le réel pose le même problème à l’intellectuel-critique-français : comment regarder la Coupe du Monde de football ? Je ne parle pas de celui que le football n’intéresse vraiment pas, qui n’y connaît rien, qui n’a jamais fait l’effort de comprendre le hors-jeu, à qui il faut quelques secondes (et encore) pour distinguer sur un écran un match de rugby d’un match de football. Je ne parle pas de celui à qui ça ne fait rien. Je parle de l’autre, celui qui est partagé. Celui qui sent au fond de son cœur le supporteur, qui aimerait le laisser vivre, mettre son grand chapeau et son maillot, crier, qui aimerait s’endormir heureux après la victoire et triste après la défaite, celui qui est tenté par le premier degré mais qui vivrait l’épanouissement de son moi-supporteur comme une abdication. Car, celui-là, en tant qu’intellectuel-critique-français, ne peut pas faire complètement fi de ce qu’il sait du football contemporain. Qu’il est miné par l’argent, que son monde compte tout un tas de personnages interlopes (agents non agréés, négriers, prostituées), qu’il est fondamentalement immoral (« Au football, l’honnêteté paye rarement » dixit Franck Leboeuf devant Algérie-Slovénie), qu’il est sans doute traversé par le dopage (pour justifier l’absence de contrôle sanguin lors de la Coupe du Monde 2006, Sepp Blatter, le président de la FIFA avait eu cette phrase magnifique : « Il n’y a pas de contrôle sanguin dans le football, car il n’y a pas de dopage dans le football »), qu’il est depuis sa création un outil de propagande, ou de distraction des masses (« C’est une décision stratégique qui engage tout le pays face à la crise » a plaidé Nicolas Sarkozy lors de son discours de soutien à la France pour l’organisation de l’Europ 2016). Bref, l’intellectuel-critique-français-amateur de football ne peut pas faire comme si le football était aimable, surtout pendant une Coupe du Monde où sa présence médiatique est telle qu’elle fait passer les élections législatives belges pour un bol d’air. A moins de considérer qu’il faut faire taire une partie de soi, ce qui est impossible pour l’intellectuel-critique-français amoureux de l’unité de son moi, le dilemme est dramatique.
Pourquoi parler de l’intellectuel-critique-français, et pas de l’intellectuel-critique-tout court ? Parce qu’une étude assez empirique et peu exhaustive du rapport des intellectuels au football dans l’ensemble du monde conclut définitivement à une spécificité française. En matière de supportérisme, l’intellectuel français est un peine-à-jouir. Quel enseignant, quel lecteur de Télérama, quel professeur d’Université, quel écrivain un tant soit peu intéressant, avoue publiquement son soutien inconditionnel à un club ou à l’équipe nationale ? Alors qu’ils sont pléthore en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, dans toute l’Amérique Latine, ils sont si rares en France que peu de noms viennent spontanément à l’esprit. Il existe certes l’exception notable d’Alain Finkielkraut et du PSG, mais le cas Finkielkraut est d’une telle complexité qu’on se demande toujours s’il n’est pas plus prudent d’en appeler à une psychopathologie de la distinction. Les raisons de cette particularité française sont sans aucun doute multiples : la tradition critique des Lumières, la prise de distance automatique avec tout ce qui pourrait avoir l’air vaguement nationaliste, le rapport compliqué au populaire. L’une d’entre elles est peut-être plus prégnante : les conséquences toujours présentes de l’après 68. Il faudrait un jour examiner de près les rapports de mai 68 et du sport français. Combien sont-ils, jeunes français des années 60, amateurs de sport, à avoir cessé toute activité compétitive, à avoir rejeté tout spectacle de la compétition, quand leur engagement politique les a poussés vers des luttes aux enjeux autrement plus collectifs et universels ? L’un raconte avoir refusé de franchir la ligne d’un 800 mètres gagné d’avance en signe de protestation, l’autre avoir mis fin à une prometteuse carrière d’athlète pour aller danser tout nu au rythme des tambourins. Gagner une course ou un match est méprisable quand l’horizon à atteindre est la quête de soi ou la Révolution. Quant à se cailler les miches sur un banc de bois en mangeant un sandwich au saucisson pour soutenir une bande d’aliénés qui a pour toute métaphysique « l’amour du maillot », faut pas déconner. Bien sûr les choses se sont tassées depuis, mais les résidus de radicalité stagnent parfois dans des zones bien mystérieuses du cerveau social, et il semble que le sport en soit une. Pour l’intellectuel-critique-français, le supporteur est toujours un peu suspect. Or, ça n’est pas du tout le cas ailleurs. Prenez Toni Negri. En termes de radicalité politique et de lutte contre l’aliénation, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Et Toni Negri est un supporteur. Pas de Livourne, rare club italien connu pour son public de gauche. Non, Toni Negri est supporteur du Milan AC, le club de Berlusconi. On sait pour combien la possession du club milanais - et ses résultats- ont compté dans la popularité de Berlusconi, et pour combien ils comptent encore. Peu importe, Toni Negri, chaque dimanche, souhaite la victoire du Milan AC. Il est fort possible qu’à distance, l’un et l’autre sautent dans les bras de leur voisin après le même but, fassent le même commentaire, et s’endorment avec les mêmes images en tête. Comment expliquer cette bizarrerie ? Toni Negri pourrait arguer qu’en supportant le Milan AC, et non pas l’Inter de Milan, il est fidèle au plus populaire des deux clubs, au Milan des usines contre celui de la bourgeoisie, que ce n’est pas pour rien qu’il avait participé à la création d’un groupe de supporters du nom de « Brigades rouges et noires », peu avant que naissent les « Brigades rouges ». Il pourrait revendiquer une forme de fidélité politique. Mais il ne le fait pas. Pour Toni Negri, foot et politique n’ont rien à voir. Ils ne relèvent pas du même registre. C’est une manière assez habile de trancher le dilemme. Après tout, on peut considérer que les « dérives » du football lui sont extérieures. On ne peut pas blâmer le football pour l’usage, politique ou économique, qu’en font certains.
Le problème de cet argumentaire, que l’on pourrait qualifier d’essentialiste, est qu’il achoppe sur deux points. D’abord, historiquement, le football ne se distingue pas de ses dérives. Le football a toujours été un instrument aux mains des puissants. A peine sorti des universités anglaises (le football n’est pas d’origine populaire, que ce soit bien clair), il a servi aux patrons des usines britanniques avec un objectif double : occuper les ouvriers pendant la demi-journée de congés qui venait de leur être octroyée tout en continuant à gagner de l’argent sur leur dos. Donc, construction d’un stade rudimentaire, vague entretien d’une équipe, tout cela étant financé par la vente de produits dans les tribunes, puis par celle des billets qui donnaient le droit d’assister aux rencontres. Parallèlement, la rivalité montante entre les équipes entretint très vite un trafic de joueurs, théoriquement amateurs, en fait largement rémunérés par les propriétaires de clubs, ce qui eut mécaniquement pour effet de priver les régions pauvres de Grande-Bretagne de leurs meilleurs joueurs (l’Ecosse par exemple) et d’inaugurer, dès la fin du 19ème siècle, cette tradition qui va à l’encontre de la « glorieuse incertitude du sport » : statistiquement, la victoire va la plupart du temps au plus riche. Quant à l’exploitation politique stricto sensu, il faut se rappeler que la deuxième Coupe du Monde de l’histoire eut lieu en Italie en 1934 et fut largement utilisée par le jeune régime mussolinien pour montrer au monde, et à son peuple, un autre visage de sa puissance. En un sens, le football a toujours ressemblé à ce qu’il est, l’impression qu’il est pire aujourd’hui n’étant question que d’échelle. Le football n’a jamais été pur, l’aimer c’est l’aimer avec ses dérives. Deuxième point où l’argument négrien achoppe : faire comme si le football et le monde qu’il draine étaient de natures différentes n’empêche pas que toute participation à l’économie footballistique, si minime soit-elle, est une forme d’acceptation de ce monde. Moi qui regarde tranquillement Cameroun-Japon en essayant de finir cet article du Tigre avant le bouclage, je suis, malgré toutes mes préventions contre le spectacle footballistique (et l’attention relative que j’accorde à ce match étant donnée l’intense concentration que me demande l’écriture de cette article - là, il a quand même fallu que je m’interrompe parce que le Japon vient d’ouvrir le score, il faut avouer que ça me dégoûte un peu, non que j’aime pas les Japonais, c’est pas ça, mais j’aimerais bien que le Cameroun gagne, c’est vrai Eto’o est un sale con il a carrément le melon, mais je sais pas pourquoi j’aime bien le Cameroun, ça doit être à cause de 1990 et Roger Milla qui se trémousse face au poteau de corner contre la Colombie, je crois que j’ai failli pleurer quand ils ont perdu en quart contre l’Angleterre, et puis il faudrait quand même qu’un jour un pays africain l’emporte cette Coupe du Monde alors pourquoi pas le Cameroun et pourquoi pas en Afrique du Sud ça aurait de la gueule ça, et puis je sais pas pourquoi mais les Japonais ils m’énervent un peu, avec leur jeu bien technique bien appliqué bien discipliné, c’est pas ça le foot merde, c’est pas pareil que fabriquer des puces à la chaîne, le foot c’est la créativité, c’est la furia, mi-temps, j’espère que Le Guen va les bien les engueuler ces Camerounais et qu’ils vont déchirer, allez les mecs, il reste 45 mn pour leur foutre la tête dans le sac à ces niaqwés) je suis un élément nécessaire à cette économie. Sans moi, sans des millions d’autres comme moi, qui allument leur télévision pour regarder un match, le football n’enrichirait personne et il n’aurait aucune utilité politique. Donc, la façon de voir de Toni Negri n’est pas de grande utilité pour l’intellectuel-critique-français.
Alors que faire ? (Eto’o il a a la grosse tête, mais là, il vient de passer en revue la défense japonaise et de donner un caviar à son attaquant qui a réussi je sais pas comment à la foutre au-dessus, celle-là le Japonais avec son application de petit soldat, il l’aurait mise au fond) La solution est à double détente. D’abord, se défaire de l’idée largement véhiculée par ceux qui vendent le football - à savoir les instances du football, mais aussi les sponsors et les hommes politiques - qu’il est porteur de morale et vertus éducatives. Non, le football est, au mieux, un spectacle. Et il est produit par une industrie. La confusion entretenue à dessein par la FIFA est de se présenter comme une ONG dont le but serait de répandre le bonheur sur terre. Alors que le type d’organisation dont se rapproche le plus la FIFA serait Hollywood. Moins celui d’aujourd’hui que le Hollywood des années 50, celui décrit par Ellroy, avec ses producteurs véreux, ses starlettes cocaïnées, son prolétariat, mais avec ses grands films et ses génies. Ce qui change, ce sont les ressorts dramatiques : un lointain sentiment patriotique (mais qui y croit encore ? les joueurs français jouent à l’étranger, les trois quarts de l’équipe d’Algérie sont nés en France...), la faible diversité des scénarios, la réalisation bas de gamme... Le reste est partagé : quête du profit, présence en sous main d’intérêts politiques, flatterie des sentiments primaires. Mais pourquoi ce qui ne nous a jamais empêchés de jouir d’un grand film hollywoodien atténuerait notre plaisir devant un match de football ? Telle est la question que devrait se poser l’intellectuel-critique-français. Oh putain, le gardien japonais vient de sortir un arrêt sur sa ligne alors qu’il reste une minute, bon de toute façon Eto’o avait fait une faute dans la surface, y aurait pas eu but, c’est fini, 1-0 pour le Japon, fait chier, j’éteins et j’envoie mon texte.