


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


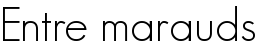
Rue des Bourdonnais, un boyau d’où l’on voit se hérisser l’hideuse architecture du Forum des Halles. Pas du côté d’Habitat, ce serait le comble, mais du côté de Saint Eustache. Au 32 crèche Emmaüs, dans un ancien immeuble de la banque Lazard cédé à l’Abbé Pierre en 1949. Drôle de structure chapeautée par une verrière et trois étages de bureaux : on est au siège national de l’association. Le bâtiment est aussi devenu centre d’accueil, de jour, puis de nuit. En plus d’être un labyrinthe, c’est un caravansérail : des gens arrivent presque à toute heure. L’accueil de nuit se fait jusqu’à 6 heures le matin - l’heure du petit déjeuner, ouvert à tout le monde -, puis en journée jusqu’à 17 heures ; le centre rouvre le soir, après le repas, à 23h. On voit défiler jusqu’à 700 personnes par jour dans cet immeuble qui abrite plusieurs fois par semaine un coiffeur, un salon de lecture, des salles de cours, une permanence médicabule, une télé, un cyber... Mais le fonctionnement du centre est en plein chamboulement depuis l’occupation du Canal Saint-Martin.
La maraude a été créée en 1999. Il en existe des dizaines dans Paris (à pied, en bus, à rollers... et même à Roissy), dans chaque quartier et dans chaque association. Sur le centre, Emmaüs partage le terrain avec Atoll et Cœur des Halles. Pas de manière très rationnelle selon Rachid, qui tente depuis deux ans de mettre en place une coordination. Pour éviter aux SDF d’être réveillés six fois la même nuit. La maraude est en passe de devenir un service autonome. Il devrait aussi se créer une maraude de jour (16h-23h), de manière à ce que les SDF puissent avoir affaire aux mêmes personnes la nuit, dans la rue, et le jour, rue des Bourdonnais... Le « suivi » met tellement de temps, il est si délicat, qu’il faut mettre toutes les chances de leur côté... « Il faut arrêter d’apporter des soupes, dit Rachid, pour apporter de l’aide sociale ». Ce n’est pas trouver un logement, c’est conduire les gens à faire des démarches pour espérer en retrouver un. « Les gars nous testent, nous sondent, mais on n’est pas une banque sociale ». En deux mots : on ne fera pas le boulot à votre place ; si vous voulez vous en sortir, c’est à vous de commencer.
J’arrive dans la salle des maraudes auprès de Manu et Kathy, en pleine querelle sur les thermos. Le modèle actuel, plutôt fait pour les randonneurs, n’est pas très adapté à la soupe (quand on veut remplir un verre, il faut pomper, pomper... au grand amusement des gens affamés qui lorgnent l’appareil récalcitrant), et le BHV n’a pas ce qu’il faut. Ça fait trois semaines qu’ils cherchent en vain le bon modèle. Il n’y a pas de boutiques spécialisées pour les maraudeurs. Manu a commencé les maraudes il y a trois ans et demi, à vingt ans, et Kathy a plaqué la direction d‘un restaurant branché pour faire un DESS de psychologie : refusée par toutes les facs de France à cause de son sujet, elle a patienté quatre ans pour qu’un prof accepte de la diriger : après avoir connu, plus jeune, l’encadrement de jour à Toulouse, elle était curieuse de voir la nuit à Paris. Elle travaille sur le thème du corps (peau, plaies, tatouages, marche à pied, image de soi...). Pendant qu’on discute, les sacs de campeur avalent tout : thermos, tondeuse (pour les cheveux : ça crée des liens), quatre-quarts, jus de fruit, chaussettes, bétadine (un désinfectant) et des kits pharmacie qui ressemblent à des filets garnis. Manu dit faire surtout de la « bobologie » : soins des pieds, pour tous, et des plaies liées aux piqûres, pour les toxicomanes.
Je ne suis pas le premier journaliste à accompagner la chose. Tous les médias s’y précipitent régulièrement, en général aux premiers grands froids. La maraude serait ainsi presque un « marronnier », un de ces sujets saisonniers qu’on peut traiter, de la même manière, année après année. « Les journalistes, il y a la dose », dit Manu avec un brin d’amusement, au point de confondre les noms des journaux qui sont venus. Récemment, L’Humanité a entrepris une série en douze épisodes pour suivre le travail du photographe d’Emmaüs, Sébastien Godefroy, sur la maraude. Moi, je ne souviens pas avoir jamais rien lu ni vu sur le thème : ce ne sont plus seulement les sdf, mais aussi les reportages sur eux qui passent inaperçus.
Les maraudes d’Emmaüs ont une spécificité : les soins sont presque un « alibi », un « outil » pour arriver à autre chose. Le but premier n’est pas de pousser les gens dans les centres, mais de venir leur parler, de nouer un contact. « Créer un lien », « amorcer un suivi » sont des expressions qui reviennent en permanence dans la bouche des maraudeurs. C’est un travail de terrain, de fond et de longue haleine. Il faut parfois plusieurs mois pour qu’un sdf accepte de parler. Les maraudeurs, dans ces cas-là, s’approchent de lui, lui parlent ou lui chantent des airs. De fait, la plupart des gens qu’on va croiser sont connus ; ils dorment au même endroit depuis longtemps. Ceci étant, bien peu acceptent le suivi qu’Emmaüs leur propose, c’est à dire de se rendre au centre dans la journée, pour discuter aide sociale, alphabétisation, accès au logement... La moindre démarche fait peur.
Sans itinéraire préconçu (tout se joue ici selon le « feeling » et l’« impro »), on traverse la salle d’accueil pour se diriger vers les Halles. Cinquante personnes sont là, uniquement des hommes, allongés par terre ou sur des fauteuils, sur des couvertures, des journaux, voire enveloppés dans du papier cadeau ; on croirait un hôpital au lendemain d’une bataille. Depuis la loi du 6 mars 2007 sur le logement opposable, beaucoup de sdf ont trouvé une place dans des centres de court ou moyen séjour, et ceux qui se retrouvent à la rue sont globalement dans des situations complexes. Des « cas », des excités, des toxicomanes, ou des gens qui refusent les structures d’accueil traditionnelles...
Munis chacun d’une thermos, on se dirige vers le Forum, baptisé « la marmite du Diable » parce que s’y concentrent les cas les plus difficiles. Il est encore tôt (minuit à peine) et il n’y a qu’un groupe de quatre jeunes, Yves, Loïc, Jérémie et leur sœur (qui restera pour nous anonyme ; peut-être, paradoxalement, parce qu’elle n’est pas souvent à la rue). Ils ont entre 20 et 25 ans. On reste trois quarts d’heure, à parler techniques de piercing, nettoyage de rangers, ou petit déjeuner à la bière... On apprend que chacun a un enfant, sans poser plus de questions... Loïc a les pieds qui enflent dangereusement, il est allongé tandis que Manu, accroupi, lui passe longuement de la pommade : c’est la fameuse bétadine, d’un rouge intense, on dirait qu’il a les pieds en sang. Image christique. Les pieds, c’est le point sensible n°1 : « la misère attaque par les pieds et finit par la tête », dit un des proverbes de la rue. Loïc s’est retrouvé en prison alors qu’il n’avait pas 18 ans, il a commencé à dessiner des mangas, selon une technique très personnelle : des mangas d’une page, sans légendes, très librement inspirés de ses aventures amoureuses. À la sortie, il continue, gardant son travail pour lui, qu’il stocke dans la cave de ses parents : huit ans de travail partiront dans un incendie. « Chacun est doué pour un talent », résume-t-il. Il pense recommencer quand il aura créé une boîte avec son frère - ça fait plusieurs semaines qu’il en parle - et se sera « posé » (veut-il dire « reposé » ou « stabilisé » ?).
L’après-midi, Loïc a vu le dentiste pour une carie qui durait depuis plusieurs jours, et est ressorti avec des cachets anesthésiants. C’est la première fois que je vois soigner des caries par des cachets. Sa sœur, à l’humour noir très appuyé, rêve depuis dix ans de se faire tatouer sur le dos un corbeau noir, avec une rose (noire) entre les pattes. Voilà pour l’ambiance. Les jeunes évoquent les projets de sorties avec Emmaüs (ils remplaceraient bien le théâtre par l’Aquaboulevard), des sorties qui sont aussi un moyen de voir les gens en situation et d’améliorer le suivi. A 1h, l’escalator s’arrête, les portes se ferment, les lumières s’éteignent. Au fond, juste avant la cour carrée du Forum, trois silhouettes fabriquent des sacs de couchage de fortune constitués de 5 ou 6 cartons ouverts et imbriqués les uns dans les autres. Au cours de la nuit, le lieu tend à se remplir, et est rapidement saturé.
Sortant de la bête par l’immense escalator à l’arrêt, j’ai l’impression d’être un mineur : ma thermos faisant office de lampe, j’émerge par un long tunnel des profondeurs ; je pense aussi au travail de fourmi que font les maraudeurs, certains depuis près de 10 ans. On traverse le jardin des Halles où on aperçoit « madame Moineau ». C’est un surnom. Elle n’est pas à la rue, elle passe ici ses nuits à nourrir les pigeons. On ne sait pas d’où elle vient, ni depuis quand. Réflexion faite, elle est moins inquiétante que les matrones qui sortent leur labrador, aperçues au même endroit le lendemain à l’aube... A l’entrée de la rue des Viarmes - des arcades grand style qui cernent la Bourse du travail - un gars nous arrête par de grands gestes. Jacky nous déconseille de réveiller Pierre. Avant de se mettre à vider son sac : Pierre ne va pas à l’hôpital, Pierre ne fait rien pour soigner sa gangrène, Pierre est collant et il n’a pas envie de se le coltiner toute la vie. Depuis quelques mois, Pierre laisse tranquillement sa gangrène au pied progresser. Pour qu’on le soigne. Les seules fois où il est allé à l’hôpital, c’est presque contraint, poussé par Manu et les pompiers appelés en renfort. Jacky, lui, est un Auvergnat qui vomit sa région. Comme je proteste, parlant d’un décor de western et de paysages paradisiaques, il me regarde fixement et dit : « J’en suis parti à 18 ans. Jusqu’à 18 ans, je ne me suis jamais senti un prince ». Et pour montrer qu’il n’a rien à perdre dans la vie, il lâche quelques minutes plus tard : « je n’ai pas de souvenirs ». Apparemment, c’est un ancien membre des « communautés », comme il dit. Il connaît par cœur la liste des centres parisiens Emmaüs. Une dame discrète s’approche (on peut l’apercevoir des journées entières sur le quai du métro Grands Boulevards, la tête enfouie dans son sac à main), se plaint du froid, prend un bol de soupe, et promet bien du plaisir à Sarkozy pour mettre tout le monde au travail. Elle a avec elle des journaux gratuits, mais regrette de ne pouvoir lire Le Monde. Pendant ce temps, Jacky tempête. La discussion passe du futile au grave quand il s’en prend aux bureaucrates ; à la Ddass ; à la France (entendre un Auvergnat dire qu’il ne se sent pas français est un grand moment) ; aux politiques... « Depuis que l’Abbé Pierre est mort, vous ne foutez plus rien, à Emmaüs ». Il a été tellement déçu depuis dix ans qu’il refuse de refaire la moindre démarche pour décrocher un logement.
Toute colère bue, on reprend la route. A deux pas, un grand barbu fait des exercices. Il refuse du café car il vient de se réveiller et compte petit-déjeuner au siège tout à l’heure. Il est deux heures : il a fait sa nuit. Direction les quais, via le Palais-Royal et la rue de Rivoli. Face au carrousel du Louvre, à la lumière d’un lampadaire, une dame est allongée sur une grille de métro, blottie dans des couvertures chamarrées. Elle a des lunettes de soleil. Il fait vraiment très chaud au dessus de la plaque. On dirait qu’elle bronze. Discussion moitié en anglais, moitié en français. Elle est Bulgare et, en habituée d’Emmaüs, s’étonne de ne nous avoir jamais vu. Ce soir, elle aurait « détesté voir du monde ». Elle change d’endroit souvent. Elle teste le café, trop fort, puis la soupe. Je sers d’interprète à mes compagnons de la nuit, mais je me sens mieux là qu’à Cannes, et notre « starlette » préserve mieux son incognito. On s’est à peine relevés qu’une silhouette file derrière. C’est Lirina, un jeune Malgache au sourire franc, qui, comme la plupart des gens rencontrés cette nuit, pose des questions sur le parcours, les habitudes de la maraude, la fréquence des visites... Il pense que les sdf sont « bien, à l’aise, libres, parce qu’ils ne sont pas standard ». Juste avant d’avouer marcher toute la nuit. Toutes les nuits. Une silhouette noire de la tête aux pieds, qui passe sa nuit à marcher... c’est Fantômas, ou rien. Il y a des gens qui marchent toute la nuit, mais d’abord par peur ou impossibilité panique de rester à un endroit : c’est ce qu’on appelle la « grande errance ».
Personne aux Tuileries, personne près du Pont Royal, mais un habitué rue du Bellechasse, au pied du musée d’Orsay. Alban est un Rennais, qui justement revient d’une ballade rue de Rennes. Il se promène souvent la nuit pour trouver le sommeil. L’été dernier, il s’est baladé jusqu’à Marseille, dit-il avec un sourire. Mais il n’aime pas le Sud, il préfère la Bretagne. Marseille, il n’y a pas assez de coins pour se promener (sic). Enfin, il regrette de n’y avoir passé qu’une semaine (froncement des lèvres, manière de dire « c’est pas des vacances ! ») et espère quand même bien y retourner cette année (lever de sourcils signifiant que ce n’est pas fait). Alban dort lui aussi sur une grille, mais pour éviter de se brûler (ce qui lui est déjà arrivé), il a interposé un carton.
Plus haut, le long du musée, on compte un matelas sous chaque arcade, avec une régularité effrayante. Ces cariatides couchées dorment toutes, à croire que les beaux quartiers sont propices au sommeil. Les quais voisins, pourtant, sont déserts : Chirac a dû faire fuir les « riverains ». Quai Voltaire, Phil dort sous une tente de fortune, avec de la musique qui joue très fort, mais ne répond pas aux appels. Nul ne sait s’il dort ou s’il boude. Un peu plus loin, deux gaillards s’approchent de nous en courant pour qu’on tranche un litige : les notes de la gamme sont-elles Do-ré-mi-sol-la-fi-do ou Do-ré-mi-fa-sol-la-si-do ? Échange minute. Chacun parle de son expérience musicale. La thermos de soupe a rendu l’âme. Il faut passer au bec verseur, ce qui entraîne des pertes irrémédiables. On repasse le fleuve par le Vert-Galant, où on espère retrouver un habitué. Chou blanc.
Il est 4 heures. Pause repas dans un bistro rugbystique des Halles, tout près du siège d’Emmaüs, où on se récite des contes africains et des proverbes espagnols. A la sortie, il fait encore nuit : plongée dans le tunnel des Halles, un des lieux qui a la pire réputation, bondé les nuits d’hiver, jonché de seringues et de kits spéciaux anti-sida. Des kilomètres et des kilomètres de couloirs, de bifurcations, de voies de stockage et de parkings. Un enfer où se perdre à coup sûr (pour le profane que je suis), un peu oppressant quand on y entre. Il y a deux ans, un gars est mort dans ce labyrinthe, un lecteur invétéré, qui ne quittait jamais le tunnel. Ce sont ses amis qui lui fournissaient les nourritures terrestres et spirituelles. A la fin, il était noir, plus noir qu’un black. Noir du temps passé dans le tunnel, ne distinguant plus le jour de la nuit, les heures ni les jours... C’est peut être la même chose pour les gens du métro, « les rats », qui savent combiner leurs itinéraires, diurnes et nocturnes, de manière à ne jamais émerger. On n’en verra pas cette nuit-là, mais ils pullulent, paraît-il, à Châtelet.
A la sortie du tunnel, nouveau repérage dans le jardin des Halles. Quatre jeunes dorment à même le sol, contre les grilles du RER, en bas des escalators arrêtés. Petit tour de routine sur la terrasse Lautréamont, qui surplombe tout le quartier Saint-Eustache, puis rencontre avec Matthieu (qui aimerait bien raconter ses soucis de santé, mais on n’arrête pas de croiser des connaissances, et il part en râlant, nous donnant rendez-vous plus tard au petit-déjeuner), Timothée (un Africain grand et fin, dont le pantalon arrive à peu près aux genoux, qui raconte sa lapidation à coups de cannettes de bière, et tente de sauver onze Ghanéennes contraintes au « trottoir » pour rembourser leur passage en France) et un de ses copains, tout juste libéré du commissariat. La veille, il y avait « une cinquantaine de flics » dans les parages. Timothée les as vus, a senti le vent tourner, et a filé dans un centre Emmaüs.
Rue des Bourdonnais, une dame est triste parce que des policiers allemands ont tabassé des jeunes. Elle parle du G8 à Rostock. Retour au point 0. Pour la seconde fois, on boucle la boucle. Le soleil se lève sur la banque Lazard. Dans la salle des maraudes, Kathy (Manu l’appelle-t-il la Catoche ou la Caboche ?) remplit le cahier de bord : bref, elle fait ce que je viens de faire, en comptant, en plus, le nombre de personnes croisées et le nombre de chiens. Des cahiers de ce type, il y en a des dizaines et des dizaines dans les archives, couvrant une période de huit ans. Personne n’ira les regarder. Les confidences de la nuit resteront un secret entre maraudeurs et marauds.