


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


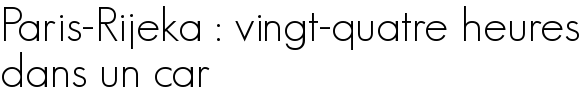
Vous vouliez de la sueur ? Vous aurez des larmes ! Quand j’ai dit que j’empruntais Eurolines pour aller en Europe de l’Est, tout le monde m’a dit : « Tu vas croiser des plombiers polonais. » Baste ! Vieux couples et jeunes célibataires, la quasi-totalité des voyageurs croisés entre Paris et Rijeka en ce début février, quittait, ou regagnait... sa famille (ou, tout au moins, sa dulcinée).
Le voyage est long (vingt-quatre heures), il n’est pas donné (quatre euros de l’heure : à vos tablettes), et la qualité de l’info fournie par Eurolines en matière de délais ou de transferts n’est pas toujours au rendez-vous.
J’arrive à la gare routière de Gallieni, un matin aux aurores. Des bus partent ce matin là pour Copenhague (via Bruxelles, Hambourg et Oslo), et pour Amsterdam (via Bruxelles, Breda, Utrecht). Aux comptoirs d’enregistrement, comptoirs endormis, seules deux petites fenêtres veillent, aux deux extrémités de la salle carrée. Machines à café inaccessibles, téléphones publics cachés, grande carte d’Europe aux trois quarts dissimulée par une palissade... À l’image des gens qu’elle voit défiler (ce matin, elle est déserte, mais l’été, je l’ai vue surpeuplée), la salle des pas perdus est un endroit de transit.
Au niveau des quais, dans une affreuse cafétéria tout en longueur, une unique hôtesse a placé devant elle les ingrédients nécessaires aux sandwichs de la journée, et un unique hôte attablé recopie sur un morceau de papier le répertoire de son portable. Quatre forts des Halles, les sacs bien remplis, arborant tous un couvre-chef différent (casquette, chapka, bonnet, bob), entourent un tout petit monsieur, avec lequel ils tentent de s’entendre. Laborieusement. Petit monsieur récite l’alphabet en leur compagnie, eux opinent ou répètent, selon les lettres. Quelques minutes plus tard, quand mon bus quittera la place, je les verrai traverser les voies après avoir troqué leurs sacs contre des cartons.
Je suis pris en main par une belle Slave, qui me confie les clefs du bus ; en fait, elle me confie que j’aurai le bus pour moi... ou tout comme, puisque nous sommes trois. Autant que de chauffeurs. Les rangées de sièges vides se reflètent dans la télé de bord. C’est la dernière fois avant l’été, m’apprend l’une des voyageuses, que le service du mercredi matin est assuré. La semaine prochaine, il n’y aura plus qu’une liaison hebdomadaire le dimanche. Et des deux lignes qui traversaient auparavant l’Europe vers Zagreb, poursuit-elle, Eurolines a même supprimé celle qui passait par l’Allemagne et qui faisait gagner trois heures : on passe donc par l’Italie, avec arrêt unique à Lyon. Mais selon les saisons, le bus fait aussi escale à Dijon, Grenoble, Turin ou Llubjana.
Le trio de chauffeurs fait un peu pieds nickelés, forcément. Il y a le rond en gilet bordeaux, le moustachu dansant qui dort au fond du bus, et le clown blanc au visage rectangulaire. Ils se relaient au volant, par tranches de quatre heures. À mon effarement, ils ne parlent qu’une langue : le croate. Pour me renseigner, jouer l’inquisiteur sur les rythmes de travail et la stratégie d’Eurolines, je suis obligé de prendre les autres passagers comme interprètes. Évidemment ils comprennent de travers et ça tourne court.
Avec cinq minutes de retard sur l’horaire officiel, nous perçons les boulevards extérieurs pour nous engager sur le manège de la porte de Bagnolet. Laissant à gauche les immenses coupoles d’Auchan et de Campanile, narguant les publicités EasyJet pour Biarritz à 32 €, lapant les surprises urbaines de Bagnolet (une baraque en planches assortie de la douce enseigne de « lutherie urbaine »), je me cale. La seule manière de pouvoir allonger ses jambes est de baisser son siège au maximum, à condition que celui de devant reste en position normale. Dans ma ration de lectures, un recueil de nouvelles hongroises. Dans l’une d’elles, le héros entreprend un voyage en train de douze heures entre Budapest et... Fiume, en compagnie d’une mère et de sa fille. L’auteur, Kosztolanyi, analyse les compartiments de train : « Ici, la vie des étrangers nous est pour ainsi dire présentée en coupe - d’un seul tenant et condensée -, de même que dans un roman ouvert au hasard. (...) Nous pouvons les épier, faire des conjectures : quel sera le début de ce roman, quelle sera sa fin ? »

En tête de bus, un homme de qurante ans compulse des piles de documents imprimés à en-tête d’un ministère serbe. Ces papiers remplissent des sacs plastique entiers. Pour tuer le temps, il lit aussi des gratuits (français) prêtés par les chauffeurs (qui lisent peut-être la langue à défaut de la parler). Mais il n’est pas très amateur de conversations, répondant un « je ne sais pas » bien accentué à la plupart de mes questions (quelle idée, aussi, d’aborder les primaires américaines avec un Croate !). Dora, la soixantaine, est plus prolixe. Elle rejoint, comme deux fois par an environ, ses parents dans la campagne de Zagreb. Elle s’apprête à rester longtemps, car « ils sont malades », dit-elle avec lenteur et un air d’infinie désolation. Elle invoque sa tonne de bagages pour expliquer son choix de voyager en bus, mais elle part toujours ainsi, sauf quand son mari l’accompagne en voiture (six heures de moins que par Eurolines). Ses enfants préfèrent l’avion, plus rapide, un peu plus contraignant au niveau des réservations... mais pas forcément plus cher : en jouant des délais, Croatian Airlines propose en effet des vols à 150 €.
Pipi du matin. Une musique très années 80 s’échappe des toilettes femmes dans un décor de fin du monde.
À Lyon, passage par le ventre de Perrache, cette gare du XIXe siècle défigurée par une plate-forme en bulle des années 70 (genre Beaubourg en plexiglas flashy qui aurait fondu au soleil). Un groupe de gars typés, une dizaine, avec sacs et casquettes, attend devant un bus Eurolines pour Sofia. Le nôtre repart, direction l’autoroute Blanche, puis celle de la Maurienne. Avec mes rêves de destinations adriatiques, je laisse les travailleurs pauvres sur le bord de la route. Ont rejoint le bus une dame et sa fille (d’un éblouissant roux métallisé, comme une insolente proportion de Croates), qui vont dans leur famille, à Zagreb ; une jeune fille tout en rondeurs et aux cheveux de jais, qui va retrouver la sienne à Serebos ; de vieux couples croates, dont la plupart habitent en France et vont faire des séjours réguliers chez des proches ou dans leur résidence secondaire, en Croatie. C’est l’un d’eux qui m’invite, un été, à Zadar. L’homme, petit moustachu râblé à l’air matois, la femme, petite mamie de cinéma, dont la tête, le nez, les yeux sont comme des ballons, et qui ne perd pas une occasion de dire quelques mots de français de sa voix suraiguë. Ainsi, comme je me vante, alors que le bus est déjà surchauffé : « Et moi, en plus, j’ai un petit radiateur sous la tête », elle s’écrie : « Mais on a tous un petit radiateur sous la tête ! » Monte aussi un petit homme barbu, peu disert.
Le soir, séance cinéma. Deux blockbusters sous-titrés en croate (à peu près ce que j’aurais pu trouver dans un cinéma de Zagreb). Dans le premier, qui raconte une attaque bactériochimique mystère dans une ville américaine, les militaires sont camouflés dans des tenues fluorescentes violettes qui les font ressembler à des envahisseurs d’un autre monde plutôt qu’à des gardiens de l’ordre. C’est ce moment-là, juste avant le tunnel du Fréjus, que choisissent les douaniers (des douaniers français, monsieur !) pour monter nous rendre une petite visite. Ils s’enquièrent auprès de chacun du but de son voyage. Lequel va être sorti du loft ?
Le petit homme barbu monté à Lyon, qui ne parle visiblement ni français, ni anglais, ne se sort pas de son échange. Après trois minutes de palabres de sourds entre les deux parties, le mot « tourist » émerge subitement de la conversation. Il le répète en claironnant : « Tourist ! Tourist ! » Je ne sais pas ce que veulent dire l’errance de cet homme qui fait les cent pas dans les stations d’autoroutes, ni, dans ses mains, le papier à en-tête de l’Hôtel Split, mais je n’aurais pas parié pour le touriste.
La nuit est pratiquement tombée quand on sort du Fréjus. À la fin du film, les chauffeurs ont commencé à passer des chants traditionnels croates. Ce n’est pas là-dessus qu’ils dansent, c’est en enjambant les corps des passagers allongés en travers des banquettes. Peu verront donc l’Italie : enfin, l’autostrade d’Italie... car les trajets Eurolines, en tout cas dans cette partie du continent, se font exclusivement via les autoroute. La slave qui nous accueillait ce matin sur le quai a ri bien fort quand je lui ai demandé si on longerait la mer à notre arrivée en Croatie, et claironné : « Non, non, pas la mer ! L’autoroute jusqu’au bout ! »
Turin se résume à une longue ceinture d’immeubles gris, aux allures de fantômes, à l’horizon desquels dépasse un clocher. De l’autre côté de la route s’alignent des usines ou des entrepôts aux formes remarquables : l’un a des façades ajourées, qui lui donnent l’allure d’une galerie commerciale hypermoderne. L’autre est si longue qu’elle se perd dans l’obscurité. De nuit, la succession d’enseignes lumineuses fait de la route entre Turin et Milan un long continuum industriel. Le retour infirmera cette impression. Malaise, et sentiment de traverser deux pays différents. Ou bien que le paysage, comme les bordures des stades de football, est constitué de publicités lumineuses et changeantes pour des entrepreneurs locaux.

Les aires de services italiennes sont appétissantes, et bien pourvues. Elles sentent le chocolat. Pas étonnant, vu les montagnes de tablettes, de toutes marques et de tous parfums, qui vous accueillent. Il y a aussi une variété incroyable de riz et de préservatifs. Aux toilettes, la chasse d’eau, compulsive, se déclenche toutes les trente secondes. Au comptoir, les serveuses s’énervent et rigolent en même temps. Près de la sortie, les chauffeurs essaient des lunettes de soleil.
Les gens ne dorment que quand le bus roule. Lors des arrêts, ils sont debout, esquissant quelques pas dans l’allée, à l’affût. On se croirait dans Le Crime de l’Orient-Express. Peuple de voyageurs qui ne se reposent jamais. Quelques rencontres, au retour, étaieront cette idée. Deux jeunes gars, Axel et Léo, squattant les dernières rangées, sont deux bourlingueurs passionnés : le premier revient de deux ans en Australie, via la Turquie et la Bosnie, mais il a aussi travaillé à plusieurs reprises en Croatie, dans un hôtel français notamment. C’est dire s’il est familier des longs voyages en bus. Il n’a pas spécialement souffert des traversées de l’ex-Yougoslavie, malgré les péripéties qu’il énumère (pannes, rétroviseurs arrachés, arbres bloquant la route et détours). Ces vingt-quatre heures sont comme un « sas de décompression » avant son retour en France. L’autre chante dans un groupe de rock nomade, qui multiplie les tournées dans les pays de l’Est. Il revient de Zagreb, ville où il a rencontré sa copine à l’occasion d’un concert. Il fait le voyage tous les deux mois.
Il est quatre heures, le moment le plus angoissant des voyages Eurolines arrive. On passe la douane à la frontière croato-slovène. Il n’est pas rare - je parle par expérience - que la durée d’un Paris-Bruxelles soit multipliée par deux parce que les chiens ont reniflé quelque chose de pas catholique dans une valise. Réveil brutal par le chauffeur, relevé des cartes d’identité, descente du bus, interrogatoires express (on me demande mon signe astrologique, si j’ai des médicaments, et de reproduire ma signature sur un bout de journal, tout ça dans un anglais où je prends souvent un mot pour un autre). Le passage de la frontière dans l’autre sens, entrée dans l’espace Schengen oblige, est plus problématique : alors qu’un premier douanier, bonhomme en apparence, questionne familièrement les passagers sur les buts de leur voyage, un second déshabille les valises cigarette par cigarette et caleçon par caleçon, sous l’œil de tout le monde. Les petits vieux ne sont pas champions au concours de réempaquetage. Les plus jeunes restent stoïques devant leurs pantalons secoués d’où s’échappent des sachets au contenu incertain.
Toutes épreuves aidantes, deux des couples, assis l’un derrière l’autre, de part et d’autre de l’allée, ont entamé une longue discussion croisée vers la fin du trajet.
Il est cinq heures trente quand le car s’arrête à Zagreb. Finalement, l’espace (à l’intérieur du bus) estompe un peu les limites du temps. On ne ressent pas le temps de trajet (pour autant qu’on arrive à entrecouper sa nuit de quelques plages de sommeil). La jeunesse apprécie de voir du pays. La vieillesse fait contre petite fortune bon cœur. Seul un quinqua se fait entendre : « C’est la deuxième fois que je prends le bus, et c’est la dernière. » L’homme, en France depuis trente ans, voyage avec deux amis croates. Il a discuté toute la nuit, pour se coucher entre huit et onze heures.
Il est cinq heures trente et il fait froid dans la gare routière, un gigantesque bloc de béton hérissé d’escaliers, de salles d’attente et de pizzerias rapides dans toutes les directions. Il est cinq heures trente et mon billet prévoit deux heures d’attente avant la correspondance pour Rijeka. Je discute avec Dora devant un plan dessiné de la capitale qui omet sobrement de préciser l’emplacement où nous sommes. La ville change à toute vitesse, me dit Dora, et depuis la guerre « la moitié du pays a été vendue ». Elle se lamente sur la jeunesse du pays, qui n’a même pas l’excuse du chômage de masse (comme nous, les jeunes Français) pour ne pas travailler, et exploite ses parents jusqu’à la moelle. Elle dit que personne ne veut combattre la corruption. Elle dit que quand on est retraité en France, on s’ennuie, et que j’ai bien raison de voyager.
Le premier bus pour Rijeka s’avance à six heures quinze, je m’y engouffre. Cela fâche beaucoup le contrôleur au moment où il le découvre. Car le chauffeur est ici secondé par un contrôleur, avec qui il alterne. Le contrôleur me crie (en croate) que ma réservation n’est pas valable, que je vais devoir acheter un autre billet. Comme il nie (« Ne ! Ne ! ») chacun de mes arguments de défense, je lui tends des liasses d’euros ; je me doute qu’il n’acceptera que des kunas, mais je n’ai pas encore fait de change. Il prend un air dépité (ou sadique, ou hiératique, son accent et la forme de ses lèvres sont trompeurs) et m’explique que je vais descendre au prochain arrêt, pour attendre le bus de sept heures trente. Je sue toutes les gouttes de mon corps en imaginant la zone où je vais devoir cantonner. Justement, on traverse une ville de garnison : grands ensemble désertiques, dalles grises ennuagées, centre commercial borgne et souterrain, dont les issues ressemblent à des bouches de métro. C’est là. Ô havre où tromper mon ennui, le supermarché local est ouvert depuis... sept heures. Les gens s’y baladent avec de tout petits sacs de courses dans de très grands caddies. On découvre des tas de choses insolites : du pâté en tube, de l’essence de kiwi, du vin de messe monténégrin. Mais le calvaire n’est pas fini : nouveau bus, nouveau départ, nouvel espoir. En voyant que je commence mon trajet à Karlovor alors que mon billet stipule un départ de Zagreb, le contrôleur manque s’étouffer. Grands gestes : j’aurais dû accomplir toutes mes formalités avant de monter. C’est tout juste si on ne me fait pas racheter un billet. Mais comme il n’y a pas d’autre étape avant Rijeka, on me garde, et on me regarde, comme un pestiféré. Aux péages, nombreux, le contrôleur range soigneusement la facture dans un portefeuille. Soudain, c’est l’horreur : à l’un des péages monte un... deuxième contrôleur. Bien que personne ne soit monté depuis le premier contrôle, il va refaire son office. Il garde le silence sur mon cas.
Je termine mon périple après avoir descendu les collines de l’Istrie, aperçu la mer, longé des parkings isolés au pied des falaises. J’aurais tant aimé vous parler de Rijeka.