


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


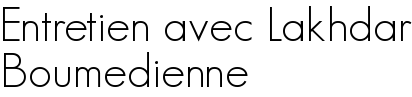
(Photo : Thierry Clech.)
Lakhdar Boumediene, vous avez donné votre nom à un arrêt de la Cour suprême datant du 12 juin 2008, l’arrêt « Boumediene vs. Bush », qui reconnaît aux détenus de Guantanamo le droit de faire valoir l’habeas corpus pour contester leur détention arbitraire et réclamer un procès équitable.
Oui. Mon nom, maintenant, c’est un arrêt. Boumediene vs. Bush, comme un match. Le jour de la décision, le 12 juin, j’étais en grève de la faim depuis un an et demi mais j’ai accepté un repas : j’étais heureux, j’avais vaincu un président. C’était la victoire de tous les détenus de Guantanamo. Le 20 novembre 2008, nouvelle victoire : j’ai été disculpé par le juge, qui a dit : « Boumediene est un homme innocent. » Et pourtant ce juge fédéral, Richard Leon, était un ami de Bush.
Vous êtes resté sept ans et demi à Guantanamo. Comment avez-vous traversé tout cela ?
Je suis croyant. C’est très simple : c’était écrit, c’est le destin. Deuxième raison, ma femme et mes enfants. Et puis je savais dès le départ que je n’avais pas fait de faute. Ça m’a permis de tenir. Avant, j’étais en Bosnie, je travaillais pour le Croissant-Rouge, et soudain je me suis retrouvé dans un tunnel noir. Pendant sept ans et demi, ma question a été : « Pourquoi je suis ici ? » Il n’y a jamais eu de réponse. On m’avait accusé de préparer un attentat contre l’ambassade des États-Unis en Bosnie. Or, pendant sept ans et demi, jamais les Américains ne m’ont interrogé sur l’ambassade. Moi je leur disais : « Mais parlez-moi de l’ambassade ! » En 2004, j’ai demandé à un interrogateur haut placé ce qu’on me reprochait vraiment : « Dites-moi pourquoi je suis là, et j’accepterai de parler chaque jour, pendant dix heures si vous voulez ; chaque jour, pas de problème, bienvenue ! »
Qu’est-ce qui vous a poussé à entamer une grève de la faim ?
Les grèves de la faim ont commencé dès 2002 au camp X-Ray [1]. Au départ j’étais contre la grève de faim. Je n’avais pas de rapport avec les autres, ceux qui faisaient grève. Jusqu’au 25 décembre 2006, où mon interrogateur m’a dit : « J’ai des ordres de Washington pour vous transférer vers le camp Iguana... »
Le camp Iguana, c’est-à-dire ?
Le camp Iguana, la vitrine de Guantanamo. Un camp « publicitaire », où chaque mercredi les journalistes venaient prendre des photos de détenus avec des vêtements propres, du savon, une télévision... Au même moment, il y avait des tortures au camp 5 ou au camp 6, juste à côté, à quelques pas de là.
Il y avait des contreparties à cette proposition de transfert ?
Mon interrogateur voulait que j’accepte de lui parler, malgré les mauvais traitements et l’épuisement. J’ai refusé. Il m’a demandé : « Pourquoi crachez-vous sur cet honneur ? » Puis il a écrit son rapport, m’a rasé les cheveux, la barbe, m’a dit de retourner dans ma cellule, et m’a donné une punition supplémentaire, un « menu spécial ». Un truc, croyez-moi... Je lui ai dit : « Désolé, mais aujourd’hui, je commence une grève de la faim. Je m’en fous, je reste ici, je me mets en grève. » Je suis resté en grève de la faim jusqu’au 15 mai 2009. Mon problème était que j’avais une fissure dans une narine, qui rendait encore plus douloureuse la pose des tuyaux d’alimentation forcée. C’était mon point faible. Ils posaient chaque fois le tuyau dans cette narine-là, en disant : « Ah, j’avais oublié... » Et le lendemain ils le remettaient dans la même narine. Je crois... je crois que vous connaissez la situation.
Existait-il une solidarité entre les détenus, des liens amicaux ?
Moi, je n’avais pas de lien avec les autres. J’étais de Bosnie, alors qu’eux venaient du Pakistan, d’Afghanistan. Des amitiés ? Bonjour, bonsoir, bon appétit... Des choses superficielles. Mais des discussions sur le travail, la vie d’avant, ce qu’ils faisaient en Afghanistan, non. J’aurais été pris pour un espion. Tout le monde est paranoïaque, là-bas. Tout le monde se méfiait de tout le monde. J’étais de Bosnie, lieu inconnu des autres, et si en plus j’avais posé des questions... non. Il y avait danger. C’est ça, le problème des relations entre détenus... Ce n’était pas pour tout le monde la même chose : pour moi, c’était « bonjour bonjour ». Si on écoute ce que chacun dit à Guantanamo, tout le monde est innocent. La vérité à ce moment-là, je ne la connais pas, et je ne peux pas poser de questions. Imaginez... et croyez-moi, c’est difficile d’imaginer... J’étais un homme comme tous les hommes, et soudain, là-bas : un terroriste.
Sans qu’il y ait des relations de confiance, il y avait des émeutes, donc une organisation collective ?
Non, pas une organisation collective. Une organisation automatique. Automatiquement, si un soldat vous maltraite, vous réagissez. Par exemple, des soldats crachaient dans la nourriture. Si moi je m’en apercevais et pas mon voisin, automatiquement je le prévenais : d’où, après, des grèves, des émeutes...
Les profanations du Coran entretenaient ces tensions ?
Là-bas, tous les détenus étaient musulmans : 100% ! Il y avait des soldats qui jouaient avec ça. Qui jetaient le Coran par terre, à la poubelle. D’autres posaient des questions pendant la prière, et si vous ne répondiez pas, les gardes armés chargeaient. Pendant le Ramadan, certains faisaient exprès de nous apporter le repas après le lever du soleil... Au début, les détenus étaient tellement méfiants que certains, pour prier vers la Mecque, prenaient le sens opposé à celui indiqué par les Américains.
Le fait de pouvoir se parler une langue que les gardiens ne comprenaient pas devait être une force ?
Mais non, n’oubliez pas : il y avait des microphones, des caméras, des interprètes dans chaque coin. Organisation automatique, oui. Pas plus.
Y avait-il chez certaines personnes de l’encadrement du camp un comportement plus humain qui vous aidait à supporter l’enfermement ?
La plupart des militaires de Guantanamo sont des jeunes. Quand ils voient un musulman ou un détenu barbu, ils disent tout de suite : « C’est Ben Laden. » J’ai eu des problèmes avec eux pendant sept ans et demi. Il y avait quand même peut-être un pour cent des soldats qui n’étaient pas comme ça, qui avaient un cerveau clair, qui réfléchissaient en être humains et me disaient : « Je sais que vous êtes innocent. » Mais c’était limité. Ils ne pouvaient pas parler avec moi trop longtemps, et entre eux et moi il y avait toujours le grillage. Même chose pour les interrogateurs. Les vrais interrogateurs, il y en a eu jusqu’à fin 2002, début 2003. Ensuite, il n’y a plus eu que des stagiaires. Des jeunes qui me redemandaient éternellement de raconter ma vie, mes emplois successifs au Pakistan, au Yémen, en Albanie. Alors que pour tout cela j’avais toujours été en règle et ils en avaient la preuve : mes papiers, mes passeports, un dossier gros comme ça établi par la justice bosniaque. Toute ma vie, ils la savaient depuis le début ! D’ailleurs ces papiers, ils ne me les ont jamais rendus.
Et les interprètes ?
C’est une autre tache noire de Guantanamo, les interprètes. Je suis désolé de dire ça, mais c’étaient des abrutis. Ils commettaient un nombre d’erreurs incroyable. Pour eux, tous les Arabes étaient terroristes. Au début, c’étaient des Américains qui ne parlaient que quelques mots d’arabe, ils arrivaient avec deux ou trois gros dictionnaires. La première fois que j’ai eu affaire à l’un d’eux, j’ai parlé en arabe littéraire pour qu’ils puissent comprendre. Quand j’ai dit : « J’ai travaillé au Croissant-Rouge », l’interprète a traduit : « Il a acheté des croissants rouges » ! Quand j’ai entendu ça, j’ai dit : « C’est bon, j’arrête tout de suite. Torturez-moi si vous voulez, mais je ne continuerai pas. »
Au bout d’un an, ils ont remplacé ces interprètes américains par des arabophones. Des Libanais, des Palestiniens, quelques rares Marocains, et une grande majorité d’Égyptiens, des chrétiens. Je disais un mot et l’interprète en disait trois. J’en disais quatre et il en disait huit. Ils interprétaient toujours les choses au lieu de se contenter de traduire. Au bout de trois ou quatre ans, quand les procès ont commencé, les Américains ont eu beaucoup de problèmes. Quand les juges disaient : « Vous avez dit ça, c’est écrit là », les détenus disaient : « Mais non, je n’ai jamais dit ça, moi ! »
Vous parliez déjà anglais ?
Oui mais je ne pouvais pas le montrer, sinon c’était la catastrophe. Pour eux c’était une évidence : tous les Arabes qui parlaient anglais avaient forcément été en contact avec Al-Qaida. D’ailleurs je ne parlais pas bien, j’avais simplement appris quelques mots quand j’étais jeune. Mais à Guantanamo, impossible de ne pas apprendre. Chaque jour j’apprenais deux, trois mots, un peu de syntaxe.
Les gens de la Croix-Rouge vous apportaient-ils du réconfort ?
Assez peu en ce qui me concerne. Ils pouvaient entrer dans le camp et voir vraiment ce qui se passait, à la différence des journalistes qui ne voyaient que le camp Iguana. Mais ils n’avaient pas le droit de dire à l’extérieur ce qu’ils voyaient [2]. Pour les gens qui venaient d’Afghanistan et dont les familles étaient dans les montagnes, c’était différent. Grâce à la Croix-Rouge, ils pouvaient recevoir de temps en temps une lettre. À la fin aussi, à partir de 2008, nous avons commencé à pouvoir téléphoner à nos familles, au départ une fois par an, puis tous les six mois. J’ai lu qu’aujourd’hui, les détenus allaient pouvoir téléphoner avec la vidéo.
Comment s’est fait le choix de vos avocats ?
Il y avait plusieurs cabinets qui s’occupaient des détenus. J’étais à Guantanamo, je n’avais aucun contact avec le monde. Et un jour, en 2004, des gens sont venus voir ma femme et lui ont dit que des avocats commençaient à défendre des détenus, des Koweïtiens notamment, qui avaient payé plusieurs millions de dollars. Elle a contacté Clive Smith, qui défendait déjà bénévolement de nombreux détenus ; il lui a conseillé de s’adresser à Stephen Oleskey, du cabinet WilmerHale. Je l’ai rencontré pour la première fois en août 2004.
Depuis 2001, c’était votre premier contact avec un avocat ?
Le premier. Jusque là, il y avait des gens qui se faisaient passer pour des avocats. Ils arrivaient avec de faux habits, et en fait c’était un piège pour vous faire parler.
Comment avez-vous su que Stephen Oleskey était un vrai avocat ?
Je lui ai demandé pourquoi il était prêt à me défendre gratuitement ; je sais qu’en Amérique on est très matérialiste, que c’est donnant donnant. Il m’a répondu, les larmes aux yeux, qu’il avait une longue histoire, et que pendant les années 1950, au moment de la chasse aux communistes, sa mère était avocate et avait sauvé des innocents. Il avait choisi la même voie. Il m’a dit : « J’ai lu votre dossier, je sais que vous êtes innocent. » Je lui ai demandé comment nous allions faire financièrement. Il m’a répondu que dans son cabinet, 5% des bénéfices étaient consacrés à la défense des clients sans moyens. Je lui ai dit d’accord. Je n’avais rien à perdre. Il s’est finalement occupé du cas des six Bosniaques [3].
Avez-vous pu suivre votre procès ?
Deux semaines avant le début du procès, mon avocat m’avait dit qu’il essaierait de me faire venir témoigner à Washington. Une semaine avant, il a été question que j’intervienne par vidéo, mais les autorités ont dit que je risquais d’adresser un message à Al-Qaida ! Alors on m’a dit : « Peut-être par téléphone. » Finalement, il n’y a même pas eu de téléphone. En revanche, on a obtenu de suivre le procès ensemble, les cinq autres Bosniaques et moi, en léger différé, de Guantanamo. On allait dans une salle avec des avocats et on écoutait le procès jour après jour. Malheureusement, presque chaque jour, il y avait des problèmes techniques. Mais le dernier jour, on a pu écouter le verdict en direct. Le juge a parlé pendant longtemps, presque une heure, en disant au gouvernement américain : « La prochaine fois que vous arrêtez quelqu’un, je vous conseille de faire plus attention. » Et enfin il a annoncé sa décision et nous a déclarés innocents.
Comment s’est passée la période qui a précédé votre libération effective ?
Un haut responsable, je crois que c’était un amiral, m’a dit : « Boumediene, » - non : « monsieur 10005 » (c’était mon numéro, là-bas) - « vous commencez une page blanche. Une nouvelle page. » J’ai posé plusieurs conditions : parler avec ma femme, ne plus jamais avoir affaire au responsable d’Iguana, avec qui j’avais eu trop de problèmes.
Ensuite s’est posée la question, assez inattendue, de trouver un pays d’accueil.
J’ai dit à mon avocat : « Je vais maintenant en Somalie, sur la Lune, n’importe où. [4].. mais je veux sortir d’ici. » Je crois que c’était en mars 2009. Au bout de trois semaines, mon avocat m’a dit : « L’Algérie, oublie, la Bosnie, oublie, les Serbes du Parlement refusent. Maintenant, c’est la France. » J’ai dit : « Comment la France ? » Pour moi, c’était incroyable, la France, à cause des amalgames que j’imaginais là-bas, depuis le détournement de l’Airbus en 1994 et les attentats islamistes de 1995. Il m’a dit : « C’est la vérité. Obama a parlé avec Sarkozy, il lui a dit : «acceptez des gens», il en a accepté un, je crois que c’est vous. » Au bout d’une semaine, on m’a dit : « C’est bon, la France accueille Boumediene. »
Le 14 mai, un Français m’a rendu visite et m’a amené de la nourriture. Il m’a dit : « Vendredi, il y a un vol vers Paris, votre femme vous attend là-bas. » J’étais très très heureux. J’ai rompu ma grève de la faim pour manger quelque chose avec lui. J’étais intimidé.
Et vous êtes parti le lendemain, le 15 mai 2009.
Oui. Je suis innocent, je peux partir. Et malgré tout je monte dans un avion militaire, attaché aux mains, aux pieds. Sans pouvoir aller aux toilettes autrement qu’enchaîné et filmé. Les caméras militaires américaines m’ont surveillé jusqu’à Roissy. Là, enfin, ils m’ont enlevé les chaînes. J’ai retrouvé ma femme et mes enfants... que malheureusement je n’ai pas vu grandir, la petite avait dix-huit mois au moment de mon envoi à Guantanamo, l’autre neuf ans... La petite ne me connaissait que par les photos, en me voyant elle a dit à sa mère : « Maman, ce n’est pas mon père, lui c’est un homme vieux. » Je n’ai pas oublié ce moment. Ma femme pleure, les enfants pleurent, je pleure, vingt minutes de pleurs.
Quelle est votre vie aujourd’hui ?
Non, non... Je laisse passer cette question. Désolé, mais il y a des choses... Mon but maintenant, c’est de construire ma vie avec ma famille. C’est difficile... Je vous donne un exemple : maintenant, quand je me lave les mains, il y a des cicatrices, à cause des menottes, ici, ici, et ici... et automatiquement j’y pense. Je vais là-bas, à Guantanamo. Il y a des fois aussi, avec internet... Chaque jour, avant d’aller consulter mes mails, je vais sur Yahoo voir les dernières nouvelles de Guantanamo : qui sort, qui entre. Ou je tombe sur des sites qui parlent de torture. C’est très difficile, ça génère des réactions... Je crois que vous avez compris.
Quand j’y repense, à cette cage de un mètre cinquante sur un mètre quatre-vingt, en short, pieds nus, au milieu de ce sol et de ce plafond en métal... J’étais en Bosnie, j’ai travaillé avec des organisations humanitaires pendant plus de huit ans. J’aimais mon travail. Je m’occupais de mille cinq cents orphelins et de veuves de guerre. C’était ça mon travail. J’avais un travail que j’aimais, et maintenant je me sens comme un pauvre, timide, amoindri. Il y a une grande différence entre ma vie en Bosnie et ma vie aujourd’hui. J’espère qu’à l’avenir ça va s’améliorer mais ça fait déjà plus de huit mois et c’est très difficile.
Trouvez-vous qu’on a tendance, ici, à oublier ce qui se passe là-bas ?
Il y a des gens qui oublient, parce qu’aussi certaines choses doivent être oubliées. En janvier les gens y pensaient, à cause de la promesse d’Obama de fermer Guantanamo. Et puis il y a eu Haïti et les gens ont oublié. Mais il y a des associations, des gens qui ne peuvent pas oublier, Amnesty International par exemple. Pour moi, encore maintenant, c’est très difficile d’oublier. J’ai rendez-vous tous les quinze jours à Marseille, pour un suivi psychiatrique. Je n’ai pas d’amis ici. J’ai de la famille, ma belle-sœur, ma femme. Mais je ne peux pas parler avec ma femme toute la journée de Guantanamo, ce n’est pas bien pour elle, psychiquement. Je cherche des amis pour parler, comme ça, là, maintenant. Là, maintenant, je me sens bien. C’est très difficile. Il y a des gens, des milliers de gens, quand vous leur dites : « Guantanamo », pour eux c’est comme la grippe A ! Je ne sais pas comment dire... j’ai peur de parler de ça avec les gens. « Je viens de Guantanamo », « J’ai été à Guantanamo »...
Les gens ont pourtant de quoi être admiratifs de votre combat.
Oui, mais vous êtes journalistes. Les journalistes, les avocats, les ONG savent ça. Il y a des gens qui lisent sur internet ce qui s’est passé et qui me disent : « Boumediene, j’ai lu que tu étais innocent. » Mais la plupart des gens n’ont que des idées reçues sur tout ça. Ils n’ont pas le temps de réfléchir. Et je ne peux pas expliquer à tout le monde que j’étais employé du Croissant-Rouge, que je suis innocent, que je n’aime pas les terroristes, etc.
Et avec d’autres anciens détenus, vous pourriez en parler ?
Je ne sais pas. Ce n’est pas facile.
Avez-vous laissé des gens auxquels vous teniez, là-bas ?
Un ami tchadien est sorti, peut-être un mois après moi. Il avait été arrêté parce qu’il portait une montre Casio, la montre qui a servi de détonateur à des terroristes. Au procès, le juge a sorti sa montre et il a dit : « Moi aussi j’ai une montre Casio, moi aussi je suis un terroriste ! »
Vous avez déclaré vouloir porter plainte contre George Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld et Alberto Gonzales, le procureur général des États-Unis.
Jusqu’à ma mort !
Est-ce qu’il y a une action en justice en cours ?
Pour le moment il faut attendre, pour ne pas bloquer la libération du sixième détenu bosniaque.
Lakhdar Boumediene sort une liasse de documents, qu’il feuillette devant nous. Il y a là toutes les coupures de presse recueillies par sa femme. Des articles de journaux en arabe, en français, en anglais.
Là c’est le juge, Richard Leon. Voilà le papier avec sa décision. Mon nom est là. Là, ce sont mes avocats. Ici Robert Kirsch, ici Stephen Oleskey. C’est une photo du 20 novembre, juste après la décision du juge.
Vous avez une mémoire impressionnante des dates.
Le 17 janvier 2002 : verdict proclamant mon innocence en Bosnie. Le 22 janvier : arrivée à Guantanamo. Je n’ai pas oublié. Juin 2008 : décision concernant tous les détenus. 20 novembre. 20 décembre. 15 mai. Voilà la vie de Boumediene.
HORS-CHAMP
Lakhdar Boumediene avait accordé plusieurs entretiens à la presse (France 24, RFI, Le Monde) à son arrivée en France en mai 2009. L’idée d’un entretien plus « à froid » avec lui, huit mois après sa libération, nous est venue en décembre, au moment où la presse annonçait l’arrivée en France d’un second ancien détenu de Guantanamo, Saber Lahmar. Très vite il nous a semblé insuffisant de revenir une fois de plus sur les mauvais traitements qu’avait subis Lakhdar Boumediene : pénible pour lui qui s’était déjà exprimé à ce sujet, et presque inutile au vu des nombreux livres et témoignages déjà parus sur Guantanamo. Nous tenions à ne pas réduire Lakhdar Boumediene à son statut de victime et à mettre en avant la dimension active de son combat - en évitant les accroches spectaculaires du type : « Pizza et jus d’orange : le bonheur tient à peu de chose. », (Le Monde, 27 mai 2009).
Nous sommes arrivés à Nice sans savoir à quoi nous attendre. Au téléphone, Lakhdar Boumediene nous semblait sur la réserve - sans que nous sachions s’il fallait attribuer cela à la fatigue ou à la lassitude face aux journalistes. L’idée d’être ceux qui l’interrogeraient une fois de plus sur « l’enfer de Guantanamo » nous était assez désagréable. La présence d’Hanane Benjeddir, notre interprète d’appoint (Boumediene parlant un très bon français), trouvée quelques heures plus tôt par un ami niçois et qui, par un extraordinaire effet de hasard, avait travaillé dans une association chargée du relogement de Lakhdar Boumediene, a été une aide précieuse. Les premières phrases de Lakhdar Boumediene, qui avait fait une heure de route en bus pour nous rejoindre, ont été pour elle ; très vite, sa joie de parler arabe a détendu les premiers instants. Nous nous sommes installés dans un café. Le début de l’entretien nous à obligés à revoir certaines idées que nous nous étions faites. Dans les témoignages d’anciens détenus que nous avions pu lire, l’idée d’une résistance collective revenait souvent : il était question de grèves de la faim organisées, de mots d’ordre, de meneurs. Était évoquée l’apparition d’un « contre-règlement » interne, mis en place par les prisonniers avec les moyens du bord pour se défendre : jet d’eau sur les gardiens en cas d’insulte, jets d’excréments en cas de violences...* La lecture du recueil de poèmes collectés par les avocats, Poèmes de Guantanamo, où il est question des « écrits de gobelets » ou des vers du poète et essayiste pakistanais Shaik Abdurraheem Dost*, allait dans ce sens. Mais ces hommes venaient du même pays, voire se connaissaient entre eux. Nous n’avions pas mesuré à quel point, du fait de son origine algérienne et bosniaque, Lakhdar Boumediene s’était retrouvé dans une situation d’isolement par rapport aux autres. C’est l’une des choses qui ressort le plus de notre conversation, même si elle doit être tempérée - nos questions sur la résistance collective auraient sans doute rencontré plus d’écho en fin d’entretien, où il esquissait ses amitiés avec d’autres détenus. Le temps nous a manqué. Autre « étonnement », nous nous sommes retrouvés face à un homme d’une bonté et d’une vivacité extrêmes. L’œil rieur, très loin de la personne austère que montrent les images disponibles sur internet. Pas une once d’amertume ou de ressentiment dans le regard. Le souvenir de la torture et sa difficulté actuelle à vivre ont été évoqués avec une pudeur immense, et toujours entre deux sourires. L’entretien a été dans son ensemble si détendu que nous avons hésité à ajouter la mention théâtrale (rires) à plusieurs moments, ainsi après la phrase « jusqu’à ma mort ! », pour faire valoir au lecteur cette sérénité, qui ne transparaît sans doute pas suffisamment à l’écrit - d’autant que ne sont pas retranscrits les apartés amusés avec notre interprète. L’entretien, au final, a duré le double du temps que Lakhdar Boumediene nous avait d’abord accordé - et nous l’aurions bien volontiers prolongé. Il reste de tout cela une très vive émotion.
L.B. & S.P.
* Nizar Sassi, Prisonnier 325, camp Delta, Denoël, 2006.
**Poèmes de Guantanamo, 2007, éditions Biliki, 2009.
[1] Le camp X-Ray est le premier camp ouvert à Guantanamo au lendemain du 11 septembre 2001. Il a été remplacé en 2002 par le camp Delta. Les images de prisonniers vêtus en orange et entravés dans des cages grillagées à ciel ouvert, images qui ont ému l'opinion internationale, sont celles du camp X-Ray. Dans le camp Delta, les cages grillagées ont été remplacées par des containers métalliques de format tout aussi contraignant mais où la communication entre détenus est plus difficile. Le camp Delta est subdivisé en six parties, les détenus étant déplacés de l'une à l'autre selon leur degré de coopération lors des interrogatoires. La torture est avérée dans les camps 4, 5 et 6, dont une part de torture « invisible » : isolation sensorielle, torture par le froid, par le bruit, etc. La presse américaine a révélé en 2008 l'existence d'un camp 7 où sont détenues les seize personnes jugées les plus dangereuses. Rappelons qu'un décret de George W. Bush a forgé fin 2001 le statut de « combattants illégaux » (unlawful ennemy combattant), qui permet de soustraire les détenus de Guantanamo au droit interne américain et aux Conventions de Genève protégeant les prisonniers de guerre, et de les détenir sans procès pour une durée illimitée.
[2] Si les images de Guantanamo ont été un choc pour la communauté internationale, il est utile de les remettre dans le contexte des conditions de détention extrêmes des prisons américaines les plus dures : la soixantaine de prisons de très haute sécurité appelées « Supermax ». Dans ces prisons, l'isolement sensoriel 23h/24, l'entravement, la cagoule et la fameuse tenue orange sont de mise. Ironie du sort, certains détenus actuels, si Guantanamo venait à fermer, seraient transférés dans l'une des Supermax des États-Unis et se retrouveraient donc une situation plus dure encore (Cf. The Washington Post, 22 octobre 2009).
[3] Les « six bosniaques » : le groupe des six Algériens (Mustafa Aït Idir, Hadj Boudella, Mohammed Nechla, Lakhdar Boumediène, Belkacem Bensayeh et Saber Lahmar) ayant pour certains d'entre eux la nationalité bosniaque, arrêtés en octobre 2001, soupçonnés de préparer un attentat à la bombe contre les ambassades américaine et britannique à Sarajevo. Après une enquête menée par Interpol et les autorités bosniennes et américaines, la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a rejeté les accusations de terrorisme et ordonné leur libération en janvier 2002. Malgré cette décision de la cour, ils ont été immédiatement livrés aux autorités américaines.
[4] Une cinquantaine de détenus libérables attendent toujours un pays d'accueil. Le cas des Ouïgours reconnus innocents et persécutés par la Chine, notamment, pose problème. Certains ont été accueillis aux Bermudes, d'autres iraient vers Palau, un petit État du Pacifique. Les pays de l'Union Européenne sont actuellement divisés sur la question de l'accueil d'anciens détenus de Guantanamo.