


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


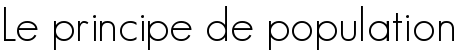
« On ne trouverait pas dans toute l’Angleterre un homme plus vertueux que M. Malthus. Son plus grand désir, le seul but de ses efforts, étaient que la vertu et le bonheur domestique soient mis à la portée de tous les hommes, comme la Nature l’a voulu ». Si l’on fait abstraction de l’enthousiasme de quelques admiratrices [1] (et de J. M. Keynes) force est de constater que le révérend Thomas Robert Malthus a plus souvent qu’à son tour suscité la réprobation et la haine. Cet « insolent sycophante des classes dirigeantes » (K. Marx) est, aux yeux de P. J. Proudhon, le « seul homme de trop sur terre ».
En dépit de contributions importantes pour l’économie politique classique, M. Malthus est resté, pour ses contempteurs, l’auteur coupable des 1 600 000 signes de l’Essai sur le principe de population, ou exposé des effets passés et présents de l’action de cette cause sur le bonheur du genre humain ; suivi de quelques recherches relatives à l’espérance de guérir ou d’adoucir les maux qu’elle entraîne [2]. La thèse centrale du Principe de population tient en peu de mots : il existe une « tendance constante dans tous les êtres vivants à accroître leur espèce au-delà des ressources de nourriture dont ils peuvent disposer ». Plus précisément, mais Malthus n’entend ici établir de façon rigoureuse aucune proposition et se borne à illustrer la mécanique de cette « grande cause » : (i) « les moyens de subsistance, dans les circonstances les plus favorables à l’industrie, ne peuvent jamais augmenter plus rapidement que selon une progression arithmétique [...] (1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9) », tandis que (ii) « nous pouvons tenir pour certain que lorsque la population n’est arrêtée par aucun obstacle, elle va doublant tous les vingt-cinq ans, et croît de période en période selon une progression géométrique [...] (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256) ». Pour le dire autrement : les subsistances croissent de façon linéaire, tandis que les hommes se reproduisent à un rythme exponentiel. Il en résulte un écart (exponentiellement) croissant entre la population et les ressources disponibles. Ou, plus exactement, il en résulterait un tel écart si le caractère fini (ou presque) des subsistances n’imposait une borne définitive à la croissance sans frein de la population, ramenant celle-ci à la mesure des subsistances par le jeu d’une série d’obstacles particuliers se rapportant « à ces trois chefs, la contrainte morale, le vice et le malheur ». Par quoi, Malthus désigne tout à la fois les guerres, la famine, les épidémies, mais aussi le dérèglement des mœurs (libertinage, homosexualité, prostitution, etc.) et le célibat. Sous l’empire du principe de population, les hommes sont condamnés à osciller entre une situation de relative abondance - précaire, fugitive - qui libère le déchaînement des forces démographiques et un état d’extrême dénuement qui seul mettra un obstacle à la croissance de la population contribuant ainsi à une amélioration marginale de la situation qui, de nouveau, les précipitera dans le malheur.
Malgré le jugement réservé de J. A. Schumpeter - « l’ensemble est déplorable quant à la technique et, quant au fond, quasiment stupide » écrit-il dans son Histoire de l’analyse économique - la plupart des démographes et de nombreux économistes n’ont pu, pendant deux siècles, sur cette question de la population, que penser pour ou contre le révérend Malthus. Peut-on former aujourd’hui un jugement serein sur cette œuvre ?
Au moment où Malthus publie la première version de son Essai, on dénombre, sur l’ensemble de la planète, environ un milliard d’habitants. Il s’agit d’une hausse sensible par rapport à la période antérieure : aussi loin que l’on puisse remonter, la terre n’est peuplée que de quelques centaines de millions d’habitants et ce nombre demeure relativement stable pendant plusieurs siècles. Au premier chapitre de l’Essai, Malthus envisage un doublement de la population tous les vingt-cinq ans, soit, remarquons-le, une croissance annuelle moyenne de l’ordre 2,8 %. Depuis les premières décennies du XIXe siècle, la population mondiale a cru à un rythme un peu inférieur à 1 % par an ; ce taux de croissance n’a jamais dépassé 2,1 % par an - entre 1965 et 1970 - et a aujourd’hui décéléré au niveau de 1,2 %. Surtout, on a assisté au sein des nations d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord à une baisse continue et parallèle de la mortalité et de la natalité assurant la transition d’un régime démographique de forte natalité et de forte mortalité vers un régime démographique symétrique de faible natalité et de faible mortalité. Dans ces zones géographiques, la croissance soutenue de la population depuis deux siècles est moins imputable à un emballement de la machine démographique qu’au décalage de calendrier entre l’inflexion des courbes de natalité et de mortalité — ce décalage induisant mécaniquement un excédent transitoire des naissances sur les décès. Au cours de cette transition démographique, le taux de croissance de la population s’élève rapidement avant de refluer tendanciellement.
Malthus n’a pas perçu le mouvement de fond qui, partout en Europe, travaille la famille. Dès la fin du XVIIIe siècle, la contraception devient un phénomène de masse qui aboutit à une réduction drastique du nombre d’enfants par famille. « L’art criminel et dangereux de prévenir la naissance des enfants sans renoncer au commerce des femmes » selon la formule du marquis de Turbilly est sans doute au nombre des « vices » susceptibles, d’après l’auteur de l’Essai, de constituer un obstacle à l’accroissement sans bornes de la population. Il n’en demeure pas moins qu’à partir des XVIIIe et XIXe siècle, la famille se transforme tant dans sa dimension que dans ses fonctions (effacement du rôle économique de la famille, refondation sur le critère du sentiment, découverte de l’enfance, affirmation de la dimension éducative, etc.).
Mais l’erreur centrale de Malthus apparaît moins démographique qu’économique. Les moyens de subsistance, loin de progresser de façon arithmétique, ont crû de façon géométrique tout au long de la période : entre 1820 et 1998, le PIB mondial s’est élevé au rythme de 2,2 % par an (soit un doublement tous les trente-deux ans). À rebours de la théorie malthusienne, on constate que le niveau de richesse par habitant s’est accru de façon considérable (et, disons-le, exponentielle) passant de 667 $ en 1820 à plus de 5708 $ en 1998 [3].
En dépit de ce démenti historique, le discours apocalyptique de Malthus revêt aujourd’hui encore une troublante actualité. La population mondiale a plus que doublé depuis 1960 pour atteindre 6,5 milliards d’habitants en 2005. Le scénario central des Nations Unies envisage une stabilisation de la population mondiale autour de 9 milliards... à moins qu’elle ne progresse de façon explosive jusqu’à 36 milliards d’habitants. Surtout, on doit s’interroger sur le caractère soutenable des évolutions qui ont permis, pendant deux siècles, de conjurer le spectre malthusien. La population mondiale n’a pu extraire de son environnement les richesses nécessaires à une progression considérable du niveau de vie par habitant qu’au prix d’une pression destructrice sur ses ressources — et, ce n’est pas indifférent, d’inégalités de conditions vertigineuses. C’est la question de « l’empreinte écologique » de l’homme. Abstraction faite de toute croissance démographique, le « simple » fait, pour l’ensemble de la population mondiale, d’adopter les modes de production et de consommation des pays aujourd’hui les plus développés aboutirait à une multiplication par 12 de l’empreinte écologique actuelle [4] : quatre planètes Terre supplémentaires n’y suffiraient pas.
Nous n’abandonnerions la condescendance amusée de l’historien ou de l’économiste que pour nous réveiller en plein cauchemar malthusien : un monde où le caractère borné de la croissance des moyens de subsistance condamnerait une fraction prépondérante de la population, surnuméraire, à la faim et à la guerre.
[1] La citation précédente est empruntée à l'une d'entre elle, Harriet Martineau.
[2] On fait ici référence au texte de 1803 parfois qualifié de « deuxième édition » de l'Essai, beaucoup plus modeste, paru en 1798.
[3] Angus Maddison (OCDE) a fait profession de calculer le PIB de la plupart des pays du monde pour les périodes les plus reculées de leur histoire.
[4] Diamond, Jared, Collapse, How societies choose to fail or succeed (Penguin Books, 2006).