


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


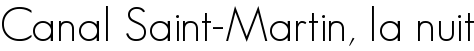
« Est-ce qu’il vous reste une tente ?
— Alors, ce sera un duplex, avec vue sur la Tour Eiffel ».
Je suis sur le canal Saint-Martin, fin décembre, au quinzième jour du
campement des « mal-logés »
— Première nuit (pour moi) dans la rue, première chorba, première
conversation sérieuse avec des gens de la rue : organisé par les Enfants de Don Quichotte. Je
viens quémander une des 250 tentes posées entre la rue de Lancry et la
rue Léon-Jouhaux. Il y a à peu près le même nombre de campeurs, pas mal
de « relais » et d’associations qui apportent de la nourriture, et des
voisins, des jeunes, des « solidaires » — tous bien-logés ; les SDF
regrettent qu’ils ne soient pas plus nombreux —, qui viennent passer
une ou plusieurs nuit sous la tente. « Et je me déniaisai au
bordel embué d’une armée en déroute… »

On ne part pas. C’était prévu autrement, mais on ne part plus. L’un doit dormir le soir à l’hôtel, mais l’hôtel dormira sans lui ; l’une veut embarquer demain, grâce à un conducteur complaisant, dans le train de Perpignan, où sa mère l’attend pour affronter un notaire indélicat ; il faut se lever à cinq heures pour être à la gare Montparnasse à temps. Ce sera finalement grasse matinée. Le week-end à Amsterdam d’un troisième se transforme au bout de deux jours en week-end à Amiens... qui se transforme en regret. Bon gré, mal gré, l’excès de projets ou la fatalité, tous les départs ont été supprimés. Le voyage est marqué d’un mauvais fer. Est-ce la poisse, ou l’insolite impression d’avoir un endroit un peu plus à soi que d’habitude, qui empêche de partir ? Si quelqu’un a la tentation de filer, une voix anonyme lui glisse dans la nuit que c’est une hérésie : pour préserver l’unité, on serait peut-être capable de le séquestrer... Et quand un gars un peu saoûl fait la tournée du campement, il décerne ironiquement à ceux qu’il aime ces simples mots éraillés, qui ont valeur de brevet de sympathie : « t’es viré ! »
Quand on approche, dans la nuit, du canal, le tableau n’est pas rassurant. Des armées de visages hagards, blafards, hérissés, parmi lesquels on serait bien en peine de distinguer son prochain... Qui est « à la rue », qui ne l’est pas ? Je joue mentalement à Qui est-ce ? Évidemment, je gaffe. « Vous allez souvent dans des centres d’hébergement ? - Ah ! Mais je ne suis pas à la rue ! » Campeurs et riverains discutent actualité, accueil des bailleurs, ou stratégie pour passer une nuit tranquille. Celui-ci considère Paris comme un coupe-gorge, et a trouvé une planque à La Défense ; il en a après les Kurdes, tous sapés comme des rois, qui squattent les places en centres. Et les Polonais ! « Un Polonais bourré, c’est la pire engeance. » « Quand la place de la République a été occupée par des réfugiés des pays de l’Est, rajoute un autre, ça ressemblait à un dépotoir, on voyait les rats courir. »
Une dame qui est visiblement travailleuse sociale et connaît bien la question plaisante. Un jeune gars en verve, blouson ouvert, un simple sweet sur le dos, s’époumone : « Je suis un bobo, mais un bobo conscient. » Un maçon souriant est venu de Strasbourg passer ici ses dix jours de vacances. Il dort sous la pile d’un pont, protégé par deux bâches, avec cinq colocataires. Plus loin, sur un banc, deux amoureux s’abritent sous une couverture (mais je ne suis pas certains qu’ils soient SDF). Tous les soirs, entre huit heures et dix heures, c’est la même fraternité timide, mais communicative, autour de deux tables, d’un bol de soupe, et de café à volonté.
Je suis arrivé, vers 20h30, en même temps qu’une meute de caméras, et je repartirai le lendemain au milieu d’une nuée de journalistes. Les télés (dont beaucoup d’étrangères) ont mauvaise presse, ce qui amène des discours assez amusants : « On n’est pas TF1 ! On vient mobiliser ! On est bien d’accord avec vous ! » Le matin, quelqu’un a manqué se jeter d’un pont sous les caméras de la Une. Mais cette semaine de Noël, malgré la visite quotidienne de journalistes, la presse n’a pas franchement suivi la cause. C’est surtout après le 31, vœux présidentiels oblige, qu’elle s’est mobilisée et qu’on a vu des reportages un peu consistants. Manière de voir ce que les SDF avaient dans le bide... Ou - autre lecture - de se laisser dicter son sommaire par l’agenda politique.
Quand un SDF a trouvé à qui parler, il ne vous lâche plus. Il y a les timides, les bavards, mais guère de juste milieu. Jean-Marc le volubile, un des héros du lieu, a donné sept interviews dans la journée : après cinq minutes de conversation, je le reconnais. C’est lui qui fait la manche à l’entrée de la librairie La Hune, à Saint-Germain-des-Prés. J’ai envie de l’appeler « le libraire ». Il a passé douze ans devant chez Castel, et entame sa treizième année sur le boulevard Saint-Germain. Parfois, il pousse jusqu’à l’église du même nom pour « emprunter » des cierges. Un jour, le curé a appelé les flics. Qui ont rigolé : « Estimez-vous heureux qu’il ne s’en soit pas pris aux troncs ». Jean-Marc : « Quand votre bedeau emmène l’argent à la banque avec le Diable, vous ne lui dites rien... Ben oui, pour porter l’argent, il lui faut un diable ! » Fin de l’épisode. Jean-Marc, qu’un étudiant en socio a suivi pendant huit mois, et auquel il a consacré un film, dort en compagnie d’un jeune gars, se balade seul longtemps après avoir dit qu’il allait se coucher, et ne manque pas d’inviter à visiter son blog...
J’engage la conversation avec un habitué, dont j’approuve à haute voix les indignations. Il habite le XIIIe, juste à côté du Château des rentiers, ancien centre d’hébergement à l’encadrement quasi-carcéral (comme à Nanterre, où le personnel de la préfecture traite les SDF « comme des prisonniers »). Il touche aujourd’hui une pension d’invalidité, et affiche un pessimisme mesuré, mais certain, sur l’avenir du pays : le problème, c’est « les Inertes ». Lui aussi, il est intarissable. On vient d’apprendre que Paris manquait d’espace pour accueillir des palaces ; Johnny aurait pu offrir un immeuble aux SDF avant d’aller se planquer en Suisse ; le squat du canal a été provoqué par l’expulsion de sans-logis qui dormaient sous les ponts d’Austerlitz, mais ça fait plusieurs semaines que les bennes de la mairie vident les tentes installées dans Paris par Médecins du monde. Et n’y a-t-il pas jusqu’à Raffarin qui soit venu narguer, en toute impudeur, les affamés de Saint-Eustache, du temps de sa superbe ; aux gens qui faisaient la queue pour la soupe populaire, il a demandé : « Alors, elle est bonne, la soupe ? » « C’est comme si Villepin venait ici demain matin et demandait : “vous avez passé une bonne nuit ?” »
À 22 heures, le mégaphone retentit depuis une passerelle : c’est le passage de relais des services de sécurité. Les « gros bras » censés éviter tout grabuge et surveiller l’abord des tentes, ou que personne ne se trompe de côté en sortant de son lit (les tentes sont vraiment au bord de l’eau, et naturellement, la vision qu’on a en se levant le matin, paradisiaque). Soudain, on est bousculés par un vieux monsieur qui a failli avoir un malaise en se réveillant. On le drogue au café, en lui promettant des danseuses pour bientôt. Tour d’horizon des secours (le 115, les pompiers, la Croix-Rouge) : personne ne veut se déplacer. Une seconde tentative auprès des pompiers a plus de succès. Discours philosophique autour d’un homme qui se réchauffe : « La vie est une drôle de chose. On apprend tous les jours quelque chose »... « Le monde est un immense hôpital psychiatrique. − Et il y en a qui essaient de canaliser toute cette folie » (c’est une Gitane auto-proclamée qui donne la réplique).
Bon ! Il va être minuit, et je suis toujours sans logis. Je vais voir l’un des responsables... A priori, toutes les tentes vides (c’est-à-dire sans vêtements à l’intérieur) sont « libres » : ça veut dire que personne n’y est installé. Rabat, qui a trouvé il y a un an boulot et appart, mais a déboulé dès que ses amis lui ont demandé, m’enfouit sous une montagne de duvets et de couvertures. C’est tout un art de ne pas prendre froid : mettre un maximum de couches entre soi et le sol, si possible une palette sous la tente, et sous le duvet des cartons, voire des couvertures. Au dessus, des couvertures à l’envie (Christophe en a six : il se rattrape, ou il thésaurise).
Sur les tentes, certains ont apposé un petit carton, avec prénom, âge, profession, et le nombre d’années passées à la rue. Sadok est ainsi « serveur-couturier ». Quand il s‘agit d’un couple, ça fait froid dans le dos... Pour un peu, on dirait une place de cimetière. Les SDF n’ont pas de nom, le plus souvent, même, juste un surnom : Cosmos, Couscous, Gavroche... Moi, ce sera « Jaquou le croquant », car je lorgne avec avidité, paraît-il, les assiettes de mes voisins. Cosmos me présente Francky, à la poigne herculéenne ; c’est devenu un jeu, parce que chacune de ses poignées de main est anticipée avec un sourire par ses acolytes. Après m’avoir démantibulé l’avant-bras, il s’inquiète de ma santé. Eh oui, je tremble en buvant mon vin chaud. On m’a dit cent fois que je manquais de sucre, mais Grand-mère ne m’a jamais donné de remède pour compenser. Francky rattrape ça. Médecin, Polonais et colosse − je prends son conseil. Désormais, aussi longtemps que je boirai de l’eau sucrée durant la nuit, je penserai à Francky.

Je fais des tours du campement, dans ce quartier que je pensais connaître comme ma poche, et qui brille ce soir d’une lumière singulière. Le coude que forme le canal à la hauteur des Récollets sépare le quartier en deux, toutes les tentes se trouvant en-deçà, entre la première écluse et le Faubourg du Temple. La lune luit au-delà, sur une eau miroitante impavide. Jusqu’à Jaurès, la zone est déserte. Effet de vertige. En revenant de l’autre côté, je me fais alpaguer par deux gars ; ils veulent un euro ou m’acheter un ticket-restaurant. Quand ils apprendront que je dors aussi dans une tente, ils diront regretter. (Pourquoi ? Le mot de « solidarité », inculqué par les Enfants de Don Quichotte, semble ici un passeport miraculeux. « Qui tu es ? Pourquoi tu viens ici ? Ah ! Tu es “solidaire”... ») Ils parlent - ce sont les premiers ce soir mais j’en verrai ensuite beaucoup d’autres - de la « galère » comme d’une carrière : l’un a « huit ans de galère », l’autre « huit mois ». Le premier a fait de la prison (il a touché à la drogue) et reçoit une allocation handicapé de 600 euros par mois ; comme il fait partie des anciens, les « assoces » lui trouvent régulièrement des séjours à l’hôtel (par tranches de quinze jours à chaque fois). L’autre est Marseillais, divorcé, a démissionné de son boulot et gardé une voiture. Ils évoquent leur suspense quotidien : « Est-ce que je vais pouvoir dormir toute une nuit ?... Est-ce qu’ils vont m’accepter aux bains-douches ?... Est-ce que je vais attraper des champignons ? » Ils explosent en parlant du centre, où les vols sont récurrents et où la moitié des hôtes sont « cassés » (saoûls) et risquent de leur pisser dessus en pleine nuit. Christophe, « l’ancien », en a après les « condés », après les photographes. À un reporter de RTL qui lui demandait s’il voulait écrire sa vie, il lui a répondu : « Je sais pas écrire. Dis à Sarko que je l’encule. »
Après s’être fait jeter de la gare du Nord, ils restent ici, dormant trois ou quatre heures par nuit. « On tiendra, on tiendra, jure Christophe, on restera dix ans s’il le faut, mais ça pétera. Ça pétera. » Et de rêver que les 100 000 SDF du pays se réunissent ici. « Tu te fais jeter du McDo, tu te fais jeter du métro, les gens changent de place en te voyant. Je suis propre, moi, je suis toujours comme maintenant, mais quand t’es fatigué... t’es fatigué, t’es cassé, t’as l’air d’un camé... ».
Le lendemain, il a rendez-vous à neuf heures avec l’assistante sociale, pour qu’on lui propose un nouvel hôtel. Il jure ses grands dieux qu’il restera ici. Une heure après, il parle d’inviter ses potes à l’hôtel. Et le lendemain, réveillé à 8 h 45, il angoisse. Si l’assistante sociale lui refuse une chambre, il dit qu’il est capable de lui foutre un coup. « Pistonné », lui lancent, hilares, les organisateurs. Le soir, il est toujours là.
De l’autre côté de la rue, Colombo est en train de parler à une voiture de la Ville de Paris. Colombo, c’est son nom. « Le Kabyle mexicain », comme l’ont surnommé des jeunes gars à cause de sa couverture bariolée. Colombo parle un sabir difficilement compréhensible ; Colombo serre systématiquement la main des gens qu’il croise ; Colombo a deviné que j’écrivais pour un journal avant que je le lui dise. Il vient de Tunisie et se promène avec un vin blanc infect que les autres tentent à tout prix de cacher quand passent des voitures de police. Ici, on peut boire, dès le matin même, autant qu’on veut, mais discrètement.
Il est 2 h 30. J’arrive sous la tente : pan ! Le numéro de Libé du jour ! « Quai des exclus », trois pages de papotage institutionnel sans verve. Crevé, je n’ai qu’une envie : me torcher avec, comme dans un film de Jan Kounen. Je ne pensais jamais voir le canal comme ce soir, à raz du pavé. Je dois dormir une heure, deux à tout casser. Des groupes discutent jusqu’à cinq heures du matin, le moment où le froid est le plus vif. C’est comme ça que je saisis ce que je ne devrais pas entendre. Deux bénévoles essayant de convaincre un campeur de rester : « Tout le monde s’intéresse à nous ; il y a une cellule de l’ANPE qui va venir faire un tour du camp ; dans deux mois, t’as un logement et un boulot. » Au réveil, Ahmed tiendra un discours plus radical encore. Ahmed est un enfant, et pas seulement de Don Quichotte : il me regarde avec des yeux de chat, des yeux sombres et martiaux. « Ah, tu crois pas qu’on va gagner ? » Si je n’y crois pas, c’est que je suis contre lui. Répéter qu’on va gagner, c’est peut-être ce qui permet de rester : ici, et ensemble. C’est peut-être ce qui permet de durer. C’est peut-être ce qui permet de gagner.
À force d’entendre des pas à la hauteur de mes oreilles, j’ai parfois l’impression d’être en laisse. Le duvet et les couvertures font très bien leur office, c’est plutôt en dessous qu’on a froid. Pas assez de cartons, de palettes... Et comme oreiller, il y a mieux que le pavé. Le matin, j’enlève ma peau de nuit (le duvet), j’enfile ma peau de jour (mon blouson, bien fragile par le temps qui court), et je fais irruption à l’air libre, au milieu des passants effarés. En une demi-heure, tout le monde est levé. Ce qui m’intrigue, c’est qu’il n’y a pas 200 personnes : la moitié, tout au plus. Ou certains se défilent durant la nuit pour aller courir dans Paris, ou ils font la grasse matinée... Ou bien il y a encore beaucoup de tentes vides. Les voisines arrivent : échange de thermos, bâillements, étirements... C’est le moment privilégié. On est tout froissés, on se mêle à des petits groupes, on se prend à taquiner les passants pressés... Antoine, venu de Liège, trouve que je ressemble à un flic belge (moins les épaulettes). On siffle les minettes qui passent à vélo. Couscous : « Avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous permettez que vous puissiez... » Les enfants des écoles voisines ont apporté des dessins : « Tenez bon, les gars ! » Une mamie qui vagabonde se voit gratifiée d’un bonnet russe et d’un sac (vêtements et victuailles) gros deux fois comme elle : elle repart avec un « garde du corps » pour le lui porter. À côté, Pierre Balmain (ou l’un de ses représentants sur terre) arrive au bureau. Tati aurait fait un bijou de cette scène. Tiens, justement, Christophe hèle ainsi un motard : « On n’est pas à New York, ici ! » C’est, presque mot pour mot, la réplique du facteur de Jours de fête (« Eh, on n’est pas à Paris, ici ! »)
Quelqu’un (une fée ironique) a déposé trois exemplaires de Libé : je fais défiler les pages à la recherche d’un gros coup, d’une tribune, d’un reportage. À côté de moi, Christophe articule péniblement le chapeau des articles. La moisson est maigrichonne : un courrier des lecteurs, et un bas de page sur le « sauveur », Arno Klarsfeld, d’après qui Sarko avait tout vu, est d’accord sur tout. On retourne se goberger sur l’autre rive : des voisins ont déposé des trésors. Tartelettes, mandarines, pain d’épice, gaufrettes, café à volonté... On brunche, quoi. En face de chez Prune : c’est le lieu, c’est gratuit, et plus on est, plus on rit.
Je me retourne plus souvent que je ne voudrais vers l’Hôtel du Nord, qui est à deux enjambées, et d’où d’aucuns, jadis, se jetèrent dans le canal. C’est un peu ma Mecque à moi, lieu de mémoire qui a fourni le cadre d’un beau roman à Eugène Dabit et d’un classique du cinéma à Marcel Carné. L’hôtel a été encastré dans un immeuble moderne des années 70 ; le rez-de-chaussée est devenu un bar branché (quatre euros le verre de vin). Marcel Carné, aujourd’hui, c’est le nom des bateaux qui passent (vides), sous les yeux des SDF, en direction de la Bastille. Étranges bateaux fantômes en rupture de touristes. Les romans de Simenon et de Tristan Rémy sont loin. La pointe d’amertume qui m’assaille tient du symbole : ce n’était pas plus jojo avant. Mais, je le vois, je l’entends, la plupart des gars qui sont ici trouvent Paris « merveilleux ».
Onze heures, je plie bagage. Devant les caméras, Augustin, le fondateur des Enfants de Don Quichotte, martèle que la France a besoin de cette force de travail, etc., etc. Il est très doué, ses réponses sont des successions de phrases clef, pertinentes et très réfléchies, dont chacune peut être prise isolément sans nuire au propos. Discours diablement rodé. Christophe, lui, persécute les photographes : il a l’impression qu’ils réveillent les SDF pour faire des photos. Comme le bruit court, insistant, que de nouvelles tentes vont arriver, il lance une dernière pique : « Ah, si on a cinquante tentes de plus ce soir, Sarko, il prend de la came. »