


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


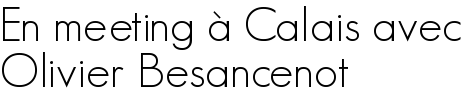
« Nos vies valent mieux que leurs profits. » Je suis à un meeting de la L.C.R., avec Olivier Besancenot, à Calais. C’est la deuxième fois de ma vie que je vais à une réunion politique. La précédente, c’était Philippe Seguin lors de la campagne municipale à Paris en 2001. Quelques jours avant sa défaite qui était devenue certaine. Manifestement profondément déprimé, Seguin n’avait même pas tenté de jouer le jeu. Je me souviens de la sortie du petit gymnase du cinquième arrondissement au trois-quart vide ; il était monté, seul au monde, à l’arrière d’une voiture qui l’attendait là. Une masse sans ressort, comme un gros animal épuisé qu’on évacue pour raisons sanitaires. Cette fois, c’est plus énergique.

Il y a du vent. Du vent comme je n’en avais pas senti depuis longtemps. C’est normal : on est au bord de la mer. Calais, sur la côte d’Opale, juste à côté du tunnel sous la Manche : j’ai pris l’Eurostar, c’est direct mais c’est assez paradoxal de voyager à côté de touristes anglais, d’expatriés fiscaux ou d’hommes d’affaires outillés électroniquement pour aller écouter un discours de la Ligue communiste révolutionnaire (comme dira Besancenot, avec un ton presque nostalgique, à propos du nom de son parti : au moins, on ne cache pas la couleur). Arrivée à Calais-Frethun, une de ces gares modernes posées en pleine nature à distance des centres-villes pour faire comme les aéroports. Je prends la navette qui va vers le centre, un bus qu’on est six à emprunter. De la notion de service public : ça me paraît être une bonne introduction théorique.
J’aurais voulu aller voir le port, un de ces ports industriels comme j’aime, mais il y a, vraiment, trop de vent. À l’hôtel (Bonsaï, juste en face de la gare du centre, 32 euros la nuit) j’ai eu le temps de voir, sur i>télé, Besancenot signer la charte d’« Assez le feu » à Clichy-sous-Bois. Le soir, je reverrai le même reportage (consacré aux trois-quart à Ségolène Royal, qui a signé la charte en premier), et je vérifierai qu’il était habillé pareil, un petit pull noir en V sur un T-shirt blanc, et une veste en jean. Le temps de m’acheter un bonnet au H&M de « l’Espace 4B », une galerie commerciale destinée à redynamiser le centre-ville, qui fête sa première bougie m’explique Nord-Littoral dans lequel la présidente de l’association des commerçants précise : « il était connu dès le départ que Calais a un pouvoir d’achat faible, un taux de chômage par contre qui est fort », me voilà au théâtre municipal.
À l’entrée du théâtre, il y a confusion, manifestement, entre la queue qui vient réserver des places (peut-être pour Si... Si... avec Danièle Évenou, le 1er avril à 16 heures), et ceux qui vont au meeting. Un membre de la Ligue lève les doutes en proposant à ceux qui le souhaitent d’entrer dans la salle. Qui se trouve être un charmant petit théâtre à l’italienne, avec décors en stuc, galeries rondes sur trois niveaux et fauteuils en velours rouge. C’est chic, mais ça casse un peu le mythe de la soirée politique : je m’imaginais dans une ambiance de grand hall venté, type Palais des sports avec des chaises en plastique pliantes. Pour politiser ce décor bourgeois, il y a des affiches de Besancenot accrochées partout, et, au-dessus de la scène, un grand panorama avec le slogan « Nos vies valent mieux que leurs marchandises » qui surmonte une galerie des jeunes en train de lever le poing d’un air rageur, traitées en simili-sérigraphie. Parmi les visages inconnus, je repère le Che Guevara de Alberto Korda, bizarrement il regarde dans une autre direction. Ernesto, un peu de discipline !
Sur la scène, une responsable (locale ou nationale ?) colle avec du scotch des affichettes vertes écrites à la main : Laurent Roussel, Olivier Besancenot, et Christian Ternisien (un responsable de la LCR qui aura la particularité de ne pas prononcer pas un mot de la soirée). La salle se remplit tranquillement, le public est mélangé - beaucoup de jeunes, quand même, dont certains, me semblent-ils, n’ont pas encore l’âge de voter. J’essaie d’évaluer le type social de l’auditoire, mais je n’ai jamais été très doué pour la qualification sociale au faciès, et de toutes façons je ne suis pas là pour ça. Il y un peu de gêne dans les gens qui rentrent, une façon de rire nerveusement ou de parler trop fort, comme s’ils faisaient quelque chose d’un peu transgressif.
Le rideau rouge tremble un peu. De l’autre côté, j’aperçois des journalistes qui arrivent en même temps que Besancenot. Petit à petit, ils vont passer de notre côté, puis descendre dans la salle. Les journalistes de la presse écrite ont l’air le plus blasé - ils passent avec leur grand bloc-notes où il n’y a pas plus de cinq lignes par page (moi j’écris tout petit sur un tout petit carnet), et l’un soupire, à deux reprises, comme si c’était une terrible souffrance, pour lui, d’être là. Je joue au petit jeu des paris : Libération ? Le Monde ?
Voilà les caméras. J’en compte six. Et une dizaine de photographes, qui patientent sur la scène. L’un d’entre eux est au téléphone - j’imagine avec sa rédaction. Un autre mime une scène à un copain, sans trop réaliser que toute la salle le regarde. Un membre de l’organisation demande au régisseur (je suis placé juste devant) la jauge de la salle : 250 places en bas. Il part enquêter aux étages supérieurs, et il revient annoncer aux journalistes, d’un air triomphant, qu’il doit y avoir environ 350 personnes (ce qui ne me paraît pas exceptionnel, mais c’est vrai que je n’ai aucun repère). Un journaliste rigole : « Allez, on met 2000 ». Juste derrière moi, un autre petit groupe de journalistes se forme et discute de l’épisode qu’ils viennent de vivre. Les coulisses, donc (l’arrivée de Besancenot, à la gare ? devant le théâtre ?). Ils râlent. « C’était la foire d’empoigne. » Un autre, en ricanant : « Comme si c’était le reportage du siècle. » Une journaliste d’une radio locale, qui est arrivée plus tard, commente à un collègue d’une télé locale le décor du théâtre : « Ça fait des belles images pour vous. » Ils parlent de la venue de Ségolène Royal dans la région, quelque temps auparavant : « Je l’ai faite quand elle est venue à Dunkerque. Avec elle, tu ne peux rien faire. Tu arrives, il y a des prises jack, tu te branches, tu restes là. Tu ne peux rien faire. » L’autre : « Par contre, Arlette, c’était peinard. » « C’était pas intéressant. » « Mais il faut le faire ! ». Un autre recentre la discussion, il prépare l’angle de son papier de ce soir : « Pour moi, la question, c’est : pourquoi ici ? ». Je pense à au slogan de la LCR, et ça me fait rire : pour eux, les hommes politiques, c’est avant tout une marchandise.
Un homme sort des coulisses, prend le micro : « Je demande Romain. » Un jeune homme, coiffure rasta, se lève et le rejoint. Il est 19h16. Olivier Besancenot arrive enfin sur scène, sous les applaudissements. Le fameux Romain s’assied auprès de lui, de Ternisien, et de Laurent Roussel, le responsable de la section locale qui ouvre la réunion par un discours de présentation. Pour être gentil, je dirais que ce n’est pas un tribun charismatique : il n’a manifestement pas l’habitude de faire un discours. Beaucoup d’hésitations, et l’accent est systématiquement mis sur une mauvaise syllabe - je surveille Olivier Besancenot pour guetter un fou rire, mais il reste sérieux, quoique manifestement un peu fatigué. Il s’autorise un sourire quand Roussel parle d’une des rares activités procurant encore des emplois, « les câbles sous-marins », évocation somme toute assez poétique dans ce type de discours, mais il le réprime assez vite. Laurent Roussel se rassied sous les applaudissements : il y a toujours dans ces phases-là, des moments de flottement un peu étonnants ; là Roussel, pour faire quelque chose, tape sur l’épaule de Besancenot, comme s’il était le vieux sage qui intronisait le jeune fou, les applaudissements continuent, une seconde fois il lui tape amicalement sur l’épaule, Besancenot reste imperturbable. Puis le jeune Romain, militant de Boulogne(-sur-Mer) prend la parole pour évoquer la question de la jeunesse. Je remarque qu’il est friand, comme son chef de section, de statistiques (ils doivent se dire que cela rend le discours plus professionnel), statistiques parfois incongrues (« l’âge moyen du premier emploi se situe à 23 ans ! » dit-il d’un ton très contrarié, alors qu’en soi ce n’est pas vraiment un problème), parfois carrément louches : pour payer leurs études, « quarante mille étudiants sont obligés de se prostituer », petit blanc, il se reprend : « près de quarante mille étudiants sont obligés de se prostituer »...

Après les premières parties, voici la vedette. Derrière le pupitre, avec un micro à pied et une grande affiche avec photo (les candidats plus institutionnels ont un cadrage toujours ultra-pro, avec la phrase-slogan sur le pupitre sous leurs mains et un petit logo ou adresse internet calé juste au-dessus de leur épaule droite, ici ce n’est manifestement pas l’enjeu), Besancenot s’installe. Le contraste est frappant : avec les orateurs précédents, et surtout avec le Besancenot un peu assoupi de derrière la table. Il est immédiatement chaud, bouillant même, et il entame son discours par une sorte de tour d’horizon humoristique qui, manifestement, prend la salle (et moi aussi) à contre-pied. On est venu voir un leader d’extrême gauche, on se retrouve avec Laurent Ruquier. « Azouz Begag a annoncé qu’il voterait Villepin, même s’il ne se présentait pas. Mais Sarkozy s’en fout, parce que lui, comme soutien, il a Johnny ! ». Le tout avec force mouvements de bras, regards appuyés - et les blancs dans les phrases sont enfin bien placés. Un vrai numéro de pro, mais qui me semble trop bien huilé, trop mécanique, et manifestement plus adapté à des audiences moins intimidées que dans ce théâtre chic où cela sonne un peu faux.
Contrairement aux deux autres, il ne regarde jamais ses notes. Mais ce n’est pas étonnant : manifestement, il s’agit d’un discours-type. Après l’introduction humoristique, il déroule son argumentaire, de façon extrêmement bien structurée et argumentée. À côté des discours de Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy qui sont très écrits, c’est impressionnant parce que ça semble improvisé, parce que c’est dit avec un style oral (le fameux « parler vrai » que recherchent les politiques) mais que ça retombe toujours sur ses pattes, que tout s’enchaîne, et surtout que la structure reste assez complexe, le tout prononcé vite, presque trop vite : j’arrive à suivre toute son argumentation, mais, et ici je suis très sérieux, il faut quand même rester concentré, s’agissant de points techniques assez précis. En tout cas, cela change de la soupe à concepts qu’on entend en boucle dans la bouche des grands candidats (la justice, l’équité, la libération des énergies, ou même la « taxation du capital » de Laguiller), et c’est assez étonnant puisqu’il s’adresse à un public pas forcément très diplômé.
La salle me semble (mais peut-on vraiment juger une salle ?) plutôt assoupie, et voilà que Besancenot évoque Mai 1968 comme dernier épisode où les salariés ont obtenu, en descendant dans la rue, une augmentation générale ; il ajoute : « Vous voyez ce qu’il vous reste à faire », et soudain la salle éclate en applaudissements (applaudissements qui me semblent spontanés, mais je n’en jurerais pas - ce qui était spontané en tout cas c’est, quelques minutes auparavant, le clap-clap d’une dame à l’évocation du fait qu’il fallait renforcer les moyens de l’école « dès la maternelle »). Et je me demande si c’est toujours comme ça, si les salles réagissent toujours de la même façon aux mêmes invocations. Quelques minutes après, trois personnes au premier balcon se lèvent et quittent la salle. Je vois le regard de Besancenot qui lève les yeux, sans s’arrêter de parler, et les regarde partir. J’ai presque un peu de peine pour lui.
Il y a environ un an, je me souviens avoir vu à la télé François Hollande très content de sa façon de piéger Besancenot en lui reprochant de ne pas vouloir le pouvoir, de préférer ne rien faire plutôt que de tenter d’améliorer le sort du peuple, et j’ai l’impression qu’il répond à cet argument précis, lorsqu’il s’en prend à ceux qui disent « Besancenot, il ne veut pas mettre les mains dans le cambouis ». Il répond, lyrique (mais là aussi je sens bien que cette phrase il la sort à chaque fois) qu’on ne l’achètera pas avec « un strapontin ministériel, ou une circonscription électorale », et la salle, à nouveau, applaudit à tout rompre. « Je suis libre, insiste-t-il, je suis indépendant », avant d’évoquer, de façon inattendue, les « doutes » de la LCR : « Des fois, on a de la mélancolie. Parce que le socialisme à visage humain, autogestionnaire, qu’on défend, c’est vrai, il n’existe encore nulle part. » Et encore : « On fait un bilan critique des révolutions. » Je suis assez troublé et touché par ces accents de sincérité. De la même façon, il expliquera qu’il n’est pas en accord avec le Parti communiste qui est prêt à participer à un gouvernement avec le Parti socialiste : « Mais s’ils estiment qu’ils préfèrent peser de l’intérieur, eh bien c’est leur choix. » Bien entendu, tout cela a un sens politique (montrer que la LCR n’est pas celle qui a créé la division à l’extrême gauche), mais la façon dont c’est dit, pas simplement sincère en surface, tranche.
Olivier, comme tout le monde l’appelle, retourne s’assoir. C’est le moment des questions. On se croirait dans ces débats d’après-film à la Cinémathèque, il n’y a pas de micro dans la salle (ou alors il met trop de temps à arriver) et on n’entend rien ; et comme Olivier Besancenot préfère noter les questions pour y répondre d’un coup ensemble, il y a un étrange moment de flottement - des journalistes de M6 en profitent pour interviewer un militant que j’entends mieux que les gens dans la salle qui posent leurs questions. Besancenot répond aux questions, dans un style un peu plus lâché, mais qui ne tranche pas avec la reste de son discours - je note tout à coup que ce n’est pas traditionnel d’utiliser des expressions comme « faire de la provo », « sans déconner », et c’est sans doute ça qui rend sa façon de s’exprimer plus agréable, pour moi en tout cas (mais je sais bien qu’on dit des Français qu’ils aiment bien avoir l’impression que leurs responsables politiques sont bien éduqués et parlent un langage châtié, tout en pensant que leurs responsables politiques ne connaissent rien à la vraie vie).
C’est la fin de la réunion. Applaudissements. Les gens commencent à se lever. Je m’approche de la scène. Bousculade derrière moi : un caméraman fonce droit devant parce que Besancenot vient d’entamer une Internationale - il ne faudrait pas rater ça. Arrive ce moment particulier de fin de réunion, moment un peu universel où une vague de spectateurs quitte la salle, cependant qu’une vaguelette fait le chemin inverse et s’approche de la scène pour toucher à l’intimité du candidat. C’est le moment des photos-avec-Besancenot. Une, deux, trois, quatre personnes, sans doute plus, se mettent à côté de lui. Flash flash flash. Puis des autographes : sur un cahier, sur une photo, sur une bouteille en plastique. Trois caméras filment en temps réel tout. Je suis sur la scène, un peu en retrait. Je regarde l’image sur le petit écran du viseur : le bic de Besancenot qui écrit un petit mot. Je m’interroge sur l’intérêt de tout cela. L’intérêt pour le caméraman, de le filmer. L’intérêt, pour le candidat, d’y participer. J’ai envie d’interroger Olivier Besancenot, là, à la place de ce journaliste qui lui demande s’il pense qu’il va faire un meilleur score qu’en 2002, j’ai envie de lui demander comment il vit cet étrange culte de la personnalité, ce jeune garçon qui s’approche de lui juste pour lui serrer la main, et qui s’en va, les yeux brillants, le visage rouge d’émotion (et ce n’est pas un truc d’écriture de ma part, je le vois vraiment rougir). J’ai envie de lui demander, à cet Olivier Besancenot qui ne dit jamais « je » mais toujours « nous », ce qu’il pense dans ces moments-là, s’il fait abstraction de lui-même quand il signe, quand il prend la pose, ou s’il éprouve du plaisir à voir que des gens l’aiment, veuillent le toucher, comme une relique laïque - est-ce que c’est, aussi, un peu son carburant, comme tous les hommes politiques qui parlent souvent des attaques qu’ils inspirent mais rarement de la fascination qu’ils génèrent.
Les caméras ne s’arrêtent pas de tourner - je remarque soudain que ce ne sont que des petites chaînes : M6, BFM TV, Public Sénat. Toute la petite troupe se retire vers les coulisses. Je les suis. Devant le rideau, un homme filtre, comme à l’entrée d’une boîte de nuit, il aiguille ceux qui continuent et les autres. Tous les porteurs de caméras et de micro passent. Je m’avance. Il m’arrête. « Je suis avec BFM ». « Avec qui ? » « Avec BFM TV ». Je les montre qui s’éloignent, il me laisse passer. Ça y est, me voici de l’autre côté du rideau, et pas seulement au sens propre. Il n’y a plus que des journalistes, on descend un petit escalier, ça bouchonne. Quelqu’un de l’organisation semble dire que c’est fini, qu’il faut arrêter de filmer. Le filtreur me double, s’approche de la journaliste de BFM TV et lui demande : « Il est avec vous ? » Elle, étonnée : « Qui ? » Il me montre du doigt. « Lui ». Elle fait non, il me dit de repartir - c’est assez drôle puisque de toutes façons il n’y a plus rien à voir. Et puis c’est presque rassurant pour moi, ça veut dire que je ne fais pas vraiment journaliste. De retour vers la salle, je croise un jeune homme qui demande si son copain Romain va ressortir par là ou pas. Christian Ternisien, l’homme qui n’a pas parlé, replie un drapeau rouge. Un journaliste d’Europe 1 interroge un spectateur, avec cette façon très particulière des hommes de radio de faire d’immenses hochements de tête pour susciter la confiance et la parole de l’interlocuteur.
Je sors dans la rue. Je pars dîner seul, avec mon tout petit carnet sur lequel je note ces derniers moments. J’imagine les journalistes qui se connaissent, qui dînent par groupes, qui discutent de banalités sans fond. Je pense aussi à Olivier Besancenot qui, selon Wikipédia, a une compagne et un enfant, je me demande ce que c’est que sa vie quotidienne. Je me demande s’il est rentré à Paris ce soir en voiture, ou s’il va rester dormir ici. Est-ce qu’il verra un peu plus Calais que moi, qui reprend le train le matin ? Il a mon âge, à peu près. Quel avenir s’imagine-t-il ? Comme Alain Krivine, être là encore dans trente ans et continuer à tenir ce discours ? « Je suis conscient que les révolutionnaires sont minoritaires, mais les gens nous trouvent de plus en plus utiles. . Je rentre à l’hôtel Bonsaï. À la télé (mais il n’y a pas BFM TV ici) je vois des images de Nicolas Sarkozy à Madrid, Ségolène Royal à Clichy-sous-Bois et François Bayrou à Metz, mais rien sur Besancenot à Calais. Drôle de système médiatique, où il y a six caméras pour pas une seule image au final... J’imagine quelque part, dans les locaux de BFM, une étagère sur laquelle on va poser ces cassettes, deux heures de rush, ce temps réel inutile que peut-être personne ne va même regarder en entier.
Le lendemain, avant de reprendre le train, je regarde la presse locale, qui manifestement boucle trop tôt : rien dans Nord Littoral, un entrefilet dans La Voix du nord sur la visite à Boulogne avant le meeting de Calais. Il faudrait attendre le surlendemain, mais comme les vrais journalistes de la presse parisienne je ne serai plus là. Reste la presse nationale. Rien dans Libération, mais un petit papier dans Le Parisien, centré sur la question des 500 signatures - deux feuillets comme on les aime, à coup de formules-type (« l’incertitude était palpable chez les militants ») et de raccourcis. Décidément, c’est agréable de ne pas être journaliste.