


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


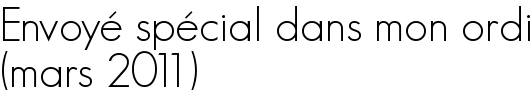
Suite aux déboires laborieusement narrés dans un reportage précédent (mon Firefox devenu immaîtrisable, des fenêtres s’ouvrant d’elles-mêmes tout à fait hors de propos, des cookies impossibles à supprimer, des plantages inopinés), je me suis rabattu sur une solution de facilité : changer de navigateur. Là, une sorte de sursaut vaguement politique, - à moins que ce ne soit le refus presque inconscient de ce qui aurait été ressenti comme une régression -, m’a interdit de me remettre à Internet Explorer. Je veux bien renoncer temporairement à Firefox, avec la beauté de son ouverture et de ses lignes de code fournies bénévolement par des programmeurs intermittents, mais pas pour retomber sur Microsoft. Faut pas exagérer.
J’ai donc cliqué sur l’icône Google Chrome.
Là, il faut préciser. Je ne sais pas comment cette icône est arrivée sur mon bureau. Je n’ai aucun souvenir d’avoir téléchargé Google Chrome. Un jour, l’icône était là. Elles étaient même deux (l’icône « normale » + un raccourci). Avec les couleurs de Google (jaune, vert, rouge) et le graphisme minimal caractéristique de cette entreprise qui a compris que même dans le champ de l’innovation continuelle - surtout dans le champ de l’innovation continuelle -, le « d’emblée un peu has been » avait un côté rassurant. Je parle de ces icônes avec légèreté, comme si j’avais bien vécu leur irruption, mais j’avais en fait refoulé le traumatisme de leur intrusion. Un peu comme si un matin, vous vous réveilliez avec un nouvel objet dans votre salon, sans aucun souvenir de l’y avoir apporté. Trois solutions : soit quelqu’un l’a fait à votre insu dans une sorte de cambriolage inversé (mais qui ? pourquoi ? comment ?) soit vous l’avez fait vous-mêmes, mais l’avez oublié (Alzheimer ? Kleptomanie ? Ecstasy ?). Ces deux solutions, les plus évidentes, sont déjà assez effrayantes. Mais la troisième, celle qui se rapproche sans doute le plus de la vérité, l’est encore plus. Vous avez apporté un objet, vous l’avez posé sur votre bureau et pendant la nuit, il a muté, s’est changé en un autre objet, et vous défie dorénavant de toute son impassibilité d’objet... Bref, pendant plus d’un an (mais, en vérité, je serais bien incapable de dater cet événement), j’ai fait comme si les icônes n’étaient jamais apparues. Je les ai littéralement ignorées. Beauté du cerveau. La même, avec une différence de degré j’en conviens, que celle qui permet à l’automobiliste de rouler dix kilomètres avec le piéton qu’il a renversé encastré dans son pare-brise.
Passons sur le fait que la curiosité de découvrir le nouveau navigateur de Google n’ait pas permis de dissiper plus vite le syndrome post-traumatique. Mais j’étais heureux avec Firefox. En plus, politiquement, j’étais du bon côté. Alors pourquoi risquer d’aimer Chrome ? Parce que, sans diaboliser bêtement Google, je constate juste sa présence croissante dans ma vie. Mon smartphone est équipé avec le système Androïd, développé par Google. Je trouve des infos sur le moteur de recherche de Google (et quand je veux savoir ce qui vient de se passer sur un sujet qui m’intéresse, je le fais sur Google News). Je reçois des mails dans ma boite Gmail. Je regarde des vidéos sur Youtube, qui appartient à Google. C’est un peu comme si mon téléphone, ma télévision, mon courrier, mes journaux et mes dictionnaires m’étaient fournis par le même type, qui vit à 10 000 kilomètres, que je ne verrai jamais, dont je ne sais rien, si ce n’est qu’il est toujours vêtu d’un sweat tricolore à la coupe un peu désuète. De quoi concevoir quelques réticences à confier un élément supplémentaire de ma vie à une boîte qui certes, a pour slogan « Don’t be evil », mais subventionne un cursus universitaire où des mecs à longue barbe viennent expliquer que bientôt, on pourra vivre éternellement en téléchargeant son cerveau dans des robots. Et si le chargement de Chrome à mon insu était le signe que j’avais été choisi pour un programme secret, vous y avez pensé ? Et s’il suffisait que je clique sur une de ces icônes pour que mon être numérique soit aspiré par Google ? Qu’il se transporte dans un serveur, où il tremblerait de froid au milieu de millions d’autres serveurs alignés au fond d’un hangar californien ?
Mais j’ai cédé. Il y a quelques jours, excédé par un énième plantage, j’ai cliqué sur une icône Chrome. J’ai fait pire, d’ailleurs. J’ai migré. En trois manipulations simplissimes, j’y ai transporté la liste de mes favoris et mon compte Diigo (qui permet de marquer des pages et les mettre en partage). J’ai rompu, je suis parti.
Comment faire comprendre ce qui s’est passé ensuite ? Je pourrais le décrire platement. Plus de publicités qui s’ouvrent de manière impromptue. Plus de navigateur qui « ne répond plus ». Quand je fais une recherche et clique sur un lien, j’arrive directement au site, sans passer par des moteurs de seconde de zone qui ne mènent jamais nulle part. En deux mots : ça marche. L’impression est analogue aux premiers kilomètres que l’on fait sur un scooter qui sort de révision. La disparition des bruits bizarres, des vibrations inquiétantes, l’assurance - assez agréable il faut avouer - que si on appuie sur les freins, on s’arrêtera. De la même manière que l’on retrouve alors le plaisir simple de la conduite, j’ai retrouvé le plaisir de naviguer sur le web. A l’heure des applications, ça fait un peu ringard d’évoquer « le plaisir de naviguer sur le web ». Mais il suffit de l’avoir perdu quelques mois - ou de faire l’effort de se souvenir de ce que c’était de parcourir le web avec un modem, les pages qui mettaient trois minutes à s’afficher, les déconnections impromptues... - pour que l’expression reprenne tout sens. Et là on devient forcément un peu lyrique. Parce que le « plaisir de naviguer sur le web », c’est quand même, je le rappelle aux blasés, celui de passer en un clic d’un manuscrit de Madame Bovary à la place Tahrir, tout en suivant sur Twitter #pdlt, et en faisant défiler sur Youtube un mixe de Danton Eeprom, et de tout laisser tomber pour se lancer dans une vaste recherche sur les calamars géants, qui nous mènent d’extraits de films en épopées scandinaves. Quand tout ça se fait soudain sans relancer trois fois son navigateur, sans devoir fermer cinq sites de poker en ligne, sans être bloqué sur un site pourri impossible à fermer malgré quinze clics frénétiques sur la croix rouge, c’est une sensation forte : la première baignade de l’année dans une eau à la bonne température, une concession à vie dans la librairie du Congrès, avec les livres qui volent tout seuls jusqu’à notre table et s’y ouvrent à la page recherchée, la possibilité de laisser un post-it sur les frigos de tous les gens qu’on connait. Avec le sentiment que l’écran ont gagné en pixels, que les lettres ressortent mieux. Alors je m’y suis jeté. Comme au début. Comme quand c’était nouveau. Comme quand c’était merveilleux.
Deux remarques. D’abord quand sera-t-il possible de décrire l’expérience numérique sans avoir recours à l’analogie ? Ou mieux, quand l’expérience numérique deviendra-t-elle elle-même une analogie pour décrire autre chose ? Ensuite, cette joie fut-elle un tant soit peu gâchée par l’abdication politique consistant à délaisser Mozilla pour s’ébattre dans Google ? Ben non. Pas tellement. C’est bien ce qui m’inquiète. Et là, je me suis dit que la politique en matière numérique sera aussi compliquée à faire entrer dans les mœurs que les comportements écologiques en matière de consommation. Paresse, facilité, inaptitude, autant de petits vices rognant les idéaux.